Décembre 1922 : Jean Saltas à la Comédie-Française
Octobre 1928 : Mille francs pour Jean Saltas
Notes 01 à 50
Annexe I — Les Derniers jours d’Alfred Jarry
Notes de l’annexe I
Jean Saltas II ►
Page mise en ligne le quinze septembre 2024. Temps de lecture : quarante minutes. Cette page est la première de deux parties très inégales, avec la guerre comme césure.

La seule photographie de Jean Saltas que nous connaissons
À une pointe ouest de la Turquie, face à la Grèce, à une centaine de kilomètres au nord d’Izmir, se trouve le petit port d’Ayvalık (avec un ı sans point), sur la mer Égée, face à l’île grecque de Lesbos. C’est dans cette ville (trente-cinq mille habitants de nos jours), qui se nommait alors Kydonies considérée comme grecque, qu’est né Jean Saltas, le 19 janvier 1865 du calendrier grégorien en vigueur en Grèce.
Si l’on regarde un peu ce qu’il s’est passé dans la région au cours des cinquante années suivantes, Jean Saltas a eu bien raison de se réfugier en France où personne ne s’est jamais plaint de sa venue.
On l’imagine d’une famille aisée, faisant des études et parlant français puis, jeune homme, émigrer en France. Mais en fait on n’est sûr de rien.
En 1891 il a 26 ans. Paraît à Montpelier un texte sur les amygdales signé de son nom, peut-être sa thèse de doctorat. Dans le dossier de la Légion d’honneur de Jean Saltas, dressé en 1929, le fonctionnaire a indiqué, toutes majuscules dehors :
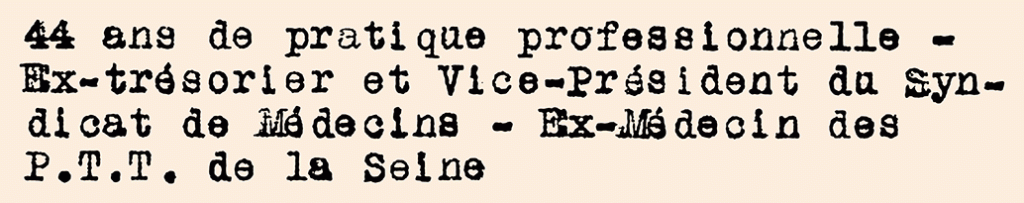
44 ans de pratique en 1929, Jean Saltas a donc débuté sans doute par des stages, à l’âge de vingt ans. En France ? Peut-être.
En octobre 1903, Jean Saltas a épousé, à la mairie du VIe arrondissement de la place Saint-Sulpice, Blanche Druaut née en 1860, artiste dramatique1. Blanche mourra en 1941 des suites d’un accident domestique dans les épouvantables conditions que nous verrons dans la seconde partie de ce texte à paraître le quinze octobre.
Le mariage à la mairie du VIe, cela indique qu’il habitait déjà l’arrondissement. Ou Madame. Mais habitait-il déjà au 24 rue du Regard, cet immeuble luxueux, à un angle de la rue de Rennes ?

Cette adresse ne sera pas sans conséquence sur la fréquentation régulière du très collaborationniste Alain Laubreaux, qui habitait le même immeuble. Alain (Alin) Laubreaux est né à Nouméa en 1899 et mort en exil à Madrid en 1968. Il a été engagé comme journaliste dans le très droitier quotidien Le Journal avant de rejoindre L’Œuvre, du bord opposé, puis La Dépêche (de Toulouse) où il devient critique littéraire. C’est à partir de 1936 que la carrière de Laubreaux est la plus connue et la plus voyante parce qu’il entre à l’hebdomadaire Je suis partout. Pendant l’Occupation Laubreaux et son journal se sont engagés dans la collaboration avec enthousiasme. À la Libération il s’est réfugié dans l’Espagne de Franco. Il sera condamné à mort par contumace.
Donc, sans nécessairement partager les mêmes enthousiasmes, Alain Laubreaux et Jean Saltas se connaissaient, ce qui a permis à Jean Saltas de placer quelques articles dans Je suis partout en hommage à Alfred Jarry et à Paul Léautaud. Ajoutons qu’Alain Laubreaux avait un indiscutable talent de polémiste, ce qui n’excuse rien, mais peut séduire certains.
⁂
Jean Saltas a été le médecin de Paul Léautaud durant la majeure partie de sa vie et dieu sait s’il en a consulté beaucoup, autant à lui seul, que tous les habitants d’un quartier parisien. Ce n’est pourtant pas de ces consultations dont il sera question ici — le sujet n’offrirait aucun intérêt — mais de leurs relations amicales ou littéraires, qui ont été étroites.
La première fois que le nom de Jean Saltas apparaît dans le Journal de Paul Léautaud est le quatorze avril 1908. Il vient d’être embauché comme secrétaire au Mercure de France (le premier janvier). Ce mardi, deux visiteurs de Rachilde sont évoqués, dont le musicien Jean Poueigh (1876-1958), qui « a un tel je ne sais quoi d’humide, de luisant, qu’on dirait toujours qu’il sort d’un baquet. » vient ensuite…
Le docteur Saltas, un grec, vrai marchand de pastilles du Sérail2 par son bagout, son zézaiement, ses gestes arrondis et son sourire aimable. Son amitié avec Jarry l’a introduit dans la littérature. Il se trouve si bien dans sa transformation en homme de lettres depuis la publication de sa Papesse Jeanne3 qu’il serait certainement encore plus dangereux qu’auparavant de le prendre maintenant comme médecin.
Jean Saltas sera pourtant bientôt le médecin de Paul Léautaud sa vie durant.
En attendant, dans le Mercure du seize décembre 1908, paraît une « Variété » signée Gaston Danville4 et Jean Saltas. Ce texte est le compte rendu d’une représentation de l’Électre de Hugo von Hofmannsthal par la troupe du théâtre de L’Œuvre dans la salle Femina de l’avenue des Champs-Élysées. C’est le seul texte signé Jean Saltas qui paraîtra dans la revue.
Le 21 décembre de l’année suivante, 1909, Paul Léautaud devrait être bien maussade, son ami Charles-Louis Philippe est en train de mourir. Passé le matin à la clinique de la rue de La Chaise, il n’a pas pu le voir. Il mourra dans la soirée. Pourtant il se livre encore à un de ses jeux favoris, l’entreprise de démolition des visiteurs des mardis de Rachilde, dont :
Poueigh souriant à tout, approuvant tout. Saltas, perpétuellement admiratif sans jamais savoir au juste de quoi on parle.
Pourtant, le premier août suivant (1910), Paul Léautaud écrit à Jean Saltas.
Mon cher Docteur,
Voici le rapport d’analyse. Je souhaite qu’il vous donne toutes indications utiles pour l’établissement d’un régime.
La lettre se poursuit, exposant des problèmes de santé. Le choix a été fait ici de ne pas entrer ici dans les détails des affections innombrables de Paul Léautaud. Traitant de son médecin, cette page les accumulerait et deviendrait vraiment trop accablante.
La lettre se conclut par :
J’irai vous voir dans quelques jours, pour la suite à donner à ce rapport d’analyse.
Je me permets de vous charger de présenter mes hommages à Madame Saltas et je vous serre la main bien cordialement.
Dans le salon de Rachilde, des dames sont aussi invitées et Paul Léautaud a donc eu l’occasion de saluer la charmante Madame Saltas.

Portrait de Madame Saltas, pastel de Maxime Dastugue, collection du musée des Beaux-Arts de La Rochelle
Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle, contacté, reste muet sur l’histoire de ce portrait. Nous voyons une fort jolie femme à qui l’on peut donner 35 ans, donc vraisemblablement peint vers 1895. Le musée précise aussi « don de 1936 » et « Ancienne appartenance : Saltas Jean ». Cela interroge. Si l’on croit ce musée (on ne le croit pas), Jean Saltas aurait donné ce portrait au musée de la Rochelle en 1936. Pourquoi ? Nous savons que le couple est demeuré uni jusqu’à la mort accidentelle de Madame Saltas en avril 1941. La seule explication acceptable serait que Madame Saltas ne se plaisait plus sur ce portrait, peut-être pas très ressemblant et qu’elle a souhaité s’en débarrasser.
Paul Léautaud aura l’occasion de reparler de ces dames du salon le 24 janvier suivant (1911) :
Aujourd’hui, réouverture du Guignol Rachilde, dans le nouveau décor des meubles de l’héritage, au milieu des portraits de famille ramenés du Périgord5. Grande assistance [dont] Mme Saltas, jolie, de bon ton, élégante de la vraie élégance.
Ce début de 1911, Paul Léautaud cherche du travail, son salaire du Mercure est insuffisant. Il suit plusieurs pistes dont une, suggérée par Jean Saltas, de « s’occuper » du Bulletin du Syndicat des médecins de la Seine ». Cela n’aboutira pas. En juin 1913 nous apprendrons incidemment que Blanche Blanc, la maîtresse de Paul Léautaud, consulte aussi Jean Saltas.
Dix ans passent. En octobre 1921, Jean Saltas fait paraître dans Les Marges, la revue de son ami Eugène Montfort « Les Derniers jours d’Alfred Jarry ». Cette revue et cet article, introuvables de nos jours, sont intégralement reproduit infra en annexe I après une première série de notes (et ne sont donc plus introuvables).
Alfred Jarry méprisait Jean Saltas6, qui l’a pourtant aidé jusqu’au dernier jour. Il est impossible d’évoquer Jean Saltas sans Alfred Jarry, qui lui a valu sa petite notoriété dans le monde des lettres. Il n’est pas non plus possible d’évoquer Jean Saltas sans évoquer Eugène Montfort tant ces deux personnages étaient proches. Une page sur Eugène Montfort est d’ailleurs prévue ici à la rentrée de 2025.
De la même façon que le symbolisme était né du rejet des parnassiens dogmatiques, le naturisme d’Eugène Montfort, la « beauté moderne », est né du rejet du symbolisme et de son mysticisme de fête foraine. Eugène Montfort (1877-1936) est connu comme le fondateur, en novembre 1903, de la revue Les Marges, dont il va être encore un peu question ici. Eugène Montfort est aussi l’éditeur, le 15 novembre 1908 du premier « premier numéro » (il y en aura un second) de La Nouvelle revue française. Un portrait d’Eugène Montfort sera dressé par Paul Léautaud qui s’est rendu chez lui, rue Chaptal, le 28 septembre 1908. Un autre portrait en sera dressé par André Billy dans La Terrasse du Luxembourg, pages 297-298. Eugène Montfort est mort en décembre 1936 d’un coma diabétique dans la couchette d’un train de nuit.
Ce 18 octobre 1921 nous lisons, dans le Journal littéraire :
Ce matin, Léon Deffoux, lisant le dernier numéro des Marges, faisait de grands éloges de la fin de l’article du Docteur Saltas sur Les Derniers jours d’Alfred Jarry, que Saltas m’a demandé de lui arranger sur un brouillon informe et dont je pourrais me dire l’auteur. Je n’ai pas bronché.
Ce numéro des Marges du 15 octobre a été annoncé dans le « Memento » du numéro cent de La NRF un peu tardivement (janvier 1922), page 127. En même temps, rien ne nous affirme que le numéro des Marges daté du quinze octobre soit vraiment paru le quinze octobre. Voici cette annonce, très succincte :
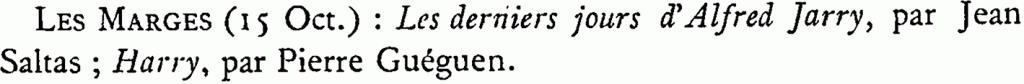
Ces années 1921 et 1922 Paul Léautaud est allé consulter Jean Saltas à plusieurs reprises et se fait faire ses piqûres par lui. Ces visites semblent « amicales » et il est vraisemblable qu’elles ne sont pas payées. En remerciement, à la fin de l’année, Paul invite Jean Saltas à la Comédie-Française voir une pièce pour laquelle il a reçu un service pour deux personnes, ce qui ne lui a donc rien coûté. Sans doute Jean Saltas aurait préféré se rendre au spectacle en compagnie de Madame mais il aurait eu du mal, au contrôle, à se faire passer pour Paul Léautaud, fort bien connu dans tous les théâtres de Paris.
Décembre 1922 : Jean Saltas à la Comédie-Française
Voici, intégralement reproduite, la journée du 9 décembre, huit lignes dans l’édition papier du Journal littéraire (jusqu’à « fichu spectacle ») mais quatre grands paragraphes ici grâce aux lacunes retrouvées par Bertrand Vignon dans le tapuscrit de Grenoble. Même si ce texte est complètement hors-sujet (Paul Léautaud traite surtout des familles Richepin et Jean Rostand) il est complètement inédit :
Samedi 9 Décembre [1922]
Je recommence depuis quelque temps à me faire soigner par Saltas. Mercredi dernier, pour lui faire plaisir, ce que je lui dois bien, je l’ai emmené à la Comédie-Française, à la première de l’Ivresse du Sage7 de François de Curel. Aujourd’hui, à ma visite, il me demandait si je suis allé à la Renaissance voir la pièce de Jacques Richepin8 et Carco9 : les Chercheurs d’Or10. Je lui ai dit non, n’ayant pas eu de service. J’ai ajouté que ce doit être un fichu spectacle11 et que d’ailleurs, un journal annonçant hier que la pièce est pleine d’emprunts à un livre de M. Rouquette12, le Grand silence blanc, à telle enseigne que Richepin et Carco ont offert à l’auteur, devant sa réclamation, de lui donner une part de leurs droits, ce que l’autre a refusé, préférant leur faire un procès13. J’ai dit à Saltas qu’au reste Jacques Richepin est une sorte de faiseur littéraire avec lequel il n’y a à s’étonner de rien.
Saltas m’a alors raconté ce qui suit. Pendant la guerre, Jacques Richepin était en Orient dans l’aviation, un service de tout repos. Le directeur de l’épicerie Potin, mobilisé là-bas aussi, y ayant fait mobiliser des tas de gens, faisait venir à profusion des provisions de toutes sortes. Ces messieurs ne s’embêtaient pas. Jacques Richepin venait souvent en permission à Paris et se rendait chaque fois souvent à la place14 pour faire prolonger ses permissions. Il était si bien connu que dès qu’il arrivait, tout le monde disait : Voilà le grand maquereau (grand à cause de sa taille). Cela m’a rappelé ce que disait Albert15 lors du mariage de Cora Laparcerie16 avec Jacques Richepin : « Laparcerie va pouvoir se faire payer ses “passes” plus cher ». Le frère17 de Jacques Richepin venait aussi à la place, pour des visites de santé. Lui, quand il arrivait, c’était “le petit maquereau”. Mme Rostand18 multipliait les démarches pour lui, sollicitant qu’on le laissât à l’arrière, s’autorisant du désir de Rostand lui-même : « Edmond sera si content » et donnant à tout le monde des livres de Rostand avec des dédicaces pleines d’effusions, dédicaces qu’en réalité elle écrivait elle-même, Rostand ignorant tout. Saltas parla un jour de ces dédicaces écrites par Rostand pour tous ces volumes à Fasquelle19. Fasquelle éclata de rire : « Lui ! mais il n’a jamais rien écrit sur aucun volume. C’est elle qui inventait et écrivait tout cela. »
Il paraît que c’est l’histoire de Rosemonde Gérard avec Tiarko Richepin qui amena la séparation de Rostand et de sa femme, lui vivant seul à Cambo20, elle faisant l’amour ici avec Tiarko. Les rendez-vous avaient lieu chez la première Mme Richepin21 avec qui vivait Tiarko, d’une pension servie par Jean Richepin depuis son divorce. Rosemonde Gérard dépensait déjà un argent fou pour lui. Après la mort de Rostand, devenue plus libre de ses actions, elle l’installa à ses frais, dans un atelier et c’est elle qui continue à l’entretenir, et assez bien. Elle a essayé de vendre Cambo, sans y réussir. Il paraît que la villa Arnaga n’est pas habitable. C’est une folie de poète, dont on ne peut rien faire de pratique. Toutes sortes d’étrangers sont venus pour la vente : Américains, Brésiliens. Personne n’en a voulu. Mme Rostand en a été pour 50 000 francs de frais inutiles. Saltas tient de Fasquelle que Rostand n’existait que pour sa femme. Il ne faisait rien que par elle, sous son influence, ses encouragements, sa présence. Il lui soumettait tout ce qu’il écrivait et puisait l’ardeur au travail dans ses compliments et ses approbations. À partir du jour qu’il y eût entre eux une sorte de rupture, une séparation amenée par les amours de sa femme avec Tiarko, il ne fit plus rien.
Fasquelle donne ces deux exemples : on envoya un jour Rostand visiter le front, en lui exprimant l’espoir qu’il trouverait là le sujet d’un grand poème national qui pourrait être comme une grande réclame guerrière pour le public22. Il paraît qu’il eût surtout très peur de se trouver ainsi si près de la ligne de feu et ne put rien tirer de son voyage23. De même, à l’Armistice, il se promena dans les rues, au milieu de la foule, pensant qu’il allait peut-être trouver là une excitation littéraire. Encore rien. Livré à lui-même, à lui seul, il ne pouvait rien trouver ni écrire. Saltas montre Rosemonde Gérard comme une femme ardente, alors que Rostand était physiquement un homme faible et malade. Selon lui aussi, Mme Rostand est une femme extrêmement intelligente. Elle a dû être vraiment jolie et même doit l’être encore. Je ne l’ai jamais vue. Il y a dans le cabinet de Saltas un portrait d’elle avec une dédicace à Saltas et à sa femme qui déborde d’exagération mondaine et qui doit se rapporter aux services rendus par Saltas pendant la guerre comme médecin-major.
Deux mois plus tard…
Mardi 13 Février [1923]
Saltas connaît Basile Zaharoff24, le mécène du Prix Balzac. Il me dit tenir de lui que les membres du jury25 ont touché chacun 6 000 francs pour le travail, Basile Zaharoff n’ayant pas voulu qu’ils aient la corvée de lire tant de manuscrits sans en être dédommagés.
Candeur de Saltas. Il a envoyé à Zaharoff le numéro des Marges contenant son article sur Jarry (écrit par moi). Il me montre la lettre de compliments que Zaharoff lui a écrite, lui disant qu’il trouve intéressant ce que Saltas lui a dit de sa façon de travailler : en métro, en tramway. J’écris ceci sans méchanceté. Je suis enchanté d’avoir fait ce petit plaisir à Saltas de lui mettre debout ses notes sur Jarry, mais je suis sûr qu’avec le temps ce phénomène s’est produit dans son esprit : il doit regarder cet article comme de lui tout à fait.
Trois ans passent, pendant lesquels Jean Saltas n’est évoqué que comme médecin. Paul le consulte, semble-t-il, toutes les semaines.
Mardi 9 février [1926]
J’ai parlé aujourd’hui à Saltas, sans lui nommer personne, de la cure de désintoxication des opiomanes. Il m’a dit que les débuts sont en effet assez durs. On enferme les malades seuls, dans une pièce. Tous les jours des bains chauds. On trompe leur besoin de la drogue en leur donnant je ne sais quel composé à l’eau. Saltas dit qu’on arrive assez bien à les guérir. Mais sitôt libres, ils recommencent fatalement. Il paraît que les premiers temps de la cure, privés d’opium, ils sont comme des loques, des fantômes, battant l’air de leurs bras tendus. Cette pauvre Mme de Gonnet26 si bonne créature, si simple, toujours si gaie, va passer par de durs moments.
Saltas m’a dit — il me l’avait déjà dit — qu’il a usé du même truc de la maison de santé, et en la faisant déclarer irresponsable par une visite médicale, pour Mme Danville27, qui ne coupait pas, sans cela, à la correctionnelle et à la prison.
Le cinq décembre 1927, c’est le docteur Saltas qui est malade, sérieusement, semble-t-il, puisqu’invisible « depuis trois ou quatre semaines ». Ne pouvant le voir, Paul Léautaud lui écrit :
Au docteur Saltas
Paris le 5 décembre 1927
Mon cher ami,
Je vous demande mille pardons de vous déranger dans votre tranquillité. Lire ne vous fatiguera pas trop, je pense ? Et pour la réponse, vous n’avez qu’à répondre en deux mots à la question finale.
Depuis trois ou quatre semaines, je ne vais pas bien du tout.
Paul se livre alors à une longue énumération, en douze points, de ses malaises. C’est vraiment pénible et Jean Saltas est un saint.
À partir de septembre 1928, Paul Léautaud note des rendez-vous chez Jean Saltas tous les lundis.
Lundi 8 octobre [1928]
Visite à Saltas. Il me raconte qu’il va s’entremettre auprès d’Albin Michel pour la publication du roman de Montfort Cécile ou l’amour à 18 ans28. Ce n’est tout de même pas drôle pour Montfort de se trouver ainsi sans éditeur, à son âge et, tout de même, avec le petit nom qu’il a. Il paraît qu’il a trouvé le moyen de se brouiller avec tous les éditeurs qu’il a eus.
Octobre 1928 : Mille francs pour Jean Saltas
Le huit février 1929 arrivent au Mercure les exemplaires de Passe-Temps. La mise en vente est le douze. Paul Léautaud touche un peu d’argent. Du coup, le 22 avril, glissé dans un recueil de poésie, il peut remettre ce mot à son ami :
Je vous prie d’accepter le papier ci-joint.
C’est un grand plaisir que je me fais à moi-même et ce n’est rien auprès de toutes vos bontés pour moi.
Avec mes amitiés
P. Léautaud
Ce « papier » est un billet de mille francs29, comme nous le comprendrons ci-après. Ça tombe bien, un nouveau billet venait de sortir :

Puis, dans le Journal littéraire à la même date :
J’ai donné aujourd’hui 1 000 francs à Saltas. Voilà un an, je crois, que j’y pensais. Il a été un ami si dévoué, si obligeant pour moi. La façon dont il m’a soigné en 1908 passage Stanislas30, venant chaque jour, se mettant en bras de chemise, faisant l’infirmier complet, tout cela avec la meilleure humeur possible. Et depuis, que de consultations, que de médicaments donnés, toujours accueillant, toujours serviable. J’ai été long à me décider. Je pesais le pour, je pesais le contre. J’avais comme deux individus en moi, l’un qui disait oui, l’autre qui disait non. L’idée de la somme à donner. L’idée que c’était bien le moins. Le sentiment qu’il doit bien penser que je gagne quelque argent. Ses clients de mon genre lui font des cadeaux au moins. Moi rien ! Dans l’intimité, avec sa femme, il devait bien en parler. Cette pensée aussi que si je venais à être malade, obligé de rester chez moi, je serais bien content qu’il se dérange pour venir me voir. Je pensais d’un autre côté à la situation qu’il a l’air d’avoir maintenant. Il a l’air d’être assez à son aise. Il ne reçoit plus que sur rendez-vous. Il a repris une bonne. Il n’a pas besoin de mon argent. Mille francs ! cela ne va peut-être être rien pour lui ? Je me reprenais : même s’il est riche, même si 1 000 francs ne sont rien pour lui, je dois les lui donner, je ne dois pas les lui donner s’il en a besoin, je dois les lui donner parce que c’est mon devoir. Et puis, qu’est-ce que mille francs ? Je n’aurai qu’à me figurer que j’ai touché 1 000 francs en moins. Passe-Temps m’a rapporté 13 500 francs. Je me figurerai qu’il ne m’a rapporté que 12 500 : D’après mon compte, même, je ne comptais que sur 12 300. Je me disais aussi : Je suis sûr que j’aurai un très grand plaisir, la chose faite.
Lundi dernier, le matin, en partant j’étais absolument décidé. Sitôt arrivé à mon bureau, j’avais fait le petit bout de lettre destiné à accompagner le billet sous enveloppe, prévenu le caissier du Mercure que je lui demanderais 1 000 francs après déjeuner. Après déjeuner, la présence de Dumur, de Batault31, restant là à bavarder, me mettant en retard pour me rendre chez Saltas, m’empêchant de réfléchir encore une bonne fois sur ce que je devais faire, firent que je ne fis encore rien.
Je ne sais plus si c’est le lendemain ou le surlendemain, en tout cas un jour de la semaine dernière, j’ai parlé de mon projet à ma chère amie32, lui disant toutes mes réflexions, mes contre-réflexions. Elle a été de mon avis ; je devais faire la chose. Je le devais. Au surplus, très peu de chose pour moi. J’ajoute, moi : très peu de chose ?… relativement. Car, enfin, 1 000 francs ?
Je l’ai fait aujourd’hui. Ce matin, j’ai pris 1 000 francs dans mon tiroir. J’ai fait un petit mot à Saltas. Petit mot et billet dans une enveloppe. Cette enveloppe dans un volume de vers de Paul Éluard33 arrivé ce matin, et dépassant du volume pour plus de sûreté. Été voir Saltas. La consultation terminée, au moment de le quitter, j’ai feint d’oublier que j’avais apporté un livre pour lui et je lui ai donné le volume, me trouvant aussitôt dans l’escalier, la porte refermée sur moi. Il a dû avoir une jolie surprise, et c’est vrai, la chose faite, je suis enchanté de l’avoir faite. Auprès de ce qu’il est pour moi depuis tant d’années, ce n’est même rien de ma part.
Une chose drôle. Il me prenait mon pouls. Je pensais à la façon dont j’allais lui remettre le volume contenant l’enveloppe. J’avais le cœur un peu serré, inquiet. Il me dit : « 80 pulsations ? Qu’est-ce que vous avez fait ? Vous avez couru ? Vous vous êtes disputé ce matin ? »
Nous rirons bien quand je lui dirai la raison lundi prochain.
Justement, aujourd’hui, en m’accompagnant à mon départ, comme je le remerciais, il m’a dit : « Mais non, mais non, vous savez bien que c’est avec grand plaisir… »
C’est vraiment un homme délicieux, l’obligeance, la serviabilité mêmes, et toujours avec le meilleur accueil.
Lundi 24 juin 1929
Visite chez Saltas […]
On a coupé une jambe à Courteline il y a 4 ans. On vient de lui couper la seconde. Saltas me dit : une sorte d’obstruation des artères, de desséchement des artères. Cela commence par le pied. Puis monte. Il faut couper une jambe. Le tour de l’autre arrive. À son avis, la mort pour Courteline n’est pas loin34, et avec de grandes souffrances, auxquelles on remédie aujourd’hui par des « piqûres ».
Le seize août, Jean Saltas est fait chevalier de la Légion d’honneur, parrainé par Eugène Montfort.
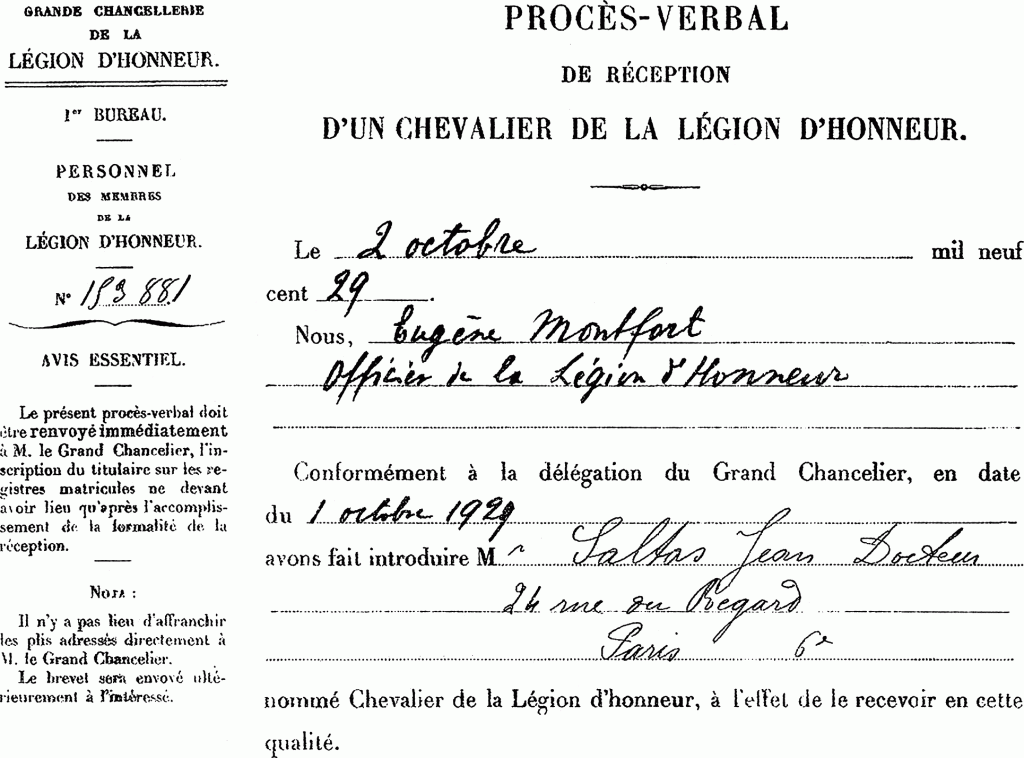
Le seize septembre, Paul Léautaud écrit :
Saltas a été décoré, comme homme de lettres, ce qui est un comble. Sa nomination a paru quand il était encore à la campagne. Il est rentré. Auriant l’a vu aujourd’hui. Saltas lui a raconté que le jour que sa nomination a paru, Montfort est arrivé là-bas (où il était en vacances) dans sa voiture, pour lui donner l’accolade, l’embrasser, le couvrir de félicitations, se réjouir d’une croix enfin bien donnée. Une embrassade générale. Il paraît que tout le monde pleurait. On a gardé Montfort à déjeuner. Mme Saltas préparait justement un lapin façon lièvre. Il paraît qu’à l’annonce de ce menu, Montfort n’a plus desserré les dents jusqu’à l’heure de se mettre à table, et au déjeuner dévorait le lapin façon lièvre à se faire crever sans prononcer une syllabe, malgré tous les avis que lui prodiguait Saltas, en raison de son diabète.
Lundi 4 novembre [1929]
Tantôt, visite à Saltas. Au moment que je vais partir, Montfort arrive, que Saltas attendait. Il me dit d’attendre que la bonne l’ait fait entrer dans le salon pour m’en aller. « Vous ne tenez sans doute pas à le voir ? » Je lui dis : « Pourquoi ? Je suis très bien avec Montfort ! » Il n’en a pas moins attendu que Montfort soit entré dans le salon et la porte refermée sur lui pour me laisser partir. Je soupçonne fort Montfort de lui avoir dit tout le mal qu’il pense de Passe-Temps. Saltas doit penser que je le sais et que je suis fâché avec lui. S’il savait comme je m’en moque, et comme je suis incapable d’en vouloir à quelqu’un pour cela.
Lundi 21 Juillet [1930]
Visite à Saltas, que je n’ai pas vu toutes ces dernières semaines.
[…]
Saltas, qui doit le tenir d’Albin Michel, qu’il voit très souvent, me dit que la vente de Pierre Benoit a considérablement baissé. Son dernier roman, Le Soleil de Minuit35, je crois, tiré à 40 000, resté pour compte à Albin Michel. Il paraît que c’est toujours la même histoire, comme dans L’Atlantide : une femme fatale, des hommes qui sont ses victimes, dans un cadre différent, voilà tout.
Déception aussi d’Albin Michel, paraît-il, avec Dorgelès. C’est lui qui a engagé Dorgelès à faire un voyage, avec lequel il ferait un livre, voyage dont il paierait tous les frais. Résultat, le volume Partir36 dont les premières pages sont bien : description du navire, et le reste du pur remplissage.
Saltas me dit que Albin Michel a dû prendre un nouveau magasin à Montrouge pour loger tous ses retours. Avec tout ce qu’il publie, cela ne m’étonne pas.
Lundi 18 Août [1930]
Saltas va partir en vacances. Il devait partir plus tôt, aller à la mer, chez les Albin Michel. Mais il se serait trouvé là-bas avec Mme Michel37. seule. Elle est si bête, incapable de conversation. Il a préféré n’y pas aller. Il me dit : « Il faut qu’elle soit bête, pour m’avoir raconté, par exemple, que Albin Michel avait eu une amende de 100 000 francs pour dissimulation de bénéfices. (Je dois déjà avoir noté cela). Mais oui, mon cher, 500 000 francs de dissimulés. Il faut croire d’ailleurs que cela a dû s’arranger, car trois jours après je le voyais jouer aux cartes, au café où il va, avec le bonhomme du fisc. Vous comprenez, hein, il a dû lui graisser la patte. L’autre a arrangé les choses. Mais la femme venant me raconter cela, à moi, un étranger, somme toute, et sur son mari, alors qu’elle aurait dû le cacher, hein ? »
Mercredi 20 Août
Auriant me parle du sans-gêne de Montfort avec Saltas, ce qu’il doit tenir de Saltas lui-même. Quand la mère de Montfort était si malade, Saltas lui avait prêté un fauteuil spécial pour malade, tout neuf. Après la mort de sa mère, à qui Saltas avait fait en plus de nombreuses visites, à titre gracieux, comme il fait si gentiment pour nous tous, Montfort lui a retourné le fauteuil, le siège tout crevé, sans avoir eu au moins la délicatesse de le faire réparer. Il a donné une fois, il y a quelques années, 500 francs à Saltas, lui, l’homme riche, et encore plus riche depuis la mort de sa mère. Jamais rien de plus.
6 juillet [1931]
Auriant a fait pour Saltas et Fasquelle un travail de recherches de documents pour un volume de Jarry qui va paraître. Comme il parlait à Saltas de la nécessité pour Fasquelle de réserver les droits d’auteur, en vue d’une réclamation possible de la sœur de Jarry, il a appris que pour Ubu Roi, publié par Fasquelle38 en 1923, à 9 ou 10 francs, dont Fasquelle a vendu en peu de temps 17 000 exemplaires, Fasquelle a reçu un jour la visite de la sœur de Jarry39, complètement ivre et qu’il lui a fait faire, avec 6 000 francs, l’abandon de tous ses droits sur Ubu-Roi. Voilà une belle opération d’éditeur.
Lundi 14 Septembre
Une tuile ! Auriant m’apprend que Saltas a le projet de se retirer complètement et d’aller s’installer en Suisse40. Moi qui avais l’habitude de me faire ausculter et prendre ma tension tous les lundis ! Un médecin qui me connaît par cœur ! Juste au moment que je commence à être sérieusement malade avec mon estomac ! Au prix auquel sont les consultations aujourd’hui ! Vieillir n’apporte rien de bon de tous les côtés.
Samedi 27 Août [1932]
Ce matin, à la sortie de la gare du Luxembourg, Saltas qui m’attendait pour me faire lui arranger la fin, qui n’allait pas, d’une petite introduction de lui à un volume de Jarry qui va paraître chez Fasquelle41.
Au début d’octobre 1932, André Castagou perd un peu la tête et, après un passage à l’infirmerie spéciale du dépôt ; se retrouve en maison de santé.
Mercredi 12 octobre
J’avais rendez-vous chez Saltas, à 4 heures […]. Je lui raconte l’histoire Castagnou. Il m’offre lui-même aussitôt de se rendre avec moi demain matin à Sainte-Anne pour avoir des nouvelles. Nous avons rendez-vous demain matin à 9 heures et demie à la gare Denfert-Rochereau, à deux pas de Saint-Anne, sauf si mauvais temps. Saltas n’est pas seulement l’obligeance, la serviabilité faites homme quand on le sollicite. Il est ainsi spontanément, naturellement, dès qu’on lui en donne l’occasion.
Jeudi 13 Octobre
Ce matin, à Sainte-Anne, avec Saltas dans le service du docteur Marchand. Nous avons d’abord vu le docteur, en train de passer sa visite dans une salle de malades couchés. Il a renseigné Saltas sur Castagnou […].
Et l’on termine cette année 1932 par un petit inédit provenant du tapuscrit de Grenoble (entre « argent à Fargue » et « Pour les pertes ») :
Mercredi 28 décembre [1932]
Saltas me raconte aussi que Rosemonde Gérard (Madame Rostand) adresse à Fasquelle des demandes d’argent « pour manger » ! Sans un sou, paraît-il. Les droits Rostand touchés en avance, considérables. Madame de Noailles également serait fort dans le besoin.
Une fois rentrée à son bureau, Paul Léautaud se souvient d’une autre partie de la conversation :
Parlé avec Saltas de Dumur, du traitement qu’il suit, de l’aggravation de son état, considérable en cinq jours. Il y a longtemps qu’il le considère comme perdu. À propos de sa mort possible dans une hémorragie, il m’a dit : « Si cela lui arrive dans le bureau, vous verrez dans quel pétrin vous vous trouverez. »
L’autopsie d’Alfred Jarry
11 janvier [1933]
Il y a une petite histoire de l’autopsie de Jarry, après sa mort à l’Hôpital de la Charité43. Il y a quelques jours, un docteur Chauvet, demeurant rue de Grenelle, qui a déjà donné quelques petites choses au Mercure, a écrit à Vallette pour lui proposer deux pages sur l’autopsie de Jarry, qu’il aurait pratiquée, comme interne à la Charité à l’époque de sa mort, et demandant si cela intéresserait le Mercure, au moment qu’on reparle de Jarry, qu’on écrit sur lui et qu’on réédite ses livres. Vallette me lit la lettre et me dit qu’il va répondre au docteur Chauvet qu’il publiera avec plaisir ces deux pages, Ce ne peut être que très intéressant. Quant à l’autopsie de Jarry, c’est pour lui la première nouvelle. Jamais il n’en a entendu rien dire. Il a vu Jarry dans sa bière (comme c’est l’usage pour les morts dans les hôpitaux) avant le départ du cortège. Jarry avait toute la poitrine et le visage à découvert. Rien ne révélait que l’autopsie eût été faite. Il pense qu’il y aurait eu, dans ce cas, une demande d’autorisation soit à lui, soit à Saltas, qui représentait, en quelque sorte, la famille. Il me dit d’en parler à Saltas et de lui demander s’il a été au courant. J’en parle à Saltas. Première nouvelle pour lui aussi. Il jure ses grands dieux que l’autopsie n’a pu être faite. Le médecin-chef de l’hôpital était à cette époque le docteur Roger, aujourd’hui doyen de la Faculté de médecine, ami de Saltas. Il n’aurait pas manqué de parler à Saltas de cette autopsie, et même de lui en demander l’autorisation. Saltas ajoute que le règlement est formel : jamais d’autopsie sans l’autorisation de la famille. L’Assistance publique encourrait le risque de dommages-intérêts à payer. Il conclut qu’il y a lieu de se méfier du récit de cette autopsie. Je rends compte à Vallette qui me dit : « Attendons toujours d’avoir les deux pages. Nous verrons. »
Aujourd’hui, Saltas me reparle de l’affaire. Ce n’est plus du tout la même chose. Il a appris que, dans les hôpitaux, tous les corps de malades décédés sont ouverts quand il n’y a pas, dès le décès, défense de la famille. Bien mieux, même dans le cas de défense, il arrive qu’on pratique l’autopsie. On prend seulement soin de recoudre soigneusement les ouvertures, de replacer le mieux possible la tête près du tronc, au besoin de maquiller un peu le visage. Il me cite le cas d’une femme ayant perdu son mari à l’hôpital. Elle fait défense pour l’autopsie. On la pratique quand même. Le jour des obsèques, elle va reconnaître le corps. Dans sa douleur, elle se jette-sur le corps et le prend dans ses bras. La tête, sectionnée, reste dans le cercueil. Procès intenté par elle à l’Assistance publique. Dommages-intérêts de plusieurs dizaines de mille francs. L’autopsie de Jarry est donc fort possible. On peut même maintenant la tenir pour certaine. Saltas s’étonne seulement qu’en sa qualité de médecin, d’ami de Jarry et l’ayant amené lui-même à la Charité, et d’ami du docteur Roger, on ne lui ait parlé de rien. Il me décrit la façon dont on ouvre la tête […]. L’excellent Saltas, me racontant cela, est tout remué, malgré les années écoulées, qu’on ait pu faire cela à son ami Jarry. Quant au récit de cette autopsie proposé par ce docteur Chauvet, il dit que c’est une affaire extrêmement délicate. En réalité, c’est la divulgation de pratiques clandestines, pratiquées au mépris des règlements. C’est renseigner le public, qui croit ces règlements formellement observés. C’est en quelque sorte manquer à « l’esprit de corps ». S’il existait une Chambre des Médecins44, comme il existe une Chambre des Notaires, le docteur Chauvet s’attirerait sûrement un « blâme ».
Raconté cela à Vallette en rentrant. Il me dit : « Attendons toujours les deux pages du docteur Chauvet. » Il s’étonne en même temps de ne pas les avoir encore. Ce qui nous amène à [nous] demander si le docteur Chauvet ne s’est pas rendu compte après coup de l’irrégularité qu’il allait commettre.
Vendredi 13 janvier [1932]
À cinq heures, arrivée des deux pages du docteur Chauvet. Deux pages qui sont en réalité huit pages de dactylographie serrée. Cela a été le premier mot de Vallette en les tirant de son enveloppe : « Si c’est cela qu’il appelle deux pages… » Il en a pris connaissance à haute voix devant moi. Bavard, long, mal écrit, plein de détails inutiles, des fautes de français, un ton d’étudiant. Au fur et à mesure qu’il lisait, Vallette s’exclamait sur l’impossibilité de publier cela. Sur les huit pages, au plus une sur le sujet : l’autopsie de Jarry, l’ouverture de la tête telle que me l’a décrite Saltas et la conclusion qui en a été tirée : Jarry mort d’une méningite tuberculeuse. Il est probable que Vallette va renvoyer ses huit pages au Dr Chauvet.
Vallette a eu ce mot, après la lecture du passage décrivant l’ouverture de la tête et en se rappelant la « reconnaissance » de Jarry dans son cercueil : « Eh ! bien, vous savez, je n’y ai absolument rien vu. Je l’ai pourtant bien regardé. »
Samedi 14 Janvier
Je demande ce matin à Vallette s’il est toujours dans l’idée de retourner son article au docteur Chauvet. Il me répond : « Pour sûr. C’est un imbécile. Il n’y a qu’à voir le ton qu’il emploie. Ce qu’il nous a envoyé est simplement inepte. On ne peut pas publier cela. Je me propose de le lui dire poliment en lui renvoyant son article. »
Lundi 16 Janvier
[Vallette] me dit la façon dont il a répondu au docteur Chauvet pour son article sur l’autopsie de Jarry, en lui retournant ledit article. Il a marqué sur le manuscrit tous les passages à supprimer, en lui disant que s’il accepte de faire ces suppressions, on publiera le reste avec plaisir. « Je ne lui ai pas dit qu’il est une tourte, naturellement. Car il est une tourte ! » Son sentiment est que le docteur Chauvet consentira très bien aux suppressions et retournera son article tel qu’on le lui demande.
Cet article, lui aussi sous le titre « Les derniers jours d’Alfred Jarry », ne paraîtra que dans un an, dans le Mercure du 15 février 1933, pages 77-86.
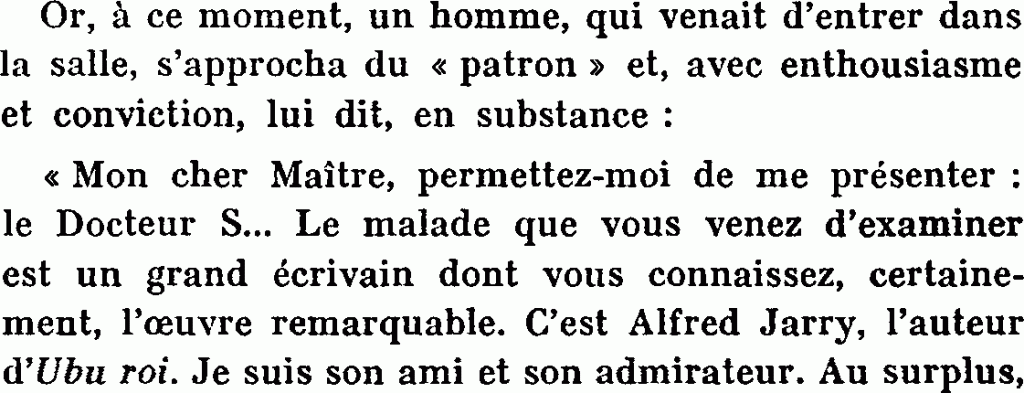
Jean Saktas y apparaîtra au bas de la page 80 sous le nom de « docteur S… »

L’article est signé « Dr Stéphen-Chauvet » (avec un tiret) mais il est vraisemblable qu’il s’agisse de Stéphen Chauvet (sans tiret), personnage brillant. Alfred Jarry est mort le premier novembre 1907 et Stéphen Chauvet allait fêter son 22e anniversaire à la fin du mois. Avant la date de la parution de cet article du quinze février 1933, Stéphen Chauvet avait précédemment écrit deux autres articles dans le Mercure de France, le premier juillet 1917 et le premier octobre 1923, ce qui interroge, puisqu’Alfred Vallette ne semble pas le connaître. On ne confondra pas cet article du Mercure avec celui de Jean Saltas paru sous le même titre dans Les Marges d’Eugène Montfort onze ans plus tôt (octobre 1921).
Lundi 20 Novembre [1933]
Auriant me raconte ce soir : Montfort lui a parlé de Saltas : « Au fond, c’est un cagot. » Comme Auriant s’étonnait, n’ayant, comme moi, jamais vu Saltas sous ce jour : « Mais si, il va à la messe, il pratique, c’est un cagot. Il y a sans doute là l’influence de sa femme… Comment peut-on croire à ces choses-là… »
Au printemps 1935, Jean Saltas se rend au cimetière de Bagneux. Il apprend que la sépulture d’Alfred Jarry n’existe plus depuis 1927, le renouvellement de la concession n’ayant pas été honoré. (Comœdia du 27 avril 1935, cinquième colonne de une).
Trois ans plus tard, le samedi douze décembre 1936, Eugène Montfort meurt. Le vendredi suivant, 18, Paul Léautaud se rend chez Jean Saltas :
Vendredi 18 décembre [1936]
À quatre heures, visite de Saltas. Nous parlons de la mort de Montfort. Saltas me dit qu’à chaque visite qu’il lui faisait, Montfort lui demandait comment j’allais.
Il me dit aussi qu’on ne connaissait pas bien Montfort. Il était extrêmement sensible et tendre. Saltas me dit qu’il a de lui deux lettres extrêmement touchantes. L’une à propos de la mort de son chien, un fox, qu’il a eu pendant dix-sept ans. « Ma meilleure compagnie. Il me comprenait. Lui seul m’a vraiment aimé. » Encore un… L’autre à propos de la mort de sa mère qu’il adorait.
Mardi 9 Août [1938]
Visite chez Saltas, qui a eu la gentillesse de me faire dire de venir le voir, pour qu’il m’examine, avant son départ en vacances. […].
Saltas a dans sa maison le nommé Alain Laubreaux, qui a été autrefois, si je ne me trompe, le secrétaire de Henri Béraud45, qui s’est séparé de lui, si je ne me trompe encore, pour des motifs fâcheux. Ce Laubreaux a fait depuis une certaine carrière de journaliste. Il a écrit récemment un article dithyrambique sur Saltas, dans La Dépêche de Toulouse46, à propos de la publication par Saltas d’un petit volume de Jarry : Ubu enchaîné47, je crois, parlant de Saltas comme d’un homme qui sait le français mieux qu’un professeur en Sorbonne, alors qu’il n’est pas capable d’écrire trois lignes correctement et que tout ce qu’il a publié de son cru a été remis debout par Montfort, ou Auriant, ou moi-même, qui, au reste, lui devions bien cela cent et cent fois. Saltas ne se tient plus de satisfaction depuis cet article qu’ont reproduit en tout ou en partie nombre de journaux de province48. Il me montrait tantôt deux enveloppes pleines de « coupures » de L’Argus. Alain Laubreaux a parlé avec lui d’Auriant et de ses articles sur Maurois49 et est allé jusqu’à émettre cette opinion qu’on a été tout près d’expulser Auriant, ce qui, à son avis, aurait été très juste. Je commence à trouver le procédé un peu fort, quand je vois Saltas être tout à fait de l’avis de Laubreaux, en me disant que, en effet Auriant, en sa qualité d’étranger, n’avait pas le droit d’attaquer un écrivain français et à me soutenir cela avec virulence, avec passion, presque avec colère. Ah ! non, je n’ai pas pu admettre cela. Je l’ai dit à Saltas : « Auriant est un très honnête garçon. Il est fort lettré. Il écrit ce qu’il pense. Sa vie est très estimable. Il n’a écrit que des choses très justes sur Maurois. Il a eu la caution du Mercure qui lui a pris son premier article et ne l’aurait pas pris si les faits qu’il contient n’avaient été probants. Le mot de Dumur : « C’est une œuvre de salubrité littéraire. » La réponse de Vallette à Maurois, lui disant : « Vous auriez dû me prévenir. Nous aurions pu nous entendre. — Mais Monsieur, nous ne sommes pas ici dans une maison où on peut s’entendre. » Le mot de Régnier : « Il a pris, il est pris, tant pis pour lui », ces trois mots dits devant moi. Ce50 ne sont pas les articles d’Auriant qui sont scandaleux, c’est l’élection de Maurois à l’Académie, c’est sa carrière faite grâce à la publicité que lui a permise sa fortune. Auriant un étranger ? Et après ? Pourquoi un écrivain étranger n’aurait-il pas le droit de critiquer un écrivain français ? Un nègre, qui ferait de la critique littéraire, écrirait que telle ou telle chose de moi est absurde, qu’il n’y comprend rien, je dirais : c’est son opinion. Il a bien le droit de l’exprimer. Les gens qui ont cherché à faire expulser Auriant sont des coquins, et si Maurois s’en est mêlé, c’est un coquin. » Il paraît, d’après ce que m’a dit Saltas, qu’il s’est absolument refusé à cette action. Je sais bien que Saltas m’a opposé la question de l’hospitalité donnée en France à Auriant, qui est étranger. C’est pour moi un point de vue bien étroit. Je n’ai pas convaincu Saltas, qui a fini par se radoucir. Le comique, c’est qu’il est Grec comme Auriant, avec cette différence qu’il a, je crois, acquis la qualité de Français par sa mobilisation comme médecin pendant la guerre. Il m’a demandé de garder entre nous cette discussion, ce qui est bien mon intention.
Je lui ai dit : « Le seul défaut d’Auriant, — je le lui dis souvent à lui-même, — c’est d’user d’une trique dans ses articles, au lieu de l’ironie, de la raillerie, du ridicule et de faire rire aux dépens de celui qu’il attaque. »
Notes
1 Annonce du Figaro du 21 novembre 1903, page six.

2 Les pastilles du sérail étaient réputées au XIXe siècle pour stimuler le désir sexuel et ont donc dû être fort vantées par les charlatans. Le dictionnaire de l’Académie française de 1832 indique « Pastilles qui viennent de Constantinople, qui répandent une odeur agréable, et dont on fait différents bijoux. » dans L’Éducation sentimentale (III-5), Flaubert écrit « Aux coins, dans les deux vases, des pastilles du sérail brûlaient. » L’Officine de Dorvault (1880) indique : « Vanille, Musc, Cannelle, Safran, Ambre gris, Girofle (Clou de), Gingembre, Macis. »
3 Personnage légendaire qui aurait accédé à la papauté en se faisant passer pour un homme. La Papesse Jeanne, roman médiéval, traduit par Alfred Jarry et Jean Saltas depuis l’œuvre grecque d’Emmanuel Rhoïdis (1836-1904) écrite en 1866. Lire l’article de Démétrius Astériotis dans le Mercure du seize mai 1908 (rubrique « Lettres néo-grecques ») pages 363-365. Une réédition de l’ouvrage est parue chez Actes sud en 1995. Pour d’Emmanuel Rhoïdis, voir la note 71 de la seconde partie de cette page, à paraître le quinze octobre 2024.
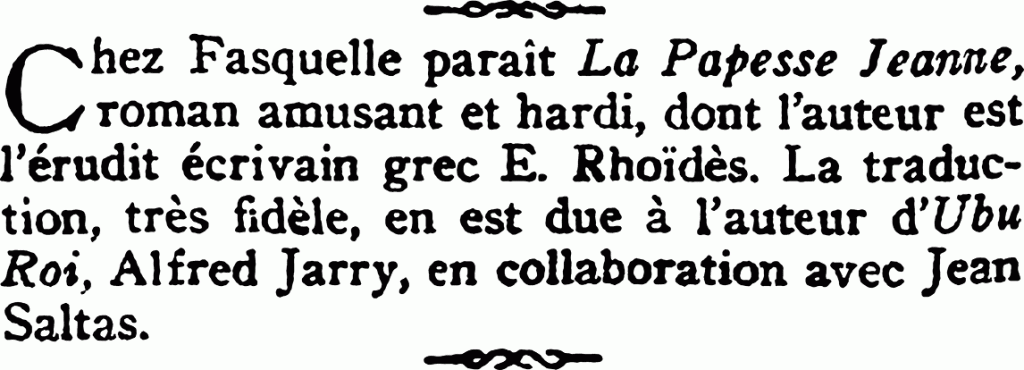
Annonce de la parution de la traduction française de La Papesse Jeanne par Alfred Jarry et Jean Saltas avec une faute dans le nom de l’auteur (en une du quotidien Le Journal du quinze février 1908).
4 Gaston Danville (Armand Abraham Blocq, 1870-1933), romancier Mercure (le plus souvent), a dédié Comment Jacques se suicida (1891) à Alfred Vallette, L’Ange noir (1892) à Louis Dumur et Le Rêve de la mort (1892) à Rachilde. Ces nouvelles ont été rééditées, avec celles d’autres auteurs (150 nouvelles en tout, plus de mille pages), en 2008 dans la collection Bouquins sous le titre collectif Petit musée des horreurs. Nouvelles fantastiques, cruelles et macabres. Gaston Danville est le promoteur d’une réforme de l’orthographe. Son épouse se suicidera (Journal littéraire au 22 décembre 1931).
5 En effet, le père de Rachilde, Joseph Eymery (1822-1892), avait laissé une veuve née Gabrielle Feytaud en 1837 et morte le quinze décembre dernier à Charenton. Il reste maintenant sans doute à vendre la maison de famille de Château-l’Évêque.
6 Voir la lettre, violente, d’Alfred Jarry à Félix Fénéon datée du six juin 1906 : « J’ai collaboré avec le Dr Saltas, qui est un sot, j’en ai toutes les preuves […] Cet Oriental […] est insinuant, obstiné, arriviste. » Cité par Maurice Saillet en préface de La chandelle verte, lumières sur les choses de ce temps, librairie générale, 1969. Voir Philippe Régibier, Ubu sur la berge, Alfred Jarry à Corbeil (1898-1907),
7 François de Curel, L’Ivresse du sage, comédie en trois actes créée à la Comédie-Française le six décembre 1922 (19 représentations). Cette pièce n’a pas été chroniquée par Maurice Boissard. François de Curel (1854-1928), romancier et auteur dramatique naturaliste élu à l’Académie française en mai 1918.
8 Jacques Richepin (1880-1946) est le fils de Jean Richepin, l’auteur de La Chanson des gueux. En mai 1901 Jacques Richepin a épousé la comédienne Cora Laparcerie. En 1913 le couple a dirigé le théâtre de La Renaissance jusqu’en 1928.
9 Francis Carco (François Carcopino-Tusoli, 1886-1958), romancier du réalisme social dans la veine d’un Mac Orlan, est surtout connu pour son premier roman, Jésus-la-Caille (1914, remanié en 1920) et L’Homme traqué, qui a reçu le Grand prix de l’Académie française en 1920.
10 Jacques Richepin et Francis Carco, Les Chercheurs d’or, pièce d’aventure en quatre actes, Lectures pour tous, Hachette, mars 1923. Dans la Revue hebdomadaire du 23 décembre 1922, François Mauriac écrira : « La mise en scène est digne du Châtelet, et Mme Cora Laparcerie joue de l’éventail en tout à fait grande dame. MM. Harry Baur et Collin méritent d’égales louanges. » Voir aussi l’article d’Armory sur la moitié de la une du Comœdia du treize décembre.
11 Ici se termine la journée de l’édition papier. Le reste de la journée provient du tapuscrit de Grenoble, relevé par l’indispensable Bertrand Vignon, très discret ces temps-ci.
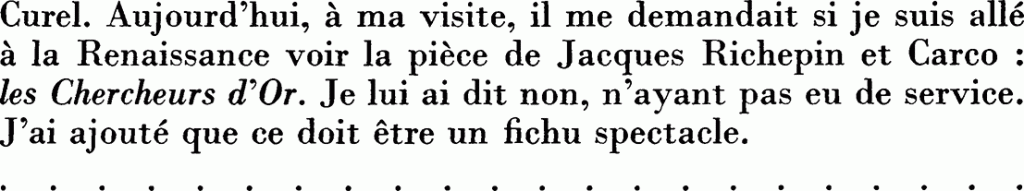
L’édition papier du Journal littéraire.
12 Louis-Frédéric Rouquette (1884-1926), né à Montpellier, s’est installé à Paris en 1908 et effectue divers travaux de secrétariat pour vivre avant d’être recruté par le ministère des Affaires étrangères pour organiser la participation française à l’exposition universelle de San-Francisco qui doit se tenir en 1915. À cette occasion, L.-F. R. s’est vraisemblablement rendu sur place. Après quelques romans empreints de sa culture provinciale, Le Grand silence blanc « roman vécu d’Alaska » paraît en 1920 chez Ferenczi (252 pages). Le succès incite L.-F. R. à publier d’autres romans de la même veine, qui n’atteindront jamais l’audience du premier.
13 Comœdia du treize décembre 1922, page quatre : « Un de nos confrères annonçait hier qu’un incident aurait surgi entre M. L.-F. Rouquette, auteur du livre Le Grand silence blanc et MM. Jacques Richepin et Francis Carco, auteurs de la pièce actuellement jouée à la Renaissance, Les Chercheurs d’or. / Notre confrère affirmait que cette pièce contenait des emprunts au livre de M. Rouquette d’un caractère si évident, que les auteurs lui auraient offert de l’intéresser dans leur affaire. M. Rouquette aurait refusé et son éditeur prendrait, paraît-il, “toutes les mesures que comporte la situation”. / Nous avons eu l’occasion de joindre dans la soirée MM. Jacques Richepin et Francis Carco, qui ont été très surpris de la teneur de cet écho dont ils ignoraient la publication. Ils n’ont été l’objet d’aucune réclamation, ignorent le premier mot de l’offre qu’ils auraient faite, et tout en rendant hommage à l’œuvre de M. Rouquette, se sont uniquement inspirés, dans leurs recherches documentaires nécessaires à leur pièce, des indications contenues dans les livres de M. Jack London. »
14 « chaque fois souvent », on voit bien que ce tapuscrit de Grenoble est juste sorti de la machine à écrire de Marie Dormoy. La « place » en question semble être la « place de Paris » (peut-être à l’École militaire), un service de l’armée gérant ces affaires de permissions pour raison de santé.
15 Henri Albert (Henri-Albert Haug, 1869-1921) signait de ses seuls prénoms et beaucoup pensaient ainsi qu’il se nommait Albert. Spécialiste de Nietzsche et auteur Mercure depuis 1891, il y tint une rubrique de « Lettres allemandes » de janvier 1893 à juin 1921. Dans d’autres journaux il utilisait parfois le pseudonyme de Matin Gale. Lire, à l’occasion de sa mort, un court portrait au trois août 1921.
16 Cora Laparcerie (Marie-Caroline Laparcerie, 1875-1951) a débuté à l’Odéon en 1896 avant d’épouser Jacques Richepin en mai 1901. Elle s’est rapidement tournée vers la direction de théâtres.
17 Tiarko Richepin (1894-1973), compositeur de musiques de scène, d’opérettes et de musique de films.
18 La comédienne Rosemonde Gérard (1866-1953) a épousé Edmond Rostand en avril 1890 et lui a donné deux fils : l’écrivain Maurice Rostand (1891-1968) et le biologiste Jean Rostand (1894-1977).
19 Comme souvent les petites entreprises, les éditeurs de ce temps-là étaient des affaires de famille. Eugène Fasquelle (1863-1952), a été embauché à 23 ans secrétaire du libraire et éditeur Georges Charpentier (1846-1905), l’éditeur des naturalistes (Zola, Flaubert, Maupassant…). Trois ans plus tôt étaient entrés dans la maison Charles Marpon, Ernest Flammarion et leur capital. En octobre 1887, un an après son entrée dans la maison, Eugène Fasquelle épouse Jeanne Marpon (1868-1960), fille de Charles. Ils auront deux filles et un fils, Charles (1897-1965). Charles Marpon meurt en 1890. Ernest Flammarion cède ses parts à Eugène Fasquelle, qui devient majoritaire dans la maison Charpentier, ce qui entraînera son déclin au point qu’en 1946 Marie Dormoy refusera de se faire éditer par Fasquelle, qui sera absorbée par Grasset en 1959.
20 Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bayonne. La maison Arnaga abrite de nos jours le musée Edmond Rostand. L’endroit est très luxueux.
21 Jean Richepin s’est marié une première fois en 1879 à Marseille avec Eugénie Constant qui lui a donné ses deux fils Jacques et Tiarko et une fille prénommée Sacha. Il a divorcé pour épouser en décembre 1902 Marianne Stepowska (1873-1953).
22 À l’occasion d’une reprise de Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte-Saint-Martin avec Charles Le Bargy dans le rôle-titre, la répétition générale du 26 octobre 1915 en matinée est « rigoureusement réservée » aux blessés de guerre. Edmond Rostand est parti sur le Front (Champagne, Vosges, Alsace) et en est revenu le 31 octobre. Voir Le Matin du premier novembre 1915 (page trois, colonne six) et la une du Gaulois du quatre novembre, colonne deux.
23 Le Siècle du cinq novembre 1915, page deux, sous l’intertitre Ironie : « Un de nos confrères, dont la réputation de courtoisie n’est plus à établir, informe en ces termes ses lecteurs du voyage de M. Edmond Rostand au front : “Edmond Rostand vient de faire un voyage sur le front. Pour un civil qui n’est pas entraîné, le déplacement est souvent difficile, parfois périlleux, et toujours fatigant. On aime à voir ainsi que le poète, qui vient d’exécuter cette petite randonnée de plusieurs jours, est en parfaite santé. / Tout le monde sait, en effet, que M. Edmond Rostand s’enrhume assez facilement.” »
24 Basil Zaharoff (1849-1936), marchand d’armes d’origine grecque, financier et philanthrope. Ce prix Balzac, financé par Basil Zaharoff était organisé par Bernard Grasset dans le but de concurrencer le prix Goncourt. Le montant du prix, récompensant un jeune auteur était de 20 000 francs plus 10 000 venant de Grasset, à titre d’avance de l’éditeur. Les deux « jeunes » lauréats ont été Émile Baumann (54 ans) pour Job le prédestiné et Jean Giraudoux (40 ans) pour Siegfried et le Limousin, livres qui furent évidemment édités chez Grasset (Giraudoux étant depuis longtemps chez Émile Paul). Les réactions de la presse furent contrastées. Pour la pièce Siegfried, voir le Journal littéraire au 17 mai 1945.
25 Quinze membres se réunirent le 28 octobre dans la maison de Balzac, rue Raynouard pour départager les douze finalistes sur 380 candidats : Maurice Barrès (absent, ne vota pas), Henri Bidou, Marcel Boulenger, Paul Bourget (président), Élémir Bourges (jury Goncourt), René Boylesve, Gaston Chérau (futur Goncourt au couvert d’Élémir Bourges qui mourra en novembre 1925), Léon Daudet (jury Goncourt), Georges Duhamel, Henri Duvernois, Daniel Halévy, Edmond Jaloux (secrétaire), Léon Lafarge, Jean de Pierrefeu, Fortunat Strowski.
26 Diane de Gonnet, maîtresse d’André Rouveyre. Voir le Journal littéraire au huit février 1926.
27 « Danville » restitué depuis le tapuscrit de Grenoble. Voir la note 4.
28 Le roman d’Eugène Montfort, Cécile ou l’amour à 18 ans paraîtra chez Flammarion, daté de 1929.
29 Que valaient 1 000 francs en 1929 ? Un mois de salaire environ. Le seize septembre 1930 Paul Léautaud dira être payé 750 francs par mois mais Alfred Vallette payait notoirement mal.
30 C’est plus tard, mi-janvier 1910 que Paul Léautaud s’est installé au treize passage Stanislas (actuelle rue Jules Chaplain), pas loin du carrefour Vavin. Il a souffert, ce printemps-là, d’une grave maladie vénérienne transmise par une certaine Thérèse, ce qui l’a conduit à demeurer alité quatre mois. C’est Alfred Vallette qui a alors mandaté Jean Saltas auprès de Paul Léautaud. C’est de cette date que Jean Saltas est devenu le médecin attitré de Paul Léautaud.
31 Georges Batault (1887-1963), écrivain, historien et philosophe suisse d’expression française, nationaliste et antisémite, proche de Louis Dumur. Georges Batault écrit dans le Mercure depuis 1908 et tiendra la rubrique des journaux à partir de 1928.
32 Anne Cayssac dite Le Fléau.
33 L’Amour la poésie, sorti chez Gallimard le douze mars 1929, qui contient ce vers : « La terre est bleue comme une orange ». Du coup, André Fontainas ne fera pas de compte rendu de ce recueil.
34 En effet, Georges Courteline à qui l’on a coupé la jambe la veille, va mourir le lendemain 25 juin, à l’âge de 71 ans exactement puisqu’il est, comme Octave Mirbeau, né et mort le même jour de l’année.
35 Juillet 1930.
36 Septembre 1926.
37 Albin Michel (1873-1943) a épousé en 1901 Claire Villaume (1881-1909, à 28 ans). Le couple a eu deux enfants, Andrée et André. À la mort de son épouse, Albin Michel s’est remarié en 1911 avec Georgette Deshays (1870-1953).
38 En 1922, semble-t-il, avec une préface de Jean Saltas.
39 Caroline Jarry (1865-1925 à hôpital Boucicaut à l’âge de soixante ans). Caroline Jarry a été professeur de piano, brodeuse, femme de ménage… Alfred Jarry avait eu aussi un frère cadet, Gustave (31/08/1870-13/09/1870).
40 Jean Saltas, né en 1865, a 66 ans. Ce projet n’aboutira pas.
41 Vraisemblablement Les minutes de Sable mémorial suivies de César-Antéchrist, Fasquelle 1932, 264 pages. Journal littéraire au 26 décembre 1941 : « Saltas ignore complètement les temps des verbes : il les emploie au présent pour des événements qui remontent fort loin. »

43 L’hôpital de La Charité a été établi au début du XVIIe siècle. Il sera actif jusqu’en avril 1935, abritant à cette époque 680 lits. La démolition complète de cet hôpital a laissé place au campus universitaire du 45 rue des Saint-Pères, ouvert en 1953 après seize années d’errances administratives et une guerre.
44 L’ordre des médecins a été créé sous Vichy, en septembre 1940, puis dissout en août 1944 avant d’être ré-institué en septembre 1945.
45 Henri Béraud (1885-1958), avait bien commencé mais il a très mal fini. Journaliste aux premiers temps du Canard enchaîné, ami de Paul Vaillant-Couturier, de Roland Dorgelès et d’Albert Londres, il collaborait aussi au Crapouillot de Jean Galtier-Boissière. En 1922, Henri Béraud reçoit le prix Goncourt pour son Martyre de l’obèse chez Albin Michel. L’affaire Stavisky le trouble et en février 1934 il écrit dans Le Canard enchaîné un article favorable à la manifestation antiparlementaire d’extrême droite du six février, ce qui lui vaut son éviction du journal satirique plutôt à gauche. C’est le début de la dérive d’Henri Béraud vers l’antisémitisme, puis la droite puis enfin l’extrême droite à l’entrée de la guerre. À la Libération Béraud a été condamné à mort aux derniers jours de 1944 mais a été gracié par Charles de Gaulle. Atteint d’hémiplégie en prison, Béraud a été libéré en 1950 et est mort en 1958. Voir la note dans l’Avant-propos aux chroniques dramatiques, signé Marie Dormoy, rattaché à l’année 1908. Voir aussi le repas chez Florence Gould du onze janvier 1945.
46 Numéro du 22 juin 1938, page quatre, accompagné de la photographie ouvrant cette page web. Cet article est reproduit en annexe II (page Saltas II, avant les notes).
47 Alfred Jarry, Ubu enchaîné, suivi de Ubu sur la butte, des Paralipomènes et d’essais sur le théâtre. Préface de Jean Saltas, Fasquelle 1938, 185 pages. Un Ubu enchaîné avait été représenté à la Comédie des Champs-Élysées en septembre 1937 dans une mise en scène de Sylvain Itkine.
48 Voir aussi Le Jardin des lettres « revue mensuelle de tous les livres français & du mouvement intellectuel contemporain » (juillet-août), page seize. Voir aussi Le Journal des débats du treize juillet, page deux, milieu de la colonne cinq et un « Écho » en page deux du quotidien Le Journal du 17 juillet.
49 Le nom de Maurois est, dans ce débat, absent de l’édition papier du Journal et a été rétabli ici. Il s’agit d’une allusion au long chapitre de l’affaire dite des « Plagiats d’André Maurois » ouvert fin décembre 1927. Le bouillonnant Auriant — grec lui aussi — s’est enflammé pour avoir découvert quelques similitudes çà et là. Paul Léautaud et l’ensemble du Mercure (Alfred Vallette compris) ont suivi avec, semble-t-il, plus d’enthousiasme que de raison. L’ensemble de la presse a été très réservé, et parfois déraisonnablement hostile aux affirmations d’Auriant. Quelle que soit la tendance naturelle à défendre le pot de terre contre le pot de fer, la lecture des preuves d’Auriant, chipatouillant parfois sur des guillemets oubliés, entraîne au mieux un avis réservé. Dans son édition papier du Journal littéraire, le Mercure de France a sagement supprimé ce débat qui lui aurait peut-être valu un procès bien inutile. Seule la lecture du tapuscrit de Grenoble permet de se faire une idée de l’ampleur que l’affaire a prise au sein de la rédaction du Mercure de l’époque.
50 Cette phrase provient du tapuscrit de Grenoble.
Les notes 51 à 57 se trouvent après l’annexe..
Annexe I — Les Derniers jours d’Alfred Jarry
Par Jean Saltas51
Alfred Jarry est né à Laval le 8 septembre 1873, jour de la Nativité de la Vierge, il est mort à l’Hôpital de la Charité, le 1er novembre 1906, jour de la Toussaint.
Malgré son érudition profonde et variée, il fut toujours un garçon simple et naïf, content de tout et de lui-même. Ubu-Roi52, son chef-d’œuvre, cette pièce légendaire et bouffonne, qui renferme la simplicité satirique d’Aristophane, le bon sens et la truculence de Rabelais et la fantaisie lyrique de Shakespeare, fut composée à l’âge de quinze ans. C’est avec raison qu’on a écrit que le héros de cette géniale guignolade est entré dans l’humanité et l’histoire comme Don Juan, Tartufe, Hamlet et Panurge53-54.
À l’époque où je collaborais avec lui pour un roman adapté du grec, la Papesse Jeanne, Jarry, déjà atteint moralement et physiquement suivit mon conseil et alla se reposer chez sa sœur, à Laval.
J’ai de lui, nombre de lettres aussi curieuses qu’intéressantes qu’il m’adressa à cette époque. En voici une qu’il avait envoyée d’autre part à Mme Rachilde, avec qui le liait une grande amitié. On y retrouve toute son originalité intellectuelle, doublée de cette sorte d’ironie qui ne l’abandonnait pas.
À Madame R…
Laval, le 28 mai 1906
Madame R…,
Le Père Ubu, cette fois, n’écrit pas dans la fièvre (ça commence comme un testament, il est fait, d’ailleurs.) Je pense que vous avez compris maintenant, il ne meurt pas (pardon ! le mot est lâché) de bouteilles et autres orgies.
Il n’avait pas cette passion, et il a eu la coquetterie de se faire examiner partout par les « merdecins ». Il n’a aucune tare, ni au foie, ni au cœur, ni aux reins, pas même dans les urines ! Il est épuisé simplement (fin curieuse, quand on a écrit : le Surmâle55, et sa chaudière ne va pas éclater, mais s’éteindre. Il va s’arrêter tout doucement, comme un moteur fourbu… Et aucun régime humain, si fidèlement (en riant en dedans) qu’il les suive, n’y fera rien. Sa fièvre est peut-être que son cœur essaye de le sauver en faisant du 150. Aucun être humain n’a tenu jusque-là. Il est depuis deux jours « l’extrême-oint du Seigneur » et tel, l’éléphant sans trompe de Kipling « plein d’une insatiable curiosité ». Il va rentrer un peu plus arrière dans la nuit des temps. Comme il avait son revolver dans sa poche-à-cul, il s’est fait mettre au cou une chaîne d’or, uniquement parce que ce métal est inoxydable et durera autant que ses os, avec des médailles, auxquelles il croit, s’il doit rencontrer des démons. Çà l’amuse autant que des poissons… Notons que, s’il ne meurt pas, il sera grotesque d’avoir écrit tout cela… Mais nous répétons que tout ceci n’est pas écrit dans la fièvre. Il a laissé de si belles choses sur la terre, mais disparaît dans une telle apothéose !… Et comme disait sur son lit de mort, Socrate à Ctésiphon : « Souviens-toi que nous devons un coq à Esculape. »
Maintenant, Madame, vous qui descendez des grands inquisiteurs d’Espagne, celui qui, par sa mère est le dernier Dorset (pas de folie des grandeurs, j’ai ici mes parchemins), se permet de vous rappeler sa double devise : Aut numquam tentes, aut parfice (n’essaye rien ou va jusqu’au bout). J’y vais, Madame R… toujours loyal… et vous demande de prier pour lui : la qualité de la prière le sauvera peut-être… Mais il s’est armé devant l’Éternité et n’a pas peur.
. . . . . . Une ligne de points. . . . . . .
Le Père Ubu a fait sa barbe, s’est fait préparer une chemise mauve par hasard ! Il disparaîtra dans les couleurs de Mercure… et il démarrera, pétri toujours d’une insatiable curiosité. Il a l’intuition que ce sera pour ce soir à 5 heures56… s’il se trompe, il sera ridicule et voilà tout. Les revenants sont toujours ridicules.
Là-dessus, le Père Ubu, qui n’a pas volé son repos, va essayer de dormir. Il croit que le cerveau, dans la décomposition, fonctionne au-delà de la mort, et que ce sont ses rêves qui sont le Paradis.
Le Père Ubu, ceci sous condition (il voudrait tant revenir au Tripode)57 va peut-être dormir pour toujours.
Alfred Jarry
P.-S. — Je rouvre ma lettre, le docteur vient de passer et croit me sauver.
En effet, le pauvre Jarry ne mourut pas. Il ne voulait d’ailleurs pas mourir dans son pays natal. Il l’avait quitté depuis longtemps et y était complètement inconnu. J’ai fait un séjour à Laval pendant la guerre. J’ai pu me rendre compte de l’ignorance dans laquelle on y était d’un écrivain dont on avait tant parlé.
À moitié rétabli, Jarry revint à Paris. Ma surprise fut grande de le voir arriver un matin chez moi. Je reconnus bien là les qualités charmantes qu’il avait sous sa brusquerie affectée ; il m’apporta une photographie de lui en escrimeur, le montrant plein de vie et de santé. Il voulait absolument me faire croire qu’elle était récente, alors qu’elle remontait à plusieurs années. Le vrai, c’est qu’il n’avait déjà plus dans les yeux, dans la physionomie, cette vivacité d’expression qu’on lui a connue, ni ce sourire convulsif et brutal qui passait si rapidement du sérieux au comique et qui donnait souvent à son visage quelque ressemblance avec un masque japonais.
Je le revis le lendemain, au Mercure dans un état d’abattement complet, et j’eus avec Mme Rachilde une impression d’inquiétude. Il devait venir me voir le surlendemain. Il ne vint pas, et négligence assez curieuse, étant donné ses habitudes de parfaite correction, oublia de s’en excuser.
Il y avait trois jours que je ne l’avais vu. Le sachant si malade, j’allai en informer Vallette. Nous nous rendîmes chez lui, au 7 de la rue Cassette, au fond de la cour, au deuxième ou troisième étage, une chambre singulière, extrêmement basse de plafond. On a souvent pensé que le propriétaire de l’immeuble, pour multiplier ses locaux, avait dû diviser chaque pièce originale en plusieurs dans le sens de la hauteur. Après avoir frappé plusieurs fois nous entendîmes enfin Jarry nous répondre, de l’intérieur, d’une voix faible et rauque, qu’il allait venir ouvrir. Cependant, au bout d’une heure, nous étions encore là à attendre. Ne devinant que trop l’état dans lequel il devait être, Vallette, ayant frappé de nouveau, lui demanda s’il ne valait pas mieux envoyer chercher un serrurier. Il approuva aussitôt avec ces mots : « En effet, ce ne serait pas si bête.» La porte fut ainsi ouverte. Nous entrâmes. Nous le trouvâmes au fond de la chambre, étendu à terre, ne pouvant plus se relever. Auprès de lui se trouvaient deux bouteilles vides et une troisième qui lui servait de bougeoir. Comme mobilier, une guitare accrochée au mur, un hibou empaillé, divers vases à fleurs qui exhalaient toute autre odeur que celle des roses, et une table de bois blanc avec quelques volumes. Jarry avait cette opinion qu’il était ridicule d’acheter des livres quand on a à sa disposition, comme tout le monde, la Bibliothèque Nationale. Ce fut ce jour-là que Jarry quitta sa chambre de la rue Cassette pour n’y plus revenir. Vallette et moi, nous le descendîmes dans nos bras, nous l’installâmes dans un fiacre et le conduisîmes à l’Hôpital de la Charité. Il entra aussitôt dans le service du professeur Roger, doyen actuel de la Faculté de Médecine. On va voir un exemple à la fois de sa délicatesse et de son humour : pendant le trajet dans le véhicule. Il me confia, comme un grand secret, qu’il était sans argent et me pria de régler les frais de son hospitalisation. Il ne pouvait concevoir, ajoutait-il, l’entrée de malades aisés dans les hôpitaux.
Il passa ainsi ses derniers jours à la Charité, admirable de patience, de calme, de bonhomie, de savoir-vivre et surtout d’insouciance. Il savait que le Dr Henri Roger s’était fait connaître également comme auteur dramatique à succès. Il tint à répondre aux compliments qu’il recevait de lui comme écrivain. Sa mémoire disparue ne lui permettant plus de le faire, il me fit écrire un jour, pour le montrer à mon confrère, le titre de sa pièce qu’il avait vu jouer maintes fois.
Son affaiblissement fut rapide. L’aspect qu’il prenait ne laissait plus de doute. La veille de sa mort, Mme Rachilde, sortant de le voir, en avait été si frappée qu’elle me dit ne plus pouvoir retourner auprès de lui, que, positivement, « il sentait la mort ».
Alfred Jarry eut une fin curieuse comme sa vie et son esprit. À la dernière visite que je lui fis, je lui demandai s’il désirait quelque chose. Ses yeux s’animèrent. Il y avait en effet quelque chose qui lui ferait grand plaisir. Je l’assurai qu’il l’aurait immédiatement. Il parla. Ce quelque chose était un cure-dents. Je sortis aussitôt pour aller lui en acheter et lui en rapportai tout un paquet. Il en prit un entre deux doigts de sa main droite. Une joie visible était sur son visage. Il semblait qu’il se sentit soudain rempli d’une grande aise comme aux jours où il partait pour une de ces parties de pêche, de canotage ou de bicyclette, ses trois sports préférés. J’avais à peine fait quelques pas pour parler à l’infirmière que celle-ci me fit signe de me retourner : il expirait.
Jean Saltas
Cet article — cela a été dit — est paru dans Les Marges d’Eugène Montfort le quinze octobre 1921. On peut consulter ci-après l’exacte reproduction (y compris les publicités), de ce numéro introuvable.
Notes des « Derniers jours d’Alfred Jarry »
51 Un large extrait de ce texte est aussi paru dans le quotidien L’Homme libre du 27 octobre 1921.

52 Ici avec un trait d’union. Distraction de Jean Saltas ou erreur du typographe ?
53 Note de Jean Saltas : « Une nouvelle édition d’Ubu-Roi vient de paraître chez Fasquelle. »
54 Les noms d’œuvres ne figurent pas en italiques ainsi que le veut l’usage. Jean Saltas rassemble ici trois titre d’œuvres et le nom d’un personnage, récurrent chez Rabelais, mais n’étant le titre d’aucune œuvre chez cet auteur.
55 Alfred Jarry, Le Surmâle, roman moderne, éditions de La revue blanche, 1902, 249 pages. En 1928, Rachilde écrira Alfred Jarry, le surmâle des lettres, chez Grasset.
56 Alfred Jarry mourra dans six ans, le premier novembre 1907.
57 Note de Jean Saltas : « Pied-à-terre de Jarry aux environs de Corbeil. »
La deuxième partie de cette page paraîtra le quinze octobre.