Page mise en ligne le quinze octobre 2024. Temps de lecture : 23 minutes.
La guerre — L’accident et la mort de Madame Saltas — Notes sur le texte (58 à 81)
Annexe II Silhouettes d’écrivains : Jean Saltas — Annexe III Jean Saltas : « Le Médecin de l’“Ami des bêtes” » — Notes sur les annexes (82 à 91)
La guerre
Le onze août 1941 paraît dans l’hebdomadaire collaborationniste (mais pas que) de Robert Brasillach Je suis partout, page huit, « Le Médecin de l’ami des bêtes », un article signé Jean Saltas dont il sera question ici en annexe III.
En novembre 1941 survient cette malheureuse affaire de l’arrestation du couple Mandin et, plus largement, du réseau de « La vérité française ». Lisons, à ce propos dans le Journal de Paul Léautaud, la part de Jean Saltas :
L’accident et la mort de Madame Saltas
Dans son Journal au treize février 1941, Paul Léautaud note :
Accident assez grave de Mme Saltas. Il y a trois semaines, elle était dans sa chambre, se préparant à faire sa toilette, une sorte d’étourdissement la prend, et, se raccrochant au hasard, répand sur elle une bouilloire d’eau bouillante à 80°. Brûlée sur tout le bassin, et certaines parties intimes, devant et derrière. Beaucoup souffert. Saltas passé quinze jours pas drôles, à lui faire des pansements jour et nuit. Va mieux. Brûlée au 2e degré, seulement. J’apprends de Saltas ce détail médical très intéressant : dans les cas de brûlure sur le corps, d’une certaine étendue, on peut risquer l’empoisonnement interne, le corps ne respirant plus par les pores de la peau.
Puis le 28 avril :
La pauvre Mme Saltas est morte des suites de ses brûlures, après bien des souffrances. Je ne suis arrivé au Mercure aujourd’hui qu’après déjeuner. J’ai trouvé sur mon bureau un mot de Mandin m’annonçant la nouvelle et que la cérémonie avait lieu ce matin à Saint-Sulpice à 9 heures. Dans quel état doit être le pauvre Saltas, qui est, comme homme, un enfant. J’irai le voir demain.
Mardi 29 Avril [1941]
Été voir Saltas, après déjeuner. C’est vrai, je le plains de tout mon cœur pour sa détresse, se retrouver seul à son âge, un ménage parfait58, comme il paraît bien qu’était le sien. Il a passé toute ma visite à pleurer, à me faire les plus grands éloges de sa femme. Les questions de vanité apparaissent-elles donc toujours dans ces circonstances ? Il a tenu à me faire lire des lettres d’Auguste Vacquerie59 à Mme Saltas, jeune fille, quand elle se présentait au Conservatoire, à l’occasion d’un concours, des billets aimables et flatteurs de Rosemonde Gérard. Saltas n’est pas un croyant, mais Mme Saltas était profondément croyante, allant tous les matins à la messe de 6 heures et demie. Comme médecin, il savait qu’elle était perdue. Le dernier jour, tout en larmes, il lui dit : « Comme c’est gentil ! Alors, tu me laisses seul… » Elle lui répondit : « Ne pleure pas. Je veillerai sur toi de là-haut. »
Je lui ai demandé comment il l’avait connue. Jeune médecin, en soignant sa mère, qu’il ne sauva pas. Elle était jolie, intelligente, honnête. Elle restait seule. Il en parla à son maître, le Professeur Debove60. Celui-ci « Épousez-la, Monsieur. Épousez-la. Seule. Pas de famille. Bien élevée. Épousez-la ! »
Vendredi 19 décembre [1941]
Quelle généreuse nature que cet homme, quelle capacité d’amitié, et d’une amitié active, dévouée. Je n’ai pas noté son aventure : étant monté, ne sachant rien, chez Mandin, et s’étant trouvé, comme dans une souricière, devant trois Allemands qui l’ont chambré, interrogé, emmené à la Kommandantur, là encore interrogé, puis enfin ramené chez lui. Il s’est élevé devant eux contre ces procédés, leur disant que pendant la guerre de 1914-1918, il a soigné, comme major, 2 000 Allemands, et qui plus est, le général… je n’ai pas retenu le nom. Un de ces trois Allemands dut reconnaître qu’il y a en effet un général allemand de ce nom. Il faut croire qu’ils ont fait s’informer du fait auprès de ce général, car celui-ci a répondu : « Le Docteur Saltas ? Qu’on lui dise bonjour de ma part. Et pas cela seulement. Je désire qu’il me donne de ses nouvelles, qu’il me dise ce qu’il devient. » Changement d’attitude à la Kommandantur. Les Allemands pleins de prévenances pour Saltas, venant lui exprimer le bonjour dudit général et son désir d’avoir de ses nouvelles. Saltas a griffonné quelques lignes, en disant qu’il allait écrire à ce général. Offre de venir chercher sa lettre, pour la faire parvenir. Saltas a répondu qu’il avait besoin de quelques jours, qu’il la leur porterait lui-même. Or, Saltas va tout bonnement dans cette lettre plaider la cause de Mandin, se porter garant de son innocence, expliquer que les papiers à signes cabalistiques qu’on a trouvés chez lui sont des travaux sur Shakespeare, les fameux cryptogrammes qui se trouvent déjà dans l’ouvrage du général Cartier sur la question Bacon-Shakespeare-Lord Derby61, que Mme Mandin n’a pas du tout vendu son piano pour acheter une machine à écrire, mais un divan-lit (Mandin et sa femme désirant faire lit à part pour plus de repos), divan-lit pour lequel Saltas lui-même a fourni des bribes de tapisserie qu’il avait chez lui, que la machine à écrire a été fournie à Mme Mandin par un parent, chimiste de son état, qui habite Versailles, et pour lequel elle faisait des copies pour ajouter un peu d’argent dans le ménage. Le feu, l’ardeur de dévouement avec lesquels Saltas m’a développé tout cela ! Cœur merveilleux, et d’un si parfait désintéressement !
Tout le long de la guerre, et jusqu’à la mort de Louis Mandin, Jean Saltas se préoccupera de son sort.
Mardi 26 mai [1942]
À propos de mon observation, que ce Docteur 62 ne me connaît pas, ne sait rien de moi (je l’entendais : physiologiquement), Saltas me dit : « Mais si, mais si, il vous connaît très bien ! » Tout cela parce qu’il a lu cette niaiserie que Saltas a écrite et publiée dans Je suis partout63, je crois, sur les visites qu’il m’a faites chez moi passage Stanislas, et que Saltas a éprouvé le besoin de lui envoyer. Il a recherché la lettre qu’il a reçue à ce sujet de ce Docteur et me l’a donnée à lire, pour me montrer que j’y suis nommé. À en juger par son écriture (celle d’un écolier) comme par les lieux communs les plus plats de sa lettre, ce Docteur S. doit être un homme fort ordinaire. Ce qui peut ne pas empêcher, il est vrai, le savoir médical. Cet excellent Saltas est un enfant, avec sa petite vanité littéraire. Il coupe dans tout ce qu’on lui écrit à ce sujet.
Mercredi 27 mai [1942]
Après une visite à l’hôpital Laennec chez ce docteur S. …
J’ai ensuite retrouvé Saltas chez lui pour aller déjeuner ensemble comme convenu. C’est à l’Acropole, boulevard Montparnasse, qu’il m’a emmené. Nous avons retrouvé là, nous attendant, une dame, d’une quarantaine d’années, avec laquelle il semble au mieux. Excellent déjeuner. Je n’ai pas eu à donner un ticket. Je n’en avais du reste aucun. C’est cette dame qui y a fourni. Saltas au mieux avec le maître d’hôtel, un nommé Pigeon. Il doit prendre là tous ses déjeuners. Je voulais payer le mien. Il n’a pas voulu.
Je dis : excellent déjeuner. Sur le moment. Avec cette accoutumance à manger peu, à laquelle on est forcé, à laquelle l’estomac finit par s’habituer, sur le moment on est vite rassasié. Une heure après, on a de nouveau faim et on recommencerait bien. Grande gaieté de Saltas. Un bon plat, du bon vin, la société de cette dame et la mienne. Il a eu à un moment, deux fois : « La vie a du bon ! la vie a du bon ! » Ah ! les douleurs d’un veuf. Comme elles passent. La pauvre Mme Saltas, de « là-haut » comme elle disait, doit faire de tristes réflexions.
[…]
Saltas est rentré chez lui avec cette dame, lui donnant le bras pendant le chemin.
« Chez lui »… Il semble que ce soit à cette époque, fin mai ou début juin que Jean Saltas a déménagé dans la petite et très calme rue Dupin, à cinq cents mètres, reliant la rue du Cherche-Midi à la rue de Sèvres. Âgé de 77 ans, il n’exerce sans doute plus ; veuf, un appartement plus petit lui convient peut-être. Le neuf juin 1942 nous lisons : « En sortant de chez Saltas, rue Dupin ». Pourtant le 17 juillet :
Passé voir Saltas. Alain Laubreaux, qui habite sa maison, malade, 39 et crise de foie, à la suite d’une ripaille de grand format.
Peut-être ne faut-il voir là que des délais de déménagements.
Le premier octobre 1943 nous en apprendrons davantage sur la dame. Paul est encore en consultation chez Jean Saltas quand il écrit :
Cette doctoresse (qui est certainement l’« amie » de Saltas) est arrivée pendant ma visite.
Le huit octobre 1943, Je suis partout publie, page six « Le Souvenir d’Alfred Jarry », d’André Saltas, un gros quart de page à l’occasion de la prochaine parution de La Dragonne64, dernier ouvrage d’Alfred Jarry.
Le 19 novembre 1943 est la parution officielle du second volume du Théâtre de Maurice Boissard, le premier étant paru en novembre 1926. Le lendemain vingt :
J’ai porté ce matin les exemplaires Saltas, Cario65, Alice Liquier66. J’ai trouvé Saltas sur le trottoir, partant déjeuner au bras de sa doctoresse. Elle a bien mis la main sur lui, c’est sûr. Il n’y a pas à avoir de doute. Elle a dû penser à l’héritage.
Parce que, bien sûr, pour PL, une femme est forcément sans le sou…
Jeudi 9 Mars
Visite à Saltas. Il me parle de Fargue, qu’il est allé voir chez lui, dans son cinquième étage de la maison67, boulevard Montparnasse, au rez-de-chaussée de laquelle se trouve le café François Coppée. Il le juge très malade et qu’il n’en a plus pour longtemps68. Il l’a trouvé en train de travailler, une bouteille d’alcool à côté de son encrier, dont il prenait une gorgée fréquemment, à même la bouteille. Fargue a dû être de tout temps de ces écrivains qui ne peuvent travailler sans un excitant. Fargue a questionné Saltas sur la mort de Jarry, ses causes, et comme Saltas lui disait : « Alcoolisme au plus haut degré », il a eu cette réplique : « Il ne devait boire que de mauvaises choses. »
Au Docteur Saltas
Samedi 25 mars 1944
Cher ami,
Merci pour votre petit mot. Hier vendredi, rue de Vaugirard, devant la librairie Flammarion69, comme j’allais à mes courses habituelles, un passant que je ne connaissais pas, mais qui, lui, sans doute me connaissait, m’a abordé en me nommant et m’a fait part de l’article de Laubreaux qu’il avait été enchanté de lire70. J’ai acheté Je suis Partout, comme chaque vendredi. J’ai lu l’article de Laubreaux à une heure du matin. J’en suis ébloui : Je tombe toujours de mon haut quand je lis de pareilles choses sur moi. Je pense que de votre côté vous devez n’être pas peu fier d’avoir un « client » de ma sorte.
Amitiés
P. Léautaud
Le vingt avril 1944, se tient à la bibliothèque Doucet l’exposition Verlaine pour le centième anniversaire de sa naissance, organisée par Marie Dormoy.
Vendredi 21 Avril [1944]
Déjeuné avec M. D. au restaurant […]
Elle me raconte que Saltas est venu hier à l’Exposition Verlaine. Il lui a dit qu’Abel Bonnard a lu les articles de Laubreaux sur mon tome II Chroniques dramatiques, qu’il a parlé de moi avec Laubreaux et lui a dit (de moi) : « On pourrait le pensionner. » Laubreaux rapportant cela à Saltas, Saltas lui aurait dit : « Je vais le faire tâter » (savoir si j’accepterais ou non), ce dont il l’a chargée, elle. Comme je lui ai dit, à elle : « Je n’ai pas à bouger. Si Abel Bonnard veut faire quelque chose pour moi, il saura bien me trouver. »
Pour cette peu glorieuse affaire de pension, que Paul Léautaud regrettera dans un mois, voir le Journal littéraire aux 24 avril, 2, 5, 25 et 27 mai.
Saltas a traduit en français, — pas tout seul, car il ne sait guère l’écrire, — un livre remarquable, suite de morceaux sur divers sujets, intitulé Pararga (Passe-Temps) de l’écrivain grec Rhoidis71, qu’il se propose de proposer à Gallimard. Il m’en a donné à lire l’introduction, écrite par lui. Je suis bien resté cinq minutes, après l’avoir lue, à réfléchir, comme si je lisais encore, si je devais lui indiquer des corrections utiles, si je devais le faire profiter de mon savoir, de mon expérience, des observations que je fais chaque jour dans ce domaine, si je devais me mêler de lui apprendre qu’on ne doit pas commencer des phrases par : Mais… lui faire enlever des expressions comme : Et puis…, lui donner ainsi l’air d’un savoir qu’il n’a pas72, — ce que j’ai déjà fait plus d’une fois… Si je ne ferais pas mieux de lui dire : « C’est parfait… » À la fin je me suis décidé : « Mon cher, si vous le permettez, je vous indiquerai quelques corrections… » Il s’est récrié aussitôt qu’il en serait enchanté, qu’il m’en saurait même gré, et j’ai fait le pion, pour quelques passages.
Il m’a aussi fait part du désir d’Alain Laubreaux d’avoir ma brochure Amour, Aphorismes, qu’il n’a pas et ne peut trouver nulle part.
Mardi 4 Juillet [1944]
Tantôt visite à Saltas, pour lui restituer deux chapitres du livre de Rhoïdis qu’il m’avait donnés à lire, et lui remettre l’exemplaire d’Amour pour Alain Laubreaux.
Mardi 25 juillet
Ce matin, lettre de Saltas. Il a paru, dans Je suis partout, un article défavorable à La Dragonne, le roman posthume de Jarry publié par lui à la N.R.F73. Il s’en est plaint à Laubreaux qui lui donne le conseil de répondre au critique. Singulier conseil. Saltas m’envoie le texte de sa réponse pour avoir mon avis. Je le verrai ces jours-ci. Je lui dirai qu’on ne doit jamais répondre à un critique littéraire, que tous les jugements sont permis, même les plus défavorables, et surtout quand la réponse qu’on a préparée commence par : J’ai parcouru l’article… ce qui donne beau jeu au critique de vous répondre à son tour qu’avant de juger son article il eût convenu de le lire et non de le parcourir, et quand cette réponse est pleine de fautes d’orthographe et de français, autre occasion pour le critique d’une bonne réplique. Saltas est un enfant qui se prend pour un grand homme.
Jeudi 28 Septembre [1944]
Visite à Saltas, pour mon certificat mensuel de suralimentation. Je lui demande des nouvelles de B74. : « Il est parti en Allemagne ? — Oui. Il est venu me faire ses adieux. Il pleurait : « Pauvre France !… Avoir tant travaillé, lutté pour « la sauver… Les juifs vont revenir… » Je demande à Saltas : « Et sa femme ? sa fille ? — Elles sont restées, elles sont toujours là. C’est son frère qui s’occupe d’elles. Il a un frère, vous savez75, commandant dans l’armée coloniale76, qui est maintenant en France. » J’ai vu en effet ces jours-ci, un Écho, dans un journal, sur cet autre B., officier dans l’armée gaulliste. […].
Mercredi 28 mars [1945]
Les journaux ont annoncé récemment qu’Alain Laubreaux, qui était passé en Allemagne avec l’équipe de Je suis partout, est passé en Espagne77. Saltas me raconte qu’il écrit de là-bas à sa femme, très ouvertement, sur cartes postales. Elle est venue lui en montrer une qui l’intéressait : « Et comment va le bon docteur Saltas ? » « Ah ! non, non, pas cela, lui a dit le docteur Saltas. Dites-lui qu’il ne s’occupe pas de moi. »
Mercredi 27 Juin
Passé un moment chez Saltas. Je lui ai parlé de l’état de Valéry. Lui aussi, il dit : cancer. Quant au fait qu’on ne peut voir Valéry, il explique : les visites, les conversations créeraient une excitation qui pourrait provoquer de nouvelles hémorragies. C’est pourquoi elles sont à éviter.
Samedi 30 Juin [1945]
Saltas me raconte tantôt : Laubreaux78 — qui est allé, de l’Allemagne, se mettre à l’abri en Espagne, — a passé les quatre années de l’occupation sans payer un sou de ses impôts. Il faisait figure de personnage, par ses nombreux articles dans les journaux de ce temps. Aucune réclamation de la part du fisc. Son procès doit bientôt venir devant la Cour de Justice. Il sera condamné par contumace. La saisie de ses biens s’ensuivra. Le fisc, créancier privilégié, fera alors valoir sa créance. Il s’est produit ces temps derniers ce qui suit, qui est merveilleux. Un policier s’est présenté chez Mme Laubreaux, pour l’informer que le procès de Laubreaux va bientôt venir et lui conseiller, la condamnation étant certaine, de mettre à l’abri le plus possible de ses affaires. Le gérant de la maison qu’elle habite lui a donné tout de suite l’autorisation de déménager un très beau piano à queue. Et on sait que le mobilier d’un locataire est la garantie du propriétaire. […].
Jean Saltas a eu 80 ans le vingt janvier et, depuis cette date, n’a plus le droit d’exercer, selon la loi de l’époque. Pourtant il continue de délivrer à Paul Léautaud des certificats divers — pieds plats pour des chaussures ou de suralimentation (pour lui et pour Marie Dormoy). Malheureusement à l’automne Jean Saltas s’est vu retirer ce pouvoir (JL au vingt novembre).
Pour clore cette année 1945, paraît, le seize décembre Marly-le-Roy et environs aux éditions du Bélier de Mathias Tahon (1 000 exemplaires).
Deux mois et demi plus tard, Paul Léautaud écrit à Marie Dormoy, qui est en séjour à Lyons-La-Forêt, 35 kilomètres avant Rouen, vraisemblablement à l’hôtel de la Terrasse, où elle a ses habitudes :
À Marie Dormoy
Jeudi 28 Février 1946
Voici ma carte d’alimentation, et les tickets : Viande — Charcuterie — Denrées diverses — des tickets R. S. Farine de Soja (une nouveauté).
Vous remarquerez qu’il y a des tickets supplémentaires : viande.
Hier je suis monté chez Saltas, pour lui remettre son exemplaire Marly-le-Roy.
De lui-même, il m’a offert de me redonner un certificat suralimentation.
Je n’ai su que faire pour vous, ne sachant pas si vous y teniez ou non.
Si vous voulez recommencer aussi pour votre certificat (régime 2, je crois) je verrai à le lui demander.
Je me suis acheté une lampe à pétrole. Mais un abat-jour : introuvable. J’ai voulu m’en faire un. Je n’y arrive pas.
Mille bonjours
P. L.
Puis, à la fin de l’année 1946, le 18 novembre…
Marie Dormoy écrit ses Mémoires : Mémoires d’une jeune fille de l’autre siècle (ou : du dernier siècle)79. Le premier chapitre, qu’elle m’a donné à lire, est plein d’intérêt, de passages remarquables dans leur force d’expression et leur brièveté. Évidemment, c’est grave, sérieux, réfléchi. Quand même, je le répète, très intéressant. Je lui ai appris à ne pas commencer des phrases par : Mais, à éviter les : d’ailleurs, en tout cas, pour ma part, cependant, l’abus du tout, des tous, des adjectifs dramatiques, funeste, horrible, désolant, etc. J’ai noté la quête que fait Saltas, doublé du secrétaire du fils Fasquelle80, de manuscrits intéressants (il paraît qu’il ne leur en vient aucun), pour remonter un peu, par leur publication, cette maison d’édition que Fasquelle père a laissé tomber, par son dédain, depuis une vingtaine d’années, des auteurs nouveaux, que d’autres éditeurs, plus réfléchis, comme Gallimard, par exemple, ont su faire venir chez eux. J’ai donc dit à Saltas, il y a un mois environ, ou un peu plus, sans lui nommer l’auteur ni le sujet du livre, que je lui apporterai un jour un manuscrit très intéressant, de vraie littérature, sérieuse, bien menée. Aujourd’hui, à déjeuner, comme je demande à Marie Dormoy si elle continue à travailler à ce livre (ce pour quoi elle n’a guère de loisir), elle me dit : « Et puis, vous savez, je ne veux pas aller chez Fasquelle. Aller dans une maison tombée ! Non, non. »
Je lui ai donné le conseil, ou plutôt je lui ai dit qu’elle devrait publier ce livre sous un nom d’homme. Elle m’a répondu qu’elle compte même le publier sans nom d’auteur. Cela me permettra peut-être, le jour venu, de lui trouver un éditeur. Car, le livre sous son nom…
Depuis quelques temps, le nom de Jean Saltas s’espace dans le Journal littéraire, même pour des raisons médicales. Venir à Paris est de plus en plus difficile à Paul Léautaud. Le nom de Jean Saltas sera tout de même écrit à 31 reprises entre 1947 et février 1956, dont cette lettre…
Au docteur Saltas
Vendredi 11 juin 1948
Mon cher ami,
Je vous rapporterai le texte de Rhoidis. Il est au-dessus de mes forces de faire ce travail. Il s’agirait de qq. pages, bon ! Un pareil paquet ! Un pareil bavardage ! Cela m’assomme. Je suis désolé d’être bâti comme je suis : je me refuse à faire ce qui m’embête, ou me dérange, ou me déplaît.
J’ajouterai : mon travail — l’état de ma vue.
Cordialement à vous
P. Léautaud
Donc à 83 ans passés, Jean Saltas continue de traduire Emmanuel Rhoïdis mais son jeune camarade de 76 ans refuse de l’aider, ce qui causera leur rupture. Paul Léautaud ne se rendra jamais compte que ce refus est incompréhensible pour Jean Saltas. Il ne se souvient plus que le neuf août 1938 il écrivait qu’il lui devait bien cela « cent et cent fois ».
Cinq jours plus tard, le seize juin :
Tantôt, une lettre. Je crois reconnaître sur l’enveloppe l’écriture de Saltas. Je me dis : « Il n’est pas content du renvoi de son fatras Rhoïdis et il me l’exprime. » J’en riais à l’avance. La lettre ouverte, déception. Elle est de Gabriel Brunet, qui m’annonce sa visite pour après-demain vendredi et que j’ai grand plaisir à revoir, après pas loin de huit années.
Seize mois plus tard, le onze octobre 1949 :
J’ai écrit à Saltas, le 23 septembre, une lettre très cordiale, lui demandant de ses nouvelles, lui donnant des miennes, lui expliquant les raisons qui font mes visites si rares. Plus de quinze jours passés. Aucune réponse. Il est décidément fâché pour de bon. Tout cela parce que je me suis refusé à l’examen d’un manuscrit de souvenirs, absolument sans intérêt, de l’écrivain grec Rhoïdis (j’écorche probablement le nom81) — l’auteur de cette Papesse Jeanne, que lui, Saltas, a publiée en français, avec Jarry, — manuscrit qu’il voulait publier (chez Fasquelle) pour jouer encore à l’homme de lettres. Tant pis ! tant pis ! Je trouve excessif, moi, ce sans-gêne, même de la part d’un ami, de vous flanquer une pareille corvée, alors qu’on a soi-même son travail. Ce pauvre Saltas s’abuse. Je me rappelle le mot qu’il eut, avec un air attristé qu’on pût en douter, lors de son petit différend avec Thadée Natanson, au sujet de la propriété d’un manuscrit de Jarry, qui était vraiment celle de Natanson, ce qu’il ne pouvait digérer malgré tous mes efforts pour l’en convaincre : « Je suis tout de même quelqu’un, moi ! » Quelqu’un ? Oui. Peut-être. Comme médecin.
Jean Saltas ne sera plus évoqué que deux fois dans le Journal littéraire, en passant, et une fois dans une lettre datée du trente décembre 1950 en réponse à André Lebois, auteur d’Alred Jarry l’irremplaçable qui venait de paraître au Cercle du livre.
Notes sur le texte
La numérotation des notes poursuit celle de la page Saltas I, qui se termine à la note 57.
58 Corrigé de l’absurde « pas fait » dans l’édition papier.
59 Auguste Vacquerie (1819-1895), poète proche de Victor Hugo. Le quinze février 1843 Auguste Vacquerie a épousé Léopoldine Hugo (née en 1824). Ils mourront tous deux noyés le 4 septembre.
60 Maurice Debove (1845-1920), médecin en 1873, médecin des hôpitaux en 1877, agrégé en 1878, chef de service en 1884, doyen de la Faculté de médecine de Paris de 1901 à sa retraite en 1907.
61 L’affaire est compliquée comme un roman policier britannique et s’étale sur plusieurs siècles, mettant en cause la paternité de Shakespeare sur les œuvres qui lui sont attribuées et la maternité d’Elisabeth Ire sur Francis Bacon. Des chercheurs ont inventé, bien avant l’informatique une machine capable de mettre en évidence des analogies entre les styles d’écriture de Shakespeare avec celle de Francis Bacon, d’où les « signes cabalistiques » en question. Voir « Le Mystère Bacon-Shakespeare un document nouveau » page 289 du Mercure du premier septembre 1922.
62 En blanc dans l’édition papier et peut-être dans le manuscrit, Paul Léautaud ne se souvenant peut-être pas du nom de ce médecin. Depuis le début de la guerre, Paul Léautaud souffrait de nombreuses douleurs et voyait de nombreux spécialistes de toutes sortes. Celui-ci semble exercer à l’hôpital Laennec où il est chef de service.
63 Voir l’annexe III ci-dessous.
64 Alfred Jarry, La Dragonne, préface de Jean Saltas, Gallimard : « La Dragonne est le dernier ouvrage auquel ait travaillé Alfred Jarry. Il l’entreprit à Paris, en 1906, et le continua à Laval, où, déjà malade, il en dicta la plus grande partie à sa sœur Charlotte Jarry. Celle-ci, après la mort de son frère, acheva le livre, d’après les notes laissées par l’auteur d’Ubu-Roi. »
65 Louis Cario (1876-1960), docteur en droit en 1904, commissaire répartiteur des contributions directes et homme de lettres et peintre amateur. Louis Cario a été un temps, en 1937, pressenti par Paul Léautaud comme exécuteur testamentaire.
66 Alice Liquier, bibliothécaire de l’université, avait été, un temps, détachée à la bibliothèque Doucet.
67 Note de l’édition papier : « Fargue habitait à l’entresol ». La confusion est surprenante. Léon-Paul Fargue habitait au 1 boulevard du Montparnasse qui prolonge le boulevard des Invalides au croisement de la rue de Sèvres. En 1957 l’espace créé par ce carrefour a été nommé place Léon-Paul Fargue. Ce bel immeuble de 1934, à trois façades, est bien dans le style de l’époque. Il est accessible par trois entrées.
68 Avant de fréquenter les mardis de Rachilde, Léon-Paul Fargue (1876-1947), a été reçu aux mardis de Stéphane Mallarmé (1842-1898), où il a rencontré Paul Claudel, Claude Debussy, André Gide, Marcel Schwob, Paul Valéry… Il est devenu l’ami de Maurice Ravel. En 1924 il a fondé avec Valery Larbaud et Paul Valéry, la revue Commerce. Voir aussi son portrait dans le Journal littéraire au 28 décembre 1932 et sa nécrologie dans le Mercure du premier janvier 1948 par Georges Randal (Auriant) (page 185) et « Fargue — Premières rencontres », par Adrienne Monnier dans le Mercure de février 1948 en ouverture de la revue. Léon-Paul Fargue mourra le 24 novembre 1947.
69 À l’angle de la rue Rotrou, de l’autre côté du jardin du Luxembourg. La façade de la librairie s’étalait jusqu’à l’angle de la rue voisine, qui est la rue de Condé.
70 Cet article, « Le critique égale l’homme », particulièrement élogieux et long (plus de deux colonnes et demie) est reproduit ici en annexe IV.
71 Emmanuel Rhoïdis (1836-1904), « Écrivain, romancier, nouvelliste, critique littéraire et journaliste, directeur de la Bibliothèque nationale de Grèce » selon BNF Data qui n’indique que La Papesse Jeanne dans la liste des ouvrages de l’auteur. Emmanuel Rhoïdis est aussi l’auteur de Parerga, recueil d’articles littéraires et historiques (1885) et des Idoles (1893).
72 Paul Léautaud avait des avis bien tranchés sur l’écriture du français, qui paraissent un peu désuètes de nos jours.
73 Je suis partout du 21 juillet, page quatre : « La critique des livres / un roman de Jarry », signé de François-Charles Bauer.
74 Vraisemblablement Alain Laubreaux, en fait réfugié en Espagne. En mai 1947 il sera condamné à mort par contumace.
75 Trois sœurs et six frères (un garçon et une fille n’ont vécu que deux mois) dont Félicien, né en 1905, évoqué dans Les Lettres françaises du 23 septembre 1944 comme rédacteur en chef du Trait-d’union, hebdomadaire collaborationniste paru du 23 juin 1940 à février 1945. La famille est originaire de Nouméa.
76 Charles Louis Laubreaux (1903-1952), ingénieur, lieutenant de réserve au centre de mobilisation colonial d’infanterie en 1936.
77 En mai 1947 Alain Laubreaux sera condamné à mort par contumace. Il mourra a Madrid en 1968.
78 « B. » dans l’édition papier.
79 Ce livre paraîtra au Mercure dix-huit ans plus tard, le 29 mars 1963 sous le titre Souvenirs et portraits d’amis (312 pages).

80 Le fils d’Eugène Fasquelle est le très discret Charles Fasquelle (1897-1965), pas plus intéressé que ça par la littérature (note 19).
81 En effet, PL a écrit Rodidis.
Annexe II
Silhouettes d’écrivains :
Jean Saltas et le cycle d’Ubu
L’annexe I a été rattachée à la première partie du texte sur Jean Saltas.
Article d’Alain Laubreaux paru dans La Dépêche (de Toulouse) du 22 juin 1938.

Le docteur Jean Saltas est vif et malin comme son compatriote Ulysse. Ce Grec de Paris, qui sait le français comme un professeur en Sorbonne, et qui l’écrit mieux encore, a conservé un diable d’accent où l’on voit gambader les sirènes, flamber le ciel d’Ithaque et se profiler les colonnes du Parthénon. Près d’un demi-siècle de vie parisienne n’y ont rien fait. La fréquentation des plus grands poètes et des plus hauts artistes du temps ne l’ont pas corrigé. Il paraît que c’était déjà le cas de Jean Moréas.
Je rencontre souvent le docteur Jean Saltas, car nous sommes voisins, ou je l’aperçois à sa fenêtre, la figure ronde, le teint brun, avec son éternel sourire, sa petite barbe blanche taillée en pointe, son regard aigu et flambant comme un verre de vin d’Anjou, et chaque fois il m’appelle pour me parler d’une édition qu’il prépare d’Alfred Jarry, son ami de jeunesse, qu’il a aidé à vivre et à mourir. Il est hors de doute que Jarry devra sa survie littéraire au docteur Saltas. C’est plus qu’une amitié qu’il y apporte, c’est une religion. On lui doit déjà les précieuses rééditions de La Papesse Jeanne, des Minutes de sable mémorial, où le surréalisme apparaît dans sa fleur, mais un surréalisme de lettré, non ces débauches de bouviers ignorants dont nous eûmes le spectacle il y a une quinzaine d’années, et d’innombrables études sur les origines d’Ubu-Roi.
Au sujet d’Alfred Jarry, le docteur Saltas est intarissable. Il l’avait connu, au cours de l’hiver de 1897, dans un petit hôtel de la rue Bara82, où se réunissaient les poètes de la jeune école. Il y avait là, Rachilde, Henry de Régnier, Pierre Louÿs, Maurice Ravel, etc. Un lundi soir, très tard, un jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, bien musclé, arriva dans une tenue de bicyclette. C’était Jarry. Aussitôt, ils sympathisèrent. Depuis, ils ne se sont plus séparés et la plus tendre amitié les lia jusqu’à la mort de l’auteur d’Ubu.
Voué à l’œuvre et à la gloire d’Alfred Jarry le docteur Saltas préside aujourd’hui à l’édition d’Ubu enchaîné (Fasquelle, éditeur)83. Cette œuvre avait été présentée au public, pour la première fois, par la Revue blanche, en 1900(84). Elle avait passé tout à fait inaperçue. Le scandale soulevé par les représentations d’Ubu roi s’était alors apaisé. On considérait Jarry comme un joyeux farceur. On ne se doutait pas de l’importance que le personnage qu’il avait inventé allait prendre dans la galerie des grotesques de la littérature. Il a fallu l’Exposition de 1937 et les représentations que le Théâtre d’Essai a donné d’Ubu enchaîné85 pour s’apercevoir que cette pièce, dans son outrance caricaturale, allait aussi loin que sa devancière.
L’ouvrage que présente aujourd’hui le docteur Saltas ouvrira les yeux de beaucoup. Le personnage d’Ubu y prend ses véritables proportions. II ne peut plus être question désormais d’une pochade d’étudiant. Quand, après Ubu roi, on lit Ubu enchaîné, Ubu sur la Butte et Les Paralipomènes d’Ubu, ces farces grandioses qui complètent et achèvent ce que nous appellerons le cycle d’Ubu, on se rend compte que Jarry n’a point créé son héros au hasard d’une inspiration de fumiste, mais qu’avec la prescience géniale de tout ce que l’avenir réservait aux hommes de bouffonnerie et d’absurdité dans la conduite des États, il en dressait, dans l’énorme charge d’Ubu, la synthèse quasi organique.
Pour l’avoir si parfaitement établi, le docteur Saltas a bien servi l’histoire littéraire et la mémoire d’Alfred Jarry.
Alain Laubreaux
Annexe III
Jean Saltas : « Le Médecin de l’“Ami des bêtes” »
Texte de Jean Saltas (sauf, évidemment, l’introduction) paru dans l’hebdomadaire Je suis partout du 11 août 1941, page huit.

Le bruit a couru, dernièrement de la mort de M. Paul Léautaud, connu également, en littérature, sous le nom de Maurice Boissard. Articles nécrologiques, regrets, fleurs et couronnes. Mais Léautaud-Boissard était bien vivant. Il a lui-même, dans La Nouvelle Revue française, fait l’exposé critique des articles qui lui ont été consacrés. À cette occasion, le docteur Saltas, ami et exécuteur testamentaire d’Alfred Jarry, a adressé à M. Paul Léautaud une lettre qui constitue une plaisante contribution à l’histoire anecdotique des lettres contemporaines. Une indiscrétion nous permet de la reproduire ci-dessous :
Mon cher ami.
Je suis toujours plongé dans la même vague de tristesse et de désolation. Quand je suis seul, ce qui m’arrive souvent depuis la perte cruelle de ma chère compagne, je ne cesse de penser à peu d’amis que je conserve, dont l’attachement soutient mon courage et dont l’affection a toujours été ma plus douce consolation. Car la plus belle chose certainement qui puisse consoler dans la vie, c’est l’amitié : elle seule justifierait notre passage sur la machine ronde. Pour distraire et calmer mon chagrin, je pense à ces amis et je mets ma mémoire à l’épreuve en cherchant à fixer l’époque et les circonstances où je suis entré en relations avec eux.
Il y a quelque temps, le bruit a couru que vous étiez mort, et les journaux ne faisaient que publier des articles nécrologiques sur votre compte. Malgré votre émotion, que je crois profonde, car dans une de vos lettres vous m’écriviez ceci : « Comme la femme captive de Chénier86. je ne veux pas mourir encore87 (un encore qui me paraît du reste un bien mauvais français) », vous avez eu le grand privilège et l’extrême curiosité, sans l’extrême-onction, de savoir de votre vivant, ce que les autres pensent de vous, parce que si vous étiez vraiment mort je ne crois pas que tous ces articles seraient parvenus jusqu’à vous, les communications postales avec l’autre monde étant toujours et pour longtemps encore interrompues88. Je suis donc doublement heureux de l’occasion qui se présente de rappeler de votre vivant l’époque et les circonstances où j’ai fait votre connaissance et de dire ce que je pense de vous. Nous nous sommes connus en 1905 (il y a trente-six ans), et notre première rencontre a été tragique et comique en même temps.
Après la mort de mon ami et collaborateur Alfred Jarry, je suis allé demander à Alfred Vallette, directeur du Mercure de France de m’indiquer quelqu’un de la revue (n’ayant pas assez de temps disponible, à cause de mes obligations professionnelles) pour aider à corriger les épreuves de son dernier ouvrage, La Papesse Jeanne de Rhoïdès, qui devait paraître chez Fasquelle. « Adressez-vous de ma part, me dit-il, dans la pièce à côté, à la personne maigre qui porte des lunettes. » Je fus si mal reçu aussitôt que j’eus parlé à cette personne d’une traduction grecque, que je partis en me disant : « C’est un original ou un malade qui est plus à plaindre qu’à blâmer. » Son camarade de bureau89, qui ne portait pas de lunettes aux yeux, mais des sandales aux pieds, croyant que j’allai, me plaindre à Vallette, courut derrière moi, en m’offrant de remplacer le défaillant. Je me suis débrouillé comme j’ai pu.
Mais un matin, quelques mois plus tard, je reçois la visite de mon client et ami Danville, accompagné de Valette. Avec la tristesse sur la figure, comme si un grand malheur lui arrivait, ce dernier me demanda de visiter un rédacteur du Mercure, qui se trouvait très malade et sans soins et dont Vallette conseillait d’avance l’hospitalisation90.
Nous arrivons au passage Stanislas91, au cinquième étage, et grande fut ma surprise de me trouver en présence du même homme qui, quelques mois auparavant, m’avait si mal reçu. Il était dans son lit, entouré de deux ou trois chats, qui, en train de manger leur soupe, n’ont pas laissé de continuer en notre présence, et de deux ou trois chiens dc toute taille, race et sexe, et qui, pour exprimer leur contentement, ne faisaient que poser leurs pattes sur moi, transformant ainsi mon pardessus simple et uni en un pardessus de fantaisie.
Quand je rentrais chez moi de la visite que je vous avais faite, ma femme s’étant aperçue aussitôt du changement de couleur de mon pardessus, je lui dis que cela provenait probablement d’une chaise du Luxembourg où en passant, je m’étais assis pendant quelques minutes.
Au cours de la visite, comme je connaissais l’originalité du malade, j’avais proposé avec beaucoup dc précautions, sur le conseil de Vallette, qu’on le fit hospitaliser. Après une heure de discussion, parfois bien orageuse, comme il rejetait notre proposition, et que je ne voulais pas le laisser mourir chez lui, faute de soins, j’ai pris, malgré toutes les objections de Valette, la responsabilité de le soigner à domicile. Ainsi, je l’ai visité pendant trois semaines, et chaque fois en entrant, j’étais reçu par les chiens qui exprimaient leur reconnaissance pour les soins donnés à leur maître en continuant de poser leurs pattes sur moi et la transformation de mon pardessus devenait de plus en plus visible. Je fus forcé d’avouer ces visites à ma femme, ce qui l’amusa énormément car elle vous connaissait et elle était ou courant de l’affection chronique et incurable dont vous étiez atteint : la zoomanie.
Au bout de ces quelques jours de traitement, j’ai été content de constater non seulement que mon malade était hors de danger mais complètement guéri et en état de reprendre son service.
Depuis ce moment, cet homme si original et si brutal, qui n’ignore certainement point que vivre peu à la fois est le plus sûr moyen de vivre longtemps, est devenu le plus doué, le plus fidèle et le plus reconnaissant des amis.
Donc, soyez bon pour les animaux !
Jean Saltas
Notes des annexes II et III
82 La petite rue Bara, entre Le Dôme et La Coupole, relie la rue Notre-Dame des Champs et la rue d’Assas.
83 Ubu enchaîné, suivi de Ubu sur la butte, des Paralipomènes et d’Essais sur le théâtre, préface de Jean Saltas, portrait en frontispice par Balande, Fasquelle 1938.
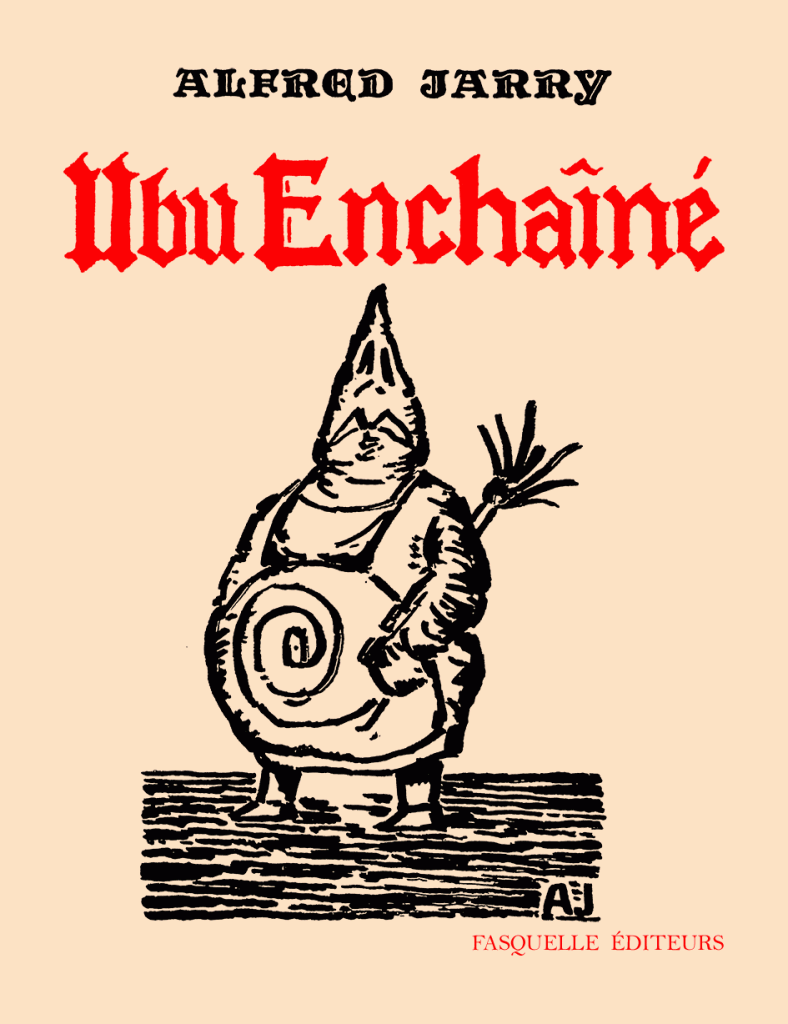
84 Alfred Jarry, Ubu enchaîné, précédé de Ubu Roi, daté de La Frette, septembre 1899, éditions de la Revue blanche, 1900. La Frette en question est le « phalanstère » de La Frette, à savoir la maison de Rachilde et Alfred Vallette à Corbeil.
85 Laubreaux n’a sans doute pas bien noté tous les détails fournis par Jean Saltas. Ubu enchaîné a d’abord été représenté par le théâtre des Arts en octobre 1936 puis repris à la Comédie des Champs-Élysées de l’avenue Montaigne en septembre 1937.
86 André Chénier, La jeune captive. Ce texte aurait été écrit par André Chénier la veille de sa mort, le 7 thermidor an II.
87 « Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui, / Quoi que l’heure présente ait de trouble et d’ennui, / Je ne veux pas mourir encore. »
88 Allusion évidente, cet été 1941, aux difficultés de communications entre les deux zones.
89 Paul Morisse. On peut être surpris de cette date de 1905 dans la mesure où PL n’a été employé au Mercure qu’au deux janvier 1908. Jean Saltas est évoqué pour la première fois dans le Journal littéraire le 14 avril 1908, ce qui reste compatible avec la date de parution de La Papesse Jeanne.
90 PL était atteint d’une hydarthrose blennorragique sévère.
91 Paul Léautaud a emménage passage Stanislas à la mi-janvier 1910. Cette visite de Jean Saltas semble avoir eu lieu le 25 mai 1910.