(André Gide IV)
Texte mis en ligne le premier novembre 2023. Temps de lecture : 40 minutes.
◄ 1re partie : 1903-1925
◄ 2e partie : 1926-1945
◄ 3e partie : 1945-1950
La Mort d’André Gide dans Paris Match (page privée) ►
Journal de Paul Léautaud :
19 Février 1951
Une heure après-midi, téléphone de Jean Denoël1 qui sort de chez lui : Gide est mourant.
Ce matin dans Combat cette note :

Il y a 15 jours, Jean Denoël lui rendant visite avant son départ pour rejoindre Mme Gould2 à Juan-les-Pins, Gide se sentant atteint (je l’avais déjà trouvé très changé le soir des Caves du Vatican3) lui avait dit : « J’ai bien peur que vous ne me revoyiez pas. »
André Gide est mort chez lui, rue Vanneau, le 19 février à 22 heures vingt.
20 Février 1951
Mallet 11 h. ½ vient me chercher ce matin. Pas pu voir, toilette funèbre pas terminée. Pas de cérémonie religieuse, obsèques civiles. Comme je m’étonne : au cours de nombreuses conversations que j’ai eues avec lui. Il était profondément religieux mais en dehors de tout dogme. Recommandé de bien noter tout cela.
Mallet vient me prendre à Fontenay à 2 h. ¼. Rue Vanneau4. Le trottoir plein de photographes. Dans l’entrée, feuillets de papier pour s’inscrire. L’ascenseur bloqué. Nous montons les 6 ou 7 étages5. Je trouve dès l’entrée Denoël, Amrouche6. Dans une sorte de petit salon, des gens font queue pour pénétrer dans la chambre où Gide est étendu sur son lit. Amrouche et Denoël me font entrer directement par une petite porte au fond du couloir. Je passe dans la ruelle du lit voir Gide de tout près, étendu, le visage très pâle, très reposé, phénomène habituel dans la mort, les mains croisées sur sa poitrine. Je suis peu resté, les larmes me prenaient. Un peintre, de l’autre côté du lit, sur un grand carton ou toile, dessinait7. Ce matin on a pris un moulage de son visage. Ensuite : Roger Martin du Gard8 à ma sortie. De nouveau, photographes. Il est bien probable que je vais aller à Cuverville9 avec Mallet. Il doit me téléphoner quand il saura quand l’enterrement.
Voici ce qu’écrit Robert Mallet dans son essai : Une mort ambiguë (Gallimard, été 1955) :
Léautaud m’avait demandé de le prévenir dès que Gide serait décédé. Il voulait le voir sur son lit de mort. J’allais donc le chercher dans sa banlieue et le menai rue Vanneau. Pendant le trajet en auto il parla peu, évita les commentaires. Il me dit seulement : « Je suis content d’avoir été lui dire bonjour après avoir vu sa pièce10. Je ne pensais pas que c’était la dernière fois que je le rencontrais. »
Quand nous y pénétrâmes, l’appartement de Gide était déjà plein de monde. Herbart11 était obligé de se battre avec les photographes pour leur interdire de mitrailler à bout portant le corps de Gide qu’on avait exposé sur un petit lit de fer dans son salon. Léautaud retira son chapeau et laissa apparaître la calotte de soie dont il ne se séparait jamais et, d’une démarche raide, saccadée, en s’aidant de sa canne à pommeau d’argent, il s’approcha du lit. Il pencha sa tête vers celle de Gide : son regard de myope plongea par-dessus ses besicles de fer et fixa les traits du mort. On aurait dit un vieil oiseau de nuit fasciné par sa proie. Puis, d’un brusque mouvement il s’écarta du lit, faillit buter contre l’un des montants de métal et se retira précipitamment vers la porte en maugréant : « C’est trop bête ! » Je le vis passer sa main gauche sur sa joue comme on écrase un insecte qui vient de vous piquer. « Allons-nous en ! me dit-il, je ne peux plus supporter ça, je deviens sentimental. » Et il répéta : « C’est trop bête ! »
Dans la rue, après quelques instants de silence, il se mit à parler d’abondance :
— Quel beau visage il avait sur son lit ! Si détendu, si reposé ! Il était mieux que de son vivant. Ça me réconforte. Je me dis que lorsque mon tour viendra, moi dont la figure n’est pas précisément réussie, on pourra me trouver séduisant. Tout de même, quelle drôle de chose que la mort !
En une de Combat du 21 nous lisons :

Le numéro du 22 rend largement hommage à André Gide avec, en page deux un article de Constantin Brive « Gide, tel qu’en lui-même » à propos du film à venir de Marc Allégret12. En pages six et sept, des articles de Maurice Nadeau, Adrienne Monnier, Gérard Boutelleau, Gabriel Marcel, Colette, Louis Martin-Chauffier, Arthur Adamov, le musicologue Marcel Schneider…
Dans Le Monde du 22 paraît un court texte signé A. S. : « Dernière visite à André Gide » :
Dans la petite chambre attenante à la salle de travail il repose sur un lit de fer.
Le dessinateur Mac’Avoy13 est venu, pour un dernier portrait. « A. S. » décrit la pièce et relève :
Un grand pastel de Van Rysselberghe14 représentant Gide à trente ans avec de longues moustaches. […] Plus haut les photographies des maîtres aimés : Baudelaire, Paul Valéry, Mallarmé, Charles-Louis Philippe.
Les Cahiers de la Petite Dame
L’installation de la pièce telle que l’a décrite le journaliste du Monde a été arrangée dans la soirée du 19. On n’a pas dû dormir beaucoup, rue Vanneau, cette nuit-là.
On avait décidé que l’exposition du corps se ferait dans le petit salon à cause de l’accès facile et direct par la première pièce où travaillait la secrétaire. Il faut donc vider ces deux pièces de tout ce qu’y accumulait la vie : livres, papiers, dossiers, accessoires de bureau. On remplit les armoires, on emporte le reste ; chacun trouve un soulagement à s’activer, à être utile. Moi seule je ne fais rien et, inutile, rentre chez moi.
Qui parle ? Qui est cette « Petite Dame » ? Les connaisseurs de Paul Léautaud ne sont pas nécessairement ceux d’André Gide (qui sont très bien aussi) ; ces derniers excuseront ces précisions :
Maria Monnom (1866-1959), écrivaine belge, a épousé en 1889 le peintre Théo Van Rysselberghe (1862-1926). Le couple eu une fille, Élisabeth (1890-1980). En juin 1899 chez Francis Vielé-Griffin, André Gide a rencontré le couple et leur fille, âgée de neuf ans. Est née alors la grande amitié de toute une vie. À partir de 1918, Maria a rédigé au jour le jour le récit de ses rencontres avec André Gide et noté ses confidences jusqu’au lendemain de sa mort. Ces cahiers ont été édités par l’Association des Amis d’André Gide et publiés chez Gallimard de 1973 à 1977 en quatre volumes sous le titre Les Cahiers de la Petite Dame. Aucune étude de la vie d’André Gide ne peut être entreprise sans la lecture de ces Cahiers.

Les Cahiers de la petite dame, quatrième volume dans l’édition originale de1977 et premier volume de la réédition de 1996 (toujours disponible).
Lisons la suite, dont seuls de cours fragments peuvent être donnés :
Dès le lendemain matin […] reste à organiser le petit salon […]. Pierre15 décide de décrocher tout ce qui se trouve au mur et de le remplacer par des choses plus sobres qui prennent une signification et ont du moins des rapports directs avec lui, et qu’on vient décrocher chez moi16 : un portrait de Valéry, un de Mallarmé, un de Baudelaire, un de Nietzsche, un grand dessin de Verhaeren, lui en 1900, grand dessin de Théo. Tous ces blancs et noirs sous la lumière tamisée d’un lustre, tous rideaux baissés, font un cadre sobre, calme, sérieux. Le petit lit de fer sera placé tête à la fenêtre, de manière à pouvoir tourner autour.
Le jeudi 22 février, à l’exception de Maria, toute la famille quitte la rue Vanneau à dix heures pour se rendre à Cuvervile, près de Caen, où sera inhumé André Gide. C’est aussi un 22 février, dans cinq ans, que mourra Paul Léautaud. La cérémonie ne se passe pas vraiment comme prévu. Les journaux en parlent en une. Regardons trois de ces journaux.
Combat
Six paysans normands ont porté André Gide dans sa tombe
Cuverville, 22 février (par téléphone) — Six paysans normands ont porté à bras, du château au cimetière de Cuverville, le cercueil d’André Gide. […] Ramenée de Paris au début de l’après-midi la dépouille de Gide avait été exposée dans le grand salon du château dont il avait fait sa « maison ». […]
L’enterrement était prévu pour quinze heures […] C’était un chemin de Normandie, un mauvais chemin à travers champs. Un talus glissant le bordait, de place en place. Les pantalons étaient relevés au-dessus des chevilles. Les cinéastes, crottés, couraient comme une meute autour du convoi, à la recherche de l’angle propice. Ils mitraillaient le foulard jaune de Paul Léautaud qui tenait dans sa main gauche un bouquet d’œillets rouges, serrait contre lui une canne au pommeau d’argent et lançait des regards sévères.

Photographie parue en une des Nouvelles littéraires du premier mars
Sur tout cela flottait, tristement tendu dans la tempête par un amputé, le drapeau des anciens combattants de Cuverville.
On déposa le cercueil. Le pasteur récita les prières. Immobile auprès de la tombe toute fraîche, ouverte comme une plaie géante […].
Il était convenu qu’il ne serait prononcé aucun discours. Mais Dominique Drouin, neveu de Gide17, avait un dernier devoir à remplir : « Je prends la parole, dit-il pour remercier tous ceux du village. André Gide s’excuse de n’être pas venu plus souvent ces dernières années. Les circonstances de la guerre, son état de santé, l’ont empêché. Mais toujours, quand il me voyait, il me demandait des nouvelles du pays, et le pays, c’était vous. Il a pleuré en apprenant la mort du malheureux Cevestre. Comme la mère du jeune homme, il avait espéré jusqu’au bout. Il s’inquiétait de la vieille garde, et la vieille garde, c’était, pour lui, Bertin et Guédon ».
[…]
Le cinéaste tournait les ultimes séquences du film que Marc Allégret vient de réaliser sur André Gide. […].
Jean Schlumberger18, Roger Martin du Gard, Gallimard, s’inclinèrent devant la tombe. Paul Léautaud fit l’offrande de ses œillets19.
Et tandis que le redoutable pamphlétaire roulait devant l’église une cigarette bourrée de tabac bleu, on remontait de la fosse le cercueil qu’un étai empêchait d’y entrer complètement. Le fossoyeur Albert Crochemore20, le fils du maire, sauta avec un marteau, replaça l’étai malencontreux. On lui passa une échelle. Il remonta à la surface et, pour la seconde fois, on descendit dans la terre fertile et lourde […].
Roger Parment
Le Figaro
Comme tous les journaux du matin, Le Figaro a dû bouleverser sa une. N’en sont retenus ici que les fragments apportant des informations supplémentaires par rapport à l’article de Combat :
L’inhumation d’André Gide — dépourvue de tout apparat — a eu lieu hier au cimetière campagnard de Cuverville
Étretat, 22 février.
Le fourgon funèbre arriva au début de l’après-midi devant la vieille maison familiale que l’on appelle à Cuverville « le château » […].
Le corps fut déposé quelques minutes dans un salon du rez-de-chaussée, au mobilier tendu de Gobelins, et qui précède la pièce qui fut le cabinet de travail d’André Gide.
Au mur, parmi des portraits de la famille de la femme de l’écrivain, un poème autographe de Paul Valéry.
Ce sont sept paysans du domaine et le fidèle chauffeur Gilbert qui se relayèrent alors pour porter sur le chemin noyé de pluie le cercueil de leur châtelain […].
Au côté de la fille d’André Gide, Mme Catherine Lambert21, et de MM. Dominique et Jacques Drouin, ses neveux, n’étaient groupés, avec les habitants de Cuverville, dont le curé de la paroisse, que quelques amis intimes : MM. Roger Martin du Gard, Paul Léautaud, Jean Schlumberger, Gaston Gallimard et le professeur Jean Delay qui soigna l’écrivain dans sa dernière maladie.
On s’attendait à ce qu’il n’y eut aucune cérémonie religieuse. Pourtant le pasteur Bastide, du Havre, était là et prononça une courte prière.
Serge Bromberger
Paris-presse l’intransigeant
Dans le numéro du 23, une photo du cimetière accompagné du court texte qui ne nous apprend rien. Et le lendemain 24, une autre photo, fort précieuse et assez rare :

Paul Léautaud, Jean Amrouche et Nicolas Lambert, fils de Catherine et Jean Lambert. Cet enfant mourra jeune, d’un accident de la route. Le personnage en bord cadre à droite n’est pas connu. Il existe une version plus large de cette photo montrant, à gauche, Gilbert, chauffeur d’André Gide, et dépassant tout le monde de sa haute stature.
Revenons à Paul Léautaud dans son Journal, trois jours après la cérémonie :
25 février 1951
À la vérité, Robert Mallet, si choqué, avec raison, de ce qui s’est passé à Cuverville aux obsèques de Gide : anciens combattants avec leur drapeau, présence d’un pasteur, discours du neveu de Gide, a manqué tout le premier au respect des désirs exprimés par Gide. Il [Robert Mallet] a amené avec lui sa femme, sa sœur et son mari, alors qu’il avait seul qualité pour être présent22. Je regrette de m’être laissé amener avec eux, ayant derrière moi, assis dans la voiture du mari de la sœur de Mallet, Mallet et la secrétaire de Gide23, fille de Christian Beck24, qui n’a pas arrêté de parler pendant les quatre ou cinq heures qu’a duré le voyage, n’ayant guère hérité d’une qualité de son père, dont toute la conversation se bornait à quelques : « Ah ! Ah !… » de temps en temps. J’aurais dû prendre un taxi, aller à Cuverville seul, et en revenir seul, cela m’aurait coûté ce qu’il aurait fallu, au lieu de ce transport en bande, aux façons presque d’un voyage d’agrément. J’ai bien l’intention de dire tout cela à Robert Mallet25.
La lettre du pasteur Bastide
Ce même 25 février, le pasteur Émile Bastide (1914-1994) qui avait officié face à la dépouille d’André Gide à Cuverville écrivait à des amis impatients d’en connaître les détails, les circonstances dans lesquelles s’était déroulé son office.
Le texte de cette lettre a été édité et annoté par un certain Jean Claude puis publié par l’Association des Amis d’André Gide qui l’a donné dans son Bulletin de janvier 2001. Nous remercions l’Association des Amis d’André Gide de nous avoir permis de le publier ici26.
Le témoignage du pasteur Émile Bastide
présenté par Jean Claude
On connaît les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les obsèques d’André Gide à Cuverville le 22 février 1951 à travers les notes de la Petite Dame relatant les récits que lui en avaient faits Jean Lambert, Roger Martin du Gard et Jean Schlumberger, ainsi que par les témoignages que ces trois proches de Gide en ont occasionnellement donnés27. On garde surtout le souvenir de leur irritation devant la présence d’un pasteur, aussi bien lors du passage du corps de l’écrivain en sa demeure de Cuverville que lors de l’inhumation elle-même, et des protestations que cette présence à laquelle ils ne s’attendaient pas avait soulevées.
Aussi nous a-t-il paru intéressant de faire connaître le récit qu’en a fait le pasteur lui-même, à savoir le pasteur Émile Bastide (1914-1994), appelé par Dominique Drouin pour assurer la partie religieuse des obsèques. Le pasteur Bastide, alors ministre du culte au Havre depuis son retour de captivité en 1945, rend compte de cette journée à son ami le pasteur Michel Leplay28, originaire du Havre, alors en poste dans les Cévennes29.
[…]
25 février 1951.
Chers amis,
Depuis trois jours j’attends un moment de liberté pour écrire à Michel. Car je suppose qu’il est impatient de savoir comment s’est passé l’enterrement de Gide. N’ayant pas lu les journaux au début de la semaine, et n’ayant pas écouté la T.S.F. pendant quelques jours, j’ai été extrêmement surpris, mercredi30 à deux heures, d’avoir un coup de téléphone émanant de Cuv[erville] d’où me parlait Dominique Drouin.
J’ai marié ce dernier il y a 18 mois31, à la prière de P. Maury, alors malade, et ami de la famille. C’était mon tour d’être l’ami de la famille de Cuverville. Domi m’annonçait donc la mort de son oncle À. Gide et me demandait si je voulais venir à Cuverville jeudi à 14 h 30, pour l’ensevelissement.
J’ai essayé de suggérer quelques noms : Westphal, Boegner, Maury32 qui auraient fait ça mieux que moi, mais D[ominique] m’a fait remarquer que le voyage d’un Parisien serait considéré par les amis de Gide comme une provocation, et que si le mieux eût été le pasteur de Cuverville (en l’occurrence Bourcart, d’Harfleur33), ils préféraient ma présence, comme connaissance déjà faite. Et je pouvais passer, auprès des Parisiens, comme ami de Cuverville.
[…]
Jeudi matin, catéchisme puis à 11 h ½ « on » vient me chercher. On : Marc Allégret, accompagné de Mme la Vicomtesse de Lestrange — dont Gide, paraît-il, parle dans son Journal — et qui avaient été les deux compagnons du Voyage au Congo34. Allégret et Mme de Lestrange m’ont affirmé tous deux que Gide était croyant — et chrétien. Allégret, qui était filleul de Gide, me raconte que celui-ci lui avait dit : « Je suis plus chrétien qu’on ne pense, mais peu s’en sont rendu compte » (Je n’oserais pas affirmer la certitude des termes de la citation, mais c’est le sens exact d’une conversation tenue fin janvier).
Pour Mme de Lestrange, que j’ai trouvée en parfait accord avec Allégret, si Gide avait dépassé tout dogme, il gardait l’assurance de la foi, et sa sérénité des derniers mois, dans laquelle certains de ses amis ont voulu voir la fin de toute recherche et de toute inquiétude spirituelle, était réellement fondée sur sa foi.
Lundi :
Je continue ma lettre dans le train […].
À Cuverville, Domi, Allégret et moi avons cherché quel service religieux pourrait satisfaire, d’une part la famille et les fermiers, que Mme Gide avait amenés sinon à une vie spirituelle, tout au moins à la connaissance de son existence et de sa foi à elle, — et d’autre part les amis de Gide dont on attendait une « réaction ».
Nous cherchâmes dans le Journal une citation de Gide — « Dieu est en nous », pour finalement nous arrêter, pour plus de netteté (vis-à-vis des humbles, ou peut-être plus vis-à-vis de Gide) à la citation de Numquid et tu (1916)35 faite par Mauriac dans Le Figaro de mardi36. Trahison de Gide ? au même titre que l’article de Mauriac, peut-être, mais je pouvais alors me retrancher derrière ce dernier.
Mercredi. — Excuse mon retard.
Venons-en à la cérémonie.
À 14 h 30, le corps arrivait, avec un fourgon flanqué de quelques voitures de Parisiens : Catherine Gide-Lambert et ce dernier, Jean Schlumberger et Roger Martin du Gard, Paul Léautaud, la secrétaire de Gide37 (qui ne l’est que depuis quatre mois), Gallimard et Denoêl, les éditeurs, et d’autres encore…
On déposa le cercueil dans le salon et on plaça les gens : Catherine et M. Lambert, le curé de Cuverville, les amis, les Drouin (Dominique et Jacques), leurs femmes, et le fils de Jacques, Michel (17 ans), Foltz (veuf d’une sœur Drouin), et le vieux Rondeaux, frère de Madeleine Gide38, et extrêmement sourd, et qui reste le seul à s’occuper de Cuverville.
J’ai alors fait une invocation […]. J’ai ajouté : Nous aurons un moment de silence. (Pendant ce silence on a apporté à grand trouble la gigantesque couronne du Ministre de l’Éducation nationale.)
[…]
Nous sommes alors partis au cimetière, sous la fusillade des appareils de photo et de caméras, l’une de celles-ci était du Pathé-Journal, une autre celle des compagnons de Marc Allégret, celui-ci m’ayant prévenu qu’il tournait un film reconstituant la vie de Gide. Il a déjà une heure de projection39.
Au cimetière, très encombré, je me suis avancé au bord de la tombe, en travers de laquelle on avait posé le cercueil.
[…]
Drouin, sur ma prière, a ajouté quelques mots aux gens du pays.
Nous nous sommes retirés, pour que défilent les gens devant la famille, puis nous sommes revenus pour la descente du corps : les Drouin, les Lambert, J. Schlumberger, R. Martin du Gard, Allégret, Mme de Lestrange, la secrétaire et moi. Drouin a alors demandé aux photographes de cesser leur activité, et on a descendu le cercueil.
C’est alors que R. Martin du Gard a pris à partie les Drouin et a parlé de trahison de l’esprit de Gide ; et en retournant au château (pour ma part je parlais au Pr[ofesseur] Delay qui affirmait, lui, que c’était bien que Gide soit retourné à Cuverville, à sa vraie famille et… au pasteur) a commencé une discussion qui s’est prolongée ensuite sur la pelouse pendant assez longtemps.
Martin du Gard disait : « Gide m’a dit : Méfiez-vous des familles accapareuses… »
Mme Delay, femme du Pr[ofesseur], disait : « Je lui ai affirmé, il y a quelques semaines, que je priais pour lui chaque jour, et il m’en a remerciée… »
Mot féroce de Martin du Gard : « Il vous a remerciée parce que vous vous préoccupiez de lui, et pourvu que vous vous occupiez de lui, il aurait accepté même que vous fassiez dire des messes… »
Schl[umberger] et Martin du Gard regrettaient surtout la publicité faite autour de cet enterrement religieux — Pathé, etc. —, disant qu’il y avait là un démenti au défilé parisien des existentialistes venus saluer le cercueil « sans crucifix ni Bible ». À quoi j’ai répondu : « Crucifix aurait été un mensonge, mais croyez-vous que la Bible en aurait été un ? »
« Dans l’esprit des existentialistes, oui », dit M. du G.
« Les existentialistes, je m’en fous, ai-je dit textuellement, et d’ailleurs qu’ils réfléchissent sur leurs origines, Kierkegaard et Kafka40. »
Finalement, l’on a dit : Gide était tellement complexe qu’il aurait à la fois accepté et critiqué la présence du pasteur, et, dit sa secrétaire, « il a peut-être voulu qu’on se dispute sur sa tombe », et c’est pourquoi il n’a pas fait connaître plus nettement sa volonté.
Nous avons accusé Martin du Gard d’avoir été contaminé par la pensée catholique d’un dogme auquel on se soumet, et aussi d’en être resté à l’anticléricalisme de Jean Barois41, et Sch[lumbergerl a accepté ma présence, au nom d’une spiritualité dépassant tout dogme42.
Ce qui me paraissait… je ne sais comment dire, à la fois vrai et inacceptable…
J’attends le prochain article de R. Martin du Gard dans Le Figaro littéraire43.
J’ai oublié Amrouche qui, surpris d’abord, avait accepté ma présence…
Voilà un résumé, trop long, d’une journée très dure…
J’espère avoir un jour l’occasion de t’en parler.
J’espère que tout va bien chez vous.
Meilleurs messages fraternels.
E. B44.
Le Journal de Paul Léautaud, tel que nous le connaissons, ne contient aucune note au 22 février. Il a pourtant pris la peine de rédiger trois phrases qui semblent être le reflet de la conversation qu’il a pu avoir en voiture au retour de Cuverville. Ces trois phrases au ras du sol sont dans le tapuscrit de Grenoble. Bertrand Vignon a bien voulu les recueillir :
J’ai dû noter déjà ce propos de Valéry sur Gide : « C’est inouï que des affaires de derrière puissent donner une pareille réputation. » Au fond, Valéry était jaloux de cette réputation de Gide, écrivain supérieur à lui sous bien des rapports, et autrement connu à l’étranger, prix Nobel, Valéry n’avait pourtant pas à se plaindre pour son compte. Pitoyables, ces jalousies littéraires. Je le dis une fois de plus : chacun son lot.
Nous aurions tant aimé qu’il nous donne sa vision de cette journée.
La Petite Dame n’a pas fait le voyage de Cuverville. Le soir, de retour rue Vanneau, lors du repas, Catherine et son mari Jean Lambert (note 21), lui racontent la journée, qu’elle notera dans son Cahier à partir de la page 248. Ce texte recoupe celui d’Émile Bastide mais permet de comprendre le détail à l’origine du quiproquo. La veille, Dominique Drouin a demandé à Marc Allégret de téléphoner à Catherine Lambert… Lisons le récit de Catherine tel qu’il a été noté par la Petite Dame :
Hier, Marc m’a téléphoné de la part de Domi pour me demander si je n’avais pas d’objection à ce qu’on lise des textes de Gide — j’ai naturellement dit non, et j’étais loin de penser qu’il y aurait aussi des textes bibliques et que c’est un pasteur qui devait les lire, je croyais même que ce serait l’oncle Jean45.
La conversation se poursuit encore un temps puis Pierre Herbart se lève puis revient un quart d’heure après avec un court texte qui paraîtra dans Combat du 23, en plein milieu de l’article de Jean Parment :
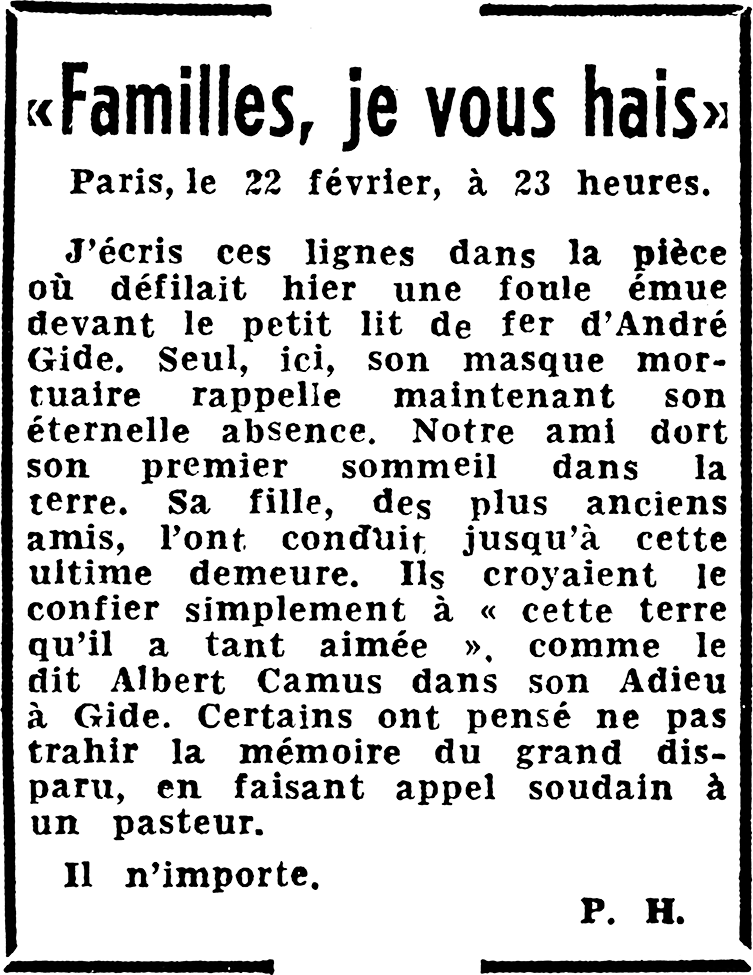
Le lendemain 23, Roger Martin du Gard passe rue Vanneau et donne d’autres détails. Il regrette de s’être emporté.
Je le questionne ensuite sur ceux qui étaient allés à Cuverville : Léautaud, amené par Mallet, qui avait déclaré vouloir suivre Gide jusqu’au bout et qui, outré de ce qui s’était passé, répétait : « Quoi, alors, on ne peut plus mourir comme on veut ? »
Revenons au Journal de Paul Léautaud :
26 février 1951
Robert Mallet m’a téléphoné tantôt. Parlé de la cérémonie Gide à Cuverville. Je lui ai développé, avec amitié, mais sans ménagements, tout ce que j’ai noté plus haut à ce sujet, à savoir que lui, tout le premier, a manqué aux désirs exprimés par Gide, en amenant avec lui sa femme, sa sœur et le mari de celle-ci, qui n’avaient rien à faire dans cette cérémonie, lui seul ayant qualité pour y être présent, que pour ma part je regrette de n’être pas allé à Cuverville seul, par mes propres moyens, cela eût-il dû me coûter une certaine dépense. Il a voulu m’expliquer qu’usant de la voiture de son beau-frère il a été bien obligé de l’emmener, et les deux femmes. J’ai maintenu, et il a fini par s’y rendre : il a manqué de fidélité aux désirs exprimés par le mort. À la fin il s’est rendu et je l’ai senti déchiré de chagrin et de remords, et touché de ma façon de lui parler franchement sur tout cela. Je lui ai dit comme un bon conseil : « Ne dites pas un mot de notre entretien chez vous. Croyez-moi, pas un mot. Tout ce petit débat entre nous deux seuls, absolument. » Un quart d’heure après, nouveau téléphone. Proposition de nous rendre tous les deux, le beau temps venu, à frais communs à Cuverville, sur la tombe de Gide, pour y marquer le sentiment, le souvenir, que tout l’odieux de ce qui s’est passé jeudi a empêché.
Une mort ambiguë
Les détails des circonstances de l’inhumation d’André Gide à Cuverville sont aussi dans l’essai de Robert Mallet : Une mort ambiguë (223 pages) paru chez Gallimard en 1955 et largement épuisé. On trouve parfois pour quelques €uros la réédition Idées de 1984, épuisée elle aussi. On peut lire, à propos de cet essai l’article de Robert Coiplet dans Le Monde du 26 juin 1955.
Bien que paru quatre ans après la mort d’André Gide, la précision des détails vient du fait que ce texte est basé sur le très abondant et très riche Journal que Robert Mallet tenait quotidiennement et qui ne sera consultable qu’après 2052 et vraisemblablement jamais édité dans son intégralité.
Robert Mallet n’est plus à la mode et il est plus que vraisemblable que l’essai Une mort ambiguë ne sera jamais réédité faute de lecteurs. Il est pourtant très riche de minuscules informations, comme ce fragment de la page 137, à propos de la mise en bière rue Vanneau sur laquelle nous revenons une dernière fois :
Trois jours après la mort, en fin d’après-midi, les « Messieurs des pompes funèbres » revinrent, non pas des employés en uniforme mais des maîtres de cérémonie habillés comme des visiteurs endeuillés. La famille se rassembla avec les intimes dans la chambre funéraire. L’un des hommes tenait à la main le couvercle du cercueil, l’autre les longs clous qu’on allait y visser, le troisième, après s’être frayé un passage à travers les fleurs, souleva les mains de Gide sans les désunir, les plaça sous le linceul et, d’un geste lent, remonta le drap vers la figure. On aurait voulu qu’il s’arrêtât en chemin, qu’il suspendît son travail pour que les regards pussent une dernière fois contempler les traits de ce visage énigmatique qui prenait le voile dans l’éternelle clôture. Mais en un tournemain le spécialiste, sachant par expérience que la rapidité est de rigueur, nous déroba la face sous le drap, et le drap prit le relief de ce qu’il dissimulait. Ainsi s’effacent progressivement les souvenirs : d’abord une fixité, puis un voile où transparaissent encore les traits saillants, enfin une plaque de bois comme celle du cercueil qui s’interpose entre les faits et notre mémoire. L’employé venait de poser le couvercle sur la bière. Les pleurs qui ne pouvaient être refoulés plus longtemps s’échappèrent en même temps que retentissait le bruit méthodique des clous dont les vis s’enfonçaient dans le bois du cercueil.
Relevons quelques extraits concernant cette cérémonie de Cuverville et les rapports entre Robert Mallet et Paul Léautaud à cette occasion. Commençons page 140 :

Je me chargeai d’emmener Léautaud qui voulait y assister. C’était une journée de fin d’hiver. Un vent violent soufflait, qui venait de la mer toute proche et secouait les rangées de hêtres derrière lesquels se cache le château de Cuverville, où le cercueil avait été déposé. Nous arrivâmes un peu en retard. Le convoi funèbre débouchait du parc et s’avançait sur le chemin de terre qui, à travers une plaine labourée, mène jusqu’au cimetière. Des hommes le précédaient, marchant à reculons : l’essaim des photographes et des cinéastes. En tête, un drapeau tricolore. Léautaud eut un sursaut :
— Qu’est-ce que ça vient faire là ?
Je lui dis que ce devait être la représentation des anciens combattants de Cuverville. Il gronda :
— J’ajouterai un codicille à mon testament : pas d’anciens combattants à mes obsèques !
Puis :
— Il paraît qu’ils se sont si bien battus. Ils ne sont donc pas tous morts ? C’est bien dommage !
Léautaud savait que j’avais été combattant et ne se privait jamais du plaisir de dire devant moi tout le mal qu’il pensait de ces associations où se regroupent para-militairement des hommes qui semblent vouloir prolonger les mauvais souvenirs et le pas cadencé. D’ailleurs il ne me choquait pas.
Sur ce point je partageai son opinion. Et je lui répondis :
— Je suis heureux qu’ils ne soient pas tous morts. Cela me permet d’apprécier votre façon de les remettre à leur place.
— En tous cas, reprit-il, leur place n’était pas à cet enterrement !
Le cercueil, selon la coutume locale, était porté sur un brancard par quatre fermiers de Gide auquel Gilbert en larmes prêtait main-forte. On l’avait recouvert d’un drap noir orné d’une grande croix d’argent. Les enfants des écoles l’encadraient, tenant des bouquets de jonquilles, de perce-neiges et de violettes. Derrière le cercueil venait un homme en toge noire avec un rabat blanc, qui portait un gros livre sous le bras46.
Léautaud, toujours aussi agressif :
— Quel est ce déguisé ?…
Apparemment c’était un pasteur. Ceux qui avaient assisté à la levée du corps au château me le confirmèrent. On les avait réunis dans le grand salon où avait été exposé le cercueil. Là, après avoir lu des passages de l’Évangile, cités par Gide lui-même dans un ouvrage qui, à l’époque, avait pu faire croire à l’imminence de sa conversion, le pasteur avait évoqué la mémoire de l’épouse dévouée que venait retrouver dans le cimetière de Cuverville celui qu’elle avait si chrétiennement aimé.
Léautaud continuait de maugréer en prenant rang derrière la famille et les intimes. Il coudoyait le curé de la paroisse et le maire de la commune. Le convoi se terminait par la population endimanchée du village. J’entendis une grosse fermière parler à sa voisine de « Monsieur Gilles ». Ici l’on semblait écorcher les noms et les principes.
[…]
Le porte-drapeau se plaça du côté de la tête en inclinant la hampe de son étendard. Le pasteur vint se placer contre le porte-drapeau ; il ouvrit son livre et lut des textes évangéliques […]
Surpris, je regardai Martin du Gard. Il me répondit par47 un regard indigné. Jean Schlumberger avait le visage crispé. La fille de Gide ressemblait à quelqu’un qui prend son mal en patience mais n’en pense pas moins ; son gendre s’efforçait de paraître impassible.
Les photographes, debout, accroupis, agenouillés, plaqués contre le sol boueux ne perdaient pas l’occasion d’un si beau cliché : le cercueil du libertaire, de l’immoraliste, du pédéraste, du pacifiste, de l’agnostique placé sous la protection du ministre d’un culte, abrité par un étendard, avec un piquet d’honneur d’écoliers.
Tandis que le pasteur récitait : « Notre Père qui es aux cieux… », Léautaud ne se contint plus :
— On ne peut donc pas être enterré comme on veut ? C’est une honte !
Je murmurai à son oreille, pour le calmer :
— On n’a pas su ce que voulait Gide…
Et lui, péremptoire :
— Sûrement pas ça !
Dominique Drouin, le neveu et filleul de Gide, héritier depuis 1938 de la propriété de famille, prit la place du pasteur et fit une allocution d’ordre « local ». Il rappela les liens qui unissaient Gide à Cuverville et voulut montrer comment s’expliquait que l’homme public fût revenu s’inscrire dans ce cadre rural et familial.
Ce fut ensuite le dernier défilé des amis devant le cercueil. Léautaud, qui avait apporté un bouquet d’œillets roses, le déposa sur la bière. Contre le mur extérieur de l’église, la famille s’était alignée pour recevoir les condoléances. Le pasteur s’était joint à elle, selon l’usage du culte protestant. Il recevait, lui aussi, les congratulations. En passant devant lui, je m’inclinais sans prendre la main qu’il me tendait. J’obéissais ainsi à un sentiment complexe : mécontentement, gêne, désir d’être conforme dans mes gestes à ma réticence spirituelle. Je remarquai que derrière moi Léautaud, tout indigné qu’il eût paru être, serra sans hésiter la main du pasteur alors que, de sa part, je m’attendais au pire, c’est-à-dire à un propos malsonnant lancé au visage de l’animateur de la comédie. Je lui dis assez méchamment, à sa manière :
— Tiens, vous avez serré la main de ce pasteur que vous traitiez une minute plus tôt de pantin ?
Peut-être étais-je aussi agressif parce que, dans le confus de ma réaction discourtoise en face du pasteur, je sentais qu’il y avait eu aussi la crainte inconsciente d’être l’objet des sarcasmes de Léautaud. Et je lui en voulais de m’avoir ainsi dupé puisqu’il est admis que lorsque nous nous trompons sur les autres nous avons été trompés par eux. Il me répondit : « Je ne pouvais pas faire autrement puisqu’il me tendait la main. Il ne faut tout de même pas être malhonnête ! »
— Vous n’avez pourtant jamais craint de l’être.
Il redevint furieux :
— Malhonnête, moi ? Jamais ! Je dis ma façon de penser quand ça me plaît. C’est différent.
— Non, car lorsque votre façon de penser correspond à ce qui paraît malhonnête aux autres, vous la dites quand même. Vous appelez honnête, en somme, tout ce que vous avez envie de dire ou de faire.
— Vous déraillez, mon ami ! D’ailleurs, ce pasteur, je ne peux pas lui en vouloir : il n’a fait que son métier.
Cette objectivité de Léautaud, au fond, je la partageai. Je ne pouvais en vouloir au représentant d’un culte dont je respectais l’idéal, car il était évident qu’il ne s’était pas imposé et qu’on l’avait prié de venir.
Martin du Gard, très ému, dit avec solennité :
— Au nom des amis de Gide, je proteste publiquement.
Le cimetière se vida aussi vite qu’il s’était rempli. La famille et les intimes regagnaient le château.
[…] Le pasteur, assez affecté par les réflexions qu’il n’avait pas manqué d’entendre, suivait la famille. Il demandait à Béatrix Beck, la dernière secrétaire de Gide :
— Enfin, vous qui l’avez approché juste avant sa mort, avez-vous l’impression qu’il aurait été hostile à cette cérémonie ?
Béatrix Beck en avait l’impression. Elle essayait de se faire comprendre du pasteur chez qui je croyais déceler plus de scrupules que je n’en aurais trouvé chez un prêtre catholique. […]
Nous atteignîmes le parc du château. Sous le cèdre géant qui abrite en l’obscurcissant une partie de la demeure, un groupe s’était formé. On y parlait fort, avec de grands gestes. Dominique Drouin devait faire front aux assauts conjugués de Schlumberger et de Martin du Gard qui le rendaient responsable du déploiement liturgique.
DROUIN. — Je n’ai pas trahi Gide. L’enterrement à Cuverville exigeait certaines formes.
MARTIN DU GARD. — Il n’a jamais exprimé le désir d’être inhumé ici.
DROUIN. — Son silence à ce sujet était une acceptation tacite.
QUELQU’UN. — C’est vraiment trop commode d’interpréter ainsi le silence ! Le silence laissait planer le doute. Dans le doute il fallait s’abstenir.
QUELQU’UN D’AUTRE. — De toutes manières, il fallait opter pour une solution qu’il n’avait pas indiquée.
DROUIN. — Si on ne l’avait pas ramené ici, où l’aurait-on enterré ? Dans le cimetière parisien où sa famille possède un caveau ? À Cabris48 ? Nous avons écarté ensemble ces solutions. Nous avons tous été d’accord pour qu’on l’enterre à Cuverville.
MARTIN DU GARD. — Peut-être. Mais pas pour qu’on l’enterre avec la participation d’un pasteur !
DROUIN. — On ne pouvait faire autrement ici. Les gens du pays ne l’auraient pas compris.
MARTIN DU GARD. — Alors, Si vous aviez prévu cela, il fallait le dire et conseiller de l’enterrer ailleurs.
[…]
MARTIN DU GARD (toujours soucieux de ne pas blesser son prochain) :
— Soyez sûr, Monsieur le Pasteur, que ce n’est pas vous que j’incrimine.
DROUIN. — Alors, c’est moi ?
MARTIN DU GARD. — Eh oui !
Dans l’ouvrage de Robert Mallet, cette journée dure depuis déjà sept pages. La suite n’est pas moins intéressante mais une page web n’est pas un livre. Sautons à la page 156 :
Songeant au conflit provoqué par la soucieuse incurie de Gide, je regagnais l’auto où Léautaud m’attendait pour rentrer à Paris. Je lui racontai la discussion à laquelle j’avais assisté. Son émotion s’était déjà atténuée en même temps que son indignation. Il retournait naturellement aux sarcasmes. Il conclut en ricanant :
— En somme, Gide, même mort, n’a pas changé : un pas en avant, un pas en arrière !…
Ce fut pourtant lui qui, dès le lendemain, au téléphone, prit une initiative à laquelle je ne m’attendais guère :
— Vous savez, j’ai réfléchi à la journée d’hier : nous n’avons pas été assez recueillis, aussi bien vous que moi. On ne pouvait pas penser à Gide dans cette foire, on finissait par oublier qu’on était à son enterrement. Il faudra réparer cela. Nous retournerons sur sa tombe tous les deux seuls quand seront revenus les beaux jours.
Quatre mois plus tard, à la fin de juin, nous allâmes donc ensemble à Cuverville. Après avoir déjeuné dans une auberge du bourg voisin, nous gagnâmes le cimetière. […]
Léautaud vint se camper devant la tombe de Gide. Il portait, malgré la saison, un grand pardessus de laine à capuchon. Sans se découvrir, les jambes prenant appui sur sa canne, il fixait le tertre de ses yeux perçants comme s’il essayait de découvrir ce qui pouvait se passer dessous. J’évitai de lui adresser la parole. Il prit lui-même l’initiative de la conversation :
— Je l’envie, Gide, d’être enterré là. Moi, j’ai acheté une place dans un cimetière de la banlieue parisienne49. Rien que de penser à tout le peuple qui s’y entasse, ça m’écœure. Il est vrai que ça a si peu d’importance !
— Mais votre désir d’être incinéré ?
— Oui. Eh bien ?
— Eh bien, vous me parlez d’un emplacement dans un cimetière. Je croyais que les morts incinérés étaient mis dans un columbarium.
— Ah, non, merci ! C’est pour le coup qu’on est perdu dans la foule. Je veux une tombe comme tout le monde…
— À votre place, je préférerais qu’on jette mes cendres au vent.
— Encore une idée de poète !
— II n’est pas plus « poétique » de vouloir complètement disparaître que d’exiger un petit morceau de terrain bien à soi avec son nom dessus ! Acheter d’avance son « lopin de terre » pour y placer l’urne dans laquelle on sera une illusion de cendres, je crois qu’il n’y a pas pire sentimentalisme : c’est le sentimentalisme du propriétaire-petit-bourgeois !
Léautaud frappa le sol de sa canne et rugit :
— Bon ! Vous ferez ce que vous voudrez. Moi aussi. Chacun ses goûts !
Il chercha une rosserie à me dire et la trouva facilement :
— Vous serez fixé sur mes goûts définitifs quand vous viendrez à mon enterrement ! Quoique, après tout, je ne sais pas si je vous ferai prévenir. Et puis c’est peut-être moi qui irai au vôtre : on a vu des choses plus extraordinaires !
Il lança son rire grinçant. Puis pirouettant sur lui-même, il s’approcha de la tombe de la femme de Gide et déchiffra les phrases tirées des Évangiles qui avaient été gravées dans la pierre. L’un de ces textes exprimait la sérénité de « la mort dans le Seigneur ».
— Quelles belles paroles, dit Léautaud. Ils ont de la chance, ceux qui croient, ils meurent plus facilement. Quand je pense que certains qui se disent libres-penseurs voudraient empêcher les autres de croire ! C’est un crime de vouloir ça. Je les vomis, tous ces sectaires !
Léautaud craignit sans doute que je pusse le soupçonner de « mollir » en vieillissant. Il tint aussitôt à préciser :
— La foi… La foi ! Il faut être naïf pour l’avoir, mais enfin tant mieux si on est naïf ! Il pointa sa canne vers le tumulus :
— Il est bien mort, lui. Il a eu beaucoup de dignité et de courage dans ses derniers moments. Et puis ça n’a pas traîné longtemps. Il a profité de la vie jusqu’au bout. Voyez-vous, c’est capital : ne pas être diminué avant de mourir.
J’essayai de lui dire quelque chose d’amical :
— Vous vieillissez très bien, vous…
Il m’interrompit avec fureur :
— Je vous en prie ! Pas de pommade. Je sais comment je vieillis. Et je vieillis comme les autres. C’est-à-dire mal. Ça ne veut pas dire que je ne me prolongerai pas encore quelque temps. Mais dans quel état ?
Comment réagir ? Je crus plus prudent de me contenter d’un : « Oui, en effet… » impertinent par esprit de conciliation.
Il continuait, redressé, la tête haute, comme si quelqu’un venait de le provoquer, oubliant de jouer comme d’habitude à celui qui se résigne :
— La mort me révolte ! Et pourtant je devrais commencer à me faire à l’idée que je vais bientôt mourir. Eh bien, non, non, je ne peux pas m’y habituer. Quand on dit que les vieux s’habituent à ça, c’est de la blague ! La vie, moi, j’y tiens, vous savez, j’y tiens comme quand j’avais vingt ans. Je crois même que j’y tiens davantage. Ça ne m’empêche pas de la trouver insupportable !…
— Insupportable parce qu’elle doit avoir une fin ?
— Oui ! On aime la vie, mais on préférerait ne pas être venu au monde puisqu’il faut la quitter ! On n’a rien demandé. On est là. Et on partira sans avoir rien à dire. Vraiment, c’est bouffon !
Léautaud avait ainsi sa façon d’exprimer l’absurdité de l’existence et d’apporter de l’eau au moulin des philosophes sans même savoir que le moulin existait.

L’église et le cimetière de Cuverville en septembre 2022, à l’angle des rues Henri Lanjuin et de Demoville. La haie a été remplacée par ce mur. Photo Google
Nous nous assîmes l’un à côté de l’autre sur une banquette d’herbe, entre la haie et l’allée qui bordait la tombe de Gide. Léautaud ne quittait pas des yeux la levée de terre. Je me taisais comme lui. Je pensais que Gide aurait peut-être été content de savoir que deux pèlerins étaient venus s’installer tout près de sa sépulture pour y méditer sur lui et sur eux. […] Léautaud me dit, comme s’il ne pouvait supporter plus longtemps le poids de son obsession :
— Je me demande dans quel état est maintenant le Fléau dans son cimetière de Bretagne50 ! Ah, ça ne doit pas être beau à voir… Gide, lui, maigre comme il était, il ne doit pas être encore très décomposé. Il va peut-être se dessécher. Son cercueil est sûrement encore intact. C’était du beau bois. Ça fait combien de temps qu’il est mort ? Quatre mois… En quatre mois, un cercueil de bonne qualité ne peut pas s’abîmer, n’est-ce pas ? Alors, il est là-dedans, là, tout près de nous… Ah, comme j’aimerais pouvoir le voir encore une fois !
— Pourquoi ce désir ?
— C’est tout ce qui reste de lui. Tout. En dehors de ça : plus rien !
— Je ne comprends pas votre attachement au cadavre.
— Il y a en moi deux choses : d’abord la curiosité, savoir ce qui se passe là-dessous, comment se fait le travail de la pourriture…
— Vous êtes morbide !
— Laissez-moi achever ! La seconde chose : c’est le culte des morts. Ceux qui n’ont pas la foi disent que ça ne rime à rien. Moi, pourtant, je le comprends, je trouve même que c’est recommandable. Pas vous ?
— Si, je suis de votre avis. Mais je m’étonne de l’approbation que vous donnez à une convention. Je vous aurais cru attaché au souvenir, pas aux tombes.
— Et puis, quand je pense à Gide, je pense aussi que je serai bientôt comme lui dans la terre, même si je ne dois pas y être de la même manière. Je veux m’épargner la décomposition. Si un jour vous venez sur ma tombe, il vous faudra beaucoup d’effort pour m’imaginer dans mon urne ! Ah ! ah !…
Le rire de Léautaud s’arrêta net. Il baissa le ton de la voix :
— Passer toute sa vie à travailler pour crever comme un animal. Non, non ! Vraiment, c’est inacceptable.
— Ce sentiment de révolte, c’est lui qui a poussé tant de gens à croire qu’il y avait une raison supérieure.
— Une raison supérieure ! Encore des mots !
— Oh !… Vous refusez les mots, mais vous exprimez les choses !
— Vous interprétez toujours dans votre sens les propos que je tiens !
— Je ne les interprète pas. Je les traduis. C’est différent.
— Ah ! voilà que j’ai besoin d’un traducteur, maintenant ! Ce que je dis est pourtant clair.
— Mais vous ne voulez pas aller jusqu’à la conclusion logique de vos réflexions ni de vos sentiments.
— La logique ! Les sentiments ! Décidément, vous ne changerez jamais.
— Vous non plus.
— Je m’en félicite. Ah ! ah !… Mais je ne vous félicite pas !
De nouveau nous restâmes silencieux. Nous passions, d’un commun accord semblait-il, par des phases de tension et de détente. Léautaud se releva, et — était-ce cette fois-ci l’aboutissement logique de sa songerie ? — il me dit avec gravité :
— La vraie vie, voyez-vous, c’est celle du moine.
Je lui répondis, sans me soucier qu’il m’accusât de le traduire :
— Je crois que vous avez du moine en vous.
Toujours inattendu, il m’approuva :
— Oui, c’est possible. J’aime la solitude, la vie réglée, et la méditation.
Il posa le bout de sa canne sur la tombe de Gide :
— C’est bien dommage qu’on ne le laisse pas tranquille. Il paraît qu’on va le mettre à côté de sa femme, à la place d’un autre mort de la famille. Et on va lui poser une dalle sur le ventre pour qu’il n’ait pas envie de revenir.
Le soleil avait tourné. La tombe de Gide était maintenant dans l’ombre. C’était l’ombre de l’église51. Je n’osais pas dire à Léautaud le symbole que je discernais là. Il prolongea le symbole en me disant : « Il fait froid. Allons-nous en ». Et il le mena jusqu’à son achèvement :
— Avant de partir, visitons l’église.
Ainsi il fuyait l’ombre que toute croyance projette sur celui qui se tient à sa lisière comme Gide au chevet de l’église catholique. Puis il illustrait la solution qui consiste à entrer dans l’édifice pour participer volontairement à l’hermétisme. Il inspecta les lieux avec une respectueuse curiosité et murmura comme d’autres bougonnent :
— Ah ! Ça, c’est une invention ! Une fameuse invention ! Toutes les autres : des fariboles ! Mais celle-là !…
Puis, tout à coup :
— Il fait encore plus froid ici que dehors ! Il faut partir. Il s’esclaffa :
— Je ne tiens pas à attraper la mort dans une église !
Son rire d’oiseau de nuit se répercutant contre les voûtes sembla l’étonner lui-même par son fracas. Il se tut soudain.
Nous retrouvâmes le soleil en quittant le cimetière. Je jetai un dernier regard vers la tombe de Gide. Les racines des pommiers devaient sous la haie d’épines aller à sa rencontre. Un sureau en fleurs, à quelques mètres de la croix, répandait un parfum sucré mêlé aux odeurs chaudes d’une étable. Des enfants, retour de l’école, galochaient en criant sur la route du village. On entendait aussi une charrette qui cahotait dans les ornières.
— Il a de la chance, dit simplement Léautaud.
Les ruissellements du soleil s’étaient fragmentés sous la poussée des ombres qui commençaient à s’y infiltrer. La plaine ressemblait à un damier vert et noir où le chemin comme un long doigt indiquait le pion pointu de l’église.
Quand je déposai Léautaud chez lui, dans la banlieue parisienne, il était minuit. Malgré la chaleur de la journée son pavillon cerné, presque envahi par les arbres, était humide et froid. Il lui fallait rallumer son feu52. Je voulus l’aider. Il m’en dissuada sur un ton qui signifiait : « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! » Il fit le recensement de ses pensionnaires. La guenon dormait dans un coin de sa chambre. Trois chats vinrent se frotter contre ses jambes en miaulant. Jaunet et Domino manquaient à l’appel. Il se pencha à sa fenêtre et lança leurs noms dans la nuit, d’une voix à la fois grondeuse et tendre. Bientôt les deux retardataires arrivèrent en courant, la queue en l’air. Il les prit dans ses bras et leur dit de ces petits mots qu’il aurait trouvé ridicules s’il avait entendu un homme les adresser à une femme. Il me raccompagna avec une lampe au bas de son escalier, me serra la main sans commenter la journée que nous avions passée ensemble et me quitta sur cette phrase : « Méfiez-vous de la marche ! »
Paul Léautaud : Une certaine grandeur…
Le dernier numéro de La NRF est paru en juin 1943 sous la direction de Drieu La Rochelle, ce qui était largement suffisant pour qu’en soit prononcée l’interdiction à la Libération.
À partir d’avril 1946 Jean Paulhan faisait paraître des Cahiers de la Pléiade qui ne trompaient personne. Le premier numéro s’est ouvert avec un texte d’André Gide, Thésée. On y trouve aussi les signatures d’Henry Michaux, d’Édith Boissonnas, de René Char, de Maurice Blanchot, de Julien Benda, de Jean Paulhan… Si ce n’est pas de la NRF, c’est quoi ? Mais voilà, le titre est interdit et malgré le luxe (en avril 1946 !) de l’édition des Cahiers de la pléiade, très nombreux sont les nostalgiques de La NRF d’avant-guerre, celle de Jean Paulhan. L’affaire se fera en douceur, à la Paulhan.
Dans cette perspective la mort d’André Gide est une aubaine. Alors que les premiers condamnés à mort pour intelligence avec l’ennemi voient leurs peines commuées en prison à perpétuité (ils seront tous libérés en 1953) la reparution devient une hypothèse crédible.
Gaston Gallimard, à la manœuvre, obtient à titre exceptionnel — il faut toujours commencer ainsi — l’autorisation de reparution de La NRF pour un numéro, exceptionnel lui aussi, d’hommage à André Gide.

La route ainsi ouverte conduira au numéro d’Hommage à Alain de septembre 1952 puis, le premier janvier 1953, à la reparution de la revue avec ce titre assez comique de La Nouvelle nouvelle revue française et une numérotation repartant à 1… puisqu’on vous dit qu’il s’agit d’une nouvelle revue.
C’est dans ce numéro d’hommage à André Gide pages 93-95, que paraît le texte de Paul Léautaud « Une certaine grandeur », que voici :
Dans un Entretien à la Radio, ou dans un fragment de Journal publié, il m’est arrivé d’exprimer ma grande sympathie et ma vive estime pour André Gide. Je reçus une lettre, d’un jeune homme, certainement, qui se déclarait « fort surpris » de ces deux témoignages. Il ajoutait à sa surprise, cette interrogation : Pour André Gide ? Ses œuvres, pour lui, complètement illisibles, à quelque époque qu’il en ait essayé la lecture, et même, au début, « il l’eût étranglé avec plaisir s’il l’avait rencontré ». Je répondis à sa lettre : « Vous jugez un peu promptement, sans beaucoup de réflexion et sans bien connaître le sujet. On peut n’être pas conquis (c’est mon cas à moi-même), et ne pas faire sa lecture préférée des écrits d’un homme, cela n’empêche nullement la sympathie et l’estime pour lui. Gide y a beaucoup de titres à mes yeux. Nous nous sommes même trouvé un jour, tous les deux, il y a longtemps, en riant de bon cœur, un point de ressemblance : que même tout jeunes hommes il ne nous est jamais arrivé de porter un manuscrit à lire à quelqu’un pour avoir son avis. Nous n’étions pas des raseurs. L’effacement de Gide m’a plu dès ses débuts. Jamais on ne l’a vu se mettre en avant, s’exhiber. Au reste la plus grande partie de sa vie s’est passée en voyages, et souvent fort lointains. Le courage qu’il a montré en publiant le Corydon53, au risque de couper, pour lui, toutes relations avec bien des milieux, et même avec des amis, Pierre Louÿs, par exemple. Il me disait récemment que de tous ses ouvrages, c’est celui auquel il tient le plus, pour le but qu’il s’y est proposé de combattre et de faire cesser la sorte de honte qui s’attache à certaines mœurs qui ne nuisent à personne. Son désintéressement des récompenses, des honneurs officiels : décorations, Académie. Sa générosité : au début de l’occupation, de séjour à Nice, il fut obligé de s’en sauver, n’ayant plus rien de son argent distribué par lui à des réfugiés. Enfin, un point qui compte considérablement pour moi, on ne l’a pas vu, à la libération, s’ériger en « justicier », comme certaines vedettes académiques54, qui se sont mérité là un certain déshonneur qui, je l’espère bien, leur demeurera attaché dans l’histoire littéraire de ce temps. Ces vedettes académiques comprenaient au moins deux catholiques de marque. Ils auraient pu se rappeler le grand mot des Écritures : Tu ne jugeras pas. Même en 1793, on n’a pas vu d’écrivains dressés contre d’autres. Cela nous était réservé. Il y eut même deux plumitifs de peu de relief pour fonder à eux seuls un comité, le Comité Saint-Just, et se donner d’autorité pour mission de veiller que les sanctions prononcées soient bien appliquées. Le Grand Prix de littérature, de l’Académie française, a récompensé le promoteur de cette innovation policière55. »
Mépris, et pitié, à ces hommes qui se sont laissé dominer par les événements, et dans le but aussi, peut-être, de faire oublier certains traits de leur comportement précédent, ont pris part, au moins moralement, à ce nouveau 93, l’un réclamant du sang, l’autre dénonçant, deux autres oubliant les grands services reçus. J’ai eu l’occasion de rappeler son rôle à l’un d’eux, en personne, tout comme j’ai rompu ouvertement toutes relations avec un autre. Un troisième, avec lequel j’étais lié depuis notre jeunesse, s’il n’était mort à temps, eût reçu, lui aussi, mes félicitations. Le mot de Gide, quand je le mis au courant de ses belles actions : « Il est difficile d’allier le génie (?) à un beau caractère. »
En dehors de cette lettre et de la réponse que j’y fis, j’ajouterai quelques lignes.
C’est plusieurs jours après la mort de Gide que je lus dans un Figaro littéraire l’article de Jean Schlumberger. Je m’y suis beaucoup arrêté. Gide, depuis le commencement de l’année, avait le sentiment de sa disparition prochaine. Ce cahier de notes, de réflexions, auquel il avait donné ce titre : Ainsi soit-il. Les jeux sont faits. Ce consentement, cette acceptation de la mort, cette sérénité, ce courage, cette compréhension. « J’ai pris congé, j’ai mon congé, il n’y a pas à revenir… Dans certains cas comme le mien, il est séant de consentir. » Sous les mots, quel profond sentiment religieux. Et ce cercueil en pleine terre, cette acceptation de retourner à la poussière, d’une disparition complète, presque anonyme. Je le revoyais sur son lit mortuaire, avec son visage un peu chinois. Savoir mourir ainsi. J’ai trouvé là une certaine grandeur. Je trouvai, sur le moment, que j’employais un bien grand mot. J’en fis l’essai sur des tiers, dans des conversations. Ils le prononcèrent, eux aussi : Oui, oui, une certaine grandeur.
Paul léautaud.
Mardi 24 avril 1951
Notes
1 Jean Denoël (1902-1976), éditeur et rédacteur à Fontaine, « revue mensuelle de la poésie et des lettres françaises » fondée à Alger en novembre 1938 par Charles Autrand. Max-Pol Fouchet en a assuré la direction dès le troisième numéro (avril-mai). Jean Denoël apparaît au comité de rédaction. Cette revue, dont la couverture ressemble à celle de La NRF a cessé de paraître avec le numéro de novembre 1947. Paul Léautaud a rencontré Jean Denoël pour la première fois chez Florence Gould le 28 juin 1945. Il le décrit alors en ces termes : « …un nouveau, nommé Denoël, en uniforme d’officier je crois bien, pas du tout l’éditeur connu ni un parent à lui… »
2 Florence La Caze (San Francisco 1895-Cannes 1983), femme de lettres et salonnière américaine, a épousé en 1923 le milliardaire Frank Jay Gould (New York 1877-Juan-les-Pins 1956). Le père de Florence, Maximilien Lacaze, éditeur d’origine française a fait fortune en Californie.
3 En 1950, André Gide a adapté son roman Les Caves du Vatican (La NRF 1914) en une « farce en 2 actes et 17 tableaux », créée à la Comédie-Française le treize décembre dernier dans une mise en scène de Jean Meyer, ici simple exécutant des désirs de l’auteur. La distribution incluait Jean Meyer dans le rôle de Protos, Louis Seigner et Georges Chamarat qui faisaient partie des noms célèbres de l’époque. Paul Léautaud avait reçu une invitation pour la première.
4 À dix minutes à pied de la rue Sébastien Bottin, en passant par la rue du Bac.
5 Certainement pas sept. Ce que Paul Léautaud ne dit pas, c’est que Marie Dormoy l’accompagne.
6 Jean Amrouche (1906-1962) a été professeur de lettres en Tunisie en 1928. Il rencontre André Gide à Tunis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début de 1944, sous l’impulsion d’André Gide, Jean Amrouche crée, à Alger, la revue littéraire L’Arche, qui accueille toutes les plumes de la clandestinité. À la Libération la revue et son directeur s’installent à Paris. Jean Amrouche a été le premier à entreprendre des « entretiens-feuilletons », d’abord avec André Gide en 1949.
7 Ce portrait dessiné par Berthold Mahn paraîtra dans le numéro de La NRF spécial Gide de novembre 1951, page 418. Dans ce même numéro est paru l’hommage de Paul Léautaud : « Une certaine grandeur »).
8 Roger Martin du Gard (1881-1958), écrivain, prix Nobel de littérature en 1937. Son œuvre majeure en huit épisodes, Les Thibault, a été publiée de 1922 à 1940 à la NRF. Roger Martin du Gard prend une grande place dans la littérature par son immense Correspondance publiée en sept volumes posthumes chez Gallimard à partir de 1980. On retiendra plus particulièrement ici sa Correspondance avec André Gide tenue de 1913 à 1951, parue chez Gallimard en 1968 en deux forts volumes de 732 et 511 pages.

André Gide et Roger Martin du Gard
9 À dix kilomètres à l’est de Caen, ou la famille Rondeau avait une propriété.
10 Les Caves du Vatican.
11 Pierre Herbart (1903-1974), romancier, essayiste et résistant, a épousé en 1931 Élisabeth van Rysselberghe, fille du peintre Théo van Rysselberghe.
12 Marc Allégret (1900-1973) est le fils du pasteur missionnaire Élie Allégret (1865-1940). À la demande de Juliette Rondeaux, mère d’André Gide, Élie Allégret, dans les années 1885, a été le précepteur d’André Gide, de seulement cinq ans son cadet.
13 Mac’Avoy (Édouard Georges Mac-Avoy, 1905-1991), peintre et dessinateur ayant eu du succès en son temps.

André Gide par Mac’Avoy, achat de l’État n 1955, huile sur toile 122 x 107 cm, 1949, centre Pompidou, (détourée)
14 Théo van Rysselberghe (1862-1926), peintre belge connu pour être l’un des représentants du divisionnisme en Belgique. Anarchiste, il collabore à la presse libertaire. Son épouse, Maria Monnom (1866-1959), écrivain belge, est depuis longtemps déjà la confidente d’André Gide, rencontré chez Francis Vielé-Griffin en juin 1899.
15 Pierre Herbart (note 11).
16 Il semble que Maria Van Rysselberghe habitait l’immeuble, voire un appartement contigu.
17 Dominique Drouin (1898-1969) était le fils de Jeanne Rondeaux (1868-1952), sœur cadette de Madeleine Rondeaux. En 1897, Jeanne Rondeaux a épousé Marcel Drouin (1871-1943), agrégé de philosophie en enseignant au lycée Janson de Sailly.
18 Jean Schlumberger (1877-1968), éditeur et écrivain fut un des fondateurs de La NRF.
19 C’est un peu triste à dire mais hors la famille, à entrées multiples, pratiquement tous les hommes de lettres parisiens ayant fait ce voyage de février sont cités ici. À cette courte liste il convient d’ajouter Jean Amrouche, dont il sera question infra.
20 Albert Crochemore (1883-1958) a été maire de Cuverville de 1935 à 1953. Il a eu au moins six enfants, dont l’aîné se prénommait bien Albert mais est mort en 1936, à l’âge de 27 ans.
21 Catherine (1923-2018), fille d’André Gide et d’Élisabeth van Rysselberghe (1890-1980) a épousé en 1946 Jean Lambert (1914-1999).
22 Robert Mallet se justifiera plus tard en disant que comme il empruntait la voiture de son beau-frère, il pouvait difficilement ne pas l’emmener, ainsi que son épouse… et la sœur de l’épouse…
23 Vers septembre 1950, Béatrix Beck a remplacé Yvonne Davet auprès d’André Gide. Béatrix Beck (1914-2008) est la fille de Christian Beck. Christian Beck est Belge, Béatrix est née en suisse d’une mère irlandaise. Béatrix sera naturalisée française en 1955, après qu’elle ait obtenu le prix Goncourt pour Léon Morin, prêtre (Gallimard, mars 1952, 240 pages).
24 Christian Beck (1879-1916), écrivain, poète et militant wallon, père de Béatrix Beck. Voir dans les Mercure de juillet et août 1949 les « Lettres à Christian Beck ».

Voir aussi Béatrice Szapiro, Christian Beck, un curieux personnage, Arléa 2010. Voir aussi le Journal littéraire au premier décembre 1947 : « Il me revient de temps en temps, comme aujourd’hui, au hasard de tout ce qui me repasse par la tête, ce souvenir concernant le pauvre Christian Beck, jeune Belge venu à Paris pour faire de la littérature, familier du Mercure et devenu souffre-douleur de Jarry. »
25 Écouter à ce propos les Entretiens (émissions 22 et 23).
26 Ce texte d’un pasteur, écrit trois jours après les événements, est tout chargé de nombreuses considérations ecclésiastiques, largement enrichies de références à des psaumes ou épitres. Ces orientations de la cérémonie, qui ont causé la fureur de Paul Léautaud et de quelques autres, n’ont pas toujours été restituées dans cette page web avec toute la dévotion souhaitable. On ne peut qu’encourager les lecteurs religieux, brebis égarées ici et forcément déçus, à consulter le texte en ligne à l’adresse https ://www.jstor.org/stable/44813149 (inscription nécessaire mais gratuite).
27 Note de “Jean Claude” : « Pour mémoire, citons : Les Cahiers de la Petite Dame, t. IV (« Cahiers André Gide 7 »), pp. 247-51 ; les notes confiées par Jean Schlumberger à son Journal, Notes sur la vie littéraire 1902-1968, éd. Pascal Mercier, pp. 344-5 ; les lettres de Roger Martin du Gard à Dorothy Bussy et à Marie Rougier, respectivement in Correspondance André Gide—Roger Martin du Gard, t. 11, p. 571, et Journal, t. III, éd. Claude Sicard, p. 941 ; enfin, le bref récit de Jean Lambert dans son Gide familier, nouv. éd. (Presses Universitaires de Lyon, 2000), p. 167. »
28 Michel Leplay (1927-2020).
29 Note de “Jean Claude” : « Nous sommes reconnaissant au pasteur Michel Leplay de nous avoir communiqué ce document et de nous avoir aimablement apporté quelques précisions. Rappelons que, lors du colloque consacré en janvier 1999 à Jacques Rivière et ses contemporains, dialogues autour de la foi, il avait donné une communication intitulée “La séduction d’André Gide : l’Évangile du bonheur” (voir Bulletin des Amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier, no 92/93, 3e 4e trim. 1999, pp. 51-69. »
30 Mercredi 21 février, veille de la cérémonie de Cuverville.
31 Note de “Jean Claude” : « Allusion au second mariage de Dominique Drouin avec Hélène de Maistre. » Hélène de Maistre (1911-1984).
32 Note de “J. C.” : « Les noms suggérés par le Pasteur Bastide correspondent à des personnages jouissant d’une notoriété certaine et occupant des fonctions officielles au sein de l’église réformée. — Charles Westphal, 1896-1972, pasteur à Paris, écrivain et poète. Il succédera au Pasteur Boegner à la Présidence de la Fédération protestante. Très intéressé par Gide, il donnera en des lieux divers une conférence intitulée “André Gide ou la liberté sans emploi”. C’était le fils d’Alfred Westphal, 1869-1928, l’ami montpelliérain de Gide et de Valéry, et le neveu d’Alexandre Westphal, 1861-1951, pasteur lui aussi, traducteur de la Bible, dont Gide à plusieurs reprises dans son Journal et notamment dans Numquid et tu… ?, commente la version ou la compare à d’autres versions. — Marc Boegner, 1881-1970, a été pasteur à Passy à partir de 1918. En 1951, il est Président de la Fédération protestante. — Pierre Maury, 1890-1955, a été pasteur de l’église réformée de l’Annonciation, rue Cortambert à Paris. Il est alors Président du Conseil national réformé et professeur à la Faculté de théologie protestante. C’est lui qui avait assuré le service religieux lors de l’enterrement de Madeleine Gide, décédée le 17 avril 1938. »
33 Note de “J. C.” : « Gilbert Bourcart, en sa qualité de pasteur d’Harfleur, avait la charge de la paroisse de Cuverville. »
34 Note de “J. C.” : « Plus exactement, la vicomtesse Yvonne de Lestrange se trouvait au Congo quand Gide et Marc Allégret y sont arrivés. Elle y était chargée de mission à l’Institut Pasteur. Elle les a reçus à Coquillatville puis a effectué avec eux une partie de leur trajet : voir l’édition qu’a donnée Daniel Durosay des Carnets du Congo de Marc Allégret, Presses du C.N.R.S., 1997, pp. 66-80, et bien entendu le Voyage au Congo où elle apparaît à plusieurs reprises. »
35 Voir la note 247 de la page Gide III.
36 Note de “J. C.” : « Dans son article du Figaro littéraire du 20 février 1951, article reproduit dans l’édition de sa correspondance avec Gide, Cahiers André Gide 2, pp. 187-190, François Mauriac cite effectivement un fragment de Numquid et tu… ? : “Seigneur, je viens à vous comme un enfant ; comme l’enfant que vous voulez que je devienne, comme l’enfant qui devient celui qui s’abandonne à vous. Je résigne tout ce qui faisait mon orgueil et qui, près de vous, ferait ma honte. J’écoute et vous soumets mon cœur.” Voir Journal 1887-1925, éd. Éric Marty, p. 987. »
37 Note de “J. C.” : « Il s’agit de Béatrix Beck. »
38 Note de “J. C.” : « Le pasteur Bastide veut parler d’Albert Foltz, veuf d’Odile Drouin, la sœur de Dominique et de Jacques, ainsi que de Georges Rondeaux. »
39 Note de “J. C.” : « Le film de Marc Allégret, intitulé Avec André Gide, sera prêt définitivement pour le premier anniversaire de la mort de l’écrivain : première projection publique le 21 février 1952. »
40 Note de “J. C.” : « Le pasteur Bastide songe vraisemblablement à l’ouvrage d’Emmanuel Mounier, Introduction aux existentialismes, Denoël, 1946, fort lu et commenté à l’époque. »
41 Roger Martin du Gard, Jean Barois, NRF 1913, 514 pages.
42 Note de “J. C.” : « Le propos correspond bien aux réactions des deux amis de Gide. Ainsi Roger Martin du Gard, plus apaisé, écrira à Dorothy Bussy le 25 février : “Je suis un peu honteux d’avoir joué ce rôle d’anticlérical sectaire” ; et à Marie Rougier le même jour : “J’ai fait figure d’un intolérant et d’un farouche anticlérical à la Harnais (Une scène de Jean Barois).” Quant à Jean Schlumberger, qui a tâché d’“empêcher des paroles irréparables” lors des altercations, il note : “Pour un service religieux, il est incontestable que le pasteur Bastide est discret” (Notes sur la vie littéraire 1902-1968, p. 345). C’est également l’appréciation de Jean Lambert qui, s’il regrette “la gêne” qu’avait causée la cérémonie, estime que “le pasteur a rempli ses fonctions aussi dignement qu’il était possible” (Gide familier, p. 167). Les incidents de Cuverville n’auront d’ailleurs pas de suites véritablement fâcheuses. Et déjà le lendemain, la Petite Dame peut noter : “Tout le monde se donne la main comme si rien ne s’était passé”, et ajoute : “Gide aurait certainement souffert de voir ces deux groupes se hérisser l’un contre l’autre” (Cahiers André Gide 7, p. 251). »
43 Note de “J. C.” : « Dans l’immédiat, Martin du Gard ne donnera aucun article au Figaro littéraire. En revanche, il s’insurgera plus tard contre l’interprétation donnée par Mauriac aux dernières paroles de Gide mourant recueillies par le Professeur Delay : “Toujours cette lutte entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas” »
44 À la fin du texte, cette dernière note de “J. C.” : « voir son Journal, t. III, pp. 958-60. et l’article qu’il donnera au Figaro littéraire le 5 janvier 1952 : “Sur la mort d’André Gide” ».
45 Jean Schlumberger.
46 Le gros livre en question est vraisemblablement la Bible personnelle de Madeleine Gide, que le pasteur a utilisé au château et utilisera devant le caveau.
47 Corrigé de pas, page 142 de l’édition de 1955.
48 Cabris est un village à 25 kilomètres au nord de Cannes. C’est le très jeune Pierre Herbard qui découvrit le village au début des années 1920. Lors de son mariage avec Élisabeth Van Rysselberghe en 1931, le couple est venu s’installer à Cabris, où André Gide a souvent séjourné.
49 Voir le récit de cet achat dans le Journal littéraire au 27 décembre 1941 et la recherche d’un emplacement.
50 Anne Cayssac est morte à Pornic le quinze avril 1950.
51 Ce souvenir est curieux. Le cimetière étant plein sud par rapport à l’église, fin juin il devait être bien tard…
52 Le mois de juin 1951 a été particulièrement froid et humide. Le site web meteo-paris indique : « Du 22 au 30 juin 1951, on se croirait en automne et il ne fait pas plus de 14° sur les côtes de la Manche — la température descend même à 1° à Mont-de-Marsan — des inondations se produisent dans tout le nord-est du pays. »
53 Corydon, essai dialogué sur l’homosexualité, est paru une première fois en 1911, tiré à douze exemplaires, sans nom d’auteur. Il y eut une « seconde » impression en 1920 à un très petit nombre d’exemplaires, avant l’édition publique à la NRF de 1924, quelques mois après la parution du Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust.
54 Paul Léautaud pense ici à Georges Duhamel. Il n’a pas forcément raison.
55 Les grands prix de littérature de l’Académie française ont été donnés, entre 1944 et 1951, à André Billy, Jean Paulhan, Daniel-Rops, Mario Meunier, Gabriel Marcel, Maurice Levaillant et Henri Martineau.
