◄ Eugène Montfort I : 1905-1908
◄ Eugène Montfort II : 1911-1923
Eugène Montfort IV : La mort d’Eugène Montfort ►
1924 : Vingt-cinq ans de littérature — 1925-1926 — 1927 : L’affaire des Nouvelles littéraires — 1928 — Été 1928 : Le « banquet Montfort » — 1929 — 1930 — 1931 — 1933 — Notes
1924 : 25 ans de littérature française
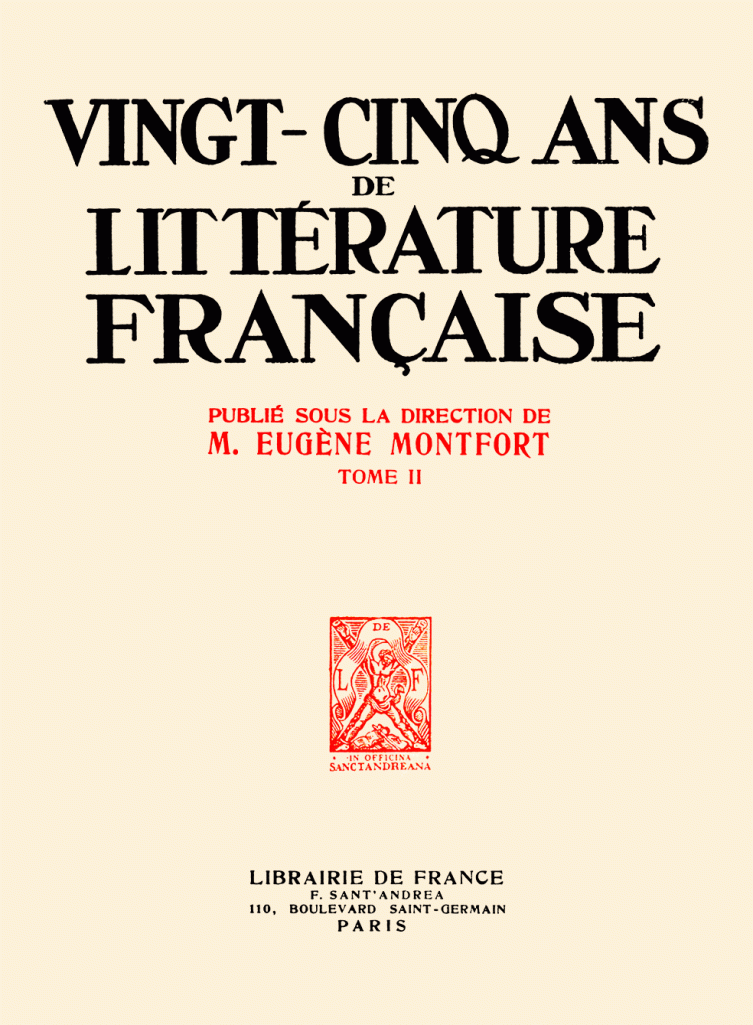
Depuis 1924 au moins, paraissent les fascicules qui formeront les deux volumes Vingt-cinq ans de littérature, sous la direction d’Eugène Montfort. Le tome II comprend un chapitre « Types curieux et pittoresques » ou les auteurs sont présentés en ordre alphabétique ;
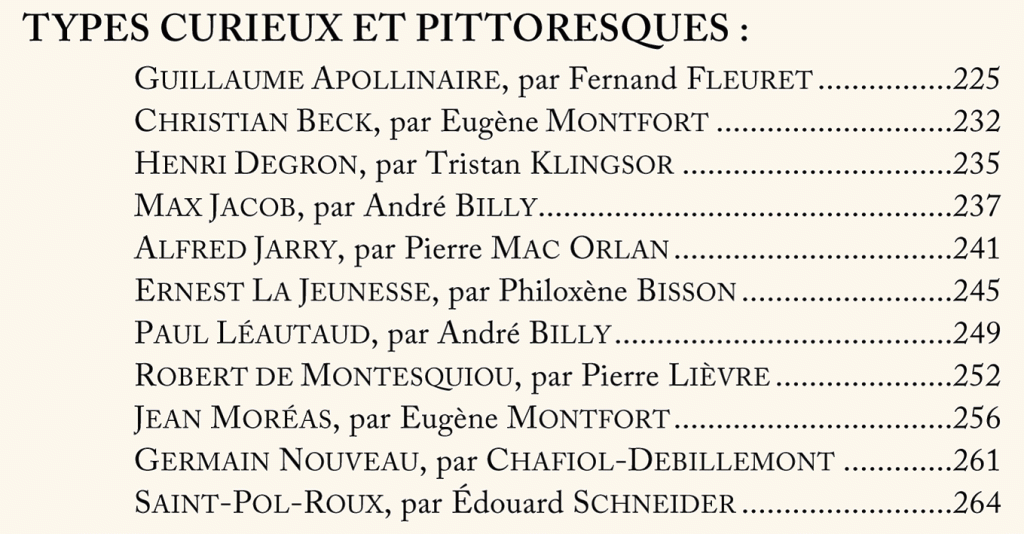
L’idée est que chacun ait sa photographie. Journal littéraire au neuf avril 1924 :
Été aujourd’hui me faire photographier pour les Vingt ans de littérature de Montfort. Arrivé à la porte du photographe, j’ai failli m’en retourner sans entrer, tant cette affaire m’embarrassait. J’ai eu la chance de trouver là, dans le photographe, un ancien employé de Santandréa. J’ai été un peu moins gêné. N’empêche que ce qu’il a fait n’est pas du tout ce que je voulais et que je n’ai pas osé faire.
L’homme aux idées de droite François Sant’Andrea (que Paul Léautaud orthographie toujours sans l’apostrophe) et aux idées de gauche Louis Marcerou (né en 1884, docteur en droit en 1925) ont tenu ensemble une maison d’édition, « la Librairie de France », d’abord au 99 boulevard Raspail en 1921 puis au 110 boulevard Saint-Germain, à l’angle de la rue Mignon. C’est précisément ces deux libraires éditeurs qui ont la charge du Vingt-cinq ans de littérature d’Eugène Montfort. Madame Sant’Andrea tient une librairie, plutôt un cabinet de lecture, rue de Vaugirard. Il arrivait parfois que Paul Léautaud lui donne, pour son cabinet, des livres reçus en service de presse par le Mercure.

Image provenant de l’album de photographies de Marie Dormoy, Mercure 1969
La photo est prête le quinze mai (1924)
Reçu aujourd’hui de la librairie Santandréa une épreuve de la photographie pour laquelle je suis allé chez son photographe pour les Vingt ans de littérature de Montfort. C’est tout à fait bien. Ma chère amie123 qui s’amuse toujours à me dire que je suis si, si laid. Mais non, mais non, pas tant que cela !
Voici le texte de la notice de Paul Léautaud (trois pages, 149-151) du second tome de 25 ans de littérature :
Paul Léautaud, par André Billy
De temps à autre, les habitués des répétitions générales voient paraître dans une encoignure de couloir, immobile mais l’oreille tendue et l’œil aux aguets, bien qu’il ait assez souvent l’air de somnoler, un personnage dont la mine et l’accoutrement font se retourner les petites cabotines effarées. Cet homme porte un chapeau difforme d’où sortent des cheveux grisonnants, évidemment peu familiers avec les ciseaux du coiffeur ; un foulard blanc remplace autour de son cou le banal faux-col. En hiver, un tricot de laine cache sa chemise, et, que la température s’abaisse un peu, aussitôt Paul Léautaud endosse deux vestons l’un sur l’autre, le plus long en dessous, de manière qu’il dépasse124. Ces vestons, qu’on devine achetés dans la confection, prennent sur les épaules de leur propriétaire, une façon d’être personnelle, ample, presque élégante ; des pantalons, disons que le premier homme à qui vint l’idée saugrenue d’introduire ses jambes dans des cylindres de drap, en dut porter de cette forme élémentaire et primitive. Même observation pour les chaussures…
Cependant, Léautaud tient à la main une petite badine et, la tête renversée, un peu inclinée sur le côté, fait une lippe insolente. Il a de beaux yeux et il le sait, il s’en sert en grande coquette, soit qu’il les voile pour se donner, comme je l’indiquais plus haut, la physionomie d’un homme endormi de lassitude et d’ennui, soit qu’il les agrandisse dans une expression de stupéfaction comique. Des lunettes chevauchent son nez aux narines flaireuses, non point de ces somptueuses lunettes d’écaille dont la mode nous est venue d’Amérique, mais de ces lunettes de fer, et rouillées, que les opticiens du quartier Saint-Sulpice vendent aux missionnaires barbus et aux séminaristes boutonneux… L’entr’acte fini, Léautaud regagne sa place d’un pas négligent. On murmure derrière son dos : « Qui est-ce ? » — « C’est Boissard ! » et beaucoup de gens de théâtre ignorent que Boissard s’appelle en réalité Paul Léautaud.
Par contre, sur la rive gauche, aux environs de l’Institut et de l’Odéon, on ne connaît pas Maurice Boissard, mais toutes les concierges, toutes les tripières, toutes les revendeuses de croûtes, toutes les commères attendries et jacassantes, toute la confrérie des vieilles à chiens et à chats dont sont hantés les ruelles et les corridors de cette région de Paris faite pour séduire Rembrandt et Daumier, Callot et Monnier, parlent avec admiration et respect de « Monsieur Léautaud ». Il est pour elles une espèce de saint, un mélange de Saint François d’Assise et de Saint Vincent de Paul, dont la bonté ne s’arrête pas aux animaux, quoi que puisse en penser certaine femme de lettres rudement houspillée par lui125. Une chiffonnière tirait sur la montée de la rue de Médicis une voiture à bras lourdement chargée. Paul Léautaud, qui gagnait la gare du Luxembourg en portant un gros sac de croûtes destinées à la pâtée de ses bêtes, aperçut cette femme qui peinait. Il déposa son sac contre la grille du jardin et, s’attelant à la petite charrette, fit le cheval de renfort, puis revint prendre son sac où il l’avait laissé. Voilà l’homme à qui ses écrits ont fait une réputation de méchanceté. Ceux qui le connaissent sourient quand on leur dit que leur ami est méchant.

Il se tient assez régulièrement rue de Condé, au premier étage du Mercure de France, derrière la porte où sont inscrits les mots : Manuscrits, Publicité, utilisant pour travailler un fauteuil d’époque Napoléon III, bas sur pieds, ce qui lui met la table à la hauteur du menton. Au-dessus de sa tête sont pendues une aquarelle de Marie Laurencin et sa caricature par André Rouveyre. Le nez sur le papier, il écrit de son écriture incroyablement serrée et rectiligne, à l’aide de plumes d’oie dont le grincement flatte, dit-il, son oreille. Il passe pour recevoir les visiteurs d’une façon incivile et peut-être est-il vrai qu’il en use ainsi avec quelques personnes dont la présence l’importune ou l’intimide. Quant à moi, je l’ai toujours vu raffiner sur la politesse à l’égard des étrangers, et le ton dont il lance : « Je vous salue, monsieur ! » ou : « Je vous salue, madame ! » a quelque chose de Régence, il me semble. Il y a d’ailleurs dans toute sa personne physique, intellectuelle et morale, une extrême distinction dont je crains bien de ne pas réussir à donner l’idée.
Paul Léautaud habite une maison au milieu d’un jardin, sur la colline de Fontenay-aux-Roses. C’est là, c’est au milieu de ses chiens — il en a quinze — et de ses chats — il en a quarante — que le personnage prend toute sa valeur. Léautaud rentrant de Paris, le soir, sa journée finie, et toute sa famille à quatre pattes s’élançant à sa rencontre dans un grand fracas d’aboiements, toutes ces gueules ouvertes, toutes ces queues qui frétillent, tous ces dos qui se frottent à ses jambes, tous ces bonds, toutes ces caresses, toute cette joie d’enfants qui retrouvent leur père, la scène serait à peindre. Elle est l’onguent, elle est le baume quotidien sur la misanthropie saignante de Léautaud.
Il a décrit son jardin où quatre-vingts tombes d’animaux divers émaillent l’herbe de briques et de fragments de faïence. La nuit, le clair de lune les fait briller et, de sa fenêtre, Léautaud les contemple en rêvant. Il a décrit sa chambre qui est aussi son cabinet de travail : de vieux meubles, quelques livres, des portraits de famille et notamment une photographie de sa mère dont il ne nous a pas caché qu’elle fut jolie femme et encline à badiner, même avec son grand fils Paul qu’elle n’avait pas revu, il est vrai, depuis sa naissance, ou peu s’en faut… Et des chats, des chats, des chats partout, sur la table, sur le bureau, sur la cheminée, sur les livres, sur la commode, sur le fauteuil, sur le tapis, sur la chaise, sur le lit. « J’ai le plus grand mal à me coucher, explique-t-il, à cause de mes chats, et quand je suis couché j’ai le plus grand mal à me lever pour la même raison. Il y a des chats sous ma tête, sous mes reins, contre mes flancs, sur ma poitrine et le long de mes jambes. Je n’ose pas les déranger… »
Je me souviendrai toute ma vie d’un beau dimanche d’été passé à Fontenay, dans la maison de Léautaud où l’on bute à chaque pas dans des plats de cendre et où les portes ont été remplacées par des treillages en fil de fer, comme dans un poulailler. Léautaud, en ce temps-là, avait une oie. Au dessert, elle monta sur la table, et, la nuit venue, je me demandai quelles étaient toutes ces lumières qui clignotaient entre les feuillages assombris : c’étaient les yeux des chats…
Au théâtre, à la ville et chez lui, tel est l’un des écrivains les plus originaux, les plus indépendants, les plus fiers, les plus spirituels que nous ayons. Un cas de sensibilité refoulée, faussée, exaspérée, que la moquerie détend et soulage. Un cœur farouche qui s’est taillé son domaine dans le monde des bêtes comme pour se le tailler plus librement, mieux à la mesure de sa tendresse. On l’a comparé à Rousseau dont il a la franchise, mais non la servilité, et à Diderot dont il a la spontanéité pétillante. Au total, un esprit de grande tradition sous les apparences d’un bon toqué.
André Billy
Une reproduction PDF de ces trois pages d’après l’original pourra être téléchargé infra, juste avant les notes.
Le quatre juillet, Paul reçoit le fascicule :
Reçu tantôt le fascicule des Vingt-cinq ans de littérature dans lequel je figure (Types curieux et pittoresques). C’est Billy qui me présente, naturellement. Il a encore un peu chargé. Toujours l’amour du pittoresque. Où je ne me vois vraiment pas le moins du monde, ce qui est bien possible. Il est très vrai, en effet, qu’au théâtre tout le monde me regarde, mais je trouve tout de même tout cela un peu chargé. On sent la plus vive amitié dans tout ce portrait. J’y suis encore couvert de compliments, d’éloges. Je disais tout à l’heure à Auriant126 qui venait de lire l’article : « Savez-vous ce que je pense, une fois de plus ? c’est qu’il n’y a pas besoin d’avoir fait grand-chose pour qu’on parle de vous, qu’on vous considère comme quelqu’un. Qu’est-ce qu’on dira de quelqu’un ayant fait vraiment une œuvre ! » Auriant m’a répondu que je suis mauvais juge. Les gens qui lui parlent de moi en parlent avec considération, me dit-il. C’est toujours un étonnement pour moi, tant j’ai peu conscience de ce plus ou moins de réputation.
Maintenant que j’ai fait le modeste, ceci : il y a des traits exacts dans le portrait de Billy. Il est très vrai que j’ai une certaine distinction physique et intellectuelle. On l’a déjà dit de ce que j’écris. On me connaît pour ne jamais dire de grossièretés. Laure Persillard127 me disait autrefois que je donnais de l’élégance aux plus vulgaires vêtements.
Je n’aime pas beaucoup le « bon toqué » de la fin de l’article.
1925-1926
Le 17 décembre 1925, conversation dans le bureau du Mercure :
Je parlais tantôt dans mon bureau avec Montfort, de Longnon128 et de Varillon129, de la Cité des livres, chez qui nous nous sommes trouvés ensemble avant-hier. Nous étions d’accord pour les trouver charmants tous les deux. Montfort avait l’air cependant de faire des réserves. Je lui dis : « Qu’est-ce que vous voulez dire ? » Il me répond : « Ils ne sont pas très affranchis… » (religion et patriotisme). Il peut parler, lui qui écrivait, aux premiers jours de la guerre, à Marie Laurencin : « Il faut me dire, Marie, si vous êtes pour le loup allemand ou pour l’agneau français. » (Marie Laurencin avait épousé, avant la guerre, un peintre allemand, avec qui elle était partie en Espagne.) Très joli d’être « affranchi » après. Mais il était mieux de l’être avant. Montfort ne se doute pas que je connais la perle qu’il a lâchée ce jour-là.
Six mois plus tard, le quatre mai 1926 :
L’après-midi, visite de Montfort, m’apportant une annonce des Marges pour le prochain Mercure.
[…]
Il dit que les Nouvelles sont décidément un peu trop un journal de publicité littéraire. Je lui dis, […], le sachant de source sûre, que même des articles en première page, aux Nouvelles, sont des articles payés. Montfort me répond que cela ne l’étonne pas, que l’article de Frédéric Lefèvre130, dernièrement, sur Bernanos131, est certainement un article payé par la maison Grasset. Je dis à Montfort qu’il est décidément impossible d’écrire dans les journaux, même dans un journal comme les Nouvelles, qui est décidément un journal comme les autres, avec des tas de petites combinaisons d’intérêts ou de ménagements, qu’on y perd, d’ailleurs, sur quoi il est bien de mon avis. Il me dit : « Il n’y a que Berton (Claude Berton132) qui s’y tienne… — Oui, et Dieu sait pourtant s’il leur donne des articles qui tiennent de la place. Comment cela se fait-il ? » Montfort me dit que c’est sans doute qu’il sait s’y prendre, s’imposer. Je raconte à Montfort ce que je sais de l’énorme contentement de lui-même que montre Berton, de l’importance qu’il se donne comme critique dramatique133 et la scène bien amusante que m’a jouée un jour Frédéric Lefèvre en imitant Berton, lui racontant que lorsqu’il entre dans une salle de spectacle, les acteurs s’aperçoivent aussitôt qu’il est là, se le désignent entre eux : C’est lui !… et jouent en conséquence, et aussi ce qu’il a dit un jour devant moi, quand nous parlions de gens décorés avec Martin du Gard et qu’il s’est mis à dire qu’il n’y a que les niais qui tiennent à être décorés, qu’une seule chose compte : se signaler par ses œuvres, et disant qu’il lui suffisait que ses œuvres fassent vivre son nom, d’un ton qui montrait qu’il était sûr qu’il en serait ainsi. Montfort m’a dit que cela ne l’étonne pas. Berton lui a dit à lui-même une fois : « Je suis le premier journaliste de Paris. Voilà même quarante ans que je le suis. Seulement, on ne veut pas m’employer. » Montfort dit qu’il sait tout, qu’il est capable d’écrire sur tout, un article brillant, plaisant, etc., etc., ou complètement assommant. Berton est, paraît-il, l’homme qui donne des conseils sur tout, sur la façon de se moucher ou d’aller à cheval. Il connaît tout, peut parler de tout, et a toujours une meilleure recette que celle d’un autre. Comme je demandais à Montfort l’âge qu’il a, il m’a répondu : 61 ans. Je disais que j’ai dû voir jouer le père de Berton. Montfort m’a dit : « Il ne parle pas beaucoup de son père. Mais son grand-père134 ! Il en parle comme d’un homme extraordinaire. » J’ai demandé à Montfort si Berton a certains moyens d’existence. Il m’a dit : « Non. — Alors, comment vit-il ? » Montfort m’a expliqué que Berton fait également la critique dramatique dans une sorte de magazine : La femme ou La Femme de France, je crois, qui a un très grand tirage135. Il écrit aussi des articles pour des journaux américains, qui doivent le payer assez bien.
Je disais à Montfort que les articles de Berton dans les Nouvelles ne manquent pas d’intérêt. C’est vivant, plein de choses. Peut-être un peu phraseur et prétentieux quelquefois… Montfort m’a dit à ce sujet : « Le plus fort, c’est qu’il dit qu’il écrit très difficilement. Il m’a dit souvent qu’il a une grande peine à écrire. » Je dis que les articles des Nouvelles paraissent pourtant écrits avec aisance. Montfort me dit : « En tout cas, moi, j’ai vu ses manuscrits quand il faisait les théâtres aux Marges. Ça avait bien l’air d’être écrit facilement, au courant de la plume. Ce doit être un genre qu’il veut se donner. » J’ai répondu à Montfort qu’on se donne plutôt le genre d’écrire facilement, quand ce n’est pas vrai.
Je crois que c’est la première fois, depuis que je le connais, que j’ai vu Montfort parler autant qu’aujourd’hui.
Quand j’ai dit à Montfort le propos de Berton sur ses œuvres qui feront vivre son nom, il m’a dit : « Il m’a dit qu’il tient depuis longtemps un Journal où il écrit tout. C’est peut-être sur ce Journal qu’il compte136 ? »
Six semaines plus tard, le 17 juin (1926), Madame Montfort mère, née Blanche Revillon (1852-1929) est souffrante mais va vivre encore jusqu’en novembre 1929 :
Vu également Montfort, venu me voir pour sa publicité des Marges dans le Mercure. Sa mère très malade. Lui très affecté. Saltas, toujours très gentil, va la voir tous les jours. Il la considère comme perdue et ne l’a pas caché à Montfort. Elle a 74 ans. Saltas m’en a parlé mardi dernier. Il la voit comme s’éteignant par usure. Je disais à Montfort : « Vous avez toujours vécu avec elle. Cela vous fera un grand changement ». Il m’a répondu que ce sera en effet un grand changement pour lui. Je lui ai demandé : « Êtes-vous capable de vivre vraiment seul ? » Il m’a répondu là-dessus : « J’ai une fille… » Je n’ai pu retenir ma surprise, n’ayant jamais rien su de cela jusqu’à aujourd’hui. Il a continué : « J’ai une fille… qui ne vit pas avec moi… Si ma mère meurt, cela fera naturellement un grand changement… » Il est probable que Montfort a une maîtresse et un enfant, que sa mère l’ignore, ou que, vivant avec sa mère, il n’a pu ou voulu faire vivre avec lui, et que si sa mère meurt, il prendra avec lui. De là, sa réponse à la question de vivre vraiment seul.
Et à la fin de l’année 1926, le deux novembre :
Vers cinq heures, visite de Montfort, m’apportant une page d’annonces des Marges pour le Mercure. Il est resté environ une demi-heure. Toujours son attitude : faire parler sans rien dire lui-même. Il est resté tout le temps à étirer sa paire de gants, à l’examiner, à la retourner dans tous les sens, lâchant de temps en temps un mot, un autre. Jamais je n’ai vu examiner une paire de gants avec une telle attention. On aurait cru qu’il était à un rayon de ganterie, en train de faire un achat. Il m’a demandé si j’ai lu le récit du voyage de Gide en Afrique, dans la Nouvelle Revue française, « vide au possible » et son Journal des Faux monnayeurs137 « sans le moindre intérêt ». Je crois que ce qui le fait avoir ces appréciations c’est à la fois qu’il est un écrivain réaliste, tout comme moi, ce qui l’éloigne des analyses un peu protestantes de Gide, et qu’il est resté littéraire, alors que Gide semble se dépouiller de plus en plus de la littérature, cela s’entendant de l’arrangement, de la présentation d’un sujet. Je ne puis croire que les dissentiments qu’il a eus avec Gide, il y a plus de vingt ans, agissent encore sur ses jugements à son égard.
1927 L’affaire des Nouvelles littéraires
Le trois janvier, Paul a une longue conversation avec Auriant, qui partage son bureau :
Il m’a raconté ce qui suit, il y a quelques jours.
D’abord, il faut noter qu’il lui est venu l’idée d’écrire pour les Nouvelles un article sur Montfort qu’il estime comme Montfort le mérite. Il en a parlé à Martin du Gard, qui a accepté l’article. Il l’a même accepté de très jolie façon. Montfort a plus ou moins dit du mal des Nouvelles et je crois bien de Martin du Gard lui-même. Auriant n’a pas été gêné pour le rappeler tout d’abord à Martin du Gard. Martin du Gard a répondu : « Mais cela ne fait rien. Au contraire, c’est une raison. Faites l’article sur Montfort et apportez-le-moi. »
Auriant a rapporté cela à Montfort. La chose a dû travailler dans l’esprit de Montfort. Un jour il a dit à Auriant « J’ai un roman de terminé. Il est placé dans une revue. Je n’ai qu’à le donner. Mais j’aimerais mieux le donner aux Nouvelles. Le public des Nouvelles m’intéresse davantage. Vous devriez négocier cela avec Martin du Gard. Le roman fera environ 4 000 lignes138. J’en veux 8 000 francs. »
Auriant a fait la commission à Martin du Gard. Celui-ci a demandé à réfléchir. 8 000 francs lui ont paru cher. Il voulait voir le roman. Montfort avait refusé par avance de le montrer. On le prenait ou on ne le prenait pas, voilà tout. Martin du Gard a encore objecté sur le prix. 4 000 francs, par exemple, il pouvait prendre la chose sur lui. Mais 8 000 ? Il fallait qu’il consulte son associé. Finalement, dans une nouvelle visite d’Auriant et la conversation arrivant sur ce point, il a dit non.
Voilà Montfort bien avancé. Il a dit du mal des Nouvelles. Il a ensuite fait solliciter, en quelque sorte, qu’on lui prenne un roman. Il a eu une réponse négative. Il sera gêné maintenant pour parler des Nouvelles, et s’il critique encore, il aura l’air d’agir par rancune. Il doit joliment se mordre les pouces de sa tentative.
Aux Nouvelles littéraires, l’Affaire Montfort ne s’arrange pas. Il faut dire qu’il ne fait rien pour ça. Journal littéraire au 22 janvier 1926 :
Auriant a téléphoné hier ou ce matin à Martin du Gard au sujet de son article sur Montfort qu’il doit lui donner pour les Nouvelles. Martin du Gard lui a parlé de l’article paru dans le dernier numéro des Marges, dans lequel il est pris à partie, mais je crois que c’est plutôt Guenne, ainsi que Florent Fels139, dans une affaire de Jacques Guenne, critique d’art contre dons de tableaux, ce qui est du reste dans les habitudes de la plupart des critiques d’art qui se montent ainsi des galeries de tableaux qui valent cher quelques années plus tard. Martin du Gard a dit à Auriant que l’affaire de l’article sur Montfort devenait délicate, après ce nouvel éreintement. Auriant lui a répondu qu’il devait connaître Montfort, que les Marges sont une revue indépendante et que Montfort n’enlève jamais un mot à ses rédacteurs… « Mais moi aussi, je n’enlève jamais rien à mes rédacteurs », a répliqué Martin du Gard, ajoutant aussitôt qu’il s’est toujours arrangé pour qu’on ne dise pas de mal de Montfort dans les Nouvelles. « Vous devriez bien parler de cela à Montfort. C’est désagréable. » Auriant lui a répondu qu’il ne peut faire une pareille commission, qu’il ne peut se charger de proposer un marché à Montfort. Il a alors demandé ce qu’il en est en définitive de son article. Là-dessus Martin du Gard lui a répondu qu’il ne pourrait lui répondre par téléphone et lui a donné rendez-vous pour mardi.
Huit jours plus tard, le mercredi 26 janvier :
Les choses vont décidément mal entre Montfort et Martin du Gard, qui, du reste, je crois bien, ne se sont jamais vus et ne se sont jamais dit un mot. Auriant m’a mis au courant ce matin du résultat de son rendez-vous de mardi avec Martin du Gard. Il avait auparavant rapporté à Montfort leur entretien par téléphone, l’espèce de marché qu’avait proposé Martin du Gard en disant que Montfort devrait empêcher désormais qu’on attaque dans les Marges les rédacteurs des Nouvelles ou de l’Art vivant140. Indignation de Montfort. Il dit à Auriant en parlant de Martin du Gard : « C’est un c…, et je l’emmerde. Et je vous prie de le lui dire, absolument, de le lui dire. » Le lendemain, Auriant le revoit. Montfort lui répète : « Dites-le-lui, n’est-ce pas, je compte sur vous. » Le lendemain encore, même recommandation de Montfort. Si bien qu’Auriant, dans son rendez-vous de mardi, après quelques airs de vouloir tourner autour, en disant à Martin du Gard : « Si je vous disais ce que M. Montfort m’a chargé de vous dire… », et s’être fait dire plusieurs fois par Martin du Gard : « Mais si, dites-le, cela ne fait rien », a fini par le lui dire tout net, et tout haut, des gens dans des bureaux voisins pouvant fort bien entendre. Il paraît que Martin du Gard a été un peu secoué faisant des signes à Auriant de ne pas parler si haut, et a dit, parlant de Montfort : « C’est un salaud… J’aime encore mieux être engueulé par M. Léautaud. Il est plus poli et il n’a pas de rancune. » Naturellement, il ne peut plus être question de l’article d’Auriant sur Montfort dans les Nouvelles. Comme Martin du Gard répétait à Auriant que Montfort aurait bien dû surveiller ses rédacteurs et les empêcher d’attaquer Guenne et Fels (car c’est bien Guenne qui a été pris à partie et non pas lui, Martin du Gard), Auriant lui a répété qu’aux Marges les rédacteurs sont libres, et a ajouté : « Vous m’avez répondu à cela que vous aussi, vous laissez vos rédacteurs libres… N’empêche que dans mon article sur M. Léautaud141, vous m’avez enlevé, sans même me prévenir, tout un passage… — Parbleu ! s’est écrié Martin du Gard, vous attaquiez des gens qui sont mes amis. » À quoi Auriant, qui, paraît-il, lui a répliqué vertement à tout, jusqu’à lui demander à un moment, d’un certain ton, comme Martin du Gard prononçait le mot de chantage, s’il disait cela pour lui, ce qui a radouci tout de suite Martin du Gard, — à quoi, dis-je, Auriant lui a répondu : « Moi, je ne m’occupe pas de cela. Je suis un écrivain. J’écris ce que je pense. J’ai les gens qui me plaisent, ceux que je n’aime pas et ceux qui me sont indifférents. »
Martin du Gard a aussi répété encore qu’il avait toujours pris soin qu’on ne dise pas de mal de Montfort dans les Nouvelles, qu’il ne s’en occupera plus maintenant, qu’on pourra bien écrire tout ce qu’on voudra, que même Montfort ne devra pas s’étonner s’il y a dans les Nouvelles un article de lui, Martin du Gard, contre lui.
Comme je l’ai dit à Auriant, on ne peut rien écrire contre Montfort. Si on dit qu’il n’a pas de talent, ça ne tiendra pas debout. Quant à sa vie d’écrivain, elle est irréprochable. Montfort peut dormir tranquille.
Quant à Martin du Gard, pas malin. Il n’a pas été beau joueur. Il aurait dû quand même prendre l’article d’Auriant sur Montfort. Montfort en aurait été éberlué. Martin du Gard « l’aurait eu » comme on dit, de la meilleure façon.
Le lendemain 27 janvier :
J’ai eu il y a quelques semaines dans un journal de Tunis, à propos de mon volume de Chroniques, un sot article me montrant comme un antisémite, pour ce que j’ai dit des petites cabotines juives d’aujourd’hui142. Il paraît que Montfort se propose de parler de moi sous ce même aspect dans les Marges. C’est Auriant qui m’a appris cela hier.
Deux jours plus tard, le 29 janvier :
Raconté ce matin par Auriant : il a demandé à Montfort pourquoi il n’y a plus de critique dramatique dans les Marges. Montfort a répondu que cela n’était pas intéressant, avec les gens qui la faisaient, qu’il faudrait quelqu’un qui ne fasse pas de pièces, qui n’ait pas de relations dans les théâtres, qui soit tout à fait libre et qui dise ce qu’il pense… Auriant a dit : « Léautaud, alors ? — Ah ! Léautaud ! certainement. Mais je n’oserai jamais le lui demander. Une chronique de Léautaud, cela se paie. Je ne suis pas assez riche. Certainement, pour lui, je ferais un sacrifice. Je donne 50 francs pour les chroniques des Marges. À lui, je lui donnerais bien 100 francs. Mais je n’oserais jamais le lui proposer. Ne lui dites pas surtout que je le lui propose. Je dis cela parce que nous en parlons, voilà tout. ».
J’ai répondu à Auriant, pour qu’il le répète à Montfort, s’il le veut, que je ne dis pas non, que les Marges me plaisent beaucoup, ce que Montfort sait depuis longtemps, mais que si je me décidais, ce ne serait pas maintenant, pas avant d’être sorti de tout mon travail, pas avant une année au moins.
Le 22 février, Auriant se rend au Figaro, alors au rond-point des Champs-Élysées afin de rencontrer Robert de Flers143, alors directeur littéraire du journal. L’idée est de placer un article sur les Vingt-cinq ans de littérature. Robert de Flers donne rendez-vous chez lui, 70 boulevard de Courcelles, face au parc Monceau. Auriant s’y rend. Le récit de cette visite est un peu hors-sujet mais peut être lu dans le Journal littéraire à cette date. Restons centré sur notre sujet :
[Flers] a été très aimable avec Auriant. Il lui a demandé ce qu’il désirait. Auriant le lui a dit : deux articles qu’il voudrait lui donner pour le Figaro. Deux articles. Ah ! Et sur quels sujets ? Un article sur M. Eugène Montfort, à propos de ses Vingt-cinq ans de littérature. Flers a dit oui, qu’il a beaucoup d’estime pour Montfort, qu’il est un homme charmant.
Mais en échange de cette faveur, R. de Flers aimerait bien que l’éditeur commande de la publicité au Figaro, tout se paie, mon bon monsieur. Il se trouve que Sant’Andrea en fait déjà… Le soir-même Auriant voit Eugène Montfort et Sant’Andrea.
Le quatorze mars, l’affaire traîne toujours :
J’ai dit à Auriant, il y a quelque temps, que Santandréa m’a offert, à l’époque que j’ai publié dans les Nouvelles mon feuilleton sur le salon d’Aurel144, de se faire l’éditeur d’une petite Gazette rédigée par moi seul, et dans laquelle je pourrais écrire tout ce qui me plairait, même sur des gens. Santandréa, lui, se moquant des cris et des procès. Il arrive ce matin avec un air renfrogné et me dit : « Je crois bien que vous devrez reparler avec Santandréa de la Gazette qu’il vous a offert de publier. » Je lui demande ce qu’il a. Il a ceci tout bonnement : Montfort lui a laissé pour compte son compte-rendu de la Vie de Lady Hamilton145 d’Albert Flament146, celui-ci étant un ami de Marie Laurencin. Auriant m’a avoué qu’il subissait une rude déception sur le compte de Montfort. Ce qui m’a joliment fait rire. « Je vous l’avais bien dit, ai-je dit à Auriant, que Montfort, lui aussi, a ses petits ménagements. Il m’offre de faire la critique dramatique aux Marges. Mais au bout de trois mois, il me faudrait m’en aller. Vous le voyez avec Flament. Si encore c’était un ami à lui. On pourrait comprendre. Mais parce que Flament est un ami de Marie Laurencin ? Non, vraiment, c’est excessif. »
Auriant ne me l’a pas dit, mais je crois bien qu’il n’écrirait plus aujourd’hui, ou tout au moins dans le même sentiment, son article sur Montfort pour le Figaro. À ce propos, cet article a été très bien accueilli vendredi dernier par le « divin marquis ».
Le quatre avril (1927) André Billy est de passage au Mercure :
Billy me parle de Montfort. Il me dit qu’il a vraiment l’air d’en vouloir à Frédéric Lefèvre. Je lui dis que ce sont toujours les vieilles histoires de la première Nouvelle Revue française, sur lesquelles le Soir a publié ces jours-ci plusieurs Échos147, desquels il semble bien apparaître que tout fut produit par l’autoritarisme de Gide, ne tolérant pas qu’on écrivît le moindre mot contre Mallarmé.
Billy me raconte qu’il y a quelque temps Montfort lui a dit en confidence qu’il a une fille, âgée de cinq ans. Il a tiré avec dévotion de son portefeuille une photographie qu’il a montrée à Billy, avec des paroles de père : « Elle est délicieuse. » Il a répété cela à plusieurs reprises et dit qu’il voudrait en avoir une autre. Billy dit que cette enfant ressemble à Montfort. Elle a sa lippe, ses gros yeux. Billy a demandé à Montfort pourquoi il n’épouse pas la mère. Montfort lui a dit : Non, non, non. Je disais à Billy que Montfort ne doit pas être un homme heureux. Il a été de mon avis, disant : « Il souffre de son physique. »
Toujours en 1927, le vingt avril :
J’ai vu hier chez Saltas le premier volume d’une collection que publie Montfort : Lettres de Louis Codet148. Tout à fait jolie. Un peu le genre des volumes bleus de Gide. J’en parlais ce matin à Auriant. Il me demande si j’aurais l’intention de faire un volume dans cette collection. Je réponds que cela se pourrait. Je me suis mis en effet tout à fait par hasard à travailler au chapitre de mes souvenirs d’enfance du Petit Ami avec l’idée à laquelle je crois bien que je vais m’arrêter de ne garder de ce livre que ce chapitre et celui de l’entrevue avec ma mère à Calais, les deux écrits sans fausse fantaisie, et de rejeter tout le reste. J’ai écrit d’un coup, avec grand plaisir, le passage de ma visite à ma mère, Passage La Ferrière. Cela m’avait mis assez en train. Restait à savoir s’il y aurait la matière d’un volume avec ce chapitre de souvenirs d’enfance — le chapitre de l’entrevue à Calais étant loin d’être fait, avec ma besogne des Poètes d’aujourd’hui. Je dis à Auriant que je compte sur la matière de cinq feuilletons des Nouvelles. Il revient tantôt, en ayant déjà parlé à Montfort et me rapportant son acceptation, avec prière de le fixer d’ici peu, car la collection comprend 7 volumes et il y en a déjà cinq d’arrêtés. Or, je constate ce soir que je suis loin de la matière de cinq feuilletons des Nouvelles. Quatre au plus. De plus, comme il m’arrive toujours quand je parle d’un travail que je fais, cela ne me réussit pas. Je constate cela depuis que j’écris. Ce soir, mon travail pour la suite ne marche pas. Vais-je continuer ? Je n’aurais pas mes notices de poètes à écrire, je dirais oui. Mais les notices sont là et je n’ai pas le temps de flâner. Je crois bien que je vais être obligé de dire à Montfort que je renonce au volume.
Encore une petite chose à la fin de l’année 1927, le trois décembre :
Auriant, qui a la manie de s’occuper de ce qui ne le regarde pas (avec les meilleures intentions du monde), s’est mêlé de parler à Montfort de ma collaboration possible aux Marges, lui disant que j’ai des doutes sur la liberté qu’il me laisserait d’écrire ce qui me plairait. Montfort lui a demandé des précisions. Auriant a donné comme exemple ce que je pourrais dire de telles ou telles gens. Montfort lui a répondu qu’il m’accueillerait à bras ouverts et que je pourrais absolument m’exprimer à ma guise. N’empêche que je dois avoir l’air, aux yeux de Montfort, de l’avoir fait tâter par Auriant, alors que je ne pense pas du tout collaborer aux Marges, surtout depuis qu’elles ne doivent plus paraître que trois ou quatre fois par an.
L’année 1927 se termine par la remise du prix Goncourt à Maurice Bedel pour Jérôme 60° latitude nord (Gallimard).
1928
Dans L’Action française, « organe du nationalisme intégral » daté du quatorze février 1928, jour de la saint-Valentin, Léon Daudet se plaît à massacrer Léon Deffoux (note 115, page précédente) et Eugène Montfort, ce qui n’étonne personne. Le contraire, même, eut déçu.
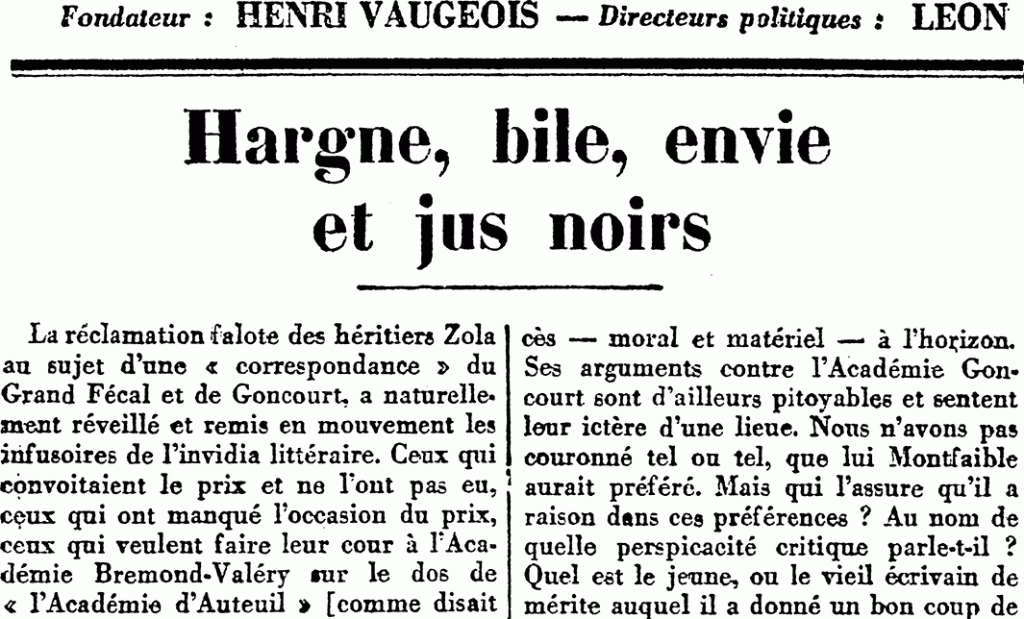
Ce n’est que plus bas dans le texte que sont cités « Le cloporte Deffoux » et « Le cloporte Souday ». Le titre de l’article, de nos jours, évoque irrésistiblement l’extrême droite de cette époque et Léon Daudet en particulier. Son père, Alphonse, est mort depuis trente ans, il est heureux qu’il n’ait pu lire ça.
Dans l’après-midi du deux mars 1928, Eugène Montfort passe au Mercure :
Je lui dis aussi que je ne crois pas du tout à ce qu’on nous raconte pour nous endormir qu’Edmond de Goncourt coupait dans des histoires inventées qu’on lui racontait et les notait comme des choses vraies. Montfort est de mon avis : il était bien trop intelligent, bien trop fin. Montfort me dit que l’opposition à la publication du Journal vient surtout de Léon Daudet. Il y a dans le Journal beaucoup de choses sur Daudet, sur sa femme, sur Léon Daudet lui-même. Montfort149 me raconte, — d’où sait-il cela ? et est-ce exact ? — que le vieux Goncourt se fait sucer la queue par Madame Daudet. Il lui a légué en reconnaissance deux amours et une grue (oiseau) qui ornaient son jardin. Goncourt n’était pas dupe de tous les pelotages de toute la famille Daudet à son égard. Il était très bien avec les Daudet, il acceptait leurs gentillesse, mais il voyait clair, et cela ne l’empêchait pas de noter, — j’ajoute, moi, qu’il avait bien raison —, tout ce qu’il savait et tout ce qu’il voyait.
Puis le onze avril :
Montfort a répondu dans les Marges (le numéro qui vient de paraître Anthologie poétique) aux méchancetés de Léon Daudet. C’est très finement fait. Montfort reproduit simplement le jugement qu’il a porté sur Léon Daudet dans Vingt-cinq ans de littérature150 (jugement pas très élogieux) et rappelant le gros mangeur qu’est Léon Daudet, il dit qu’il n’a probablement pas pu digérer cette page-là. C’est sans réplique. Cela donne à Daudet l’air d’avoir écrit sur Montfort par rancune. Montfort est très fin. On ne le dirait pas à le voir, avec son air mastoque. Son physique trompe complètement sur lui.
Puisque nous parlons de gros mangeurs… huit mai 1928 :
Auriant me dit que Montfort aussi est très porté sur les apéritifs, même sur tous les liquides en général, et la bonne table. Montfort a un diabète sérieux. Il a reçu les avis les plus pressants de Saltas. Auriant va le voir l’autre jour. Il lui dit qu’il n’allait pas bien, et avoue que le veille ou l’avant-veille il a encore pris une « cuite ».
Été 1928 ; Le « banquet Montfort »
Six juin :
Il va y avoir un banquet Montfort. Appris par Auriant aujourd’hui. C’est Ernest Tisserand151 qui a organisé cela. À quel propos, je l’ignore. C’est Maurras qui présidera. Montfort en est enchanté. Il trouve là une jolie réplique aux attaques de Léon Daudet.
Ernest Tisserand a écrit à Descaves et à Rosny aîné pour leur demander d’assister au banquet. Tous les deux ont fait la même réponse : Après l’attitude prise par Montfort à l’égard de l’Académie Goncourt, jamais de la vie. À ce que dit Auriant, l’invitation à Descaves et Rosny a été faite sans aucune illusion, plutôt pour s’amuser.
Mais Montfort tomber dans le ridicule d’un banquet !
Samedi neuf juin :
Le banquet Montfort a une suite, ou plutôt un corollaire. Vallette m’a montré ce matin un mot qu’il venait de recevoir d’Ernest Tisserand, lui disant qu’une délégation devait se rendre tantôt chez Herriot152, pour lui demander de présider ce banquet, et la rosette pour Montfort, et lui demandant de se joindre à eux. Vallette m’a dit, avec un ton d’agacement : « Je ne peux pas y aller. J’ai un déjeuner. Je ne sais à quelle heure je rentrerai. Il faut de plus que je prépare ma voiture pour partir demain matin à la première heure… Et puis, je ne veux pas m’occuper de ces histoires… Je trouve cela… »
J’ai raconté à Auriant cette histoire de la rosette ainsi demandée pour Montfort. Il n’en revenait pas. « Un homme comme lui… »
25 juin :
Reçu ce matin l’invitation au banquet Montfort. Pas plus celui-là qu’un autre.
Trois juillet :
Le comité du banquet Montfort a envoyé un communiqué aux journaux, avec l’énumération des noms des membres du comité. L’Œuvre et l’Intransigeant, en le publiant, y ont supprimé le nom de Maurras. Auriant, qui en parlait à Deffoux, a eu cette réponse : Défense formelle à l’Œuvre et à l’Intransigeant d’imprimer le nom de Maurras et celui de Daudet à quelque sujet que ce soit. Je comprendrais encore s’il s’agissait d’un acte ou d’un écrit d’eux, mais dans un comité de banquet littéraire !
Six juillet :
Le banquet Montfort a eu lieu hier soir. Vallette, qui y est allé, m’a dit tantôt, à propos de la démarche qu’un groupe d’amis de Montfort a faite auprès d’Herriot pour lui faire donner la « rosette » « Eh ! bien, Herriot était au banquet hier soir. C’est même lui qui présidait. Il n’y a pas eu du tout de rosette pour Montfort. Je m’attendais qu’il la lui donnerait là… » J’ai dit que cette remise, de cette façon, ne se fait peut-être que pour de vrais personnages, que ce sera peut-être pour la promotion du 14 juillet. Vallette m’a répondu : « Oui, peut-être ? en effet. » Il a ajouté : « En tout cas, la rosette, c’est bien inutile. Du moment qu’on est décoré, c’est le principal. » Je lui ai répondu alors : « Mais si, mais si, c’est très bien. D’abord, quand on voit des gens l’avoir à propos de rien, alors que d’autres ne l’ont pas. Ensuite, c’est plus joli. Ce petit bouton… C’est plus joli que le ruban. » Je ne pouvais m’empêcher de rire en lui disant cela, en pensant que, peut-être, dans quelques jours153 ?… Il m’a fait cette réponse, sur la différence des deux : « En tout cas, c’est plus commode à mettre et à enlever. »
Le dimanche cinq août (nous sommes toujours en 1928), à l’improviste, Auriant se rend à Fontenay :
Il m’annonce que Montfort a la rosette. Les promotions ont paru ce matin. Sans rien lui dire de plus, je lui demande s’il n’y a rien pour Vallette. Rien. Évidemment, tout vient d’Herriot. Je ne sais s’il avait à choisir entre Vallette et Montfort. En tout cas, il a choisi Montfort, qui pouvait attendre. Barthou n’a pas dû non plus s’occuper de l’affaire comme il aurait fallu.
Auriant me raconte que Montfort, à son banquet, avait chargé son secrétaire, un garçon auquel il donne 200 francs par mois pour venir, 2 heures chaque jour, à 6 heures, à son bureau chez Santandréa, de recevoir les cotisations à l’entrée de la salle. Cette besogne terminée, il l’a laissé partir, sans le prier de rester au banquet.
Auriant me dit que Montfort est très malheureux en secret de n’être pas plus connu du grand public. Comme je lui dis que Montfort n’est pas un écrivain pour le grand public, il me dit que le dernier roman de Montfort, César Casteldor154, est une tentative pour arriver au grand public. Montfort prépare une autre tentative du même genre avec un autre roman qu’il a en train155.
Auriant me dit que Montfort pense le plus grand mal d’Herriot. Voilà qui ajoute au comique de la rosette.
À l’automne, Cécile ou l’amour à dix-huit ans paraît en feuilleton dans le Mercure. Journal littéraire au cinq octobre 1928 :
Auriant m’a dit aujourd’hui que Montfort lui a demandé comme je trouve le roman qu’il publie dans le Mercure : Cécile ou l’amour à dix-huit ans et si je lui en ai parlé. J’ai répondu à Auriant que je préférais ne pas lui répondre, n’étant pas sûr de sa discrétion, attendu qu’il a la manie de répéter tout ce que je lui dis, et que mon avis pourrait ne pas plaire à Montfort, ce qui m’est indifférent, mais ce qui est aussi parfaitement inutile. Je lui ai cependant dit ceci, qu’il m’a assuré qu’il gardera pour lui. Le héros du roman de Montfort, qui est visiblement lui-même, raconte ses impressions à l’égard des femmes, ses façons d’être avec elles, ses timidités, ses désirs refrénés, ses mélancolies, ses rêveries idéales quand il avait dix-huit ou vingt ans. Or, il les raconte de telle façon que cela a l’air d’être un jeune homme de dix-huit ans lui-même qui parle, tant tout cela est petite fleur bleue et romance, alors qu’un homme de cinquante ans qui raconte comment il était à cet égard quand il avait dix-huit ans le fait avec une certaine moquerie, en riant lui-même de ce qu’il était. Auriant m’a dit qu’il a sur ce point la même impression que moi, et il a ajouté que Montfort est ainsi, encore aujourd’hui, ce qui expliquerait le ton vraiment un peu trop dix-huit ans de toute cette partie. Auriant également de mon avis : ce roman ne vaut pas, de beaucoup La Belle Enfant ou l’amour à quarante ans156.
Trois mois après la remise de sa rosette, Eugène Montfort en est encore tout heureux. 28 novembre 1928 :
Auriant dit que le plaisir de sa « rosette » n’est pas épuisé pour Montfort, il en parle, il fait la roue avec. Il parle avec sympathie de Herriot, qu’il déclarait il y a quelque temps avoir en horreur. Il dit qu’il est regrettable qu’il ne soit plus à l’Instruction publique, que c’est un homme de goût, un écrivain de talent, un homme qui s’intéresse aux gens de lettres. Il dit qu’il espère bien qu’il redeviendra ministre, qu’il compte bien le revoir alors et qu’il compte bien être nommé commandeur. Pauvre Montfort !
Il a fort bien fait sentir à Auriant qu’il avait été très surpris et froissé de ne pas avoir reçu ses félicitations pour sa rosette. Qu’est-ce qu’il doit penser de moi, alors ?
Au dire d’Auriant, Montfort passa sa vie à se brouiller et à se raccommoder avec eux.
Auriant m’a raconté que Vollard, se trouvant dernièrement chez Émile Bernard, comme on parlait de Montfort, ne s’est pas montré très féru de son talent, disant qu’il n’a pris La Belle Enfant pour sa collection de luxe que pour motiver des dessins de Dufy. Vollard trouve que la Belle Enfant ne vaut pas La Turque.
1929
Deux janvier :
Auriant m’a raconté aujourd’hui que Montfort a eu il y a quelques jours un accident d’auto qui aurait pu être grave pour lui. Un soir de pluie, en voulant éviter une voiture, il s’est jeté dans une autre et a eu un tel choc qu’il s’est trouvé la poitrine serrée sur le siège de sa voiture entre l’avant et le dossier. Resté près d’une demi-heure à demi évanoui. Saltas venu. Il paraît qu’il s’en est fallu de bien peu qu’il ait les côtes enfoncées.
Premier février :
Montfort a repris ses réunions de café : Les Amis des Marges, dans un café à côté du Châtelet, je ne retrouve pas le nom en ce moment157. Auriant y a été et m’en a parlé aujourd’hui. Spectacle comique, me dit-il, de ces gens de lettres, chacun parlant de soi, ou débinant les autres. Propos du genre de celui-ci « Mon cher, vous ne m’avez pas envoyé votre volume. Ce n’est pas gentil. — Mon cher, je ne vous l’ai pas envoyé, parce que vous-même, vous ne m’avez pas envoyé le vôtre. » Il y avait là Bachelin, « sinistre » dit Auriant, Voirol158, qui a passé son temps à se plaindre que personne n’écrive d’articles sur lui, Fagus, (une réunion où l’on boit, il ne pouvait pas manquer), Fleuret159, Mandin, etc., tout ce monde rangé à la file des deux côtés d’un rang de tables. Montfort fumant sa pipe sans dire grand chose à son habitude. Il paraît que quelqu’un a eu un mot sur Fagus (Auriant m’a bien recommandé de ne pas le lui répéter) : « Fagus ? C’est Verlaine, sans son talent. » Hé ! il y a du vrai.
Le huit février 1929 les premiers volumes de Passe-Temps arrivent au Mercure. Paul Léautaud commence les envois. Le douze février les volumes sont en librairie.
22 février 1929 :
Auriant me raconte qu’il s’est trouvé hier soir avec Montfort et Charpentier160. Il me dit : « Vous savez, sous le sceau du secret, Eugène n’est pas content… (pas content de Passe-Temps). Charpentier a dit hier qu’il était venu vous voir, que vous l’aviez reçu d’une façon charmante161, qu’il avait eu un peu peur de venir, mais qu’il était enchanté de votre accueil, que vous êtes un homme extrêmement sympathique. On a parlé de votre livre. Montfort a dit, avec un air !… « Ça n’existe pas. C’est sans intérêt. Il (moi) était bien quand il écrivait des chroniques… Son article sur Gourmont162… Ce n’est pas la peine d’avoir connu un homme comme il l’a connu pour écrire ça… Je ne comprends même pas qu’on ait édité ce volume… »
Je l’ai dit à Auriant sur-le-champ, comme je le pensais : « Je suis loin de me monter le coup. Je crois tout de même que Montfort exagère. Notez que je n’en veux pas du tout à Montfort. Mes sentiments sur lui et pour lui ne sont changés en rien. Je serai le même avec lui quand il viendra me voir ici. Le sentiment que j’éprouve… je ne trouve pas le mot… une sorte de chagrin, si vous voulez. Ce n’est pas gai d’être jugé ainsi par un ami. »
Auriant met le jugement de Montfort sur le compte de son mécontentement du passage le concernant, dans le morceau sur Charles-Louis Philippe163. Je lui ai dit : « Comment ?… Après vingt ans ? Alors que somme toute, cela n’existe plus pour lui, puisqu’il a collaboré plusieurs fois au Mercure. Il l’aurait lu à l’époque, je comprendrais qu’il ne soit pas content. Mais après si longtemps !… — Il est comme cela. Il est d’une susceptibilité !… Un rien le blesse… Ainsi, le mot de Léon Daudet sur lui… Il n’en est pas encore consolé. Il en parle sans cesse. »
Je dis à Auriant, pour ce qui [me] concerne : « Après tout, je m’en fiche. — Il a sûrement dit cela pour que je vous le dise… Il sait très bien que je vous dis tout. — Ce n’est pas sûr. Il a très bien pu penser que vous seriez gêné de me répéter cela. »
Auriant me fait remarquer que Montfort a parlé ainsi devant Charpentier également et qu’il a très [bien] pu penser que Charpentier ou lui pourraient me répéter ses paroles.
Je dis à Auriant que je ne puis croire cela de Montfort, que, dans ce cas, ce serait vraiment peu joli de sa part, avis que Auriant partage.
J’ai dit aussi à Auriant : « Est-ce de la jalousie ? Jalousie de quoi, Seigneur ! On ne peut pourtant pas dire que j’ai encombré la librairie ni accaparé quoi que ce soit. »
Auriant me dit qu’il a été un peu gêné, devant les paroles de Montfort, pour lui demander à parler de mon volume dans Les Marges. J’ai partagé le sentiment d’Auriant, en lui disant qu’un compte rendu dans Les Marges n’a plus guère d’intérêt, maintenant qu’elles paraissent trois ou quatre fois par an.
Le lendemain 23 février :
Je pensais ce matin dans le train à l’appréciation de Montfort : « Ça n’existe pas. Aucun intérêt. » Alors, la sensibilité, l’esprit, la franchise, la hardiesse d’esprit, la liberté de jugement, le dédain de tout intérêt pour le plaisir d’écrire ce que je pense, le souci de concision, etc… Rien, rien ? Il va tout de même un peu fort.
J’ai dit ce matin à Vallette, de façon tout à fait confidentielle, l’opinion de Montfort. Très surpris. « Je ne comprends pas. On peut préférer, chez un écrivain, une chose à une autre… Cela arrive… Mais à ce point-là… En bloc, comme cela… Cela m’étonne, surtout de Montfort. Êtes-vous sûr qu’il a dit cela ? » Je réponds : « Devant deux personnes. » Il continue : « Je vous dis, je ne comprends pas. »
Je montre, d’un mot, à Vallette, la façon de faire de Montfort, parlant ainsi devant deux personnes qui me connaissent, en rapports avec moi, qu’il pouvait penser qu’elles viendraient me répéter ses paroles. Pour qu’on me les répète, alors ? Vallette me dit : « C’est bien bizarre. »
Huit mars 1929 :
Comme Auriant me le disait ce matin, le petit compte rendu de L’Intransigeant164 va faire plaisir à Montfort. J’ai bien été deux minutes à rire ce matin en le lisant devant le petit commis qui me l’avait apporté.
Le treize mars :
Le roman de Montfort, Cécile ou l’amour à 18 ans, est paru. L’exemplaire pour John Charpentier et celui pour Rachilde sont arrivés aujourd’hui au Mercure. C’est tout petit. Une nouvelle tout au plus165. On ne se foule pas, à faire des livres de ce genre. Auriant, qui est de mon avis sur ce point, me dit que Montfort avait compté sur une sorte de petit scandale, lors de la publication dans le Mercure, à cause de certaines mœurs qu’il met en scène, et d’une certaine scène qui se passe dans une église166. Il ne s’est rien produit du tout. Pas un lecteur n’a réclamé. Montfort, qui a avoué à Auriant, quand il écrivait ce roman, qu’il l’écrivait spécialement en vue d’arriver au grand public, en sera pour sa peine, j’en ai bien peur.
Le vingt mars doit avoir lieu au cercle de la Librairie une réunion des éditeurs en vue d’augmenter le prix des livres. De nos jours une telle entente serait condamnable. Dans une conversation qui se tient l’avant-veille 18 mars, Alfred Vallette et Paul Léautaud observent que les livres diminuent en pagination et en qualité. Journal littéraire au 18 mars :
Le fait est que la plupart des romans sont ainsi aujourd’hui. Je regardais encore tantôt le volume de Montfort : Cécile ou l’amour à dix-huit ans. Rien comme texte. C’est une longue nouvelle, étirée pour faire un volume, et malgré le prière d’insérer ronflant et séducteur, sans aucun intérêt. Je ne dis pas cela à cause de l’avis de Montfort sur Passe-Temps. J’avais cet avis quand le roman paraissait dans le Mercure. Je n’ai pas la carrière littéraire de Montfort mais je n’écrirais pas des bêtises de ce genre. Il me semble que je saurais m’en apercevoir.
Le cinq juin, toujours 1929, entre Eugène Montfort et Paul Léautaud, ce n’est plus vraiment ça :
J’étais ce soir dans le bureau de Bernard et Mandin. Montfort est arrivé, venant voir Mandin. Il m’a dit bonjour et nous nous sommes serré la main. Je n’ai pas à le dissimuler : je suis différent avec Montfort de ce que j’étais. Je ne lui dirai jamais rien de son appréciation de Passe-Temps, mais je la trouve si bête dans son catégorisme. Nous connaissant comme nous nous connaissons depuis longtemps, jamais je n’aurais dit d’un livre de lui, même le pensant, devant des tiers, ce qu’il a dit de ce livre.
Il doit bien avoir de son côté une gêne à mon égard. Il ne sait pas que je sais ce qu’il a dit de Passe-Temps, mais il doit bien penser que j’ai dû m’apercevoir qu’il ne m’a pas envoyé son dernier roman : Cécile ou l’amour à dix-huit ans.
Paul pense aux femmes, sujet bien triste, passé un certain âge (il a 57 ans). Nous sommes le huit juillet 1929 :
Mon manque de dents par-dessus le marché. Quand il m’arrive par exemple de rencontrer quelquefois une occasion, de me dire du moins que c’est peut-être une occasion et que je me dis : Allons, tel que tu es, il vaut mieux n’y pas penser. Auriant m’a raconté alors que Montfort, que son diabète très accentué a rendu presque complètement impuissant, lui a demandé un jour : Et Léautaud, lui, comment est-il ? Auriant lui a répondu qu’il croyait bien que je n’avais pas du tout à me plaindre sous ce rapport. Montfort a dit alors : Il a bien de la chance. Je pourrais lui dire à mon tour : Fichue chance, quelquefois.
Puis le seize septembre :
Saltas a été décoré, comme homme de lettres, ce qui est un comble. Sa nomination a paru quand il était encore à la campagne. Il est rentré. Auriant l’a vu aujourd’hui. Saltas lui a raconté que le jour que sa nomination a paru, Montfort est arrivé là-bas (où il était en vacances167) dans sa voiture, pour lui donner l’accolade, l’embrasser, le couvrir de félicitations, se réjouir d’une croix enfin bien donnée168. Une embrassade générale. Il paraît que tout le monde pleurait. On a gardé Montfort à déjeuner. Mme Saltas préparait justement un lapin façon lièvre. Il paraît qu’à l’annonce de ce menu, Montfort n’a plus desserré les dents jusqu’à l’heure de se mettre à table, et au déjeuner dévorait le lapin façon lièvre à se faire crever sans prononcer une syllabe, malgré tous les avis que lui prodiguait Saltas, en raison de son diabète.
À l’automne 1929, les relations de Paul Léautaud et d’Eugène Montfort ne s’arrangent toujours pas, et tout le monde le sait.
Quatre novembre :
Tantôt, visite à Saltas. Au moment que je vais partir, Montfort arrive, que Saltas attendait. Il me dit d’attendre que la bonne l’ait fait entrer dans le salon pour m’en aller. « Vous ne tenez sans doute pas à le voir ? » Je lui dis : « Pourquoi ? Je suis très bien avec Montfort ! » Il n’en a pas moins attendu que Montfort soit entré dans le salon et la porte refermée sur lui pour me laisser partir. Je soupçonne fort Montfort de lui avoir dit tout le mal qu’il pense de Passe-Temps. Saltas doit penser que je le sais et que je suis fâché avec lui. S’il savait comme je m’en moque, et comme je suis incapable d’en vouloir à quelqu’un pour cela.
1930
Trois janvier :
Montfort a perdu sa mère, il y a quelque temps169. Cela fait un appartement libre dans la maison qui lui appartient boulevard Montparnasse170. Il s’est acoquiné avec Henry Charpentier171 — qui fera ses affaires sur son dos — pour tirer le meilleur rendement de cet immeuble. Cet appartement à louer, il en demande un loyer de vrai mercanti.
Cinq avril :
Auriant va tous les jeudis à la réunion des Marges, qui se tient au café Zimmer172 voisin du Châtelet. Il me disait ce matin : « Je ne sais pas si c’est que Montfort a des ennuis ou des déboires, mais j’ai l’impression qu’il boit. L’autre jour il était saoul. Nettement. » J’ai déjà noté que depuis que Montfort a perdu sa mère et qu’il est devenu le propriétaire de sa maison du boulevard Montparnasse il en a confié la gérance à Henry Charpentier. Celui-ci le travaille depuis quelque temps pour qu’il prenne une hypothèque sur cette maison (probablement qu’il a le prêteur sous la main et se ferait là une belle commission). Auriant me dit que ce même soir, profitant sans doute de l’état de Montfort, Charpentier est revenu à la charge, mais encore sans succès. Auriant se propose de demander à Saltas, sans le nommer, lui, Auriant, de mettre Montfort en garde contre les manigances intéressées de Charpentier.
Les Lettres Mornay sont parues à la toute fin du mois de décembre. Lundi 13 Janvier :
J’ai donné à Saltas vendredi dernier mon petit volume de Lettres. Il a dû le montrer à Montfort. Il m’a rapporté aujourd’hui ce mot de Montfort à son sujet en le regardant : et en parlant de moi : « Il prenait le double de ses lettres. C’est très malin », comme un homme qui s’aperçoit qu’il n’aurait pas eu, lui, cette idée, et qu’il a raté une chose pas bête du tout.
Depuis mars, John Charpentier (note 160), indépendamment de sa rubrique des « Romans », publie des « Figures ». Francis Carco, Jean Cocteau, Jules Romains… Dans le Mercure du premier avril 1930 (pages 622-624), c’est le tour de Paul Léautaud. Eugène Montfort ne se remet pas de ce qu’il a lu sur lui dans Passe-Temps. Le cinq mai :
Auriant me dit ce matin l’opinion de Montfort sur la « figure » de Charpentier : « Il est bien mauvais, le Léautaud de Charpentier. Il n’a aucun talent, ce Charpentier. »
Ce court texte de John Charpentier est pourtant l’un des meilleurs qui puissent se lire sur Paul Léautaud.
1931
Neuf mai :
Ce matin, Auriant. Il vient de voir Montfort. Montfort enchanté. Vient de placer un roman à Candide173. Selon son habitude, il a demandé une avance et l’a obtenue.
[…]
Il a dit à Auriant : « Aussi, pourquoi n’écrivez-vous pas des romans. Faites des romans. Faites des choses comme celles de Cabanès174, avec un peu de pornographie. Vous gagnerez de l’argent. Vos articles comme celui sur Harry Allis175 ? À quoi ça rime ? C’est sans intérêt. Personne ne lit cela. Cela n’existe pas. »
Auriant a demandé à Montfort s’il a lu son article (sur Harry Allis). Montfort a convenu que non.
Auriant me disait qu’il a été assez affecté par les propos de Montfort. Je l’ai remonté, en lui disant que d’abord les propos de Montfort ne sont peut-être pas sincères. Peut-être un peu de jalousie. On parle des articles d’Auriant. On parle peu de ceux de Montfort ni de ses romans. Ensuite, écrire des romans ! À moins d’avoir une personnalité considérable, de savoir trouver et traiter de grands sujets, le roman est une besogne sans intérêt, fastidieuse, il n’y a qu’à voir tous ceux qu’on publie. À la portée du premier venu. Il faut d’abord écrire ce qu’il vous plaît d’écrire, c’est là le premier point. Le reste : réputation ou argent, vient après ou ne vient pas, c’est sans importance.
Montfort, qui conseille aux autres d’écrire des romans, est-il si bien avancé avec tous ceux qu’il a écrits ? Auriant aurait pu lui répondre que son exemple n’est pas encourageant.
Montfort a terminé la conversation en disant à Auriant qu’« il n’y a que boire et les femmes ». Il a confessé à Auriant qu’il lui est arrivé plus d’une fois de se « saouler comme une vache ».
Seize juin :
Auriant me raconte ce soir que Montfort ne sait plus comment trouver un éditeur. Il s’est brouillé avec Fasquelle. Il s’est brouillé avec Flammarion. Il s’est brouillé avec Calmann-Lévy, à propos de son roman Casteldor176, publié à 9 francs. Le volume ne s’est pas vendu. Il a estimé que c’était à cause de ce prix, le public se méfiant, quand le prix courant est de 12 francs, des volumes d’un prix au-dessous, jugeant que ce ne peuvent être que des ouvrages de rang inférieur. Il a alors pensé à Albin Michel. Il a demandé à Saltas un mot de recommandation pour lui. Albin Michel accepte de lui prendre un roman, en lui disant : « Vous êtes peu connu. Je vous donnerai 5 000 francs en tout et pour tout, mais je vous ferai une grande réclame, qui vous fera aller au grand public. » Montfort a vu là une duperie et n’a pas accepté. Quelque temps après, toujours sans éditeur, il écrit à Albin Michel pour renouer l’affaire. Pas de réponse. Il demande alors à Saltas, qui est au mieux avec Fasquelle et avec son fils, s’il ne pourrait pas, sans en avoir l’air, parler de lui au fils Fasquelle177. Saltas accepte. Il dit que rien n’est plus facile et qu’il trouvera le moyen d’amener son nom dans la conversation. Il le fait. Le fils Fasquelle exprime à Saltas une grande admiration pour les romans de Montfort. Saltas saisit l’occasion et lui dit que Montfort a justement un roman prêt et s’il veut le publier. Le fils Fasquelle répond à Saltas que Montfort étant un ancien auteur de la maison, il ne peut décider seul et qu’il faut qu’il en parle à son père. Il dit qu’il lui en parlera et qu’on donnera une réponse à Montfort. Saltas lui-même est d’avis que du moment que l’affaire dépend de Fasquelle, il n’y aura pas de réponse.
Douze octobre :
Saltas me raconte que Montfort a ramené de sa maison de campagne, dans sa maison du boulevard Montparnasse dont il est le propriétaire, quatre coqs qu’il avait là-bas. Mais, à l’aube, chant des quatre coqs. Plainte du voisinage. Commissaire de police. Montfort s’entend dire qu’il a beau être chez lui, pas le droit de déranger le voisinage en ayant ainsi de la volaille à domicile. Alors, il fait égorger les coqs par son concierge, lui en donne deux et monte les deux autres chez lui. Saltas me dit : « Voyez-vous ce mufle ! Je vais le lui dire : vous auriez bien pu m’en envoyer un, le coq à Esculape178 ! »
Rien en 1932 qui ait paru nécessaire de relever.
1933
Après cette longue période de froid, les choses semblent, ce printemps, se réchauffer un peu…
Sept mars :
Voilà Bachelin brouillé avec Montfort, le traitant comme il traite Vallette et Dumur, jurant de ne jamais remettre les pieds aux réunions des Marges, comme il a juré pour le Mercure. Pour la même raison : un article que Montfort lui a refusé. On a raconté sa fureur à Montfort. Il a haussé les épaules : « J’ai publié quelques articles de Bachelin déjà pas drôles. Il m’a apporté cette fois-ci un article inepte. Je l’ai refusé. Je n’ai rien fait avec lui que je ne fasse, en pareille occasion, avec tous les rédacteurs des Marges. »
Le 28 mars, Louis Dumur meurt.
Auriant a demandé à Montfort s’il n’écrira pas quelque chose dans les Marges sur Dumur. Montfort a répondu non, qu’il le connaissait à peine. Il a raconté qu’il l’a surtout connu durant un voyage en Roumanie, il y a quelques années, Dumur très obligeant pour tout le monde sur le bateau.
À Eugène Montfort
Paris le 20 avril 1933
Mon cher Montfort,
Ce matin, dans le courrier, l’exemplaire de votre Choix de Proses179 pour John Charpentier. J’ai lu votre Apologie. Je vous le dis avec plaisir : je suis de votre avis.
Cordialement
P. Léautaud
Journal au 22 avril :
Ce matin, pour John Charpentier, un exemplaire d’un Choix de Proses de Montfort. En tête, une Apologie par lui-même, osée, franche, décidée, je lui ai écrit aussitôt deux lignes pour lui dire mon approbation. Montfort est un écrivain d’un goût parfait, d’une tenue exemplaire, d’une grande connaissance de la littérature, un homme, lui aussi, qui a écrit pour son plaisir.
Puis au six mai :
Montfort s’est décidé à publier dans Les Marges l’article de Bachelin d’abord refusé. Alors, on revoit Bachelin aux réunions des Marges.
Deux juin :
Auriant a proposé à Montfort de faire dans Les Marges un compte rendu du Maupassant de René Dumesnil180 qui vient de paraître, pour l’abîmer un peu, naturellement. Montfort a refusé : « Non ! Maupassant… Peuh !… Il écrivait clair, oui… Mais… Un canotier !… » Auriant trouve ce jugement un peu excessif, et sommaire. Il me disait ce soir en me racontant cela : « C’est comme si, plus tard, parlant de Montfort, on disait : Un homme de café ! »
Le six octobre :
Auriant me parle d’un dîner fin, hier soir, entre Montfort, Fleuret, le petit Pouvillon181 et Pillement182. Montfort, Fleuret et le petit Pouvillon, à la fin, complètement ivres, ce que Pillement lui a raconté tantôt, mais ivres dans les grands prix.
Le quatorze octobre, cela faisait longtemps que Paul n’avait traité d’Eugène Montfort aussi longtemps ; toute la journée :
À ce que me raconte Auriant, il y a quelques jours, et ce matin, Montfort s’intéresse beaucoup à moi en ce moment. Il a commencé par trouver tout à fait très bien ma Gazette du Mercure du 1er octobre183, à demander comment je vais, ce que je fais. Puis hier revenu sur mon compte, au sujet du premier morceau de ladite Gazette, dans laquelle il suppose que je me suis mis en cause184 : « De quoi se plaint-il, Léautaud ? Il n’est pas content. » Auriant, étonné, lui dit que je ne me plains de rien, et jamais. Il tient à son idée : « Si, si, il se plaint. Il a tort. Évidemment, tout ce qu’il fait est très bien. Mais il a fait très peu de chose. Qu’est-ce qu’il a derrière lui ? Il a un livre. C’est tout. »
Montfort se trompe bien. Si quelqu’un ne se plaint pas de son sort, c’est bien moi. Je suis le premier à dire sans cesse que je n’ai rien fait, et que, pour le peu que j’ai fait, et ayant toujours vécu dans mon coin, je suis émerveillé du résultat. Décoré ? puisque Montfort attache de l’importance à ces choses, qui contradira que si cela m’avait fait plaisir d’être décoré, je ne l’aurais pas obtenu. J’aurais trouvé vingt parrains pour m’appuyer185. Je ne me plains de rien. J’ai toujours été le premier à dire : on a la vie qu’on s’est faite — et je le dis pour moi comme pour les autres.
Montfort trouve aussi très injuste mon petit morceau sur Rictus186. Il trouve que j’ai eu tort, que je me trompe, que les Soliloques du pauvre « c’est quelque [chose] ». Il a dit que Rictus187 est resté comme un enfant, qu’il est extrêmement sensible aux critiques désagréables, qu’il en aura pour trois mois à être empoisonné par cet article. Il a demandé à Auriant ce qui m’a pris. Auriant lui a dit que j’avais fini par être agacé par les éloges excessifs faits de la poésie de Rictus, les éloges de Léon Daudet, par exemple188. Montfort : « Ça, je le comprends. Il a raison. L’article de Daudet ! En voilà un qui est surfait. Je ne peux pas lire un article de lui. Il n’y a rien. C’est à la portée de n’importe qui. » Auriant est d’avis qu’il n’a pas encore digéré les propos ironiques de Léon Daudet à son endroit, le « Montfaible » qui nous a tant fait rire avec le « cloporte » pour Deffoux189.
Montfort a dit aussi à Auriant pis que pendre de la Sapho de Daudet190, à propos de l’article d’Auriant sur le prototype de Flament. « C’est mauvais comme tout. Les caractères sont faux. Les personnages ne tiennent pas debout. Ça ne vaut rien du tout. On dit pis que pendre de l’époque de 1900. Et l’époque 1884, donc ! S’il y en a une qui ne valait rien comme littérature, c’est bien celle-là. »
Ce vendredi 25 octobre 1933 fournit l’occasion de donner un texte du Journal littéraire absent de l’édition papier :
Auriant me raconte ce soir, d’une conversation avec Montfort, Billy se plaint de ne pas avoir été très bien payé pour son dernier roman paru dans Candide191 : 20 000 francs. Montfort trouve que c’est très bien payé. Il n’a touché, lui, pour une publication analogue, que 12 000 francs. On paie selon les auteurs, c’est évident. Duhamel, par exemple, touche 30 000 francs. Toucher 30 000 francs d’un coup, pour un roman, qu’on publie ensuite en volume. Des gens comme Auriant et comme moi, nous disons : « C’est quelque chose ! »
Le neuf décembre :
Auriant me raconte ce matin qu’il a vu Montfort hier et lui a demandé s’il a lu mon article sur Fagus dans la N.R.F192. « Il est joli, n’est-ce pas ? » Montfort : « Mais pas du tout. C’est au-dessous de tout. Absolument au-dessous de tout. Léautaud a écrit des choses très bien. Mais pas ça, pas ça. »
Montfort trouve aussi que je passe mon temps à regarder mon nombril, que je parle toujours de moi. Ce n’est pas une grande découverte qu’il vient de faire là.
Rien de notable en 1934 et 1935 ?
1936
Eugène Montfort à moins d’un an à vivre, il va mourir le douze décembre, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des ambitions, comme ce onze janvier :
Auriant me raconte que Montfort voudrait bien entrer à l’Académie Goncourt, en remplacement d’Hennique193. Il estime qu’il est tout indiqué et que cela lui serait bien dû. Il a mobilisé à cet effet Jean Ajalbert194, qui est pour son compte tout à fait partisan de sa candidature. Ajalbert déclare toutefois, en dehors de lui, qu’il n’a presque rien lu de ce qu’il a écrit et s’occupe auprès des uns et des autres de se renseigner.
Mais le mercredi 22 janvier…
Vers cinq heures, tantôt visite de Billy, que je trouve dans mon bureau à m’attendre […].
Je lui dis qu’on parle aussi de Montfort, que ce serait très bien, Montfort. Il a un geste évasif. « Il n’a aucune chance. Il ne connaît personne. » Une autre petite lumière que j’acquiers sur la question. Il faut connaître des gens, — sans doute au moins quelques académiciens Goncourt.
Et le samedi 25 :
Auriant me parle ce matin de l’entretien qu’il a eu hier avec Tisserand, au sujet de l’Académie Goncourt pour Montfort. Auriant me dit que Montfort est très triste, très découragé. Je me demande pourquoi ? Auriant et Tisserand pensent que l’Académie Goncourt lui ferait grand plaisir. Ce serait pour lui un beau couronnement de carrière. Ils sont d’avis qu’il faudrait faire quelque chose, comme une petite campagne d’articles, d’échos dans les journaux. Surtout détruire cette opinion répandue, et fausse, que Montfort est riche, ce qui, paraît-il, peut nuire à son élection. Au contraire, un enfant dans les questions d’argent. Il voulait à un moment se mêler de faire construire des maisons. (Il avait donc de l’argent, alors.) Il a fallu qu’on l’arrête dans cette entreprise dangereuse. Toute une vie consacrée aux lettres. Ayant fait pendant longtemps, à lui seul, les frais des Marges. Tisserand va voir Ajalbert, pour lui parler de Montfort, tâcher d’obtenir son appui. Auriant m’a demandé tout de go d’écrire un article sur Montfort quelque part, dans Les Nouvelles littéraires, par exemple, ce qui lui ferait certainement grand plaisir. J’ai répondu carrément à Auriant que je n’ai pas à me mêler de cette affaire et ne veux pas du tout aller offrir un article où que ce soit.
[…]
Auriant a retrouvé dans ses collections de coupures de journaux ce que Montfort a écrit contre l’Académie Goncourt, — depuis sa petite campagne avec Charles-Louis Philippe, à laquelle il voulait m’associer, qui les fit surnommer par Descaves « Les frères Y a moi », jusqu’à réclamer sa suppression. Il convient qu’il n’est pas très digne de sa part aujourd’hui de mobiliser des gens et de tâcher de leur faire faire campagne pour l’y faire entrer.
Auriant me dît aussi, le tenant de Deffoux, qui est au mieux avec Descaves, et son confident pour tout ce qui concerne l’Académie Goncourt, que ce pourrait fort bien être Léopold Lacour qui succède à Hennique.
Non, ce sera Léo Larguier, le 27 mai, ancien ami de jeunesse de Paul.
Le reste de l’année n’offre, comme souvent que des bribes de peu d’intérêt. La suite de cette biographie paraîtra le premier mars 2026 dans la dernière page de la série : « La mort d’Eugène Montfort »
Notes
Le numérotation continue celle de la page précédente.
123 Anne Cayssac.
124 André Billy connait bien ce détail pour avoir assisté, invité par Paul qui, en tant que critique dramatique, avait reçu deux invitations pour assister à une représentation de La Pèlerine écossaise, de Sacha Guitry. Journal littéraire au 18 janvier 1914 : « Ce soir, aux Bouffes-Parisiens, avec Billy, pour La Pèlerine écossaise, de Sacha Guitry. Il fait un tel froid, et j’ai une telle peine à avoir un peu chaud, que j’ai pris le parti depuis deux jours de mettre deux vestons, l’un et l’autre, hélas ! presque aussi usés. Je suis allé ainsi, au risque de me faire regarder, aux Bouffes-Parisiens, comme j’aurais été de même à la Comédie. Pour rien au monde je ne mettrais un habit, avec un pareil froid. Billy regarde un peu toutes les choses sous l’aspect de l’argent. Assis dans nos fauteuils au théâtre, avec une salle de gens élégants, d’aspect cossu, gens à autos, il me dit : « Nous sommes certainement, dans toute cette salle, ce soir, les deux individus qui ont le moins d’argent. » Il entendait cela de la situation, de la position sociale. Je lui ai répondu : « Mon Dieu ! c’est bien possible, certainement. N’empêche que je suis habillé avec deux vestons. Trouvez-moi quelqu’un dans la salle qui puisse en montrer autant. » Le compte rendu de cette comédie a été publié dans le Mercure du premier février 1914. On peut voir, sur le site web de l’INA une représentation de cette pièce dans une mise en scène de Robert Manuel de 1971 au théâtre Marigny.
125 Aurel.
126 Auriant (Alexandre Hadjivassiliou, 1895-1990), a partagé le bureau de Paul Léautaud au Mercure de 1920 à 1940 et s’est trouvé de ce fait son principal confident, et réciproquement. Voir le Dictionnaire des orientalistes de langue française sur le site web de l’EHESS. Lire également les mémoires de Francis Lacassin : Sur les chemins qui marchent, éditions du Rocher 2006 : « Séduit par sa passion érudite et par ses qualités polyglottes, Vallette l’engagea dans la maison d’édition qui accompagnait la revue. C’est ainsi que chaque jour pendant vingt ans, dans le même bureau, il travaillait avec Paul Léautaud en vis-à-vis. Plus misanthrope et plus grincheux que moi, tu meurs… Rapports courtois et distants. Après la Seconde Guerre mondiale, Léautaud réservera à son ancien vis-à-vis quelques piques désobligeantes dans son Journal. Procès à l’appui, Auriant l’obligera à remplacer son nom par des initiales. Ensuite, il se vengea tout seul, sans l’aide de la justice, en lançant le pamphlet cinglant mais tombant un peu à plat : Une vipère lubrique : M. Paul Léautaud. »
127 Laure Persillard était une amie de Blanche Blanc, première maîtresse durable de Paul.
128 Peut-être Jean Longnon (1887-1979) archiviste, paléographe, historien et journaliste. En 1934, Jean Longnon sera bibliothécaire de l’Institut, avant d’en devenir le conservateur.
129 Pierre Varillon (1897-1960), écrivain et journaliste royaliste, ami de Maurras.
130 Frédéric Lefèvre (1889-1949), a publié un premier ouvrage en 1917, au titre ambitieux pour un aussi jeune homme : La jeune poésie française. En 1922, Frédéric Lefèvre, Jacques Guenne et Maurice Martin du Gard lanceront l’hebdomadaire Les Nouvelles littéraires, revue littéraire « au prix et au format d’un journal » qui paraîtra jusqu’en 1983. Frédéric Lefèvre y sera l’immortel auteur de la série de près de quatre-cents entretiens « une heure avec… ». Certains de ces entretiens seront réunis en cinq volumes chez Gallimard puis (sixième volume) chez Flammarion entre 1924 et 1929.
131 Les Nouvelles littéraires du 17 avril 1926.
132 Claude Berton (1865-1937), fils d’une lignée de comédiens, est critique dramatique aux Nouvelles littéraires (en remplacement de Fernand Gregh) et aux Marges, d’Eugène Montfort. Il a aussi écrit quelques pièces de théâtre vers la fin du XIXe siècle.
133 Voir à la fin de la journée du 13 mai 1925.
134 Le père de Claude Berton était Pierre Berton (1842-1912), auteur dramatique et comédien qui débuta au Gymnase en 1859. Le grand-père de Claude était Charles (1820-1874), comédien et auteur dramatique également.
135 On trouve des articles signés Claude Berton dans l’hebdomadaire La Femme de France, pendant presque toute la durée de ce magazine, de janvier 1926 à février 1938. Il ne s’agit pas de critique dramatique à proprement parler mais plutôt du récit commenté d’une pièce.
136 Aucun Journal de Claude Berton n’est référencé à la BNF, en tout cas sous le titre Journal.
137 Le Voyage au Congo est paru dans les numéros de novembre 1926 à avril 1927 et le Journal des Faux-monnayeurs dans les numéros d’août et septembre.
138 Il s’agit donc d’un tout petit roman, 100 à 150 pages selon le format, vraisemblablement Petite bouillabaisse, qui paraîtra, daté de 1926 au Divan, 118 pages.
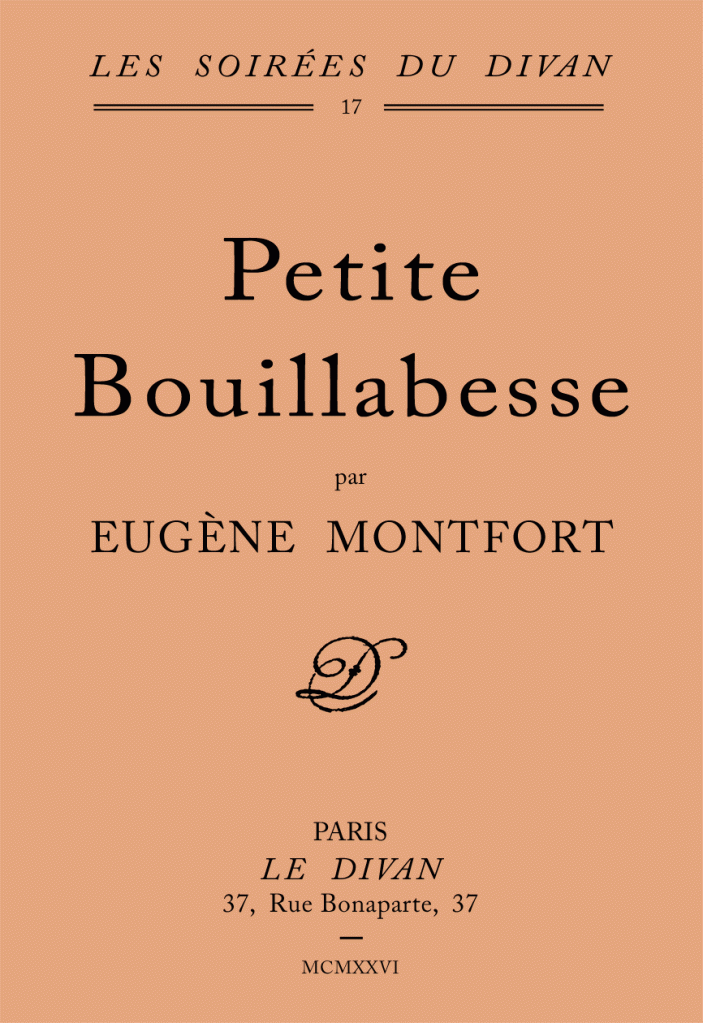
139 Florent Fels (Florent Felsenberg, 1891-1977), critique d’art avant-gardiste, fondateur puis codirecteur de la revue Action (cahiers individualistes de philosophie et d’art). Florent Fels sera directeur artistique de Radio Monte-Carlo en 1945.
140 Jacques Guenne et Maurice Martin du Gard (dans cet ordre) sont tous deux directeurs-fondateurs du bimensuel (1er et 15) L’Art vivant. Rédacteur en chef, Florent Fels. L’Art vivant « La première revue d’art à grand tirage et à bon marché pour le grand public » est le complément artistique des Nouvelles littéraires. Il a paru de 1925 à juillet 1939.
141 « Maurice Boissard et son théâtre », par Auriant, dans Les Nouvelles littéraires du vingt novembre 1926. Cet article paraît le jour de la mise en vente du Théâtre de Maurice Boissard à La NRF.

142 Chronique parue dans le Mercure du seize octobre 1911. Quinze ans — et surtout une guerre — ont passé depuis.
143 Robert de La Motte Ango de Flers, marquis de La Motte-Lézeau, comte de Flers (1872-1927), dreyfusard dans sa jeunesse, auteur dramatique à succès, Robert de Flers est connu pour nombre de pièces à succès, dont L’Habit vert (1913), critique mordante de l’Académie française où il a néanmoins été élu en 1920. L’année suivante, Robert de Flers devint directeur littéraire du Figaro.
144 « Un salon littéraire », dans Les Nouvelles littéraires du 28 avril 1923.
145 Amy Lyons (1765-1815) devient Lady Hamilton par son mariage en 1791 avec le diplomate William Hamilton (1730–1803). Plusieurs romans et films se sont inspirés de sa vie. Albert Flament, La Vie amoureuse de Lady Hamilton, ambassadrice d’Angleterre, Flammarion 1927, 194 pages. « On n’a pas idée d’une pareille ordure » (Paul Léautaud le 26 février).
146 Albert Flament (1877-1956), romancier. Journaliste sous le pseudonyme de Sparklet dans L’écho de Paris. Albert Flament collabore aussi au magazine Fémina.
147 Le 26 mars 1927, page deux, reprenant un entretien de Jacques Copeau avec Frédéric Lefèvre (une heure avec…) paru en une des Nouvelles littéraires du 19 février. Le lendemain 27 mars, page deux « La Vie de lettres » et le jour suivant dans la même rubrique. Retenons un fragment du texte de Jacques Copeau ; « Le premier numéro fut composé par lui [Eugène Montfort] et nous le lûmes avec une véritable consternation : de la première page à la dernière, il affichait des tendances violemment opposées à celles qui étaient les nôtres : ce fût la rupture… Peut-être ne manquera-t-il pas d’intérêt quelque jour de fixer dans le détail ce petit point d’histoire littéraire. C’est moi qui fus chargé par notre groupe, des négociations… de rupture avec Montfort et je possède un dossier assez abondant et peut-être édifiant… » Ça sent le chantage. Ni le Journal de Jacques Copeau (Seghers 1991) ni celui d’André Gide (Pléiade) ne font mention de l’événement).
148 Louis Codet (1876-1914, mort au combat à 38 ans). Soutenu par Eugène Montfort, éphémère directeur, Louis Codet figurait dans la liste des collaborateurs dans le premier numéro de La NRF. Le 15 juin 1924, Les Marges ont publié un numéro spécial Louis Codet. L’ouvrage cité par Paul est vraisemblablement Lettres à deux amis, parues en février-mars 1927. Les deux amis en question sont Eugène Montfort et Louis Bausil (1876-1945), peintre originaire du Sud-Ouest, comme Louis Codet.
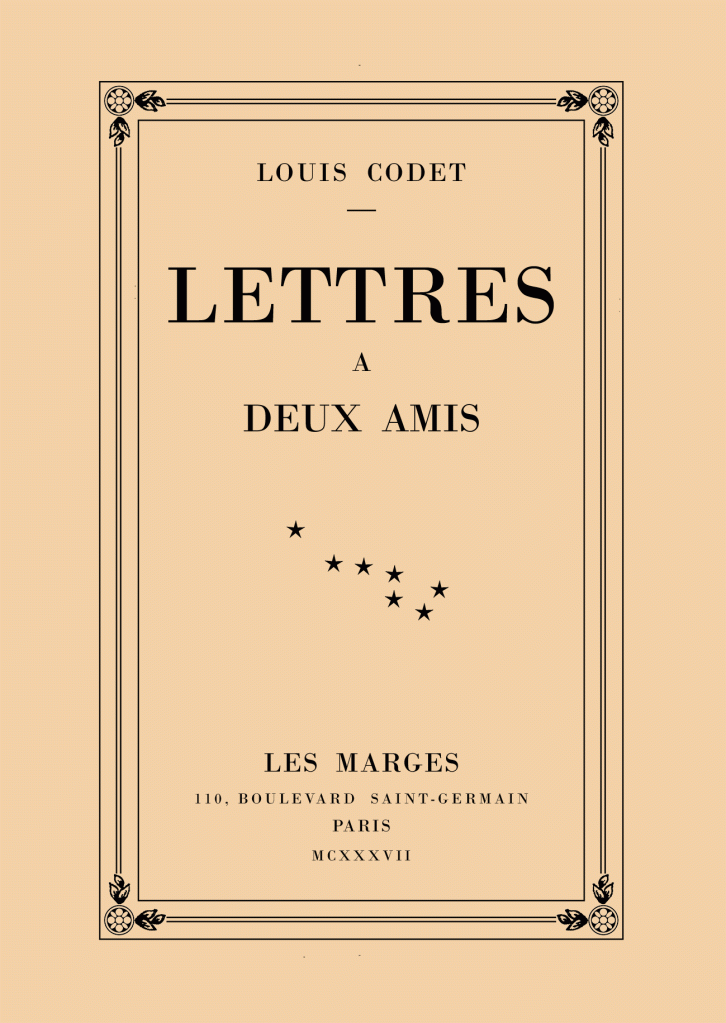
149 À partir de ce mot, deux phrases restaurées du tapuscrit de Grenoble, remplaçant deux lignes de points dans l’édition papier jusqu’à « qui ornaient son jardin ».
150 (Tome I, pages 263-266) : « … Son imagination, dérivée sur les intrigues de la police, obsédée par l’adultère, l’inceste et la luxure, est monotone, tandis que son observation est toujours prête. Il possède, au point le plus aigu, le sens du ridicule. M. Jules Bertaut a bien marqué quel avait été pour Léon Daudet, l’héritage de son père, l’usage qu’il avait fait de cet héritage : “Cette tendance subtile qui poussait Alphonse Daudet à observer très exactement et de très près les petites manies de chaque individu, avec un sens très fin des ridicules, est devenue chez le fils une véritable manie à quérir les traits comiques de l’humanité ; les traits menus que le père rendait si justement, apparaissent, derrière les verres grossissants du fils, comme d’énormes tares qui défigurent l’humanité entière, des vices prodigieux, des défauts inouïs qui deviennent le Défaut, le Vice, la Tare” » Jules Bertaut, Chroniqueurs et polémistes, collection « Figures contemporaines », Sansot 1906. L’aspect « gros mangeur » relevé par Paul Léautaud n’apparaît pas dans Vingt-cinq ans de littérature mais seulement dans Les Marges d’Avril. On peut comparer le texte de L’Action française où sourd la haine et la grossièreté avec ceux d’Eugène Montfort et de Jules Berthaud.
151 Ernest Tisserand, né en 1880, homme de lettres et romancier, critique d’art et syndic de la presse artistique. Voir aussi le Journal littéraire au 30 mars 1936.
152 Édouard Herriot (1872-1957), sénateur de 1912 à 1919 puis député radical-socialiste (dix mandats) du Rhône de 1918 à 1957, président de l’Assemblée nationale à trois reprises, six fois ministre et/ou président du Conseil. Maire de Lyon de 1905 à sa mort.
153 Paul entreprend ces jours-ci des démarches auprès de Louis Barthou afin de faire obtenir cette même rosette à Alfred Vallette.
154 Eugène Montfort, César Casteldor, Calmann-Lévy 1927, 207 pages. Ce roman est paru en prépublication dans le Mercure, numéros du quinze avril au quinze mai 1927.
155 Cette seconde tentative (il n’y en aura pas de troisième) sera Cécile ou l’amour à dix-huit ans, roman le plus connu d’Eugène Montfort, qui paraîtra chez Flammarion en 1929 (209 pages) après être paru en feuilleton dans le Mercure du quinze septembre au quinze octobre 1928.
156 Autre roman d’Eugène Montfort paru dans quatre numéros du Mercure en juin et juillet 1918 puis en 1925 à la Cité des livres (Sant’Andrea). Une édition de luxe, illustrée de 85 eaux-fortes de Raoul Dufy paraîtra chez Ambroise Vollard en 1930.
157 Ces réunions se tenaient en principe le premier jeudi de chaque mois, pas toujours au même endroit.
158 Sébastien Voirol (Gustaf Henrik Lundqvist, 1870-1930), homme de lettres, journaliste et traducteur, Sébatien Voirol s’est installé à Paris en 1889. Auteur d’une dizaine d’ouvrages d’inspiration orientalo-ésotérique, traducteur de romans américains, allemands, danois et norvégiens. Franc-maçon dès 1901, il est intégré à un milieu littéraire et artistique à la fois cosmopolite, mondain et d’avant-garde. Sébastien Voirol a épousé Claudine, sœur des frères Perret en 1901. Nous aurons à reparler d’Auguste Perret à propos de Marie Dormoy. Voir aussi André Billy, Le Pont des Saints-Pères à partir de la page 125. Un portrait de Sébastien Voirol a été dressé par Maurice Boissard dans sa chronique du Mercure du 16 août 1919.
159 Fernand Fleuret (1883-1945). Dans ses Souvenirs sur Apollinaire (Grasset 1945), Louise Faure-Favier dresse un singulier portrait de Fernand Fleuret : « Très satisfait de ressembler à un archer de la tapisserie de Bayeux. » Voir aussi le Journal littéraire au quatre juin 1936.
160 Il ne s’agit pas, comme on pourrait le croire de John Charpentier, abondant chroniqueur des « Romans » du Mercure depuis 1924 (à la suite de Rachilde) mais du poète Henry Charpentier (1889-1952), aussi critique littéraire. Henry Charpentier est exécuteur testamentaire à la suite du docteur Bonniot, pour tout ce qui concerne l’œuvre de Stéphane Mallarmé.
161 La veille, 21 février.
162 Il s’agit, repris dans Passe-Temps, des « Notes et souvenirs sur Remy de Gourmont » paru dans Les Nouvelles littéraires du dix mai 1924.
163 Alors qu’il s’agissait de chercher un rédacteur pour un article sur la mort de Charles-Louis Philippe, Eugène Montfort a été écarté. Voir supra au 22 décembre 1909. Paul Léautaud a reproduit ce passage du Journal dans Passe-Temps (bas de la page 43 de l’édition de 1987).
164 L’Intransigeant daté de la veille sept mars (L’Intran est un journal du soir), page deux, colonne quatre : « Les lettres » : « Passe-Temps, par M. Paul Léautaud (Mercure de France, ed.). — Un recueil de chroniques, de portraits, “mots, propos et anecdotes”. Pages rageuses parfois, toujours acidulées, mais l’ironie n’y est peut-être qu’un masque. / M. Paul Léautaud, qui affiche une franchise crue, d’ailleurs un peu bavarde, souffre de voir les hommes ce qu’ils sont. M. Léautaud se garde d’exprimer sa pitié parce qu’il la croit inefficace ; au moment même que son émotion est au comble, elle vire, tourne à l’aigre, se moque. D’où tant de pages d’un cynisme un peu affecté, d’une misanthropie un peu forcée, pleines de talent sans doute, mais monocordes où le paradoxe et le pessimisme deviennent du procédé. / Aussi ces “passe-temps” risquent très vite de lasser… — INTRODUIRE ici dans le texte, l’image « Signature Intran 07-03-1929 wb.gif »)… ou laisser tomber.
165 209 pages (note 155), Eugène Montfort n’a jamais su faire long.
166 « Certains, le mac-farlane ouvert sur un habit de soirée, la main gantée de blanc posée doucement sur l’épaule d’un jeune garçon, écoutaient la musique avec une grâce d’homme du monde, On chantait, articulant d’une voix suave des paroles obscènes sur des airs de cantiques, la main cachant la bouche. L’impiété s’étalait, effrontée, et le bonheur du sacrilège. De très vieux, d’antiques pédérastes voûtés, portant perruques, s’appuyaient lourdement sur leur canne. Des hommes, habillés en femmes, décolletés, un chapeau à plume sur leurs faux cheveux qui bouffaient, s’éventaient. » (Mercure du premier octobre 1928, page 156). Un macfarlane est un manteau ample, sans manches, à ouvertures latérales pour les bras, muni d’une cape descendant jusqu’à la ceinture (TLFi).
167 Peut-être à Senneville, près de Mantes-La-Jolie (la commune semble ne plus exister).
168 Eugène Montfort était le parrain de Jean Saltas pour la Légion d’honneur.
169 En novembre 1929.
170 164 boulevard du Montparnasse, pas très loin de l’avenue de l’Observatoire. L’immeuble n’existe plus.
171 Le poète Henry charpentier s’occupe aussi de gestion de biens immobiliers.
172 Cette brasserie existe toujours au un, place du Châtelet, jouxtant le théâtre. Voici ce que dit le site Internet de l’établissement : « Juste après la guerre de 1870, des familles alsaciennes voulant rester françaises s’installent à Paris et créent de grandes brasseries selon leur tradition : les Zimmer, Wepler, Dreher, Bofinger et autres en témoignent encore aujourd’hui. Lors de sa création en 1896, le Zimmer de la place du Châtelet est le plus éclatant des trois établissements appartenant à la famille. L’histoire du Zimmer est étroitement liée à celle du Théâtre du Châtelet : des portes permettaient autrefois aux spectateurs d’accéder directement à la salle du rez-de-chaussée et au salon du 1er étage… »
173 Eugène Montfort publie souvent dans Candide, depuis la première année (1924). Le premier épisode de L’Évasion manquée paraîtra dans le numéro du 18 juin. Il s’agit d’une histoire de mari fugueur. Ce roman sera édité en volume chez Émile Paul en 1933. Henri de Régnier en donnera un compte rendu dans Le Figaro du 29 août 1933.
174 Augustin Cabanès (1862-1928), médecin, journaliste et historien de la médecine. Médecin de la préfecture de la Seine, secrétaire de la Société médico-historique, Augustin Cabanès fut une référence de l’histoire de la médecine. On lui doit, en 1924 : Au chevet de l’Empereur et Dans l’intimité de l’Empereur.
175 Mercure du premier mai 1931 : « Un ami de Maupassant : Harry Allis ». Harry Allis (1870-1938), peintre américain ayant vécu à Montreuil-sur-mer entre 1906 et 1912.
176 Eugène Montfort, César Casteldor, Calmann-Lévy 1927, 207 pages.
177 Comme souvent les petites entreprises, les maisons d’éditions de ce temps-là étaient des affaires de famille. Eugène Fasquelle (1863-1952), a été embauché à 23 ans secrétaire du libraire et éditeur Georges Charpentier (1846-1905), l’éditeur des naturalistes (Zola, Flaubert, Maupassant…). Trois ans plus tôt étaient entrés dans la maison Charles Marpon, Ernest Flammarion et leur capital. En octobre 1887, un an après son entrée dans la maison, Eugène Fasquelle épouse Jeanne Marpon (1868-1960), fille de Charles. Ils auront deux filles et un fils, Charles (1897-1965). Charles Marpon meurt en 1890. Ernest Flammarion cède ses parts à Eugène Fasquelle, qui devient majoritaire dans la maison Charpentier, ce qui entraînera son déclin. Charles Fasquelle (1897-1965) reprendra la maison en 1951 puis son fils Jean-Claude, trois ans plus tard.
178 Dans l’antiquité romaine, l’usage, nous le savons, était de sacrifier un animal afin de remercier les Dieux pour une guérison. Socrate était, sinon athée, disons peu fervent. Condamné à mort (pour ça ou pour autre chose) il but la cigüe et prononça ces derniers mots à l’ironie mordante : « Nous devons un coq à Asclépios [Esculape] »
179 Ce Choix de proses est paru aux Marges à la fin de 1932. La lettre de Paul est curieuse dans la mesure où nous savons qu’un exemplaire dédicacé lui a été envoyé par Eugène Montfort avec son « Très cordial hommage. » Il ne semble pas que ce Choix de proses ait été chroniqué par John Charpentier, qui a rendu compte de L’Évasion manquée dans le Mercure du quinze juin.
180 René Dumesnil (1879-1967), médecin, critique littéraire et musicographe. René Dumesnil, spécialiste de Flaubert a épousé en 1907 Louise Laporte, fille du principal ami de Flaubert et a donc eu accès à sa correspondance. René Dumesnil a écrit 368 articles dans le Mercure de France, essentiellement sur la musique. Voir un court portrait au 19 janvier 1937. Lire, en ouverture du Mercure du 15 octobre 1937 : René Dumesnil « L’Âme du médecin — Souvenir de ma vie médicale ». Le Maupassant de René Dumesnil est paru cette année 1933 dans la collection Âmes et visages, chez Armand Colin, 254 pages.
181 Le « petit Pouvillon » est Pierre Pouvillon (1874-1944), qui a donc presque l’âge de Paul Léautaud. Il est le deuxième fils d’Émile Pouvillon (1840-1906). Une (petite) avenue Émile Pouvillon se trouve près de la Tour-Eiffel.
182 Georges Pillement (1898-1984) est auteur de livres d’art et de tourisme. Il est aussi auteur dramatique et romancier. Au début de la guerre de 1939 il entreprendra des publications destinées à la sauvegarde du patrimoine bâti. Pour Fernand Fleuret, note 159.
183 « Gazette d’hier et d’aujourd’hui » — Mots, propos et anecdotes, pages 231-236.
184 Dans le personnage de B. : « B… n’a écrit que pour son plaisir, quand un sujet le tentait. Rien qui pût être bien productif. Il est peu connu. Il ne va nulle part. Il vit modestement et n’est pas décoré. »
185 Indépendamment de ce « contradira », cette phrase bancale dans l’édition papier a été corrigée ici.
186 Dans la « Gazette » du quinze août 1933, page 242 : « Les exagérations dans les mérites littéraires sont à la mode à notre époque. On voit cela pour les morts. On le voit aussi pour les vivants. Les réclames pour les seconds valent les discours sur les premiers. M. Jehan Rictus est Villon, Porto-Riche s’apparentait à Racine, Robert de Flers était le petit-fils de Montaigne, Anatole France était un nouveau Voltaire, M. Pierre de Nolhac ressuscite Ronsard, etc., etc., ce qui, on n’y réfléchit pas assez, est réduire, chacun de ces écrivains à bien peu de chose pour répéter si bien un autre. Renversez aussi la proposition : si Villon n’avait été que M. Jehan Rictus, Racine que Porto-Riche, Montaigne que Robert de Flers, Voltaire qu’Anatole France, Ronsard que M. Pierre de Nolhac ?… On n’ose y penser. »
187 Jehan Rictus (Gabriel Randon de Saint-Amand, 1867-1933), poète populaire. Ses œuvres ont été réunies dans deux volumes : Les Soliloques du pauvre et Le Cœur populaire. Un square à Paris porte son nom. Les Soliloques du pauvre, après avoir été édités par l’auteur, ont été publiés par le Mercure en 1897. Le premier août 1933, en une du Petit Parisien, sous la signature de Maurice Bourdet on peut lire : « Le 12 décembre 1896 au cabaret des Quat’s-Arts […] entre Yon Lug et Dominus, un jeune homme de 28 ans au maigre visage […] venait réciter […] Les Soliloques du pauvre. […] L’effet fut énorme. La salle — où se trouvaient Albert Samain, Rachilde, Henri Barbusse, Alfred Vallette — acclama le poète… » Voir aussi la conversation de Paul Léautaud et René-Louis Doyon le 25 juin 1942.
188 Dans L’Action française du 22 mars 1933 : « Un grand poète : Jehan Rictus » : « Ce grand poète — et dont le magnifique esprit de force et de pitié descend directement de Villon — viendra ce soir réciter quelques-uns de ses poèmes à la fête des Camelots du Roi. »
189 Voir ici au début de l’année 1928.
190 Il s’agit ici d’Alphonse Daudet (1840-1897). Sapho, mœurs parisiennes, écrit en 1884 et paru chez Charpentier avant d’être repris par Flammarion. Il s’agit du récit romancé de la liaison d’Alphonse Daudet et de la comédienne Marie Rieu.
191 Le roman d’André Billy, Princesse folle, est paru dans l’hebdomadaire Candide du 17 août au douze octobre avant de paraître en volume chez Flammarion (284 pages).
192 La NRF de décembre 1933, page 912.
193 Léon Hennique (note 33) est mort le 25 décembre dernier. Il était l’un des cinq derniers de la première génération. Il va être remplacé par Léo Larguier.
194 Jean Ajalbert (1863-1947), critique d’art, avocat et écrivain naturaliste. Anarchiste et dreyfusard engagé, Jean Ajalbert fut aussi un soutien des peuples autochtones sous la férule coloniale. La fin de la vie de Jean Ajalbert sera hélas moins glorieuse puisqu’il sera incarcéré à Fresnes au printemps 1945 pour faits de collaboration. On pourra lire une opinion de Paul Léautaud sur Jean Ajalbert au 28 décembre 1923.