Page publiée le premier mars 2025. Temps de lecture : 37 minutes.
Le Joujou patriotisme
Mercure de France : « Malveillance »
La Revue indépendante : « Une révocation »
Le Figaro : « Les beautés du patriotisme »
L’Écho de Paris : « Un mot d’explication »
Décembre 1914 : Le reniement — Alsace-Lorraine
Annexe : « Tricot d’honneur » — Notes
Dans cette page vont être vues les conditions de rédaction de ce texte de 1891 par Remy de Gourmont, les réactions qui ont suivi puis, à l’occasion de la guerre de 1914, le reniement de ce texte par son auteur, reniement que Paul Léautaud a dénoncé. Indiquons par ailleurs qu’aucune page web sur Remy de Gourmont ne peut être publiée sans une référence amicale au très riche site « Les Amateurs de Remy de Gourmont ». Nous en saluons les auteurs.
Remy de Gourmont (1858-1915) a été parmi les dix premiers fondateurs du Mercure de France (Gabriel-Albert Aurier, Jean Court, Louis Denise, Édouard Dubus, Louis Dumur, Ernest Raynaud, Jules Renard, Albert Samain et Alfred Vallette). Il a été introduit par Louis Denise1, son collègue de la BNF et a écrit dès le deuxième numéro, de février 1890.
En ouverture du Mercure de France d’avril 1891, c’était le numéro seize, est paru cet important texte de Remy de Gourmont : « Le Joujou patriotisme » (pages 193-198).
Ce Joujou patriotisme est le onzième texte de Remy de Gourmont dans le Mercure. Six pages qui vont changer sa vie. Certains passages du début peuvent encore choquer de nos jours (ils nous choquent). Alors à l’époque… !
Il faut lire ce texte si l’on veut comprendre cette page web. Le voici :
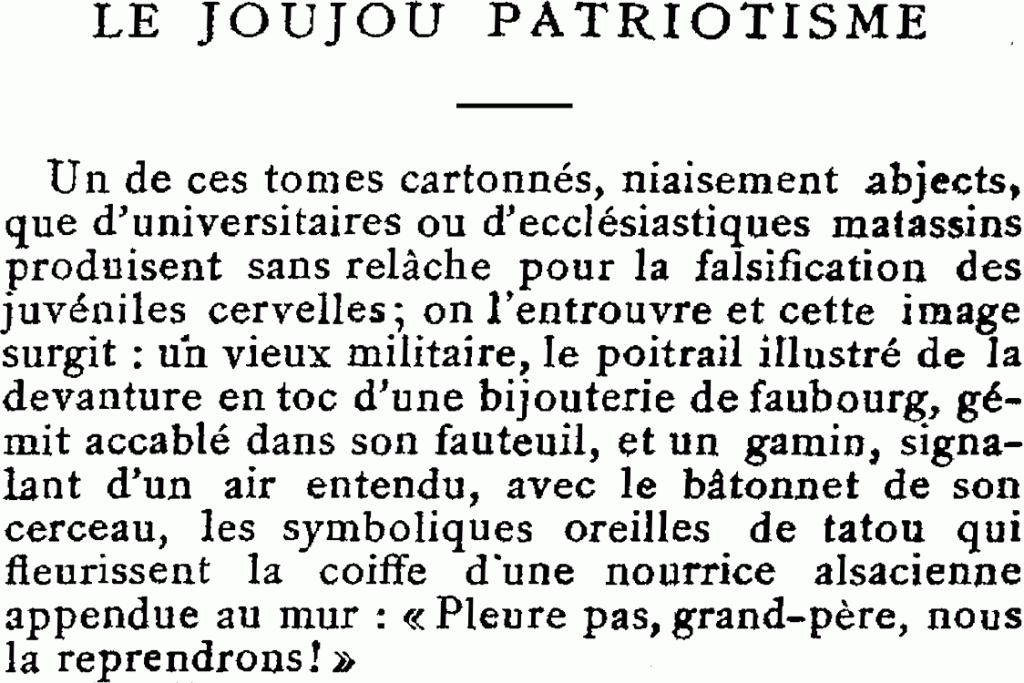
Le Joujou patriotisme (avril)
Un de ces tomes cartonnés, niaisement abjects, que d’universitaires ou d’ecclésiastiques matassins2 produisent sans relâche pour la falsification des juvéniles cervelles ; on l’entrouvre et cette image surgit : un vieux militaire, le poitrail illustré de la devanture en toc d’une bijouterie de faubourg, gémit accablé dans son fauteuil, et un gamin, signalant d’un air entendu, avec le bâtonnet de son cerceau, les symboliques oreilles de tatou qui fleurissent la coiffe d’une nourrice alsacienne appendue au mur : « Pleure pas, grand-père, nous la reprendrons ! »
Immédiatement, on pense à cet enfant monté en graine, plus hautement pédonculé que ces choux de Jersey dont on fait des cannes, — à M. Paul Déroulède3. Lui aussi fait rouler, mais avec fracas et en tapant dessus avec un vieux sabre ébréché, le cerceau avarié du patriotisme, et se penchant vers la France, qui n’est pas sourde, lui hurle dans le tympan : « Pleure pas, grand’mère, on te la rendra, ta symbolique nounou ! »
Moins gnan-gnan que le vétuste et lacrymatoire retraité, la matrone impatientée finit par répondre : « J’aimerais assez qu’on me confiât d’autres secrets. »
Nous aussi : le désir de renouer à la chaîne départementale les deux anneaux rouillés qu’un heurt un peu violent en a détachés ne nous hante pas jour et nuit. Nous avons d’autres pensées plus urgentes ; nous avons autre chose à faire. Personnellement, je ne donnerais pas, en échange de ces terres oubliées, ni le petit doigt de ma main droite : il me sert à soutenir ma main, quand j’écris ; ni le petit doigt de ma main gauche : il me sert à secouer la cendre de ma cigarette.
Inutile, à ce propos, de me traiter de mauvais Français ou même de Prussien ; cela ne me toucherait pas : Kant était Prussien et Heine aussi ; puis je vous demanderais, par curiosité pure, ce que vous donneriez de vos précieuses peaux pour joindre à la France la Wallonie belge ou la vallée de Lausanne, — pays, ce me semble, un peu plus français de langue et de race que les bords du Rhin ? Personne n’aboie contre les Anglais, qui détiennent les îles normandes, et le lointain, mais clairement français, Canada, province d’outre-mer, mais aussi nettement province de France que les Charentes ou la Picardie.
Au fait, ces coins de terre d’au-delà les Vosges, sont-ils donc devenus si malheureux ? Les aurait-on, par hasard, fait changer de langue, de mœurs, de plaisirs ? Ont-ils subi un service militaire plus long ou plus dur, une administration plus pointilleuse, des fonctionnaires plus rogues, des maîtres d’écoles plus pédants et plus fats, des embêtements de conscience plus notoires, des impôts plus lourds, un gouvernement moins digne, moins sympathique, moins probe ?
Il me paraît qu’elle a duré assez longtemps la plaisanterie des deux petites sœurs esclaves, agenouillées dans leurs crêpes au pied d’un poteau de frontière, pleurant comme des génisses, au lieu d’aller traire leurs vaches. Soyez sûr qu’avant comme après, elles mangent leurs rôtis à la gelée de groseilles, grignotent leurs bretzels salés et lampent leurs amples moss4. N’en doutez point, elles font l’amour et elles font des enfants. Cette nouvelle captivité de Babylone me laisse froid.
La question, du reste, est simple : l’Allemagne a enlevé deux provinces à la France, qui elle-même les avait antérieurement chipées : vous voulez les reprendre ? Bien. En ce cas, partons pour la frontière. Vous ne bougez pas ? Alors foutez-nous la paix.
Jadis, en de permanentes guerres, avec de vraies armées, c’est-à-dire composées de soldats de métier et de carrière, on se trouvait vainqueur sans vanité, vaincu sans rancune. La défaite n’avait pas cette conséquence : une nation pleurnichant et hihihant pendant vingt ans, telle qu’une éternelle fillette ; oui, comme une fillette qui a laissé tomber sur le bon côté sa tartine de confitures.
Jadis, le lendemain de la paix signée, les sujets des deux pays trafiquaient ensemble sans amertume, franchissaient indifférents les frontières modifiées, et les officiers des deux armées, la veille aux prises, buvaient à la même table, en gens d’esprit. Je verrais sans nul effarouchement des officiers français trinquer avec des officiers allemands : font-ils pas le même métier, et pourquoi, noble ici, ce métier deviendrait-il, là, infâme ?
Ce désintéressement supérieur, la France l’éprouva, tant qu’elle fut une nation spirituelle et de haute allure. Les Français d’alors disaient, ayant perdu, délicats et sourieurs : « Messieurs, nous vous revaudrons ça » — puis parlaient d’autre chose. Serions-nous devenus, à cette heure, des brutes rancunières, douées de cervelles éléphantines ?
Dépurons-nous de ces humeurs ; prenons quelques pilules de dédain qui fassent issir5 par les voies naturelles ce virus nouveau, dénommé : Patriotisme.
Nouveau, oui, sous la forme épaisse qu’il assume depuis vingt ans, car son vrai nom est vanité : nous sommes la civilisation, les Allemands sont la barbarie…
Oh !
On ne peut, il est vrai, nous dénier une littérature et un art supérieurs à la littérature et à l’art allemands ; mais cet art même et cette littérature, demeurés tout cénaculaires, sont inconnus à nos derviches hurleurs, et de ceux d’entre eux qui les soupçonnent, méprisés : ce qu’on en montre dans les journaux et dans les expositions devrait, au contraire, nous engager vers une certaine modestie. Quelle fierté les patriotes ont-ils jamais tirée des œuvres de, par exemple, Villiers de l’Isle-Adam ? Soupçonnaient-ils son existence, alors que le roi de Bavière l’accueillait et l’aimait ? Ont-ils subventionné Laforgue, qui ne trouva qu’à Berlin la nourriture nécessaire à la fabrication de ses chefs-d’œuvre d’ironie tendre ? Et pour ne citer qu’un seul nom d’artiste, est-ce par les patriotes que sont achetées les lithographies de Redon6, dont les admirateurs sont presque tous scandinaves et germains ? Il y a un patriotisme à la portée de tous ceux qui possèdent trois francs cinquante, c’est d’acheter les livres des hommes de talent et de ne pas les laisser mourir de misère.
Laissons donc l’art et la littérature, puisque les productions par lesquelles on nous clame supérieurs sont au contraire de celles qui nous humilieront à jamais dans l’histoire de l’esprit humain, — et parlons du reste.
L’érudition, mais elle est allemande. Les Allemands ont inauguré, et détiennent encore, la philologie romane, et s’il faut chercher des professeurs connaissant mieux l’ancien français que les maîtres de l’École des Chartes, c’est en Allemagne. Qui nous a fait connaître notre littérature dramatique d’avant Corneille ? Des Allemands, et les bonnes éditions de ces poètes sont allemandes.
Qui a connu mieux que nul l’histoire de la Révolution française ? Des Allemands, les Sybel7 et les Schmidt8.
Qui a débrouillé l’histoire grecque et l’histoire romaine, sinon les Mommsen9 et les Curtius10 ?
Je ne dis rien de la philosophie, rien de la musique : domaines allemands, — et je me borne à ces indications pour ne point répéter un ancien article de M. Barrès, dont le spirituel antipatriotisme jadis m’avait charmé.
Le vrai, c’est que l’intellect germain et l’intellect français se complètent l’un par l’autre, sont créés, dirait-on, pour se pénétrer, se féconder mutuellement : du cerveau de l’Europe, l’un des peuples est le lobe droit l’autre est le lobe gauche, et rien, en ce cerveau, ne peut fonctionner normalement si l’entente n’est parfaite entre les deux inséparables hémisphères.
Peuples frères, il n’y en a guère qui le soient plus clairement ni mieux faits pour une entière et profonde sympathie, malgré des différences évidentes dans les modalités de la pensée. Ils sont calmes et nous sommes de salpêtre ; ils sont patients et nous sommes nerveux ; ils sont lents et un peu lourds, nous sommes vifs et allègres ; ils sont muets et nous sommes braillards ; ils sont pacifiques et nous avons l’air belliqueux : dernier point où l’entente est extraordinairement facile, car il semble certain qu’ils en ont, de même que nous, assez et, de même que nous, ne souhaitent rien, si ce n’est qu’on les laisse travailler en paix.
Non, nous n’avons nulle haine contre ce peuple ; nous sommes trop bien élevés pour afficher une enfantine rancune, trop au-dessus de la sottise populaire pour même la ressentir : quant à moi, entre les assourdissants jappeurs ligués contre notre quiétude et les placides Allemands, je n’hésite pas, je préfère les Allemands.
Les défiances s’assoupissaient, lorsque M. de Cassagnac11 s’est mis à trouver mauvais que l’impératrice12, cette charmante femme, ait voulu voir Saint-Cloud et Versailles : ce sont cependant d’agréables promenades, et les choisir, une preuve de bon goût, car cette étrangère, n’aurait-elle pas aussi bien pu manifester le désir d’assister aux courses d’Auteuil ?
Dire qu’il ne s’est pas trouvé en cette ville, qui se targue d’esprit et de bravoure, un peintre assez indépendant de l’opinion populaire, assez courageux contre la sottise journalistique pour oser obéir à cet instinct naturel qui domine aujourd’hui ce qu’on dénomme l’école française : l’intérêt de la vente ! Le Patriotisme a été le plus fort, étant la sottise suprême — pourquoi s’étonner ?
Ah ! si Henri Regnault n’avait pas été tué à Buzenval13, si ce peintre patrouillait encore ses noirs savoyards, ses roses souillés, ses blancs de panaris, s’il se livrait encore, en de luxueux ateliers, à ce que Huysmans appelle « son vagabondage du dessin et son cabotinage édenté des couleurs » ! Mais les Prussiens l’ont occis. Cela ne fait jamais qu’un artiste médiocre de moins, — et il y en a tant !
Puis, à chacun son métier : le sien était de faire de la peinture, même mauvaise, — comme le métier de Verlaine est à de divines poésies. Le jour, pourtant, viendra peut-être où l’on nous enverra à la frontière : nous irons, sans enthousiasme ; ce sera notre tour de nous faire tuer : nous nous ferons tuer avec un réel déplaisir. « Mourir pour la Patrie » : nous chantons d’autres romances, nous cultivons un autre genre de poésie.
Leur supprimer, à ces « s… b… de marchands de nuages14 », — il s’agit de nous, selon Baudelaire, — leur couper toute religion, tout idéal et croire qu’ils vont se jeter affamés sur le patriotisme ! Non, c’est trop bête et ils sont trop intelligents.
S’il faut d’un mot dire nettement les choses, eh bien : — Nous ne sommes pas patriotes.
Remy de Gourmont
Que dire de ce texte, rapidement ? D’abord que l’auteur semble avoir vingt ans, dix-huit peut-être, alors que, quatre jours après la parution de ce numéro du Mercure d’avril 1891 il va en avoir trente-trois. Peut-être est-il très en colère suite à une lecture ou aux réactions à la visite de la veuve de Frédéric II à Versailles (note 12). Toujours est-il que ce n’est pas le texte d’un homme mûr, ni serein. C’est aussi en 1891 que se précisent les premières atteintes de son visage par un lupus tuberculeux dont les soins vont le défigurer.
Il « se lâche » inconsidérément, peut-être parce qu’il pense, à juste titre, écrire dans une encore petite revue sans importance. Selon Jean-Auguste Poulon15, en juin 1890, après six mois d’existence, le Mercure ne compte que cinquante abonnés. Certainement moins de cent en avril suivant. Comment ce texte publié dans une revue encore confidentielle a-t-il eu ce retentissement ?
Ce texte, comme ce numéro du jeune Mercure, aurait pu passer inaperçu sans un article d’un certain Nestor qui avait ses habitudes dans les deux premières colonnes de une de L’Écho de Paris auprès de Catulle Mendès ou d’Octave Mirbeau. À cette époque, L’Écho de Paris était un des plus importants quotidiens de la presse française, Le Joujou patriotisme y était dénoncé sous le titre « Le Dilettantisme » en premier Paris du numéro du 26 mars, quatre jours avant sa parution dans le Mercure d’avril.
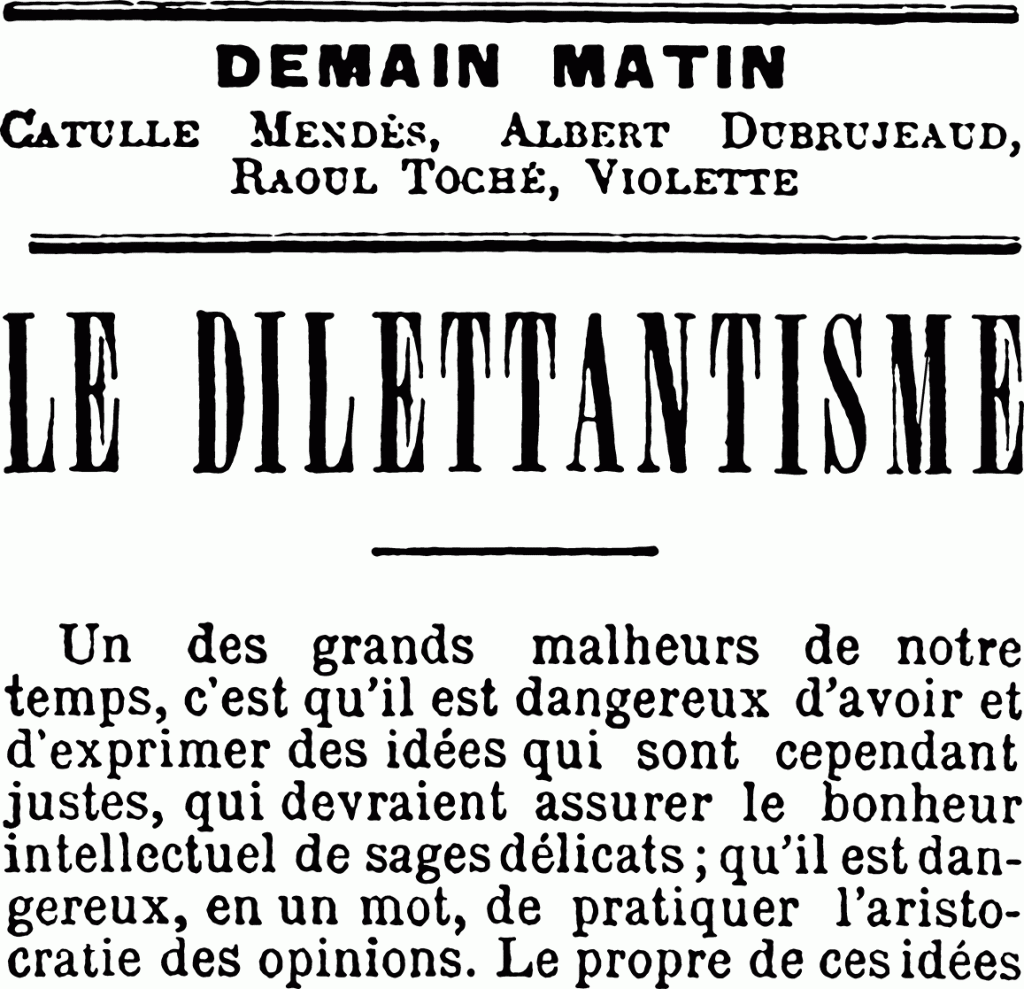
Nestor est Henry Fouquier (1838-1901), journaliste et auteur dramatique, et alors député des Basses-Alpes (de 1889 à 1893).
Il semble bien que ce soit cette première publication de Nestor (il y en aura une autre) qui a entraîné la révocation, le 18 avril, de Remy de Gourmont de son poste d’attaché à la Bibliothèque nationale.
Cette révocation va entraîner plusieurs réactions. La première retenue ici est évidemment celle d’Alfred Vallette dans le Mercure suivant (mai 1891), pages 261-268. Reproduire ici huit pages du Mercure serait peut-être beaucoup pour la patience du lecteur de 2025 d’autant qu’il est librement disponible sur le web. Lisons le début :
Malveillance (mai)
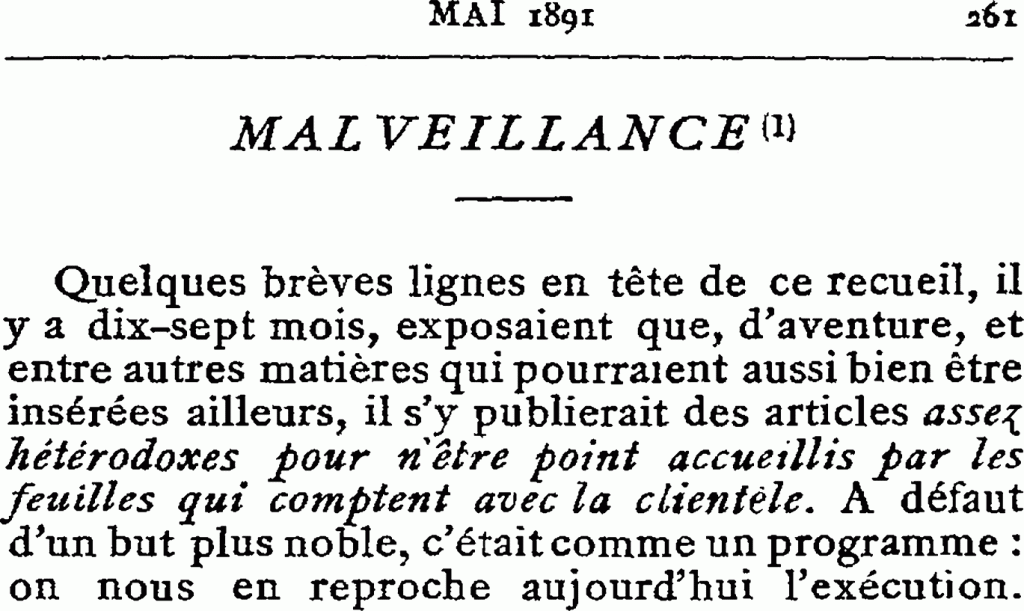
Quelques brèves lignes en tête de ce recueil, il y a dix-sept mois16, exposaient que, d’aventure, et entre autres matières qui pourraient aussi bien être insérées ailleurs, il s’y publierait des articles assez hétérodoxes pour n’être point accueillis par les feuilles qui comptent avec la clientèle. À défaut d’un but plus noble, c’était comme un programme : on nous en reproche aujourd’hui l’exécution. Jamais plus nous n’avons reparlé de nous depuis lors. Nous sommes si peu gens à manifestes que la discrétion des « Mercuriens » — une naïveté sans doute en ce temps de puffisme — est passée en force de chose jugée dans de hauts milieux littéraires. Mais la… violence à notre égard d’une éminente personnalité de la presse nous oblige, pour un court moment, à changer d’attitude. Au reste, nous ne sommes point de mœurs « engueulantes » — une sottise peut-être — : nous nous distinguons en cela de tant d’autres, et c’est encore une justice qu’on nous rend.
Je prie qu’on remarque que je ne viens pas défendre et justifier — il n’a pas à l’être — M. Remy de Gourmont, un lettré rare, esprit spéculatif un peu métaphysique, dont l’ordinaire souci est à mille lieues du sujet qu’il traita le mois dernier. Il a même fallu que la comédie patriotique se manifestât par de bien véhémentes clameurs pour être perçue du nuage qu’il habite, et où il était déjà remonté quand M. Nestor le vouait, dans L’Écho de Paris du 26 mars, à un genre de supplice tel qu’il « envierait alors les damnés du Dante. » La pénitence est douce. Je désirerais seulement remettre les choses au point.
D’abord, le fond même du débat : il ne s’agit nullement de l’idée de patrie. Encore que cette idée-là soit assez peu « excitante », d’un intérêt relatif et infiniment au-dessous — M. Nestor le concède — de l’idée d’humanité, très permise à l’heure actuelle, elle n’est pas en question, en tant du moins qu’abstraction dégagée des soi-disant nécessaires préjugés contemporains. M. Camille de Sainte-Croix l’a bien compris La Bataille du 29 mars). Après avoir précisé l’économie de l’article de M. de Gourmont, il conclut :
« Il n’y a là motif à aucune ligue pour ou contre l’idée de patrie. Ces raisons vont plus haut. D’autant qu’avec lui encore nous répétons : — Tous les Français gardent une solidarité nationale. Faites la guerre et nous partirons. Mais si vous ne la faites pas, fichez-nous la paix. »
Et M. George Hère dans le Constitutionnel17 — le sage Constitutionnel — ajoute :
« Ce dilemme n’a rien de subversif ; il est simplement imbus du bon sens français, cette vertu dont on parle toujours et qu’on n’éprouve jamais… La vision de M. de Gourmont est plus sensée certainement, et plus noble je crois, que celle de M. Déroulède18. »
Ce même journal a très exactement défini le mobile, d’ailleurs patent, du signataire de l’article tant incriminé : l’attitude indécente des revanchards quand même. De plus, et il n’est pas le seul, M. de Gourmont n’estime pas du tout la fameuse revanche indispensable au bonheur de l’humanité. Mais fût-on partisan d’une nouvelle guerre, admit-on avec La Bataille, ce qui est soutenable à un certain point de vue, que « le besoin de revanche n’est même pas discutable », de quel œil contempler les pitreries de ces étranges énergumènes toujours prêts à partir, jamais partis, et qui compromettent une fois par mois la sécurité publique ? On finit par en rire : ils rappellent invinciblement ces cocasses personnages de l’opérette d’Offenbach, qui, un quart d’heure durant, sans bouger d’une semelle, chantent avec énergie : « Détalons et fuyons19 ! Détalons et fuyons !… » Ah ! combien se trompe La Cocarde en disant que M. de Gourmont a « tourné en ridicule ceux dont la pensée est constamment orientée vers l’Alsace-Lorraine ! » Il n’a que noté un fait. Ce n’est pas sa faute, pourtant, si ceux-là grimpent sur les tréteaux, hurlent et gesticulent, au lieu de se préparer dans le recueillement à l’œuvre souhaitée. La perspective d’une conflagration de deux millions d’hommes, de l’arrêt ou de la rupture de tous les rouages sociaux, est certes très folâtre et justifie surabondamment le « caractère français », le « vieux sang gaulois », les vrais patriotes enfin de leurs… exubérances — innocentes facéties pour égayer la longue veillée d’armes. Et la farce tapage si fort, atteint de telles hauteurs dans le grotesque et s’offre d’une si franche drôlerie, qu’ils sont en effet bien étonnants les esprits assez chagrins pour ne s’en point divertir. Conçoit-on ces gens moroses saisis d’une nausée rien qu’à ouïr les lointains éclats de la parade, et qui ne regardent pas à se faufiler par les petites rues, quittes à beaucoup allonger leur route, afin d’esquiver la place où paillassent, bobèchent et fantochent les délicieux revanchards !… Une belle musique est vite insupportable une fois en bobine dans les orgues de barbarie, de fervents admirateurs de la Marseillaise — goût point blâmable en soi — ne peuvent plus l’entendre depuis qu’on en a tant mésusé : trop d’Amiati20 ont braillé et braillent encore la Revanche21 pour que nous soyons les seuls, nous qu’on dénomme d’une lèvre méprisante les « raffinés », à penser ainsi. L’ensemble des écrits provoqués par l’article de Remy de Gourmont le témoigne de reste. On n’est pas patriote de ce patriotisme-là ; quotidiennement grossit le nombre de ceux qui se débarrassent de ce « virus » nouveau, « nouveau, oui, sous la forme épaisse qu’il assume depuis vingt ans ».
La Revue indépendante (mai)
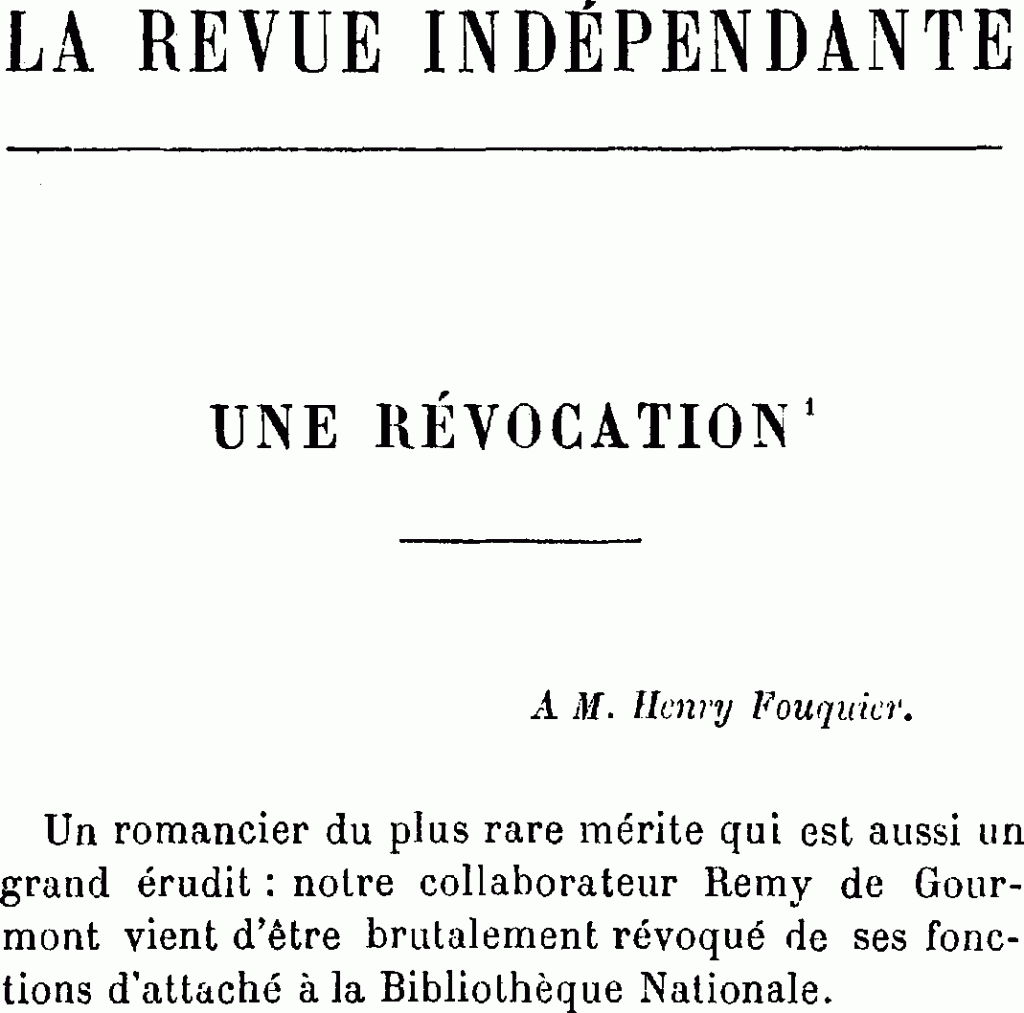
Après celle du Mercure, la deuxième réaction donnée ici est celle de La Revue indépendante. Plusieurs revues sont parues sous ce titre et c’est celle de Félix Fénéon (1861-1944) qui nous intéresse. Cette revue est parue sur quatre-vingts numéros, de 1884 à 1895.
En ouverture de la livraison de mai, Gaston et Jules Couturat, pseudonymes de Gaston Moreilhon et George Bonnamour (1866-1954) publient six pages sous le titre « Une révocation ». Ce texte est adressé « À M. Henry Fouquier », dit Nestor, le journaliste de L’Écho de Paris. Voici ce texte, intégralement reproduit :
Une révocation22
À. M. Henry Fouquier
Un romancier du plus rare mérite qui est aussi un grand érudit : notre collaborateur Remy de Gourmont vient d’être brutalement révoqué de ses fonctions d’attaché à la Bibliothèque Nationale.
Voilà le fait dans toute sa simplicité douloureuse et brutale. M. de Gourmont cependant ne s’est rendu coupable d’aucun méfait, d’aucun délit, d’aucun crime ; jusque dans ses fonctions modestes d’employé il a conservé la fierté digne, la réserve courtoise qui rendent cher ce gentilhomme à tous ceux qui ont eu l’honneur de l’approcher.
Non, M. de Gourmont n’a pas cessé d’être un parfait honnête homme, un fonctionnaire irréprochable. Seulement, il lui est arrivé, voici deux mois, lors des incidents qui ont signalé le passage à Paris de l’impératrice Augusta23, de dire leur fait aux PATRIOTES et d’avouer ses sympathies à l’égard de l’Allemagne dans un article qui a fait scandale.
On s’est vengé, depuis, des audaces de l’écrivain en frappant l’employé : — c’est lâche !
M. de Gourmont a pour lui cette supériorité d’être un artiste doublé d’un penseur. Pour lui encore il a cet insigne honneur d’être pauvre.
Or si, pour VIVRE, M. de Gourmont aliène, très noblement quelques heures de son temps et de sa liberté au profit du gouvernement qui le paie, encore que bien peu ! s’ensuit-il de là qu’il ait perdu le droit d’écrire et de donner son opinion, non sur les hommes dont il dépend hiérarchiquement, mais sur des IDÉES et des événements que chacun de nous peut juger à sa guise ?
Puis, — à supposer — car jamais nous ne saurions l’admettre — à supposer que, de par ses fonctions, M. de Gourmont soit tenu à moins d’indépendance que le dernier venu de ses confrères, à supposer cela : qu’a-t-il donc écrit qui ne soit à son entier honneur ?
Nous ne voulons citer de son éloquent article que la conclusion « S’il faut d’un mot dire nettement les choses, eh bien ! Nous ne sommes pas patriotes. » Et nous la citons pour l’approuver, persistant à ne lui rien trouver de « criminel et d’infamant ».
Nous l’approuvons pour toutes les raisons que M. de Gourmont donnait à l’appui de sa thèse, à savoir : qu’intellectuellement, l’Allemagne est pour le moins l’égale de la France, que de l’autre côté du Rhin des hommes ont vécu dont il faut saluer religieusement la mémoire et aimer les œuvres. Quant à la REVANCHE, nous trouvons odieux qu’il en soit toujours âprement — et vainement ! — question et que les plus lâches, les plus timorés l’appellent hypocritement de toutes leurs clameurs au lieu de se taire et de trembler.
Nous ajouterons maintenant que si, nous aussi, nous eussions été choqués qu’un homme de la valeur de M. de Gourmont ne fût pas patriote, la nouvelle de sa révocation nous aurait ému comme elle nous émeut, et au nom de la seule liberté qui nous soit chère en ce monde, celle d’écrire et de penser, alors comme aujourd’hui, nous nous serions levés pour protester.
Ceci exposé, nous supplions qu’on remarque bien que nous ne venons pas défendre M. de Gourmont. Il n’est pas coupable. D’ailleurs, s’il l’était, au nom de quelle logique retorse pourrait-on justifier cette étrange mesure qui, voulant punir l’écrivain, frappe l’employé ?
De pitié ? de pardon ? Nous n’en voulons pas. Une protestation circulait avec une fierté dont il faut le louer, M. de Gourmont a remercié ses amis, réclamé le silence. Qu’on ne vienne pas dire, toutefois, qu’en nous inclinant nous avons compris que nous défendions une mauvaise cause. Car plaider ? nous l’aurions pu. Énumérer les titres de notre collaborateur à la bienveillance et à la considération du ministre ? Cela nous était facile. Le Mercure de France où combat un groupe de jeunes hommes dont nous n’aimons ni les amitiés ni les tendances mais dont nous proclamons ici la féconde ardeur de travail, cette Revue même où nous avons l’honneur d’écrire, s’enorgueillissent de compter M. Gourmont au nombre de leurs rédacteurs. Il n’est pas un lettré qui n’ait lu Sixtine24 avec la joie sincère, et trop rare, de découvrir un artiste extasié dans le culte fervent de son Idéal et dédaigneux de la gloriole passagère. Il n’est pas un érudit qui n’attende avec une curieuse impatience la publication du Latin mystique25.
Cela fait sourire, nous le savons bien, les philosophes sceptiques doués du caractère et de la légèreté de cœur de M. Fouquier.
Et en effet, lorsqu’on a, par sa mauvaise foi, ses indignations de commande, privé de son pain un honnête écrivain, on peut, M. Fouquier, fort de sa situation, se frotter les mains et sourire.
On peut même, devant la clameur indignée des jeunes gens, conserver son flegme et se sentir saisi d’ironique pitié.
Mais le temps passe et notre heure viendra.
Elle viendra l’heure où, malgré tout, il faudra bien compter avec nous et prendre une autre attitude. Alors, Monsieur, nous aurons beau jeu de ramasser une à une toutes vos vilenies pour vous les jeter au visage. Car nous savons au juste qui vous êtes.
Votre patriotisme et ce qu’il faut en croire, nous le savons, car certes nous n’avons eu garde d’oublier qu’à trente-deux ans, lorsque les armées prussiennes envahissaient la France, vous acceptiez un poste officiel à Marseille.
Votre talent ? N’est-ce pas un poète de notre génération qui naguère vous jetait ce cri de justice « Vous êtes un raté » Ce jour-là, Monsieur, vous avez cessé de sourire, votre plume a grincé d’un court frisson de rage et, vous comparant à Victor Hugo — méridional que vous êtes ! — vous nous avez reproché de n’avoir pas « le respect de nos aînés ».
De la part d’un homme qui insulta des morts comme Villiers de l’Isle Adam et Barbey d’Aurevilly, ce mot est grand.
Et sachez-le donc, puisque vous l’ignorez : — Vous n’êtes pas de notre famille où les AÎNÉS sont aimés et bénis dans la noble pureté de leur gloire intacte. Lorsqu’on a comme vous, étalé, chaque jour, au hasard des feuilles publiques, la preuve éclatante de sa formidable impuissance et de son inguérissable mauvaise foi ; lorsqu’on a mis, comme vous, sa plume à l’encan, et pour toutes les causes et pour toutes les besognes ; lorsqu’on a, comme vous, dans ses plates fonctions de scribe jugeur, toisé les plus fiers talents du bas de son exaspérée médiocrité de petit employé, on a beau se draper dans une dignité fausse de grand homme méconnu : on n’est point un aîné, pas même un confrère, mais un réprouvé, et rien que cela.
On peut sourire. Nous autres, nous avons l’innocence de trouver cela grave et nous ne croyons pas être ridicules en tendant la main à celui que frappe une mesure inique, en remerciant aussi M. Alfred Vallette et ses amis du Mercure de France pour la protestation qu’ils avaient rédigée.
En cette occasion, les uns et les autres, sans distinction d’opinions et d’écoles, nous sommes solidaires et nous avons la puérilité d’en être très fiers. Ce que nous demandons c’est peu de chose : pouvoir travailler en paix. L’obtenir n’est point si aisé que beaucoup pourraient se l’imaginer. Il n’est pas d’humiliations, pas de tracasserie que nous n’ayons à subir : il est temps que cela finisse. Nous tenons pour noble notre profession et, si elle ne nous assure aucun privilège, que du moins elle ne nous attire nulle réprobation systématique. Certes, nous n’ignorons point qu’à se croire persécuté on risque beaucoup d’être ridicule. Et cependant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, voici qu’on poursuit M. Jean Richepin pour « outrage aux mœurs26 », voici qu’on révoque M. R. de Gourmont pour « attentat contre la patrie » !
Dans le premier cas, l’accusation tombe d’elle-même : c’est imbécile et c’est odieux. Vis-à-vis de M. de Gourmont comme les lois manquent, pour le punir, on lui enlève simplement son pain : c’est lâche ! Et c’est d’un cœur triste et soulevé de colère que nous venons dire :
— Ceux qui ont provoqué cette révocation, ceux aussi qui l’ont ordonnée : ceux-là sont des misérables !
Gaston et Jules Couturat
Octave Mirbeau (18 mai)
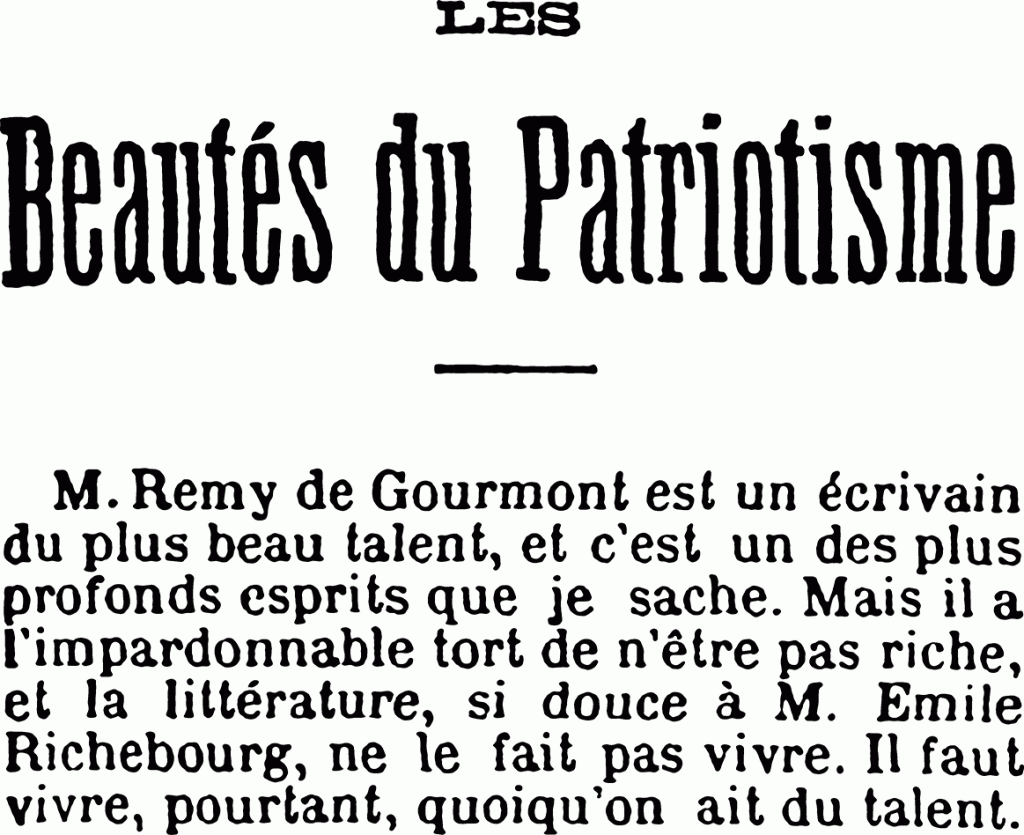
Le 18 mai dans Le Figaro, en premier Paris — à sa place — sur deux colonnes entières, Octave Mirbeau défend Remy de Gourmont :
Les Beautés du patriotisme
M. Remy de Gourmont est un écrivain du plus beau talent, et c’est un des plus profonds esprits que je sache. Mais il a l’impardonnable tort de n’être pas riche, et la littérature, si douce à M. Émile Richebourg27, ne le fait pas vivre. Il faut vivre, pourtant, quoiqu’on ait du talent. Ils sont quelques-uns à savoir combien il est difficile à résoudre, ce nécessaire problème. M. Remy de Gourmont avait accepté, à la Bibliothèque nationale, des fonctions qu’il remplissait au mieux. Ces fonctions ne lui avaient pas été confiées au hasard d’une protection. Par un phénomène très particulier dans le mécanisme fonctionnariste qui nous mène, il était à sa place, dans cette place. Je crois, en effet, qu’il existe peu d’hommes possédant, comme lui, la science de l’histoire, de la philosophie et de la littérature. En même temps qu’un artiste passionné, c’est un studieux opiniâtre, une sorte de bénédictin, toujours en désir de quelque noble savoir, toujours en quête de hautes recherches mentales. Il avait donc, à la Bibliothèque, deux fois sa vie : sa vie matérielle, car il se contente de peu et met son idéal au-delà des rêves de l’argent, et sa vie spirituelle. Il n’ambitionnait pas autre chose.
Sachant très bien de quelles mixtures ingénieusement malpropres se compose la célébrité contemporaine, et ce qu’il faut souvent oublier de dignité morale, d’intégrité esthétique, pour y atteindre, il faisait de son mieux, obscur et laborieux. Ses loisirs ne le changeaient ni de milieu ni de passion. Au Mercure de France, il était un des plus assidus, un des plus remarqués parmi les jeunes collaborateurs de ce groupe d’élite ; et il écrivait de beaux livres, comme cette étrange et métaphysique Sixtine, où sont vraiment d’admirables pages, et des beautés de pensée, et des impressions d’art vraiment supérieures. Il semblait que la vie d’un tel homme, voué à de si lointaines spéculations, résigné à se satisfaire par des joies intérieures, et qui ne gênait personne, ne disputant à personne sa part des honneurs et des succès volés, il semblait que cette vie silencieuse, cloîtrée dans le devoir et dans l’art pur, dût rester à l’abri de toute aventure, préservée de tous les heurts violents et publics. Eh bien ! non.
Je connais, dans une ville de France, un bibliothécaire. C’est un doux homme, très maigre, très triste, et qui a six enfants. Sa place ne lui procure pas le pain nécessaire à la vie de sa famille. Pour augmenter son pauvre revenu, il écrivait, chaque semaine, dans un des journaux de l’endroit, quelques inoffensifs articles littéraires, quelques comptes rendus de théâtre, aux jours solennels des tournées parisiennes. Ce modeste cumul déplut au Conseil municipal. Par une délibération où il était déclaré, expliqué que : « les fonctions de bibliothécaire étaient incompatibles avec les travaux de littérature », ce fantastique Conseil mit le bibliothécaire en demeure de choisir entre la bibliothèque et la littérature, se réservant, « en cas de non-obéissance, de prendre telles mesures immédiates et conservatoires qu’il lui plairait ». C’est ce qui est arrivé à M. Remy de Gourmont, mais avec d’inoubliables aggravations et des raffinements de bêtise inouïs. L’histoire vaut qu’on la raconte et qu’on la commente.
* * *
Aujourd’hui, la presse est libre, mais à la condition qu’elle restera dans son strict rôle d’abrutissement public. On lui pardonne des écarts de langage, pourvu, comme dans la chanson de café-concert, que le petit couplet patriotique et final vienne pallier et moraliser les antérieures obscénités. On tolère qu’elle nous montre des derrières épanouis, des sexes en fureur ou en joie, encore faut-il que ce soit dans un rayonnement du drapeau tricolore. Soyons vulgaires, abjects ; remuons les sales passions et les ordures bêtes, mais restons patriotes. On peut voler, assassiner, calomnier, trahir, être une brute forcenée, un lâche brigand, cela n’est rien, si l’on organise du « boucan » dans les théâtres, si l’on insulte les femmes qui viennent d’Allemagne, si l’on vomit sur le génie des belles œuvres, si l’on va, en hurlant de stupides refrains, porter de revendicatrices couronnes au tombeau du peintre médiocre que fut Henri Regnault. Car Henri Regnault est devenu un des nombreux symboles de la Patrie, son culte est obligatoire et national, comme l’impôt et comme le service militaire. On ne peut plus dire qu’il manquait de génie, sans recevoir aussitôt des menaces de mort ; on ne peut même plus émettre un doute sur la valeur artistique de son tombeau, sans voir, soudain, mille poings se tendre, furieux, vers vous, et mille regards vous foudroyer d’homicides colères. C’est exaspérant vraiment. Qu’on honore son souvenir, c’est bien. Il mourut bravement, mais il ne fut pas le seul, hélas ! Combien, en cette douloureuse année, sont morts qui le valaient ! Combien, en qui les balles stupides ont éteint des belles flammes de génie ignoré ? Et ce souvenir qui lui survit, et qui survit à son œuvre oubliée, pourquoi le prostituer dans de douteuses équipées ?
Dans la presse, dans la rue, au Parlement, au théâtre, le patriotisme s’étale et braille, couvrant de son manteau de pochard les plus honteuses faiblesses et les pires infamies. Il n’importe. Nous devons le respecter, nous devons subir, sans nous révolter, ses compromettantes violences, ses dangereuses brutalités, ses odieux vandalismes, ses sauvageries d’iconoclaste ; il faut courber le dos sous le flot des sentimentalités ineptes qui coule de lui et déborde sur nous. L’autorité, si prompte à lancer ses bandes de sergents de ville sur les inoffensifs promeneurs, se trouve désarmée contre ce brigandage. Elle dit : « C’est excessif ! mais si respectable ! » Et sait-on pourquoi le patriotisme est si respectable, tout en étant excessif ? C’est parce qu’il est un des meilleurs agents de la gouvernable ignorance, un des moyens les plus sûrs de retenir un peuple dans l’abrutissement éternel. Mais sitôt que, sans accompagnement de dégoûtantes polissonneries et de prud’hommesques rengaines, l’on pénètre gravement dans la discussion des idées graves, alors la société se plaint et réclame, et la justice montre les crocs.
Oui, nous sommes libres de nous réunir où nous voulons et d’écrire ce que nous voulons ; mais Gégout28 est encore en prison pour n’avoir pas trouvé admirables les belles lois inquisitoriales que nous prépare M. Joseph Reinach29 ; mais on fusille ici des ouvriers coupables de vouloir vivre et de demander du pain, ce qui est une insoutenable prétention ; mais on enlève leur pain à ceux dont le crime est d’affirmer des opinions qui n’ont point l’estampille ministérielle ou l’agrément des bourgeois. Tel fut le cas de M. Remy de Gourmont.
* * *
M. Remy de Gourmont publia, dans l’avant-dernier Mercure de France, un article intitulé : Le Joujou du patriotisme. M. de Gourmont n’est pas de ceux qui pensent au hasard ; il sait ce qu’il dit et ce qu’il fait. L’article était d’une belle éloquence ironique et d’une logique impeccable. À moins d’incompréhension ce qui n’est pas rare — ou de mauvaise foi — ce qui est une règle à peu près générale — il n’y avait pas à se méprendre sur la signification réelle de ces pages. J’ignore quelles sont les idées de M. de Gourmont sur la Patrie ; je n’ai pas à les rechercher, et lui n’avait pas à les exprimer, car il ne s’agissait pas de la Patrie ; il s’agissait du patriotisme, et ce sont deux choses très différentes et qui s’excluent l’une l’autre. M. de Gourmont flétrissait le patriotisme dont je parle, ce patriotisme abject, négatif de toute beauté, devenu une exploitation électorale, un ignoble moyen de réclame saltimbanquiste, le déversoir bruyant et malpropre de la sottise et de la grossièreté humaines.
Il n’invectivait pas l’Allemagne, étant un philosophe ; ne cachait pas son admiration de Goethe, de Heine, de Wagner, étant aussi un poète et un artiste ; enfin, il manquait d’enthousiasme envers Henri Regnault, disant qu’une balle est incapable, si prussienne soit-elle, de donner du génie à qui n’en a pas ; trois sacrilèges dans la liturgie patriotique !
L’article fit du bruit. On le discuta, on le dénatura, on le dénonça, car la presse, ainsi entendue, est une belle institution, et elle a d’admirables mœurs intellectuelles. Quelqu’un, que je ne puis nommer — car il est anonyme comme une foule — et qui n’avait pas lu l’article — car quand donc ce quelqu’un aurait-il le temps de lire quoi que ce soit ? — et qui n’en parla que par ouï-dire, mit dans l’attaque une passion spéciale, une haine à part, se permit des insinuations perfides et coutumières. À l’entendre, on aurait pu croire que M. de Gourmont — ce catholique — était un anarchiste dangereux, venu d’on ne sait quels enfers sociaux, pour dynamiter Paris et faire sauter la France. Peut-être même le croyait-il. M. de Gourmont fut fort étonné de tout le tapage qu’il avait soulevé. C’était la première fois qu’il entrait en lutte avec la grande presse, il ignorait ses ressources de polémique. Il en eut de la stupéfaction et de la tristesse, et dédaigna de répondre. D’autres travaux, qu’il aime, le requéraient, et, dans le silence de son labeur, il oublia cet article et la clameur de réprobation inattendue qui l’avait accueilli. Mais l’administration ne l’oubliait pas.
Inquiétée et mise en demeure de sévir contre le dangereux internationaliste qui, traitant de l’Allemagne, ne l’avait pas provoquée à des guerres immédiates et n’avait point déposé sur le tombeau de Regnault l’obligatoire couronne, elle le congédia. Avant de quitter ses fonctions, pour sa dignité, M. de Gourmont voulut ramener les choses à la vérité ! On refusa de l’entendre ! Avait-il insulté Goethe ? Non. Avait-il promis de fusiller Hœckel30 ? Non. Alors, quel était son crime ? Et — comble de l’audace ! — M. de Gourmont avouait garder à la mémoire de Jules Laforgue, qui avait été lecteur de l’impératrice Augusta, un culte tendre !.. Alors il ne l’aurait pas fusillé non plus, celui-là, un espion sans doute ?.. Que pouvait-on attendre d’un bibliothécaire qui s’obstinait à ne fusiller personne ? M. de Gourmont fut impitoyablement révoqué.
* * *
Voilà où nous en sommes venus, après d’innombrables révolutions ; et telle est la grande liberté intellectuelle dont nous jouissons. Nous tremblons devant l’idée ; la moindre interrogation philosophique nous effare. Et nous avons des gestes longs et de sublimes attitudes pour proclamer que nous sommes les seuls initiateurs de la civilisation et les porte-lumière du progrès, nous les vaudevillistes impénitents, les roucouleurs des plates romances. Il faut que ceux qui ont quelque chose à dire et à faire supportent toujours la peine de nos timidités intellectuelles et de nos lâchetés morales. Ah ! oui, nous sommes un grand peuple !
M. de Gourmont s’est retiré, très dignement. Il a même prié ses amis, qui voulaient organiser une protestation contre l’inqualifiable mesure qui le frappe, de ne faire aucun bruit autour de son nom. Et je pense qu’il a dû transmettre ses fonctions à quelque militaire impatient qui aura sans doute juré de nous rendre, à bref délai, l’Alsace et la Lorraine. Je le vois d’ici, ce militaire, et je l’entends, quand il passe devant les rayons où sont les œuvres de Goethe, hurler de sa voix rauque d’absinthe et de patriotisme :
— … Spèce de salop !… spèce de mufle !… Prussien !… Je t’en f…icherai, moi, des statues !… Rrran !… Rrran !…
Et il aura de l’avancement.
Octave Mirbeau
L’Écho de Paris (18 juin)
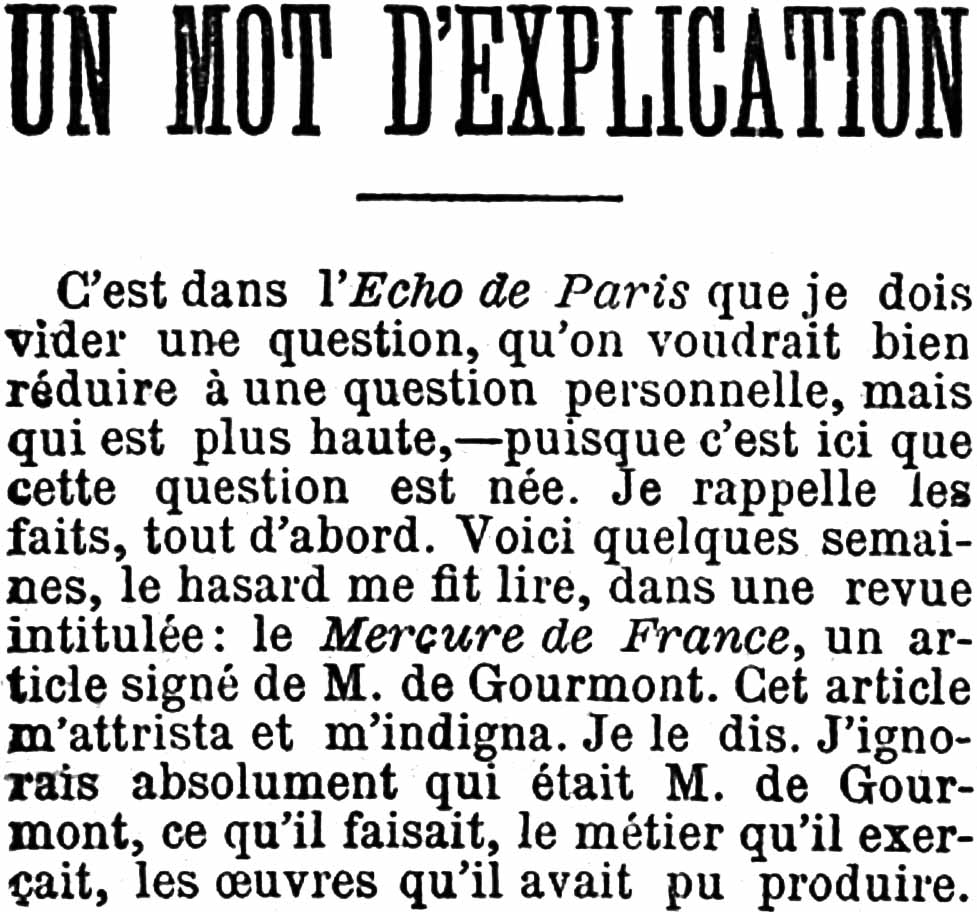
Un mois exactement après l’article d’Octave Mirbeau dans Le Figaro, Nestor (Henry Fouquier, donc), dans L’Écho de Paris du 18 juin remet ça. En premier Paris où il a ses habitudes, il titre son article « Un mot d’explication » et l’on comprend tout de suite que ça ne va rien arranger. Octave Mirbeau en 1891 semblant déjà intouchable, Henri Fouquier répond surtout à l’article de Gaston et Jules Couturat de La Revue indépendante qu’il semble avoir modérément apprécié.
Ce texte (une colonne et demie) est un peu longuet aussi a-t-il été largement amputé ici. Cette large amputation a été opérée sans remords, le texte entier étant librement disponible sur le web et pouvant même être demandé ici.
Un mot d’explication
C’est dans l’Écho de Paris que je dois vider une question, qu’on voudrait bien réduire à une question personnelle, mais qui est plus haute, — puisque c’est ici que cette question est née. Je rappelle les faits, tout d’abord. Voici quelques semaines, le hasard me fit lire, dans une revue intitulée : le Mercure de France, un article signé de M. de Gourmont. Cet article m’attrista et m’indigna. Je le dis. J’ignorais absolument qui était M. de Gourmont, ce qu’il faisait, le métier qu’il exerçait, les œuvres qu’il avait pu produire. On m’a appris depuis qu’il était « gentilhomme, » qu’il était « un artiste doublé d’un penseur, » un homme « extasié dans le culte fervent de son idéal »31. Gentilhomme, ça m’est égal. Quant à « l’artiste extasié », depuis que nous avons le bonheur de posséder une douzaine de chapelles littéraires où de jeunes roublards pratiquent le culte de la mutuelle admiration, tout en se déchirant de temps à autre, on rencontre des « artistes extasiés » à tous les coins de rue. C’est une épithète devenue commune, comme les épithètes de nature du vieil Homère. L’extasiement de M. de Gourmont restait donc, comme sa gentilhommerie, chose de peu d’importance : mais il y avait plus. M. de Gourmont était employé à la Bibliothèque nationale. J’ignorais absolument qu’il fût fonctionnaire et ne pouvais m’en douter. De plus, dans mon article, je ne le nommais pas. Ceci, je le dis parce que c’est la vérité, non pour m’excuser. Je ne le nommais pas, par je ne sais quelle pitié, et aussi pour ne pas faire, autour d’un nom, un scandale dont on paraissait chercher le bruit. J’ajoute que si j’avais connu sa qualité de fonctionnaire, j’aurais agi de même, tout en agissant d’une autre façon peut-être. Le mot de lâcheté a été prononcé ou plutôt balbutié à propos de cette affaire. La vraie lâcheté a été de ne pas dénoncer ce fonctionnaire, payé par la France, et ne la reconnaissant pas avec les droits qu’a la patrie et les devoirs qu’elle impose… Quand la presse houspille tous les jours un pauvre diable de sous-préfet ou de commissaire qui a fait une gaffe, je ne vois pas pourquoi elle ne mettrait pas en plein soleil la trahison morale envers la nation, commise par un de ses serviteurs ?
Mon article attira l’attention de quelques-uns. On parla de ce « gentilhomme » qui « ne donnerait pas son petit doigt pour l’Alsace-Lorraine », ce précieux petit doigt lui servant « à secouer la cendre de sa cigarette, » et qui engageait les Alsaciennes à « traire leurs vaches » et à nous laisser la paix. On prononça, on imprima le nom qui avait signé le manifeste du dilettantisme antinational. Les camarades de M. de Gourmont, m’a-t-on dit depuis, s’indignèrent d’être à la garde d’un des trésors de la France en compagnie d’un « extasié » pour qui il n’y avait pas de France. M. de Gourmont fut révoqué. Il paraît que c’est ma faute : j’en accepte la responsabilité.
Ceci m’a valu quelques injures, que je porte très gaillardement. Il s’est trouvé un nigaud aigri pour me reprocher de m’être caché sous le masque de l’anonyme ! Mais le réquisitoire en règle a été prononcé contre moi, dans la Revue indépendante, par deux messieurs qui signent Jules et Gaston, espérant peut-être que cette signature siamoise leur donnera le talent des frères Goncourt ? En tout cas, je ne leur ai pas porté bonheur : car j’ai rarement vu, en si peu de pages, tant de sottises. Je pourrais les dédaigner, mais il me plait, aujourd’hui, d’y répondre. C’est un grand tort que nous avons, nous qui ne sommes pas des « extasiés », mais qui nous laissons cependant prendre et absorber par notre art et nos besognes, de ne pas marcher sur les petits serpents que nous rencontrons en nos chemins.
[…]
Nestor
La réponse de Remy de Gourmont
Les choses ne pouvaient évidemment en rester là et le jour-même de la parution de l’article, Rémy de Gourmont répond à Henry Fouquier. Cette réponse est parue en tête du Mercure de juillet, accompagnée l’une note assez absconse :
« M. Valentin Simond ayant refusé l’insertion de cette lettre — non, du reste, pour sa teneur, puisqu’il n’en a pas pris connaissance, mais en principe, — M. Remy de Gourmont n’a pas cru devoir insister. »
Bien sûr à l’époque, tout le monde savait qui était Valentin Simond comme de nos jours tout le monde sait qui est Vincent Bolloré. Un siècle après, le souvenir de tout cela se perd. Valentin Simond (1842-1900, à 52 ans) était le directeur de L’Écho de Paris, au seize rue du Croissant, qui se révélera bientôt l’un des journaux les plus antidreyfusards de Paris.
On peut noter que Remy de Gourmont date sa lettre du 17 juin alors que l’article de L’Écho de Paris, journal du matin, est du 18. Il faut alors imaginer que Remy de Gourmont a eu connaissance du texte avant la parution du journal. Lisons cette réponse en entier (On notera le « vouloir bien », qui est plus un ordre qu’une prière) :
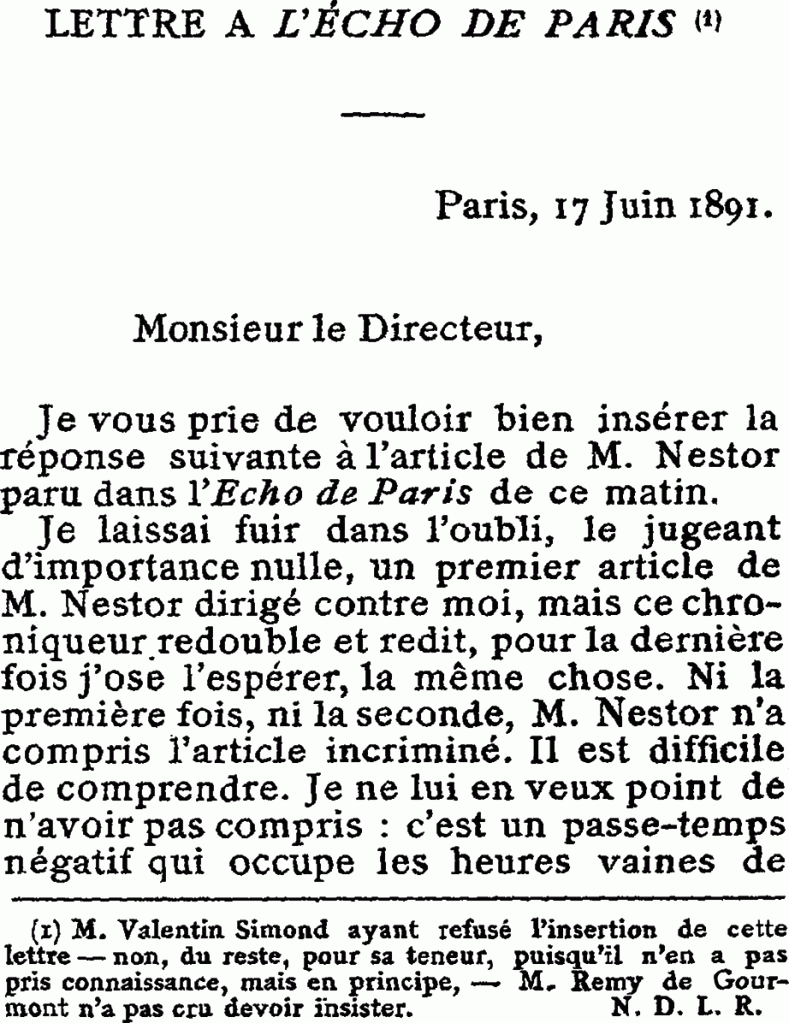
Paris, 17 Juin 1891.
Monsieur le Directeur,
Je vous prie de vouloir bien insérer la réponse suivante à l’article de M. Nestor paru dans l’Écho de Paris de ce matin.
Je laissai fuir dans l’oubli, le jugeant d’importance nulle, un premier article de M. Nestor dirigé contre moi, mais ce chroniqueur redouble et redit, pour la dernière fois j’ose l’espérer, la même chose. Ni la première fois, ni la seconde, M. Nestor n’a compris l’article incriminé. Il est difficile de comprendre. Je ne lui en veux point de n’avoir pas compris : c’est un passe-temps négatif qui occupe les heures vaines de l’universelle humanité, — dont M. Nestor fait partie, et c’est tout. Ni au chroniqueur, voix d’en bas, ni à ses diatribes, je ne veux répliquer, mais seulement mon devoir est de remettre en leur santé vraie des idées qui, à force de passer de journal en journal, se dénaturent, se gangrènent, en viennent à une pourriture excessive.
La question est simple et claire. En voici en deux mots l’économie : Au XVIIe siècle, la France s’incorpora une province d’Alsace ; au XIXe, une autre nation, l’Allemagne, enleva cette province à la France. Y a-t-il nécessité à ce que la France n’ait, en sa vie politique et sociale, qu’un seul but : reprendre à l’Allemagne ladite province « antérieurement chipée » ? Des gens croient que oui ; moi je crois que non. Les uns prônent l’alliance russe ; moi, selon des idées peut-être subversives, je préférerais l’alliance allemande, qui, du moins, nous mettrait à l’abri d’une guerre de voisin à voisin. Pour cela, il faut abandonner la productive idée de Revanche, — et cet effort, nous le demandons à l’éternel bon sens que l’on s’accorde à reconnaître aux Français. Est-ce un crime ?
J’écrivis au Mercure de France, il y a trois mois : « Nous ne sommes pas patriotes. » Non, nous (moi, veux-je dire) ne sommes pas patriotes contre l’Allemagne plutôt que contre l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la Belgique ou l’Angleterre ; nous ne sommes pas patriotes s’il s’agit d’attaquer ; nous le serions (c’est-à-dire nous ferions notre devoir) s’il s’agissait de défendre notre langue, nos idées, nos mœurs : la patrie française. Clairement je l’écrivis : je ne puis pourtant enseigner l’A B C de la logique à des chroniqueurs pressés de rédiger leur quotidienne copie.
En tout cela, l’Idée de patrie ne fut jamais mise en cause. Ai-je, comme Voltaire, félicité le roi de Prusse d’avoir « rossé les Welches32 à Rosbach33 » ? Mais non. J’ai, étant enfant, saigné des défaites subies, plus peut-être que tel confortable secrétaire général ; maintenant, je trouve qu’après vingt ans de paix tout cela est périmé, aussi ancien que l’an 1798 où les Français régentaient la Belgique, comme aujourd’hui les Allemands, par le droit du plus fort, régentent l’Alsace-Lorraine. Si vous êtes les plus forts, reprenez ces provinces. Bien, elles sont reprises. Alors l’Allemagne, à son tour, les re-reprendra… et toujours de même.
M. Nestor désire que l’on massacre quelques centaines de mille hommes. Il est prêt à partir pour la frontière, en qualité de Tyrtée34 : qu’il parte, je le suivrai avec l’enthousiasme dont je puis disposer. Partons ! Partons ! Partons ! Mais, comme je le disais en cet article désormais fameux : — « Vous ne partez pas, mes chers patriotes ? Alors, f…-nous la paix ! »
Veuillez agréer, etc.
Remy de Gourmont
Huit décembre 1914, le reniement
Depuis l’été 1911, Remy de Gourmont tient, en une, la rubrique « Les idées du jour » dans La France, honorable quotidien de la rue Richelieu. Son billet du huit décembre 1914 porte le titre « Alsace Lorraine ». Lisons-le en entier, il est important.
Alsace-Lorraine
Nos armées ont repris sérieusement pied en Alsace, mais, soit directement, soit comme conséquence de l’ensemble des opérations, il semble bien maintenant que cette province et sa voisine redeviendront françaises. Ce serait pour nous le seul résultat de la campagne, qu’il serait encore considérable. C’est donc le moment de revenir un peu sur les espoirs de reconquête, qui au cours de ces quarante dernières années, avaient fini par sembler tellement chimériques que l’on en parlait le moins possible. Le feu sacré était toutefois entretenu par Déroulède, qui mourut l’an passé non seulement en y pensant toujours mais en en parlant toujours. Même, à un moment, sa Ligue des Patriotes avait pu paraître dangereuse pour la paix. Elle était surtout exaspérante pour ceux qui avaient pris leur parti d’un état de choses de fait qu’ils ne voyaient pas la possibilité de changer à notre profit. Je fus de ceux-là, et j’ai à me reprocher un article où je concluais, non l’idée de patrie, certes, mais le groupement bruyant qui s’en servait mal à propos et, me semblait-il, indiscrètement. C’était une erreur, et je m’aperçois maintenant que cette « Ligue indiscrète » n’a pas été sans influence sur le magnifique mouvement de patriotisme qui a fait se lever jusqu’aux socialistes et pacifistes français ; jusqu’aux anarchistes français dans un mouvement de défense qui portera ses fruits. Les idées sont modelées par les événements, qui sont nos maîtres. Celles qui sont possibles dans l’état de paix naturelle deviennent inconvenantes dans l’état de cataclysmes. Il est des hommes trop concrets auxquels il faut, plus qu’à d’autres, la leçon de ces événements maîtres. Ils sont parmi les meilleurs, parce qu’ils sont les plus sincères.
Remy de Gourmont.
« Le feu sacré [de] Déroulède », sous la plume de Remy de Gourmont, la chose est énorme et le vrai reniement est là. Ainsi Paul Déroulède ne fait-il plus « rouler avec fracas et en tapant dessus avec un vieux sabre ébréché, le cerceau avarié du patriotisme » ?
Quatre jours plus tard, en une de L’Écho de Paris du douze décembre, en post-scriptum de son article « La Gentillesse française » Maurice Barrès reprend ce texte au vol :
C’est d’un véritable homme d’accepter tout au long de sa vie les leçons de l’expérience et de s’y soumettre pour se perfectionner. J’enregistre ici, parce qu’elles sont à son honneur, quelques lignes que publie dans la France un écrivain fameux et de grande influence, M. Remy de Gourmont, qui, faisant son examen de conscience, écrit spontanément :
Suivent des extraits de ce que nous venons de lire ci-dessus. Et non sans un certain panache, Maurice Barrès conclut :
Je serre la main de Remy de Gourmont.
Dans L’Action française du 18 décembre, la « Revue de presse » (page deux, colonne six) indique le texte de Barrès.
Dans le Journal littéraire de Paul Léautaud daté de « fin 1914 » nous lisons :
Gourmont a renié Le Joujou patriotisme. Je lis cela dans L’Action française et L’Écho de Paris, qui fêtent le retour de l’enfant prodigue. Je préfère ne pas aller le voir35. Je ne pourrais me retenir de lui dire ce que je pense de ce reniement, quand cet article n’a justement jamais été mieux de circonstance.
Au moment que cet article (Le Joujou patriotisme) prend toute sa valeur, est plus que jamais d’actualité, il le renie, il cède, il croit, il rentre dans le troupeau, il pense comme le premier venu. Tout son dédain, sa méfiance, son scepticisme, son mépris, n’étaient que façade, jeu d’esprit. Ce n’était pas lui pour de bon. Lui pour de bon, c’est ce qu’il se montre aujourd’hui. « Le jour du cataclysme, a-t-il écrit quelque part36, je cite de mémoire, je monterai à l’écart sur une éminence pour jouir en paix du spectacle. » Le cataclysme est venu. Il n’a plus eu qu’une âme de modeste patriote.
Nous avons oublié — et l’on peut rêver que c’est à jamais — ce qu’est la presse en temps de guerre. Dans la semaine, les plus pacifistes se transforment en combattants farouches, les plus antimilitaristes cousent des drapeaux. Un exemple saisissant peut en être donné par le pitoyable article que Remy de Gourmont a publié dans La France du six décembre 1914, page deux, intitule « Le Tricot d’Honneur »
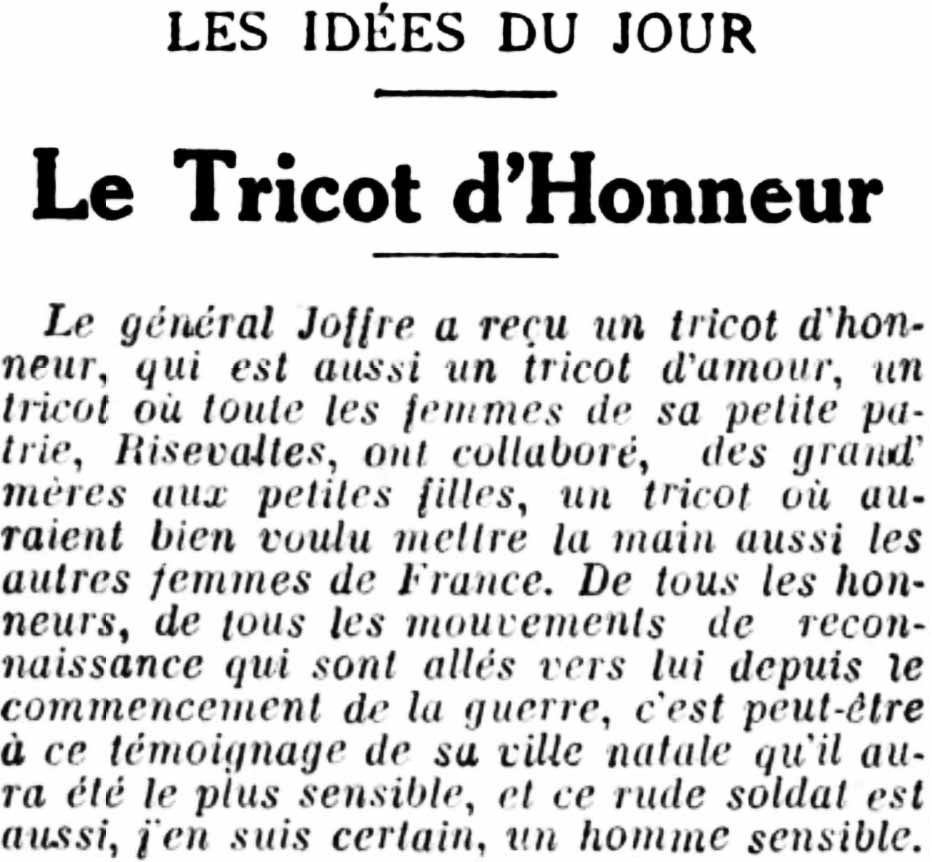
Première moitié de l’article de Remy de Gourmont paru dans La France du six décembre 1914. La suite de l’article ne rattrape pas le début. Le texte entier de cet article est reproduit en annexe ci-dessous.
Venant de Remy de Gourmont, pire reniement, il n’y a pas. Celui d’après-demain huit décembre ne sera rien. Mais en cas de guerre il ne peut y avoir de sincérité, ni même d’esprit. Ni de presse. En cas de guerre, il n’y a plus rien. Comme a dit un jour Alfred Vallette à Paul Léautaud : « je serai intelligent après la guerre ».
De nos jours encore, ce texte refait parfois surface comme à l’été 1990 où, dans une série d’été en 34 épisodes journalistiquement intitulée « Frissons fin de siècle » Le Monde, dans le quatrième épisode traitait du Joujou patriotisme dans un article non signé (l’historien Jean-Pierre Rioux ?) mais pertinent que l’on peut lire sur le site du Monde.
Annexe
Tricot d’honneur
Article paru dans La France du six décembre 1914
Le général Joffre a reçu un tricot d’honneur, qui est aussi un tricot d’amour, un tricot où toute les femmes de sa petite patrie, Rivesaltes, ont collaboré, des grand’mères aux petites filles, un tricot où auraient bien voulu mettre la main aussi les autres femmes de France. De tous les honneurs, de tous les mouvements de reconnaissance qui sont allés vers lui depuis le commencement de la guerre, c’est peut-être à ce témoignage de sa ville natale qu’il aura été le plus sensible, et ce rude soldat est aussi, j’en suis certain, un homme sensible. Son souci d’épargner la vie de ses troupes, si opposé au gaspillage féroce de vies humaines que pratique l’ennemi, en est une des preuves. Ce n’est pas seulement la raison qui lui conseille cela, c’est la sensibilité. Il pense à l’avenir de la France, il pense à tant de belles jeunesses sacrifiées à la patrie, il pense aussi à ces femmes qui ont pensé à lui et qui lui devront la joie de revoir ceux qui sont partis. C’est pour cela qu’il n’est pas seulement admiré, mais aimé et vénéré. C’est pour cela que l’idée des femmes de Rivesaltes, si jolie et si touchante, a semblé aussi si raisonnable et si juste. Et puis, à courir par ces temps, de bataille en bataille, par ces temps et par tous les temps, on n’est pas sans risquer un peu de sa santé : le tricot le mettra à l’abri des mauvais froids. Et quand même, il le ferait ranger dans une valise, tout simplement, il lui tiendrait encore chaud, ne fusse qu’au cœur.
Remy de Gourmont
Notes
1 Louis Denise (1863-juin 1914), bibliothécaire principal à la BNF, poète, et critique d’art. « Vallette […] alla chercher Albert Samain et Louis Denise, qui amena Remy de Gourmont. Jean Court fut recruté par Dubus, Julien Leclercq par Aurier, Ernest Raynaud par Dumur et Jules Renard par Raynaud. » André Billy, Le Pont des Saint-Pères, Fayard 1947, page quarante.
2 Matassin : « Bouffon imitant comiquement des danses guerrières. » (TLFi).
3 Paul Déroulède (1846-1914), licencié en droit, poète, auteur dramatique et romancier. Paul Déroulède est cependant bien plus connu de nos jours comme le fondateur de la Ligue des patriotes, association revancharde (de la défaite de 1870). Son Clairon a longtemps été le chant patriote enseigné dans les écoles : « L’air est pur, la route est large, / Le clairon sonne la charge, / Les zouaves vont chantant,… » Deux fois député de la Charente, le violent Paul Déroulède a provoqué plusieurs incidents majeurs dans l’hémicycle. En 1900, suite à une tentative de coup d’état, davantage mise en scène que réelle, il a été condamné à dix ans de bannissement pour complot contre le Gouvernement.
4 Soit une chope de deux litres de bière.
5 Sortir.
6 Odilon Redon (1840-1916), peintre et graveur très symboliste.
7 Henri de Sybel (1817-1895), professeur à l’université de Bonn surtout connu pour son Histoire de l’Europe pendant la Révolution française, Germer Baillière, libraire-éditeur, 17 rue de l’École-de-médecine (six volumes).
8 Wilhelm Adolf Schmidt (1812-1887), Tableaux de la Révolution française publiés sur les papiers inédits du département de la police secrète de Paris (Leipzig, 1867-1870).
9 Theodor Mommsen (1817-1903), spécialiste de la Rome antique, prix Nobel de littérature en 1902.
10 Ernst Curtius (1814-1896) archéologue et historien.
11 Paul de Cassagnac (1842-1904), journaliste d’extrême droite et député bonapartiste, fondateur en 1886 et directeur politique du quotidien L’Autorité, qui affiche pour devise : « Pour Dieu, pour la France ». À la mort de son fondateur le quotidien sera dirigé pas ses fils en conservant la même devise. Comme bien d’autres titres il cessera son activité après le numéro du six septembre 1914, pour ne plus reparaître.
12 Victoria Adélaïde (1840-1901), fille aînée de la reine d’Angleterre Victoria (1819-1901) devenue impératrice d’Allemagne par son mariage en 1858 avec le futur empereur Frédéric III (1831-1888) et à ce titre parfois nommée « impératrice Frédéric ». Ce voyage en France d’une semaine a eu lieu à la fin de janvier 1891, il y a trois mois. Sa visite de Versailles où Guillaume Ier avait été sacré empereur vingt ans plus tôt n’était pas une bonne idée et a causé bien des remous et est peut-être à l’origine du texte furibard de Remy de Gourmont.
13 Henri Regnault (1843-1871), peintre académique. Cette bataille de Buzenval (la seconde) se tint dans la banlieue ouest de Paris le 19 janvier 1871, Guillaume ayant été proclamé empereur la veille, dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Dans sa sculpture La Défense de Paris, toujours visible entre les tours de la Défense, Louis-Ernest Barrias a choisi, pour représenter un soldat, le visage d’Henri Regnault.

14 « Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l’impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation : “— Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts.”
Et tout à coup je reçus un violent coup de poing dans le dos, et j’entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l’eau-de-vie, la voix de ma chère petite bien-aimée, qui disait : “— Allez-vous bientôt manger votre soupe, s…. b….. de marchand de nuages ?” » Charles Baudelaire, La Soupe et les nuages, Petits poèmes en prose, Œuvres complètes, Michel Lévy 1869.
15 Jean-Auguste Poulon, Paul Léautaud, l’écrivain paradoxal page 153, Classiques Garnier mars 2023, 600 pages.
16 Allusion à l’éditorial du premier numéro du Mercure (janvier 1890 page quatre).
17 Le Constitutionnel du trois avril page une, colonne cinq, rubrique de Georges Hère : La Vie à Paris : « Le mépris qu’affichent certains pour les Revues de Jeunes me paraît injustifié. Il ne faut pas dire trop de mal de ces recueils périodiques et multicolores. Ils ont sur les quotidiens une supériorité immense : ils ne payent pas la copie. Les opinions y sont, par conséquent, libres, et l’on n’y prend la plume que lorsqu’on a réellement quelque chose à dire, ce qui n’est guère possible à nos grands confrères condamnés à pondre une chronique par jour et parfois davantage. La jeune presse a de nouveau ces jours derniers attiré les poudres de ses aînés. Je cherche à comprendre la cause des injures violentes qui ont accueilli, plutôt mal, l’article de M. de Gourmont sur le Patriotisme, paru dans le Mercure de France. »
18 Note d’Alfred Vallette : « Voir également La Chronique du 11 avril (Bruxelles). »
19 Charles-Désiré Dupeuty et Ernest Bourget, Tromb-Al-Ca-Zar ou Les Criminels dramatiques, bouffonnerie musicale en un acte sur une musique de Jacques Offenbach (1819-1880) créée au théâtre des Bouffes-Parisiens, le sept avril 1856.
20 Amiati (Marie Abbiate, 1851-1889), chanteuse populaire française d’origine italienne.
21 La Revanche, « chanson patriotique », paroles de C. Bertrou brigadier au 24e d’artillerie, musique d’Édouard Lanqueteau : « La revanche à grand pas, de jour en jour avance ; La lueur des combats embrase l’horizon ; Soixante-dix revit mais cette fois, ô France ; dans le sang ennemi tu vas là vers [laver ?] l’affront. »
22 Note des auteurs : « Cet article était écrit lorsque M. Octave Mirbeau a publié dans Le Figaro sa très éloquente protestation : Les Beautés du patriotisme. » L’article d’Octave Mirbeau « Les Beautés du patriotisme » (titre ironique) est paru en une du Figaro du 18 mai et est reproduit infra.
23 Dans la note 12 ci-dessus, était avancé avec une certitude modérée qu’il s’agissait de Victoria Adélaïde mais ce n’est pas très important ici, l’une et l’autre étant parfaites dans le rôle. Ad augusta per angusta !
24 Remy de Gourmont, Sixtine « roman de la vie cérébrale », dédié à Villiers de l’Isle-Adam, chez Albert Savine, septembre 1890 (distribué par le Mercure de France).
25 Le Latin mystique : les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au moyen âge, accompagné d’une préface de J.-K. Huysmans, paraîtra au Mercure en septembre 1892, 400 pages.
26 On comprend mal ce « à l’heure où nous écrivons ces lignes ». Nous sommes au printemps 1891. Le recueil La Chanson des gueux a été publié chez Georges Decaux vers la fin du printemps 1876 et un procès pour « outrage aux bonnes mœurs » s’en est immédiatement suivi, condamnant Jean Richepin à un mois de prison et à 500 francs d’amende. En 1881 Jean Richepin a publié chez Maurice Dreyfous, rue du Faubourg Montmartre, une version définitive, expurgée des cinq textes litigieux mais enrichie de nouveaux.
27 Émile Richebourg (1833-1898), romancier populaire fécond. Pourquoi Émile Richebourg ? La lecture des journaux montre qu’à l’évidence, il est à la mode ces temps-ci de moquer Émile Richebourg, peut-être à cause de la parution de ses romans en feuilletons, l’un suivant l’autre, dans les quotidiens populaires. Ainsi peut-on lire dans la « Chronique » de Philibert Audebrand dans L’Événement du onze mai : « Ah ! c’est pourtant fort joli, ce petit roman ! Bien traité par Émile Richebourg, ça pourrait former cent feuilletions pour le Petit Journal. »
28 Ernest Gégout (1854-1936), fondateur du journal anarchiste L’Attaque a été condamné en avril dernier (1890) à quinze mois de prison pour « incitation au meurtre et au pillage ».
29 Joseph Reinach (1856-1921), journaliste et homme politique, quatre fois député des Basses-Alpes entre 1889 à 1914. Joseph Reinach est surtout connu en tant que directeur du journal La République française où a travaillé quelques jours d’octobre 1889 le jeune Paul Léautaud. Un historien pourrait sans doute expliquer quelle était la teneur de ce projet de loi, Joseph Reinach paraissant être un assez brave homme, ayant œuvré pour la liberté du théâtre et de la presse.
30 Peut-être Ernst Haeckel (1834-1919), biologiste, philosophe et libre penseur, recteur de l’université d’Iéna de 1876 à 1885.
31 Ces qualificatifs proviennent, nous venons de les lire, de l’article de Gaston et Jules Couturat dans La Revue indépendante, qu’Henry Fouquier se garde bien de citer, préférant écrite « on m’a appris… »
32 Les Welches — le Dictionnaire de l’Académie dit Velches — reviennent souvent sous la plume de Voltaire ; c’est le nom sous lequel les Gaulois étaient connus avant la conquête romaine, et ce nom a passé dans notre langue pour désigner des hommes ignorants.
33 La bataille de Rossbach (ss) a et lieu le 5 novembre 1757, opposant l’armée prussienne de Frédéric II aux troupes de Louis XV appuyées par celles de Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780). Il semblerait que le Suisse Voltaire, dans sa correspondance avec le vainqueur, ait raillé les Français sortis piteusement de l’aventure.
34 Poète officiel de Sparte au VIIe siècle avant notre ère, Tyrtée a su créer une forme poétique nouvelle, l’élégie, ou exhortation, chant guerrier à visée éducative.
35 Chez lui, rue des Saints-Pères, le Mercure de France étant fermé depuis le début de la guerre.
36 Dans son mémoire de maîtrise de 2002 sur Jacques Bernard, Julien Doussinault écrit : « Cette phrase, citée de mémoire par Paul Léautaud et faussement attribuée à Remy de Gourmont ». Le « quelque part » de Paul Léautaud, en effet, accompagne toujours cette citation non sourcée, même dans l’article de Paul Guilly « Le souvenir de Rémy de Gourmont » paru dans Le Monde du quatre avril 1958.