Chronique du 1er août 1917 — Chronique du seize septembre 1917
Notes
Page publiée le quinze mars 2023. Temps de lecture : 32 minutes
Le quinze mars de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, est publiée ici une page à propos de la poésie chez Paul Léautaud. Comme cette seule date ne suffit pas, une autre parution annuelle a été décidée arbitrairement, chaque quinze novembre.
Le Mercure de France dès sa création a toujours donné une place très importante à la poésie, et avant lui Le Scapin et de nombreuses autres petites revues de l’époque. Les premiers écrits publiés de Paul Léautaud ont été des poèmes. Chaque numéro publiait un ou plusieurs poèmes et une rubrique permanente a été tenue à partir d’avril 1896 par Francis Vielé-Griffin (mais sur cinq numéros seulement).
Après lui la rubrique a été tenue par Henri de Régnier, puis par Pierre Quillard, jusqu’à sa mort en février 1912. Elle a été reprise par Georges Duhamel, qui a été appelé au front à l’été 1914. À l’entrée en guerre le Mercure a cessé de paraître jusqu’en avril 1915 et la rubrique des poèmes a été délaissée jusqu’en décembre 1916 pour être reprise pendant le restant de la guerre par qui passait dans le couloir à ce moment-là, dont Paul Léautaud.
La chronique sera brièvement (deux numéros en mai et juin 1919) reprise par Georges Duhamel. Elle sera ensuite, bien plus longtemps, entre les mains d’André Fontainas jusqu’en juin 1940. À la reparution de décembre 1946 la rubrique des poèmes deviendra celle de la poésie.
Donc, parmi ces noms, celui de Paul Léautaud, les premier août et seize septembre 1917. Ce qui vient d’être écrit est d’ailleurs faux puisque le nom de Paul Léautaud ne figure pas dans ces deux rubriques signées Intérim.
La première fois que l’événement est annoncé dans le Journal littéraire est le premier juillet 1917 :
J’ai terminé ce soir, à minuit, ma première Chronique de mon intérim des Poèmes au Mercure. J’ai eu bien de la peine à m’y mettre. Voilà presque un an que Vallette attend. J’ai terminé par un éloge de l’excellent Prince Charles-Adolphe Cantacuzène1 qui va lui être une surprise et un plaisir, tel que je le connais. Et dire : quatre soirées, et tout de même un peu de lecture des volumes, et le souci de faire, comme toujours, de mon mieux, tout cela, qui fera cinq ou six pages du Mercure, pour vingt-quatre francs ! Ayez donc du goût à travailler, dans de telles conditions !
Avant de lire cette chronique, le lecteur de 2024 doit être averti que cette chronique comporte un canular dont le poète Vincent Muselli fait les frais. Vincent Muselli (1879-1956), rédacteur aux Marges2 d’Eugène Montfort3, a écrit Les Travaux et les jeux, parus chez Jean Bergue en 1914 (20, rue de Condé). À l’occasion du compte rendu de cet ouvrage Paul Léautaud avance que le nom Vincent Muselli est un pseudonyme de jeunesse de Jean Moréas. C’est évidemment faux, Paul Léautaud voulant seulement marquer ici que Vincent Muselli cherche dans ce texte (et à d’autres occasions) à plagier le style de Jean Moréas.
Dans son Histoire de la poésie française du XXe siècle (Albin Michel 1982), Robert Sabatier a écrit un chapitre « Vincent Muselli ou le charme du savoir ». Mais soixante-cinq ans étaient passés…
Le lecteur de ces premières années du Journal de Paul Léautaud à propos de Paul Valéry lira aussi entre les lignes…
Lisons cette chronique d’abord, nous y reviendrons ensuite. Dans le chapeau, après le titre et le nom de l’éditeur, l’indication du prix, en francs de l’époque.
Chronique des Poèmes du 1er août 1917
Paul Valéry : La Jeune Parque, Nouvelle Revue Française, 6 fr. — François Porché : Nous, Nouvelle Revue Française, 3,50. — Henry Bataille : Le Beau Voyage, édition définitive augmentée de nouveaux poèmes, Fasquelle, 3,50. — Henry Spiess : Attendre, Jullien, Genève, 3.50. — Docteur Barbillion : Mon vieux Collège, Vogel et Cie. — Vincent Muselli : Les Travaux et les Jeux, Bergue, 3 fr. — Charles-Adolphe Cantacuzène : Hypotyposes, Perrin, 3.50.
Il n’y a pas que la mort, en ces temps effroyables, qui fasse des vers. Des gens en font aussi, sans plus de ménagements. Depuis un an et demi, les volumes s’entassent. D’abord, vingt. Puis, cinquante. Puis, la centaine, bientôt. C’est vraiment un beau spectacle. J’en ai joui d’abord à le considérer, gardien professionnel de tous ces trésors. Puis, on m’a dit, un jour : « Si vous lisiez tout cela, et si vous en rendiez compte ? Cela ferait plaisir aux auteurs, et cela fera peut-être plaisir également à nos lecteurs de savoir qu’en dépit des événements, la poésie n’est pas morte. » J’ai accepté. J’ai lu. J’ai réfléchi un petit peu. J’ai évalué la matière de mon travail. Il me faudra deux ou trois chroniques, peut-être quatre ? Voici la première.
Les poètes dont j’ai à parler peuvent être divisés en trois séries : ceux qui ont écrit ou continué leur œuvre en dehors des événements actuels, — les écrivains de métier qui n’ont pas voulu manquer l’occasion de faire un volume sur la guerre, — et enfin les gens à qui la guerre a dérangé l’esprit, qui se sont soudain découverts poètes et qui ont tenu absolument à nous le montrer. Entre eux tous, je mettrai en tête les premiers. Ils le méritent bien.
Voici d’abord M. Paul Valéry, dont on n’a pas souvent l’occasion de parler dans un compte rendu d’ouvrages littéraires. M. Paul Valéry offre un cas curieux dans la poésie d’aujourd’hui. Ce serait exagéré de dire qu’il est très connu du public, et pourtant il a une place au nombre de nos poètes, pour de rares et beaux poèmes qu’il a publiés çà et là dans des revues. Faut-il dire qu’il aurait pu avoir aussi une place au nombre de nos critiques ? Une ou deux Méthodes4, une étude sur Huysmans5, qu’il a publiées autrefois dans le Mercure6, une Introduction à la méthode de Léonard de Vinci7 parue il y a une vingtaine d’années dans la Nouvelle Revue, et ce que ses amis connaissent de ses études demeurées manuscrites, en sont des témoignages. Il faut penser que M. Paul Valéry a gardé sa préférence à la poésie, puisque le premier ouvrage qu’il publie en librairie est, aujourd’hui, La Jeune Parque8, un poème mystérieux, fluide, à la fois plein d’ombres et d’éclats de lumière, édité en une plaquette de luxe par la Nouvelle Revue Française. M. Paul Valéry, qui a très intimement connu Stéphane Mallarmé et subi profondément son influence, demeure aujourd’hui le seul vrai disciple de ce poète. On songe, en lisant la Jeune Parque, à l’Hérodiade9 célèbre :
Oui, c’est pour moi, pour moi, que je fleuris, déserte,
Vous le savez, jardins d’améthyste, enfouis
Sans fin dans de savants abîmes éblouis,
Ors ignorés…
Et M. Paul Valéry, dans la Jeune Parque, recueil de beaux vers du premier au dernier :
Tout puissants étrangers, inévitables astres
Qui daignez faire luire au lointain temporel
Je ne sais quoi de pur et de surnaturel ;
Vous, qui dans les mortels plongez jusques aux larmes
Ces souverains éclats, ces invincibles armes,
Et les élancements de votre éternité.
Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté
Ma couche ; et sur l’écueil mordu par la merveille,
J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille,
Quel crime par moi-même ou sur moi consommé ?…
Ainsi, vingt ans et plus ont passé et M. Paul Valéry a gardé le même rêve. Les mêmes images habitent son esprit, la même beauté le retient, et il est resté, par excellence, le fidèle. Je n’écris pas, songeant à lui, ces mots sans une certaine émotion. C’est une belle chose, la fidélité. C’est une grande chose. C’est une des plus belles vertus. C’est une force, souvent. C’est peut-être aussi, en littérature comme en amour, la plus désastreuse des faiblesses.
La Nouvelle Revue Française a publié également un recueil de poèmes choisis de M. François Porché, sous ce titre : Nous10. On connaît M. François Porché, et ses poèmes d’un ton grave, simple, souvent rude, qui ne sont pas de vains jeux d’art, qui toujours disent quelque chose et ont une saveur bien à eux. Je dirai même qu’il était peut-être un peu prématuré pour M. Porché de publier un recueil de poèmes choisis. Ses trois ouvrages, À chaque jour, Au loin, peut-être, et Humus et Poussière ne sont pas si anciens que plus ou moins de leur contenu ait diminué d’intérêt. Il est vrai, comme l’explique une note liminaire de Nous, qu’on a voulu rassembler là des poèmes de la même veine. Il en résulte un excellent recueil, où l’on retrouve de belles pièces, comme celle commençant :
J’ai songé, bien des fois, à mon lointain ancêtre…11
et les séries intitulées Nos Provinces, Notre Paris, etc., qu’on aura ainsi l’occasion de relire, groupées de cette façon, avec plaisir.
Nous voici maintenant en présence d’un grand personnage, paraît-il, du monde littéraire, un grand écrivain, un grand auteur dramatique, un grand poète. M. Henry Bataille a publié une édition définitive, augmentée de plusieurs poèmes, du Beau Voyage. On sait que le Beau Voyage, ce fut d’abord la réunion de trois plaquettes : La Chambre blanche, Le Beau Voyage et Et voici le jardin. Je me rappelle quand parut La Chambre blanche, en 1895(12). Un soir, à une représentation de l’Œuvre, Jean Lorrain arriva, tenant en main la petite plaquette. Il allait de l’un à l’autre, la montrant, en lisant tel ou tel passage. « C’est bien autre chose que du Jammes ! » disait-il et redisait-il. Je ne reprendrai pas le parallèle. C’est un genre littéraire que je ne goûte guère. Je ne mets d’ailleurs nullement en doute que les vers de La Chambre blanche aient été écrits avant que les premiers vers de M. Francis Jammes fussent connus13. J’estime même qu’on ne trouve dans les premiers aucune imitation des seconds. J’exprimerai seulement cette opinion : c’est que M. Henry Bataille, s’il a un grand talent, un très grand talent, il est vrai, c’est uniquement celui de faire illusion. Illusion avec ses pièces de théâtre14, illusion avec ses poèmes. Et quand je dis cela, je l’entends pour le commun des lecteurs. Quiconque a vraiment le sens et le goût de la littérature, ce qu’on appelle la « sensibilité littéraire », ne s’y peut laisser prendre. M. Henry Bataille écrit dans ses pièces, dont les sujets sont déjà inventés à l’extrême, des couplets filés en métaphores, d’un sens un peu trouble et équivoque dans leur signification comme dans leur syntaxe, et on crie aussitôt à la poésie. Les amateurs de cette poésie la retrouveront dans les poèmes du Beau Voyage, édition définitive15. Ces poèmes, en effet, n’ont en réalité aucune beauté verbale ni spirituelle, ils ne sont faits que d’exclamations, d’interjections, de lambeaux, de toutes petites notations tantôt niaises, tantôt fades, mises bout à bout fort désordonnément, ils sont écrits souvent dans le plus pur pathos, et ils sont, par-dessus le marché, dans leur ensemble, d’une longueur !… qui les enchantera. Je regrette de ne pouvoir les mettre en goût par la citation de quelques exemples. Je leur recommande, en tout cas, des poèmes comme Dialogue de rentrée16, Le jardin d’imagination, L’Œuvre, Épilogue, Le Nom, La ligne d’horizon, Passage, La Douleur moderne, La lumière électrique, Rupture, et bien d’autres. Ils sauront, d’ailleurs, ne pas faire un choix, et ils auront raison. M. Henry Bataille, c’est une autre justice à lui rendre, n’est pas économe de son talent, et dans le sens des qualités que je viens d’énumérer, tout le volume est à lire. Pour moi, que ces beautés ne séduisent point, je le dis comme je le pense : Quelle illusion sur soi-même il faut avoir pour écrire de pareilles choses, quelle confiance, quel aveuglement ! Et ces choses donnent la réputation, une réputation extrêmement provisoire, c’est entendu, mais, enfin, une réputation, tout de même ? Il n’y a qu’un mot pour qualifier le tout : c’est merveilleux.
C’est un doux poète, et intéressant, que M. Henry Spiess17. Un grand poète ? Non. Je le lui dirais qu’il serait le premier à en éclater de rire. Mais il est un poète intéressant parce qu’il se met tout entier dans ce qu’il écrit, et que ses poèmes sont vraiment l’histoire de son âme et de sa vie. J’ajouterai que, grand rêveur, il a des dons d’humour, d’ironie, qu’il se plaisante aisément soi-même, et cela donne un goût particulier à l’amertume, à l’inquiétude, au constant désenchantement qu’on sent sincères et invincibles chez lui. Il y a des morceaux de lyrisme, il y a même, Dieu me pardonne, des morceaux de poésie religieuse dans le nouveau volume qu’il publie : Attendre18, mais il y a surtout (série intitulée Printemps 1907) de la poésie intime, familière, des croquis, des promenades, des souvenirs de sa vie à Paris, qui sont peut-être le meilleur de l’ouvrage. M. Henry Spiess est un poète qui s’analyse sans cesse non seulement comme homme, mais comme poète-même (on sent qu’il doit lire beaucoup de poètes et être en perpétuelle comparaison entre eux et lui). Lisez, par exemple, cette poésie, dans laquelle la franchise du poète s’exprime avec bonhomie19 :
Quand on écrit des vers qui vont quatre par quatre,
souvent il n’y en a qu’un ou deux qui soient bons.
Les autres sont oiseux, poncifs ou disparates.
L’oreille alors est satisfaite, l’âme non.
Et c’est pourquoi Laforgue, à mon sens, eut raison.
Souvent, quand on écrit des vers en rimes plates,
on ne songe, avant tout, qu’à les bien cadencer.
Comme un danseur de corde avec son balancier,
on avance, tâchant de le faire avec grâce.
Et, les trois quarts du temps, ça devient du métier ;
et la rime est un point commode de l’espace
où l’esprit se rassure au moment de broncher.
Car nous portons en nous, parfois, tant de paresse,
tant de servilité, tant de routine aussi,
qu’en acceptant la loi nous cherchons un appui,
et qu’ainsi nous cachons ou parons nos faiblesses.
Par exemple : Un quatrain est assez réussi ;
les vers se tiennent bien et l’idée est complète.
Mais on se dit qu’en rester là ce serait bête,
puisqu’on a du talent et puisqu’on est poète.
On relit son quatrain, on rôde autour,
et c’est alors qu’on se décide à construire un sonnet.
Or c’est un jeu pareil aux bouts rimés des gosses.
On jongle avec les quatre rimes de rigueur,
en se donnant les gants de faire un tour de force.
On ne dit rien de neuf, mais on sourit en cœur.
On est un peu comme un prestidigitateur
qui fait un tour connu devant une assistance.
Et lorsque les tercets ont alterné leurs rimes,
(pauvres rimes, cent fois banales, tristes rimes !),
le dernier vers est là comme une révérence.
Je viens de parler de la poésie intime, familière, de M. Henry Spiess. J’aurais dû me contenter d’écrire : intime. Familière est un peu trop. Cette épithète, c’est aux vers du Docteur Barbillion qu’elle s’applique exactement. Mon vieux Collège (que les typos ne me fassent pas de coquille, il ne s’agit nullement d’un ouvrage galant), ce sont les vers d’un médecin20 qui rime les souvenirs de son enfance, de ses études, de sa jeunesse au quartier latin. Cela rappelle les chansons de caveau, les pièces rimées de banquets de commémoration, de dîners de société : bonne humeur, simplicité, avec une pointe de sentiment. Le Docteur Barbillion ne s’est d’ailleurs pas abusé sur leur mérite. Son volume est hors commerce. Il a écrit ses vers pour son plaisir, pour ses amis, pas davantage. C’est une réserve qu’on voudrait voir à beaucoup de poètes.
On sait que Jean Moréas21, dans sa jeunesse, a collaboré à de petites revues, sous le pseudonyme de Vincent Muselli, avec des vers dans lesquels il s’essayait pour l’œuvre qui devait un jour établir sa réputation. Ses amis ont tenu à réunir ces vers en un volume, Les Travaux et les Jeux22, auquel ils ont laissé comme nom d’auteur, selon la volonté du poète, celui qu’il avait choisi pour ces esquisses. Le futur poète des Stances s’annonce bien dans ces courts poèmes que son goût parfait lui avait fait réserver de son vivant. Malgré quelques tâtonnements, on trouve là, déjà, toutes les hautes qualités qui devaient faire de lui un maître inimitable. On en jugera par quelques citations ;
Ce bel été va fuir qui depuis de longs mois
Les grâces à son char maintenait enchainées,
Et qui, fidèlement, selon de justes lois
De joie et de lumière emplissait nos journées.
Rien ne le retiendra, ni vous suprêmes fleurs,
Ni vous qui périssez abeilles innocentes,
Ni votre deuil jardins, fontaines ni vos pleurs,
Hélas ! ni vous forêts vainement gémissantes.
Et ceci encore ;
De ces jardins pompeux et brillants la nuit sombre
Déjà détruit la forme et trouble les couleurs ;
Les marronniers, les pins ne sont qu’un noir décombre
Et le jour fatigué se retire des fleurs.
Ne prends point de souci des arbres ni des roses,
Qu’importe à notre amour leur indigne trépas ?
Là ! notre cœur échappe au désastre des choses,
Lui qui sent venir l’ombre et qui ne tremble pas23
Évidemment, tous les ouvrages dont je viens de parler ont des mérites. Au moins ceux que je me suis permis de leur reconnaître. Eh bien, je les donne tous pour celui-ci : Hypotyposes24, par M. Charles-Adolphe Cantacuzène. Un livre charmant, tendre, gracieux, spirituel, une œuvre fort originale, qui plus est, et celle d’un vrai poète, chez qui le sourire atténue l’émotion, la nuance, y met plus de douceur, et ce je ne sais quoi qui fut la gloire et l’attrait des lettres françaises et qui n’est plus de nos jours qu’un souvenir, même fort oublié. M. Charles-Adolphe Cantacuzène a grandement raison d’évoquer à plusieurs reprises, dans son livre, la mémoire du Prince de Ligne26-27. Moi qui ai lu Hypotyposes sans en sauter une ligne, qui ai entrevu, à deux ou trois reprises son auteur, homme simple, charmant, à la fois réservé et cordial, je sais qu’il n’y a, dans ces rappels répétés du Feld-Maréchal, aucune affectation. Je dirai plus : par son esprit, sa légèreté, sa grâce railleuse, M. Charles-Adolphe Cantacuzène offre plus d’une ressemblance avec le malicieux écrivain, le dandy épicurien et cosmopolite, le grand seigneur toujours riant et se moquant, qui nous a laissé tant de pages piquantes, exquises, écrites comme en se jouant, soit qu’il fit son portrait diurne et nocturne, qu’il nous racontât ses conversations avec Jean-Jacques ou ses visites à Voltaire, qu’il nous parlât de la guerre, des femmes et de l’amour, ou qu’il nous peignît quelques-uns des personnages de son entourage ou de ses connaissances. On pourra, lire dans Hypotyposes, pour juger de cette parenté spirituelle, les pages que M. Charles-Adolphe Cantacuzène a intercalées entre ses poèmes, et qui sont intitulées : Digression sur la gloire, Extrait de je ne sais quoi, Projet de notice sur un Rivarol que j’ai trouvé, Dépouillement lyrique de mon cabinet, Philosophie d’un passager du XIXe au XXe siècle. On verra si cela n’est pas de la meilleure grâce, finement et justement senti et exprimé, et plein de séduction. À côté de nos livres d’aujourd’hui, si lourds, si bêtes, si prétentieux, toujours occupés de nous enseigner quelque chose, et qui semblent écrits par des manœuvres pleurards ou professoraux, de telles pages, écrites sans importance et qui n’en valent pas moins, sont un heureux délassement. Ici, cependant, le poète seul, chez M. Charles-Adolphe Cantacuzène, doit m’occuper. Je ne lui retirerai, pour cela, aucune des qualités que je viens de lui reconnaître. Qu’il écrive en prose ou en vers, elles lui demeurent, et ce sont encore elles qui donnent à ses vers leur charme et leur originalité. Il a de plus ce grand mérite, ce mérite si rare, d’être bref à merveille, et croyez-moi, son laconisme n’en dit pas moins, en dit souvent plus que beaucoup de pièces interminables de beaucoup de poètes. En voulez-vous quelques exemples ? Voici un Poème :
Monotonie étrange et rapide des jours !
Ô jours qui deviendrez, dans mon hiver, trop courts !
Et ceci, comme madrigal À une dame :
Chaque an, Madame, tu te rajeunis d’un an,
Et tu vas à rebours rejoindre le néant.
Et encore ce distique :
Poison ne donne mort, que pris à faible dose.
Médiocre talent donne la gloire rose.
Ce n’est d’ailleurs, ici, qu’une face du talent de M. Charles-Adolphe Cantacuzène. Ne croyez pas, sur ces exemples, qu’il soit dénué d’élégie, qu’il soit sans mélancolie et sans tendresse, qu’il n’y ait rien en lui de cette rêverie et de cette émotion sans lesquelles il n’est pas de vraie poésie. Dirais-je, sans cela, qu’il est un poète ? Mais cette élégie, cette mélancolie, cette tendresse, cette rêverie, cette émotion, chez lui sont comme adoucies, comme voilées par l’esprit qui les surmonte, qui se joue d’elles et en sourit, à la fois par intelligence, par pudeur et par élégance. Je vous citerai, en témoignage, ce Sonnet :
Mon destin qui vogua, très sincère et loyal,
à travers le dédale ancien des aventures,
dans un parfum exquis, romanesque et brutal,
se repose aujourd’hui dans les choses futures.
Il attend sans frisson dans le repos final,
malgré la molle horreur sans fin des pourritures,
quelque métempsychose, ou quelque sidéral
passage en des lieux d’or et de visions pures.
Quant à ces pauvres vers que dans mes pauvres ans
je fis sans avoir ni maîtres ni partisans,
qu’ils trouvent dans l’oubli sépultures heureuses.
L’ambre faux dure plus hélas que l’ambre vrai ;
mes œuvres deviendront, tôt, des feuilles cendreuses ;
et bientôt dans l’oubli tout seul je m’en irai.
Je vous ferai lire également le sonnet qui suit. J’aime beaucoup les bêtes. Elles me consolent des gens d’esprit, qui sont si rares à notre époque. M. Charles-Adolphe Cantacuzène a pour compagnon de ses rêveries un brave bonhomme de petit chien. Il n’a pas craint, que dis-je ! il a eu l’équitable tendresse de l’honorer d’un sonnet. Ce genre de littérature est extrêmement difficile. On s’égare souvent dans le lyrisme, ou l’on tombe dans la niaiserie. Vous allez voir quelle chose charmante, aimante, souriante, M. Charles-Adolphe Cantacuzène, lui, a su écrire là :
Ô petit chien solide aux longs poils non lissés,
pas si petit vraiment ! Argent, or et lumière ;
Charley, le mien Charley, la fleur des écossais,
chien rencontré soudain un jour, bien en arrière.
Bête spirituelle aux regards insensés,
comme tu sais tourner ta tête singulière
de côté, de guingois ; — et que de jours passés,
où tu faisais le beau vers l’heure sucrière28 !
Les jours ont coulé sur ta moustache, si longs ;
sur tes beaux poils, ô chien, démesurément blonds,
qui t’inondent les yeux de leur tamis de lune.
Et longtemps, ô bouffon, nous avons de travers,
toi de tes aboîments, et, moi, moi de mes vers,
nous avons noblement égayé la fortune.
Et maintenant, je peux bien vous le dire : c’est à dessein que j’ai ainsi gardé pour la fin de ma chronique l’ouvrage de M. Charles-Adolphe Cantacuzène. Si j’avais commencé par lui, avec le plaisir que j’ai eu à le lire, je n’aurais pas pu parler d’autre chose.
* * *
Cette chronique, parue en ouverture de la « Revue de la quinzaine » du Mercure du premier août 1917 a donné lieu, comme il fallait s’y attendre, à quelques réactions concernant le compte rendu de l’ouvrage de Vincent Muselli Les Travaux et les jeux. Avant la réaction de Vincent Muselli lui-même, plus tardive, lisons le Journal littéraire aux six et sept août :
Ce matin, au Mercure, deux lettres adressées à Vallette au sujet de ce que j’ai écrit sur Vincent Muselli dans ma Chronique des Poèmes, Mercure du 1er août. L’une d’Adrien Bertrand29, l’autre d’un nommé Narcisse Lefèvre30, ami de Billy, paraît-il, et pour le moment soldat à Pont-Audemer. Cette dernière est impayable dans son genre, pour la niaiserie et l’abracadabrant qu’elle révèle chez son auteur. Vallette est absent et ne rentrera que lundi prochain. Nous verrons ce qu’il en dira.
Puis, le lendemain sept août :
À propos du même morceau sur Muselli, Dumur me raconte aujourd’hui que Meyerson31, l’ami et l’exécuteur testamentaire de Moréas, lui a dit : « Qu’est-ce que c’est que cette affaire de pseudonyme de Moréas, Vincent Muselli, dans sa jeunesse ? Je n’ai jamais su cela ? » Il prenait la chose au sérieux. Dumur l’a éclairé, et Meyerson alors : « Mon Dieu ! que je suis bête. »
Je passais ce soir devant la boutique de Mlle Monnier, rue de l’Odéon. Elle est sortie, pour me prier d’entrer, au sujet des croûtes qu’elle a eu la gentillesse de me mettre de côté.
[…]
Elle m’a dit aussi que ma Chronique des Poèmes a eu un vif succès auprès de tous les gens qui fréquentent chez elle. Tous m’ont reconnu32, et ont été enchantés d’une telle critique littéraire reprise dans le Mercure. Que le succès s’acquiert à peu de prix ! Surtout parce que personne ne disant rien en écrivant, dès qu’on dit quelque chose tout le monde le remarque.
Rencontré le charmant Cantacuzène ce soir, chez Dorbon, rue de Seine33, où j’étais entré pour demander s’il avait les quatre volumes d’Arnault : Souvenirs d’un Sexagénaire34. Parlé de la guerre. Il voit la fin pour cette année. Grande amertume pour le tour affreux joué à la Roumanie par l’Angleterre, la France et la Russie réunies, en la faisant entrer dans la guerre, au moyen de mille promesses dont aucune tenue, bien au contraire.
Alfred Vallette est rentré de vacances le treize août :
Vallette, rentré ce matin de vacances, a lu ce soir devant moi les deux lettres d’Adrien Bertrand et de Narcisse Lefèvre, au sujet de ma Chronique des Poèmes. « Je ne réponds généralement pas à ces lettres. Je ne répondrai même pas à Bertrand. » Il m’a dit aussi qu’il a reçu, avant son départ, une première lettre à propos de ma même Chronique, lettre signée seulement d’un D, et dans laquelle on exprime le regret de voir parler de vers sur un tel ton, c’est-à-dire, sans doute, pas assez sérieux, respectueux, etc. Il faut de grandes phrases aux gens, et surtout pour parler de poésie, de grandes phrases creuses, nuageuses. Sans quoi on manque de respect envers l’art sacré, et on passe même pour ne pas l’aimer et n’y rien comprendre.
Puis, le quinze août :
Malgré ce jour de fête, je suis allé aujourd’hui au Mercure. Vallette me montre une lettre qu’il a reçue de Muselli, à la fois prétentieuse et dénuée du moindre esprit. Il la mettra dans le prochain numéro.

Dans son Journal au 25 août, Paul Léautaud revient sur cette affaire :
Tout d’abord, avec le patron, j’avais trouvé cela un peu bébête. Puis, la lettre devant être insérée, il m’est venu cette réflexion : le lecteur va peut-être se dire : « Muselli sait qui est Intérim et il sait qu’Intérim a la vérole35. » Rencontrant Apollinaire, qui avait lu la lettre dans les épreuves des Échos, je lui avais soumis cette réflexion et il avait été de mon avis, m’apprenant en outre que Vallette avait fait un commentaire bien peu piquant à la lettre de Muselli. Le lendemain ou le surlendemain, j’ai dit ma réflexion à Vallette, ajoutant : « C’est bête si on veut. Tout de même, cela ne m’irait pas qu’on puisse croire que j’ai la vérole. » Il n’a pas été de mon avis, et surtout, il était si content de son commentaire qu’il s’est mis à me lire, que je n’ai pas insisté.
Il a encore reçu une lettre sur le même objet, assez drôle, d’un anonyme qui se vante d’avoir averti Narcisse Lefèvre du couplet sur Muselli, attendu que ledit Narcisse Lefèvre, dit-il, s’est institué quelque chose comme le cornac de Muselli.
Chronique du seize septembre 1917
Cette chronique de six pages (deux de moins que la précédente), traite de douze auteurs mais six seront expédiés dans le même paragraphe. Les nombres figurant à la suite du nom de l’éditeur sont toujours le prix de vente public.
O.- W. Milosz : Poèmes, Figuière, 3,50. — Germaine Emmanuel-Delbousquet : L’Heure fuit, s. n. édit. 2. — Ch. Millerd-Vannoy : L’Humble lyre, Delesalle, 1,25. — G. Cousinou : Au Hasard des Rêves, Figuière, 3,50. — Oscar-Paul Gilbert : Les Clartés intimes, chez l’auteur, 2,50. — Marcel Bosc : Fresques et Croquis, les Forgerons, 1,25. — Raymond Méchain : Le Missel de Chérubin, Messein, 3. — René Schwob : Les Cantiques de la Vie, les Forgerons, 0,75. — Charles de Saint-Cyr : L’Âme et le Cœur, précédés du Troisième Essai sur l’Intensisme, Marcel Rivière, 5. — Maurice Heine : La Mort posthume, Meynial, 7,50. — Adrien Bertrand : Les Jardins de Priape, Dorbon aîné. — René-Marie Hermant : Vingt-deux Ballades goguenardes, malévoles, inutiles ou perverses, illustrations de Jimmy Mosso, Jouve.
Il est nécessaire de donner un petit supplément à ma première chronique. Nous sommes toujours avec les poètes qui ont accompli ou continué leur œuvre sans rien qui touche à la guerre actuelle. Me permettra-t-on, à ce sujet, de dire que cela ne veut pas signifier qu’ils n’ont été atteints en rien par cette guerre, sentimentalement ou philosophiquement ? Ils ont, peut-être, au contraire, été touchés par elle très profondément, beaucoup plus que d’autres qui se sont mis soudain à claironner à grand fracas. Seulement… Ce seulement est bien délicat à exprimer. Nous verrons s’il y a moyen de le faire quand nous en serons à ceux qu’il faut bien appeler, pour la commodité du langage et pour cela uniquement, les poètes de la guerre.

M. O.-W. Milosz36 a publié un recueil : Poèmes. C’est très romantique, plein de nuit et de fantômes, de rêveries macabres et hallucinées. C’est Baudelaire et Rollinat37 associés, avec un peu d’un Heine38 qui aurait perdu sa légèreté. Au reste, un grand talent et des accents vraiment poétiques et bien des choses qui ne sont pas ce qu’on lit tous les jours. On excusera, et les auteurs tous les premiers, la brièveté de mes remarques. On comprend que je ne puis donner que des appréciations de lecture, et non une étude, même rapide, sur chaque poète. Voici (les citations sont encore ce qu’il y a de mieux pour renseigner) un poème de M. Milosz, qui semble exprimer assez bien le ton général de son inspiration. M. Milosz se sert fréquemment de vers de quatorze ou quinze pieds, même quelquefois plus, mais toujours, on va le voir, avec une grande adresse de rythme et sans que l’harmonie y perde en rien.
Danse de singe39
Aux sons d’une petite musique narquoise, sautillante,
Essoufflée, — tandis qu’il pleut, tandis qu’il pleut de la pluie pourrie, Saute, saute, mon âme, vieux singe d’orgue de Barbarie,
Petit vieillard pelé, sournois, animal romantique et tendre.
Avec ta queue d’automne effeuillée, prétentieusement tordue
En point d’interrogation sur le vide ciel du crépuscule,
Essuie tes pleurs, singe galant, mélancolique et ridicule,
Singe galeux de l’amour mort, singe édenté des jours perdus.
Encore un air, encore un air ! Celui qui sent les tabagies,
Le faubourg lépreux, la foire d’automne et les fritures aigres,
Pour faire rire les filles mal nourries, — ô sale, affreux, maigre,
Piteux, épileptique singe, animal pur des nostalgies !
Encore un air, hélas ! le dernier ! — Et que ce soit cette sourde
Valse de jamais, requiem des voleurs morts, musique en échos
Qui dit : adieu les souvenirs, l’amour et la noix de coco…
— Tandis que la pluie pauvre fait glouglou dans la boue vieille et lourde. —
Je viens de feuilleter de nouveau, dans les volumes que j’ai préparés comme matière de cette chronique, l’Heure fuit, de Mlle Germaine Emmanuel-Delbousquet40, l’Humble race, de M. Ch. Millerd Vannoy, Au hasard des Rêves de M. G. Cousinou41, les Clartés intimes, de M. Oscar Paul Gilbert42, Fresques et Croquis, de M. Marcel Bose, le Missel de Chérubin, de M. Raymond Méchain43. Décidément, je n’en dirai rien. Tous ces vers sont sans consistance, les thèmes sont usés, ressassés : tous les lieux communs poétiques. Ces auteurs sont à la fois extrêmement jeunes et extrêmement vieux. Je n’en pourrais dire que du mal, et j’ai horreur de dire du mal des gens.
J’aime mieux vous dire deux mots d’une petite plaquette de M. René Schwob44 : les Cantiques de la Vie. Elle est ornée, — ornée ? — d’une préface de M. Paul Adam45. Il est toujours bien difficile de saisir ce que veut dire M. Paul Adam, même dans une petite préface comme celle-ci, qui compte au plus une vingtaine de lignes. Cela tient-il à la confusion de son esprit, à son incapacité d’écrire clairement ou à son amour de ce qu’il croit être le beau style, on ne le saura sans doute jamais. Voici, en tout cas, la phrase finale de la petite préface en question : « Je salue avec foi les promesses que vous nous dites aujourd’hui. » On me pardonnera, mais après cela, je n’ai pas osé lire les poèmes de M. René Schwob. J’ai eu peur de les trouver écrits dans une langue aussi élégante.
M. Charles de Saint-Cyr46 n’est pas bon comme moi. Il a publié un recueil de poèmes : l’Âme et le Cœur, qui sont précédés d’un Troisième Essai sur l’Intensisme47. Il faut dire, pour l’intelligence de ce mot : troisième, que M. Charles de Saint-Cyr a déjà publié, en 1911, un Nouvel Essai sur l’Intensisme en Poésie48, et qu’à cette date, un précédent ouvrage de lui : Matines49, recueil de poèmes paru en 1910, comportait un Essai sur l’Intensisme. Pour nous en tenir à ce Troisième Essai, c’est un bel éreintement de quelques poètes qui ne sont pas dans la vérité poétique selon M. Charles de Saint-Cyr, et l’auteur y met toute l’ardeur d’un homme qui détient la vérité et combat l’erreur. MM. Rostand, Jules Romains, Saint Georges de Bouhélier, Fernand Gregh, Maurice Magre50, pour nous en tenir aux vivants, car certains morts aussi ne sont pas épargnés, peuvent lire là, sur leur compte, des choses peu aimables. L’Intensisme, ou « réalisation directe du moi dans la pensée, le sentiment ou la sensation » est, à en croire M. Charles de Saint-Cyr, la poésie de demain, laquelle enterrera bien profondément la poésie d’aujourd’hui, en compagnie de la poésie d’hier. Comme poètes de l’Intensisme, M. Charles de Saint-Cyr nomme M. Louis Mandin51, M. Paul Géraldy, M. Henry Spiess, M. Henry Dérieux, M. Guy-Charles Cros, M. Fernand Divoire, M. Jehan Rictus, plus quelques dames dont la particularité la plus intense est d’être parfaitement inconnues. Je connais l’œuvre de chacun des poètes que je viens de nommer après M. Charles de Saint-Cyr. On m’eût dit que c’est là de l’Intensisme, j’en eusse été bien étonné. Au reste, cette formule que nous propose M. Charles de Saint-Cyr, et qui le fait « manifester » ainsi à trois reprises, n’est-elle pas la formule de toute vraie poésie ? Relisons les mots : « réalisation directe du moi dans la pensée, le sentiment ou la sensation ». Un vrai poète, vraiment personnel, original, fait-il autre chose ? Mais il semble que rien ne puisse mieux nous renseigner sur l’Intensisme en poésie que les poèmes mêmes de son promoteur. J’ouvre de nouveau son recueil. Je lis bien des poèmes d’une inspiration religieuse assez fade et puérile, d’autres sur des thèmes bien peu neufs, d’autres dans lesquels s’expriment une rêverie et une mélancolie qu’on sent sincères et profondes, sans toutefois rien de particulier dans l’expression, et je trouve enfin ceci, qui me semble trancher sur l’ensemble :
Si vous avez compris, c’est bien ! mais taisez-vous.
Si vous n’avez pas su de ce cœur trop sonore
Sentir les battements, ah ! taisez-vous encore,
Et que le navrement du soir vous semble doux.
Des rêves non vécus, de précises images
Se heurtent dans mon cœur qui souffre et qui se tait,
Et c’est un tel combat que la mêlée en fait
Ardre à nouveau la cendre éteinte de ses pages.
Quoi ! cette âme d’effroi, quoi ! ce cœur palpitant
Ne goûtent pas encor le calme et le silence ?
Ah ! taisez-vous ! j’ordonne et fais le geste immense
Du Sphinx, et je m’endors les yeux ouverts tout grands.
Est-ce bien intense ?
De plus, ne peut-on pas dire que la formule poétique proposée par M. Charles de Saint-Cyr peut aboutir, comme toutes les autres formules de ce genre, à des œuvres inexistantes aussi bien qu’à des œuvres de génie ? Un poète n’a que les pensées, les sentiments et les sensations de tout le monde. Il les réalise, c’est-à-dire il les exprime, et naturellement, c’est zéro. Mais il les a réalisés « directement ». M. Charles de Saint-Cyr aura beau dire ; c’est un intensif. À ce compte-là, je crois que nous n’en manquons pas.
Par exemple, il y a deux poètes que je recommande. C’est d’abord M. Maurice Heine52, auteur d’une plaquette : La Mort posthume, suite de sonnets. Cette plaquette porte en sous-titre : Fouilles d’Antinoë. C’est dire toute son inspiration. M. Maurice Heine écrit des vers sur des momies qu’il a été regarder dans leur sarcophage. Rarement poète a mieux rendu son sujet. Les vers sont morts. La couleur est à peu près absente. C’est le néant, à peine soutenu par quelques bandelettes, et si l’on y touche tout tombe en poussière. Le second poète est M. Adrien Bertrand53. Les poèmes qu’il a réunis sous ce titre : Les Jardins de Priape, s’apparentent excellemment aux sonnets de M. Maurice Heine. M. Adrien Bertrand écrit sur l’antiquité, et ses vers sont, en effet, merveilleusement démodés. Jugez un peu, je vous prie, de ce tour de force (La mort posthume) :
LA PORTEUSE DE MIROIR
Ton suprême linceul, retournant en poussière,
A livré le secret de ton corps à nos yeux,
Et, froide et noire ainsi qu’un bronze précieux,
Ta nudité s’expose en ce tombeau de verre.
Mais l’habile embaumeur qui fut ton statuaire,
Lorsqu’il mit ta dépouille au rang de tes aïeux,
Apposa comme un sceau le disque radieux
Qui retint sur ton front le voile funéraire.
Porteuse de miroir ! nul ne doit délier,
Car sa tige le fixe aux grains de ton collier,
Cet écran de métal, où la douleur humaine
Saura lire à nouveau l’inéluctable loi,
Quand la jeune vivante, en se penchant sur toi,
Prêtera son visage à la morte lointaine…
et de celui-ci (Les Jardins de Priape) :
LE COMBAT
Point de courses de char et plus de ceste hellène,
Mais des combats versant des flots de sang humains !
Tout le peuple est en proie aux fureurs de Silène :
Le Préfet a voulu des jeux vraiment romains.
Gladiateur gaulois, rétiaire54 ionique :
Ou le glaive pesant et le casque d’airain
Ou près du fin trident le filet ironique ?
Mais le Celte a rougi le sable du terrain…
Se rend-on compte du talent modéré qu’il faut pour écrire de pareils vers ? M. Charles de Saint-Cyr fait campagne pour l’Intensisme et appuie ses poèmes de nombreux manifestes. MM. Maurice Heine et Adrien Bertrand sont d’une école plus calme et ils ont cet avantage, pour nous éclairer, de n’avoir pas besoin de manifestes : leurs vers suffisent.
On sait combien la ballade est un genre difficile. Il y faut non seulement beaucoup de virtuosité, mais encore une grande science du vocabulaire. M. René-Marie Hermant55 a composé Vingt-deux Ballades qui, comme le titre de son recueil le dit, sont tour à tour goguenardes, malévoles, inutiles ou perverses. Je crois qu’on lira avec amusement celle-ci qui rappelle les meilleurs exemples donnés, dans ce ton, par M. Laurent Tailhade.
BALLADE DE LA PLUS GRANDE SOUFFRANCE
Après le poulpe élastique aux yeux ternes,
Le gonocoque et la chair de cafard,
Le typhus noir, haleine des citernes,
Le chancre mou et les crocs du grisard,
Les vibrions, bourgeonnant avec art
En la tiédeur des bouillons de culture,
Et le sarcome, éponge à confiture,
Et l’acarus, et la morve des veaux,
Et le flux blanc, pulpe des aboutures :
« Voici l’homme qui chante faux. »
Dans les salons, les bordeaux, les tavernes,
Chez les bourgeois, chez les putes à fard,
Aux feux d’un lustre ou sous une lanterne,
Quand il arrive, importun et blafard,
Le toupet droit, l’œil au fond d’un brouillard,
On boit son verre, on lâche sa pâture ;
Le plus prompt fuit derrière une tenture,
On bondit sur ses feutres, ses manteaux ;
L’alarme court jusque sur la toiture :
« Voici l’homme qui chante faux. »
Plus de pendus illustrant les poternes
Et que toisonnent des corbeaux braillards ;
Plus d’étrangleurs opérant en cavernes,
Plus de garrots, veuves, ni tranche-lards ;
Ce ne sont là qu’articles de bazar,
Amusements et simili-tortures.
Pour lapider sur toutes les coutures,
Vider le ventre, et tous autres travaux,
Mort lente ou brusque, ou simples courbatures :
« Voici l’homme qui chante faux. »
ENVOI
PRINCE Puant des géhennes futures,
Outre les viols, meurtres et forfaitures,
Un criminel coupe encore à ta faulx.
Qu’attends-tu pour le foutre à la friture ?
« Voici l’homme qui chante faux. »
************
Cette chronique est parue dans le Mercure du seize septembre. Le 21, Alfred Vallette recevait une lettre de Paul Adam. Journal littéraire à cette date :
Vallette a reçu tantôt une lettre de Paul Adam au sujet des quelques lignes que j’ai écrites sur ce bonhomme dans ma dernière Chronique de Poèmes (Mercure 16 septembre). Quel niais, ce Paul Adam, et que sa lettre lui ressemble. Vallette riait bien en la lisant.
Notes
1 Charles-Adolphe Cantacuzène (1874-1949), poète, homme de lettres et prince roumain, a fait l’objet d’une page parue le premier mars 2024.
2 « Les Marges : gazette littéraire par Eugène Montfort » créée en novembre 1903 et parue jusqu’en 1937. Eugène Montfort en fut l’unique rédacteur jusqu’en 1908 (douze numéros), année qui vit également la parution du premier numéro de La Nouvelle revue française.
3 Eugène Montfort (1877-1936), créateur du mouvement littéraire « Naturiste », fondateur de la revue Les Marges, éditeur historique, le 15 novembre 1908, du premier « premier numéro » (il y en aura un second) de La Nouvelle revue française. Un portrait d’Eugène Montfort a été dressé par Paul Léautaud qui s’est rendu chez lui, rue Chaptal, le 28 septembre 1908. Un autre portrait en sera dressé par André Billy dans La Terrasse du Luxembourg, pages 297-298. Pour les circonstances particulières de la mort d’Eugène Montfort, voir le Journal littéraire au 13 décembre 1936.
4 Mercure d’octobre 1897, janvier 1898 et mai 1899. Ces « Méthodes » étaient des critiques de livres utilitaires. La troisième et dernière, page 481, traite du temps.
5 À propos de Durtal, personnage commun à quatre romans de J.-K. Huysmans, Là-bas (Tresse & Stock 1891, 441 pages), En route (Tresse & Stock 1895). La Cathédrale (Stock 1898, 488 pages) et L’Oblat (Stock 1903, 448 pages), qui n’était pas paru au moment de la rédaction de l’article de Paul Valéry dans le Mercure de mars 1898. En 2015, l’éditeur Bartillat a réuni ces quatre ouvrages sous la même couverture, enrichis d’une préface de Paul Valéry.
6 Dans le Mercure, Paul Valéry a aussi publié, pour être complet, mais bien après ces dates, « La Conquête allemande (1897) » dans le Mercure du premier septembre 1915, « Aurore », un poème assez quelconque, dans le Mercure du 16 octobre 1917 et « Le Rameur », un autre poème dédié à André Lebey (neveu d’Édouard Lebey) dans le Mercure du premier décembre 1918. Ces parutions ont eu lieu dans le Mercure tout simplement parce que La NRF était fermée depuis août 1914. Dès la réouverture de La NRF, dans le numéro d’après-guerre (juin 1919) nous y verrons un poème de Paul Valéry et en ouverture du numéro d’août un grand article (seize pages) sur « La crise de l’esprit ».
7 Nouvelle Revue, 1894, réédition Gallimard 1919.
8 Gallimard, 1917.
9 Premier poème de Stéphane Mallarmé, écrit en 1864, à 22 ans.
10 Nous, poèmes choisis, réunis par Charles Péguy, NRF 1916
11 Dernier poème du recueil Humus et Poussière, série La Ronde autour de l’enfant, Mercure de France, 1911 : « J’ai songé bien des fois à mon lointain ancêtre, / À celui qui reçut le nom qu’il m’a légué / Du sordide troupeau de porcs qu’il menait paître / Dans la forêt obscure et, de là, boire au gué. // La vase des marais en séchant sur sa guêtre / Alourdissait, le soir, son grand pas fatigué, / Ou bien le gueux courait les bois pieds nus peut-être, / Hirsute, à demi-fol et sauvagement gai, … »
12 La Chambre blanche fut tiré à 283 exemplaires pour le Mercure de France (61 pages) avec une préface de Marcel Schwob.
13 Francis Jammes (1868-1938) était de trois ans et demi l’aîné d’Henri Bataille (1872-1922).
14 Dans sa chronique dramatique du seize novembre 1913, à propos du Phalène, Maurice Boissard a écrit : « La répulsion que je n’ai jamais cessé de professer pour le génie lyrique et dramatique de M. Bataille vient de faire définitivement place à un sentiment de pitié très sincère. » Bien qu’il n’ait pas vu la pièce…
15 Paul Léautaud fait ici allusion à l’édition Charpentier-Fasquelle de 1916 sous-titrée : « Édition définitive augmentée de nouveaux poèmes » qui contient comme il l’a indiqué La Chambre blanche, Le Beau voyage et Et voici le jardin et qui a été complétée depuis l’édition de 1904 avec Et puis voici la rue (six poèmes) et La Porte de plâtre (treize poèmes).
16 Le texte commence par une ligne de points, ce qui n’est pas bon signe. Puis : « Avant d’entrer, assieds-toi là, sur cette malle. / N’importe où… Oui, là… que nous nous regardions / Pour la première fois dans les yeux. Qui es-tu ? / Que peux-tu bien être ? / D’où viens-tu ? / Avec ce grand visage pâle ?… »
17 Henry Spiess (1876-1940), poète et avocat genevois, a été introduit dans la deuxième édition (1908) des Poètes d’aujourd’hui. Il a tenu, trois ou quatre fois, la chronique des poèmes du Mercure, dont une fois l’an dernier dans le numéro du premier octobre 1916.
18 Chez Adolphe Jullien à Genève l’an dernier.
19 Il s’agit du poème IX de la série Printemps 1907 (pages 87-88), donné ici en entier.
20 Afin que nul n’en doute, ce monsieur sans prénom signait ses livres de son titre de « docteur », comme si sa poésie pouvait en être enrichie. Nous savons néanmoins qu’il se prénommait Lucien, qu’il pratiquait à Paris et qu’il était né à Senlis en 1859. Mon vieux collège a été édité par Louis Vogel en 1893, 80 pages illustrées de dessins de l’auteur.
21 Jean Moréas (Ioánnis À. Papadiamantópoulos, 1856-1910), poète symboliste grec d’expression française. En 1886, Jean Moréas, Paul Adam et Gustave Kahn ont fondé la revue Le Symboliste. Jean Moréas a fait partie des Poètes d’aujourd’hui dès la première édition de 1900 où sa notice a été rédigée par Adolphe van Bever. Lire l’article de René Gillouin en ouverture de La NRF de mai 1912. Voir aussi Alexandre Embiricos « Les débuts de Jean Moréas » dans le Mercure du premier janvier 1948, page 85.
22 Vincent Muselli (et non pas Jean Moréas), Les Travaux et les jeux, chez Jean Bergue, vingt rue de Condé, 1914, 470 exemplaires.
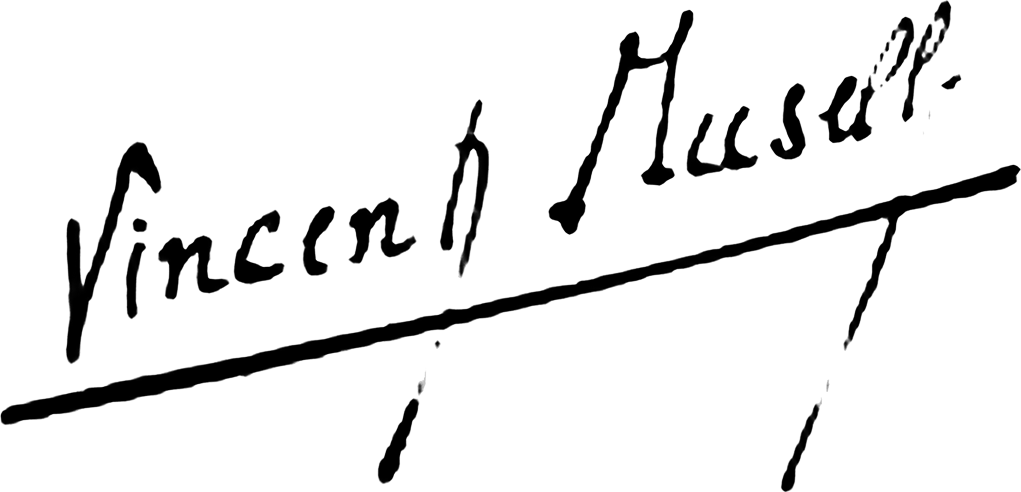
Signature de Vincent Muselli (tentant de prouver qu’il existe bien)
23 Note de PL : « Un critique littéraire de province a prétendu récemment (Dépêche de Pornic, 19 mai 1917) que Les Travaux et les Jeux ne seraient pas de Jean Moréas, mais d’un jeune poète appelé réellement Vincent Muselli. Cette prétention donne à penser que le critique en question n’a pas lu les vers dont il s’agit, ou qu’il a été victime d’une mystification. Littérairement, Vincent Muselli n’existe pas. Les Travaux et les Jeux proclament eux-mêmes leur auteur. C’est indiscutablement du Moréas. On n’imite pas à ce point. »
24 Charles-Adolphe Cantacuzène, Hypotyposes. Aléas et alinéas, Perrin 1916, 157 pages.

26 Charles-Joseph Lamoral, septième prince de Ligne (1735-1814), diplomate, militaire et homme de lettres belge de langue française.
27 Journal littéraire au cinq février 1934 : « J’ai fait des compliments ce matin à Cantacuzène, pour sa notice aux Plus belles pages du Prince de Ligne. » Voir aussi au quinze mars. Le Prince de Ligne, collection « Les plus belles pages », par Paul Morand, avec une préface de Charles-Adolphe Cantacuzène, postface de Paul Morand, Mercure de France 1934.
28 L’« heure sucrière » ! On imagine les sarcasmes de Paul Léautaud s’il avait trouvé cela chez un autre. On aura aussi remarqué l’« aboîments » qui permet la césure à l’hémistiche.
29 Adrien Bertrand (1888-1917), écrivain et journaliste, prix Goncourt 1914 (décerné en 1916) pour son roman L’Appel du sol. Blessé en 1914, Adrien Bertrand mourra de la suite de ses blessures le 18 novembre 1917. Adrien Bertrand est l’un des poètes cités dans la chronique du 16 septembre, donc pas encore parue.
30 Narcisse Lefèvre (1889-1949), n’a pas encore pris son pseudonyme de Frédéric Lefèvre. C’est sous ce nom que va paraître en 1917 son premier ouvrage, au titre ambitieux pour un aussi jeune homme : La jeune poésie française. En 1922, Frédéric Lefèvre, Jacques Guenne et Maurice Martin du Gard lanceront, sous la direction de la maison Larousse, l’hebdomadaire Les Nouvelles littéraires, revue littéraire « au prix et au format d’un journal » qui paraîtra jusqu’en 1983. Frédéric Lefèvre (1889-1949), sera l’immortel auteur de la série de près de quatre-cent entretiens « une heure avec… » tous parus dans Les Nouvelles littéraires. Certains de ces entretiens seront réunis en cinq volumes chez Gallimard puis (sixième volume) chez Flammarion entre 1924 et 1929. Pour la mort de Frédéric Lefèvre, voir la lettre de Paul Léautaud à Georges Charensol datée du 14 septembre 1949.
31 Émile Meyerson (1859-1933), est un philosophe polonais naturalisé français après 1918. À son arrivée à Paris en 1882, Émile Meyerson a fréquenté assidument le milieu littéraire parisien et s’est lié rapidement avec un autre émigré, le Grec Jean Moréas, « parisien » depuis deux ans. Dans la nécrologie d’Émile Meyerson des Nouvelles littéraires du 9 décembre 1933 (page sept), André George écrira : « […] la silhouette élégante de Moréas, sur une photographie gardée fidèlement, évoquait l’amitié ancienne du philosophe pour le poète. L’Æmilius d’une des Stances n’est autre qu’Émile Meyerson… » Voir aussi le Journal littéraire au 3 avril 1933.
32 La chronique est signée Intérim.
33 Comme les libraires Gibert, les Dorbon étaient deux frères. L’aîné, Louis, tenait ses deux librairies 19, boulevard Haussmann et sept Quai Malaquais (à côté de la librairie Champion qui se trouvait au numéro cinq). C’est Lucien, le cadet, qui était installé au numéro six de la rue de Seine.
34 Antoine-Vincent Arnault (1766-1834), homme politique et auteur dramatique. Antoine-Vincent Arnault a la particularité d’avoir été élu deux fois à l’Académie française (en 1803 et en 1829), dont il est devenu secrétaire perpétuel en 1833. Souvenirs d’un sexagénaire, chez Dufay, 17, rue des Marais-Saint-Germain (actuelle rue Visconti), 1733. « Les Souvenirs d’un sexagénaire, dans lesquels les historiens ont souvent puisé, demeurent un témoignage irremplaçable sur le monde des lettres et des arts » (notice actuelle d’H. Champion).
35 Le 23 mars 1920, Paul Léautaud écrira à René Dumesnil (1879-1967), qui était médecin : « — J’ai eu deux blennorragies : à trente-deux ans et à trente-huit ans » ce qui donne 1904 et 1910. Sauf une affaire plus récente (Paul Léautaud écrit au présent) et non révélée dans le Journal, l’affaire est assez ancienne et date de mars 1910 où une certaine Thérèse, prostituée sur le boulevard Raspail, avait donné à Paul Léautaud une maladie sévère qui l’avait contraint à garder le lit pendant plusieurs mois.
36 Oskar Wladisław de Lubicz Miłosz (1877-1939), poète lituanien de langue française né en Russie et mort à Fontainebleau. O. W. Miłosz fut également diplomate, romancier et dramaturge. Après des études au Lycée Janson-de-Sailly et à l’École du Louvre, O. W. Miłosz a été mobilisé en 1914 dans les divisions russes de l’armée française. En 1919 il sera le premier représentant à Paris de la Lituanie indépendante. Czesław Miłosz (1911-2004), prix Nobel de littérature en 1980 était son petit-cousin.
37 Maurice Rollinat (1846-1903), poète impressionnant. Plusieurs établissements d’enseignement portent son nom dans l’Indre, d’où il est originaire.
38 Harry, puis Heinrich (et Henri à Paris) Heine (1797-1856) est l’un des plus grands poètes allemands et le dernier romantique. Docteur en droit à Göttingen en 1825, HH, d’origine juive, se fait baptiser sous prénom de Heinrich pour se protéger de l’antisémitisme qui pourrait nuire à son travail mais la démarche n’a pas l’effet escompté et peut-être même un effet contraire. Face à cet échec, HH abandonne tout espoir dans les métiers de justice et se consacre alors entièrement à l’écriture. La censure littéraire, très forte dans l’Allemagne de cette époque, conduit HH à s’installer à Paris au début des années 1930, d’abord comme correspondant de journaux de langue allemande. Il fréquente les milieux intellectuels parisiens. Ses œuvres sont interdites en Allemagne. HH, rongé par une maladie neurologique meurt à Paris à l’âge de cinquante-neuf ans.
39 Ce poème est le dix-neuvième de la partie « II — Femmes et fantômes, les sept solitudes », page 82.
40 Germaine Emmanuel-Delbousquet (Germaine Delbousquet, 1896-1972), fille d’Emmanuel Delbousquet (1874-1905).

41 Gabriel Cousinou (1891-1953), poète et baryton lyrique. Au hasard des rêves, suivi de Poèmes du Front, Eugène Figuière 1917, 160 pages.
42 Oscar-Paul Gilbert (1898-1972), journaliste, romancier, et auteur dramatique belge d’expression française. Clartés intimes, vers et prose, 60 pages, 1917, à compte d’auteur.
43 Raymond Méchain, Le Missel de Chérubin, Albert Messein, 1914, 125 pages.
44 René Schwob (1895-1946), critique d’art et homme de lettres chrétien, auteur, notamment, du Vrai drame d’André Gide, Grasset, 1932. Les Cantiques de la vie, Préface de Paul Adam (1916), Librairie d’action d’art de la guilde « Les Forgerons », 1916. René Schwob ne semble pas avoir de lien familial avec Marcel Schwob.

Portrait de René Schwob signé “Bouchard”, source : Université Côte d’Azur
45 Paul Adam (1862-1920), écrivain et critique d’art. Son premier roman, Chair molle (1885), accusé d’immoralité, a provoqué le scandale. On lira avec intérêt le portrait de Paul Adam dressé par André Billy dans La Terrasse du Luxembourg, Fayard 1945, page 139 et suivantes.
46 Charles de Saint-Cyr (1875-1940), homme de lettres, chargé de mission du ministère de l’Agriculture.
47 Chez M. Rivière, 1914, 143 pages.
48 Chez M. Rivière, 1911, 73 pages.
49 Matines pieuses, Matines de Jésus et de sa mère, etc.
50 Maurice Magre (1877-1941), a été de la première édition des Poètes d’aujourd’hui et sa notice rédigée par AvB. Poète toulousain précoce, Maurice Magre a été spécialiste de l’épopée cathare avant de virer au spiritisme.
51 Louis Mandin (1872-1943), clerc de notaire, attaché parlementaire et poète. Le 5 novembre 1926 nous apprendrons que « Louis Mandin est chargé, dans son emploi au Mercure, de la correction des épreuves ». La poésie de Louis Mandin sera inclue dans la troisième édition des Poètes d’aujourd’hui. Résistant pendant la seconde guerre mondiale, arrêté en novembre 1941, Louis Mandin, né trois mois après Paul Léautaud, mourra en déportation en juin 1943. Le 24 février 1934 nous apprendrons que « Mandin est allé à la manifestation du 6 février place de la Concorde », ce qui n’est pas cohérent avec son comportement futur.
52 Maurice Heine, La Mort posthume — Fouilles d’Antinoë, plaquette carrée de 19 pages, couverture rempliée, éditée à Mâcon cette année 1917 puis la même année à Paris chez Jules Meynial. Maurice Heine (1884-1940), homme de gauche, écrivain, journaliste, éditeur et médecin suffisamment à l’aise pour ne point exercer. Issu d’une grande famille de banquiers, Maurice Heine a adhéré au parti communiste et au mouvement surréaliste.
53 Adrien Bertrand (note 29), Les jardins de Priape, Dorbon aîné 1915, 80 pages. Comme les Gibert, les Dorbon étaient deux frères. L’aîné, Louis, tenait ses deux librairies 19 boulevard Haussmann et sept Quai Malaquais (à côté de la librairie Champion qui se trouvait au numéro cinq). Lucien, Le cadet, était installé au numéro six de la rue de Seine.

54 Le rétiaire était un gladiateur armé d’un trident, d’un poignard et d’un filet.
55 René-Marie Hermant (1887-1930). Vingt-deux ballades goguenardes, malévoles, inutiles ou perverses, Jouve 1917, 32 pages. Malévole : vieux ou littéraire : Malveillantes. (TLFi).