Jean Cassou, Paul Léautaud et Maurice Martin du Gard
Jean Cassou, par Paul Léautaud
Silhouettes parisiennes — Maurice Boissard
Notes
Page mise en ligne le quinze juin 2024. Temps de lecture : 31 minutes.
À la naissance de Jean Cassou, en 1897, Paul Léautaud a 25 ans. La carrière journalistique de Jean Cassou a vraiment débuté en 1922 et en janvier 1923, son vieux collègue Paul Léautaud ne s’est posé aucune question particulière en lui écrivant tout paternellement « Mon cher enfant ».
Restons un peu sur la vie de Jean Cassou, bien oublié de nos jours.
Le grand-père, Jean, est né à Pau. Le père, Victor (1861-1913) est né à Guanajuato, au Mexique, s’est marié en 1893 à Cadix avec une espagnole (Maria de los Milagro de Ibanez Pacheco y Moreno). De ce mariage célébré à Cadix, Jean Cassou est né à Bilbao quatre ans plus tard, en 1897. Quatre années encore se sont écoulées avant la naissance de sa sœur Louise, à Saint-Quentin (Aisne). Louise épousera en 1924 le journaliste André Wurmser.
L’Espagne est donc bien présente dans la famille Cassou et assez logiquement, Jean Cassou entame une licence d’Espagnol, à Paris, avant de rejoindre Bayonne, sans doute à cause de la guerre. Tout en poursuivant sa licence d’espagnol, il vit en étant maître d’études au lycée de la ville.
La guerre finie, Jean Cassou remonte à Paris où il est secrétaire de Pierre Louÿs en 1921 en même temps qu’employé au Mercure. Le quinze janvier 1921 paraît dans le Mercure sa première chronique de « Lettres espagnoles ».
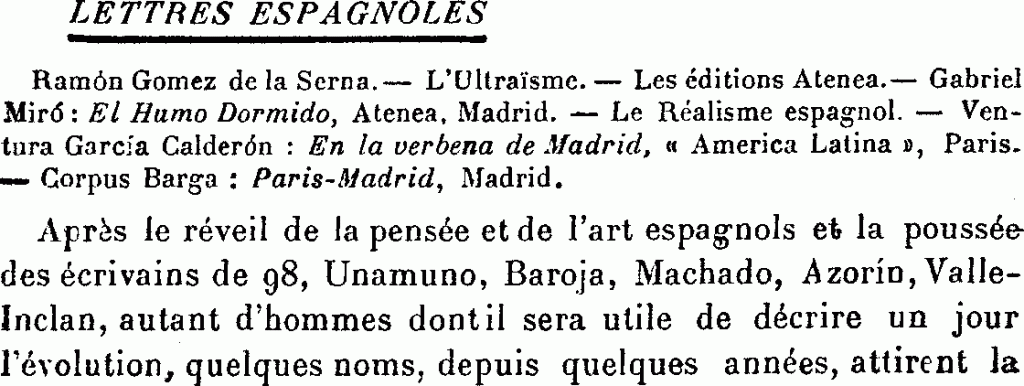
Ce sera la première d’une série de quarante-deux, jusqu’au quinze septembre 1929.
Le 18 novembre 1922 paraît ce qui semble bien être le premier article de Jean Cassou dans Les Nouvelles littéraires à propos du prix Nobel de littérature attribué à Jacinto Benavente (1866-1954). Jean Cassou restera un collaborateur des Nouvelles littéraires jusqu’en 1930.
En 1923, Jean Cassou obtient un poste de rédacteur au ministère de l’Instruction publique. En janvier il publie, dans Les Nouvelles littéraires une « Silhouette parisienne » « Un spectateur : Maurice Boissard », que l’on trouvera infra. Dans sa rubrique « L’Esprit des livres » du 17 mai 1924, le très-respecté Edmond jaloux écrit :
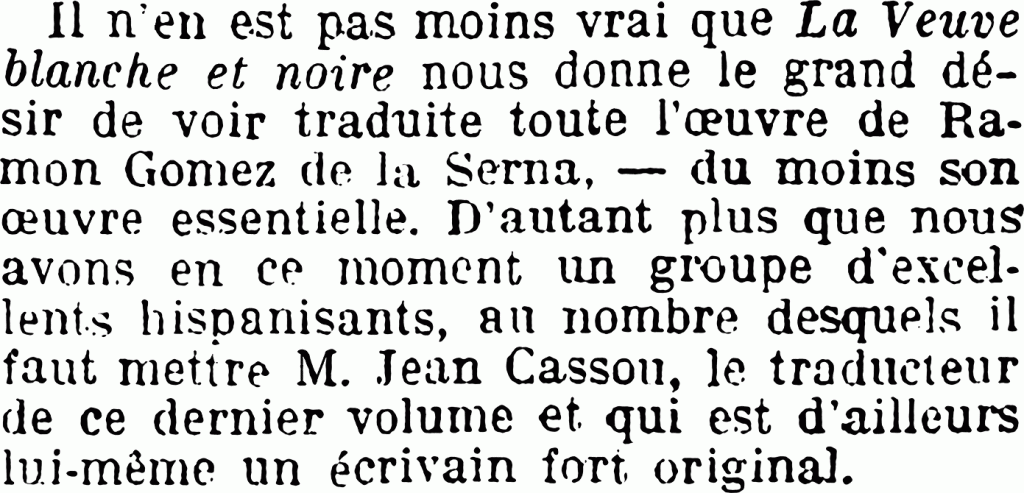
Venant d’Edmond Jaloux, c’est la consécration. C’est grâce à Edmond Jaloux que Jean Cassou a pu faire paraître son Éloge de la folie chez Émile Paul « Collection Edmond Jaloux » en 1925.
Jean Paulhan écrira à Jean Cassou :
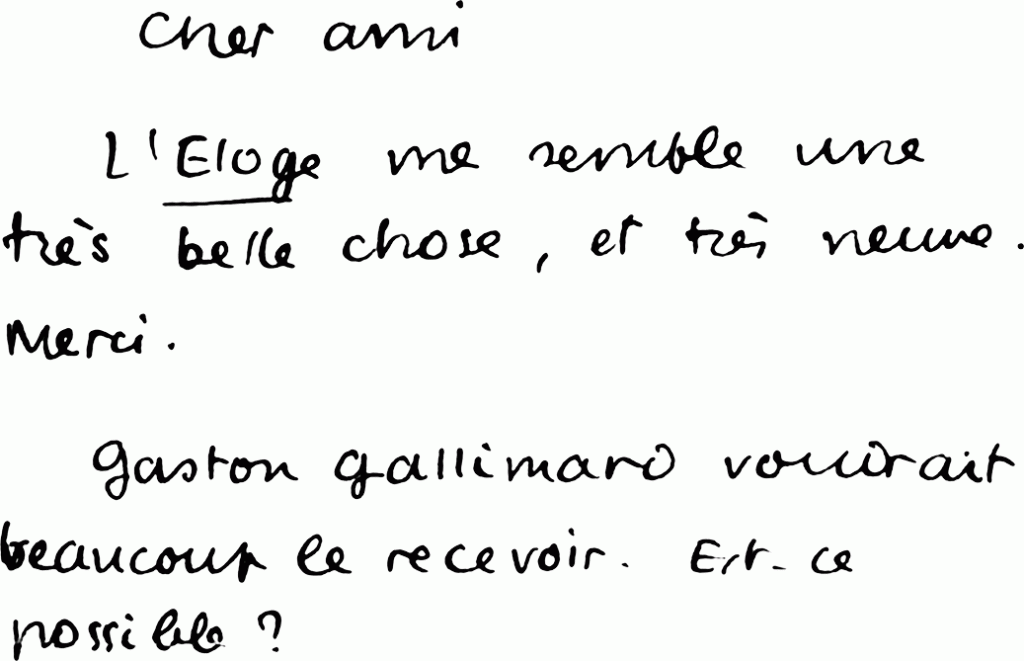
Jean Cassou, Paul Léautaud et Maurice Martin du Gard
Le premier texte concernant à la fois Jean Cassou et Paul Léautaud vient de Maurice Martin du Gard, dans ses Mémorables, recueil de souvenirs des années 1918-1923 parus en 1957 chez Flammarion. MMG raconte comment Jean Cassou lui a présenté Paul Léautaud. Maurice Martin du Gard situe cette rencontre en janvier 1920 mais comme nous l’allons voir elle a sans doute eu lieu l’année suivante. En voici un large extrait.
Nous étions dans le quartier, à l’Odéon. Le Mercure de France se trouve rue de Condé au 26, dans l’ancien hôtel de Beaumarchais. Jean Cassou y tient une rubrique : la littérature espagnole1.
— Viens, me dit-il, je vais voir si j’ai des livres et du courrier. Tu verras le père Léautaud.
Au premier étage, sur une porte : « Manuscrits. Publicité. » C’est là. Personne. Ce n’est pas gai. Cela sent le renfermé, la paperasse qui a pris la poussière, les vieilles affiches de ventes par licitation, tout à fait l’odeur d’une étude de notaire, d’avoué. Léautaud a été clerc. Il ne doit pas être dépaysé. C’est la basoche, probablement, les dossiers de divorce, de succession, qui ont dû lui donner le goût du petit fait vrai, de l’anecdote plus ou moins clandestine et scandaleuse. On devient indiscret à confesser les plaideurs, et cynique. On se mêle par profession de ce qui ne regarde personne. L’indiscrétion et le cynisme font le caractère de ses chroniques dramatiques au Mercure. Au fait, pourquoi signe-t-il Maurice Boissard, puisqu’il s’appelle Léautaud ? Pourtant pas un homme à s’avancer masqué, lui qui écrit ce qui lui chante et chantant pouille2 à ses confrères. Les originaux, les maniaques, moi aussi, c’est dans une étude d’avoué que j’ai rencontré les premiers, un moment j’ai été clerc chez mon père3 : je devrais l’être aujourd’hui, attendant de reprendre l’étude et de me marier pour la payer, comme cela se fait dans les bonnes familles. Au lieu de cela : employé de librairie, chez Berger-Levrault, 5, rue des Beaux-Arts, dans un bureau plus bas de plafond que celui de Léautaud. Paris, littérature, quand tu nous tiens ! J’ai beau me dire : « Gérard de Nerval logeait là4 », ce n’est pas le rêve.
Au Mercure, les collaborateurs réguliers ont chacun une case à leur nom ; il faut croire qu’ils ne sont pas tous très pressés d’en retirer les ouvrages dont ils doivent parler, à voir toutes ces enveloppes et ces paquets bien défraîchis. Cassou prenait dans la sienne ce qui lui revenait lorsque Léautaud est entré, l’œil brillant et beau, les lèvres serrées, glabre, les joues grises, l’air d’un comédien, d’un mauvais prêtre, non : pas mauvais, mais ingrat, à son col droit aux pointes évasées un étroit nœud noir. Il descendait de chez le Patron, ainsi nomme-t-il M. Alfred Vallette, fondateur de la maison avec Herold, Henri de Régnier, Jules Renard, d’autres encore, et qui a son bureau au-dessus et un appartement qu’il partage avec Mme Rachilde, son épouse. Léautaud commence par regarder Cassou avec défiance ; il n’aime pas qu’on fouille dans son bureau quand il n’y est pas, il le dit tout net, et puis, qu’est-ce que ce monsieur qui l’accompagne ? Les figures nouvelles, il ne les aime pas beaucoup, il lui faut une accoutumance, il ne parle pas volontiers, il ne vous met pas en confiance, il vous fixe, baisse la tête, écoute. Un timide ? Il n’est à l’aise qu’avec son papier, alors il se rattrape !
— Mon ami est avec Pillement5 aux Lettres Parisiennes. Il écrit des poèmes, il y en a un dans le dernier numéro. Vous l’avez lu ? fait Cassou.
— Je vous salue, Monsieur.
Et Léautaud, les yeux dans les miens :
— Je ne lis pas les vers ! Quelle idée vous avez ! Enfin, c’est de votre âge, j’espère que ça vous passera.
Et de rire ! J’étais interloqué. Ce mépris des vers chez l’auteur des Poètes d’aujourd’hui, l’anthologie du Mercure ! On se la passait en classe. Que de rêveries précipitaient ces deux volumes jaunes frappés du célèbre caducée, que de découvertes ! Je citai « Apogée » de Louÿs :
Psyché, ma sœur, écoute, immobile, et frissonne…
Jammes… Gérard d’Houville… Charles Guérin… Valéry. Vous avez changé la vie de bien des jeunes, lui dis-je.
— Changé ? Pas la mienne !
Bourru, il regagne son fauteuil, un Louis-Philippe bas, avachi, qu’il rembourre avec une couverture grise de soldat. En son absence on avait, sur sa table noire, apporté un tas d’imprimés, revues, épreuves d’imprimerie ; il esquissa un tri, puis, toujours sans parler, saisit une plume d’oie qu’il se mit à tailler avec un canif. Je remarquai l’absence du téléphone. Le Mercure n’a pas le téléphone.
— Vos Lettres Parisiennes6 ! C’est horrible, ces reproductions, ces tableaux. Vous ne trouvez pas suffisant qu’on expose au Salon d’Automne toutes ces horreurs ? Ce Zadkine, Osip Zadkine7, a-t-on idée de s’appeler comme cela ! Il ne se contente pas de sculpter, il écrit par-dessus le marché. Ce qu’il écrit ! « Les sculpteurs égyptiens et les Michel-Ange pour ne pas crever de faim seront forcés d’onaniser le plâtre avec une loupe. » Onaniser le plâtre avec une loupe ! À-t-on idée d’écrire ainsi ! Je ne vous fais pas mon compliment pour recueillir cet Osip !
— Tout le monde ne peut pas s’appeler Rodin, monsieur Léautaud, observe, piqué, Jean Cassou.
— C’est comme Bourdelle. Il n’a pas l’excuse de votre Zadkine, il est Français, et lui au moins se prénomme Antoine…
— Il s’appelait Émile comme tout le monde : c’est en épousant sa femme qui se prénommait Cléopâtre qu’il prit le prénom d’Antoine, fis-je discrètement8.
— Eh bien ! Bourdelle écrit comme Suarès9, c’est abominable ! Est-ce que je sculpte, moi !
Un visiteur à son bureau, une scène dans la rue, dans le train de banlieue qu’il prend deux fois par jour, toujours une comédie pour lui : il est né spectateur. Amusant quand on pense qu’il est le fils d’un acteur, Firmin Léautaud, lequel après avoir vécu sur les planches finit dessous comme souffleur à la Comédie-Française ; il ouvrait sa boîte au petit garçon qui assistait de là au spectacle, d’où l’habitude et le goût qu’il prit de regarder les gens et les choses d’en bas. Sa mère, une comédienne également, guère moins innocente que le compagnon dont elle se sépara de bonne heure. Fils de l’amour, Paul Léautaud, et sans famille ! C’était une belle personne, il l’évoque dans Le Petit Ami, le seul livre qu’il ait publié et veut toujours recommencer, où l’on découvre dans sa fraîcheur, si l’on peut dire, la franchise de cet homme qui ne craint Dieu ni le diable et continue à vivre petitement en marge de la société. Paul Léautaud raille les préjugés, les convenances, et le premier aussi à se moquer de lui-même, le type du réfractaire, mais employé ponctuel, le matin à neuf heures tapantes sous le porche du Mercure.
— Le patron a encore reçu des lettres à mon sujet, des désabonnements ! mais il me couvre toujours. Il sait qu’il y a beaucoup de gens qui lisent le Mercure pour la Chronique de Maurice Boissard : cela compense. Mais il ne m’augmente pas. Je ne me plaindrais pas, je n’y penserais même pas, si je n’avais toute cette famille d’animaux à nourrir. Pour moi, pain, fromage, pommes de terre à l’eau, je m’en trouve fort bien.
Le calme, la simplicité, la sincérité, nulle forfanterie, et brusquement reparaît ce rire, un clairon sardonique, un gargarisme bizarre, furieux creux de gorge, d’un comique ! La comédie, le cirque ! Quel mime aussi : Deburau aux Funambules. Il a manqué sa carrière. Nous en étions venus à parler de la guerre à propos d’un poème d’Arcos10 : Les Morts11, cinq fois interdit par la censure et qui paraissait enfin dans les Lettres Parisiennes. Cassou prononça : « La guerre du Droit » avec gouaille.
— Je ne trouve pas, moi, qu’elle ait tué assez de monde, coupe Léautaud, elle a laissé en vie presque tous les imbéciles ! Qu’est-ce qu’Apollinaire a été faire là-dedans ? Il aurait mieux fait de rester tranquille, on ne lui demandait rien.
Et Léautaud d’ajouter qu’il avait reçu un éclat d’obus dans la tête en lisant un numéro du Mercure au cantonnement. Il disait peut-être vrai, mais pourquoi rabaisser les mouvements sincères, les actions désintéressées, par exemple le patriotisme de Wilhelm Apollinaris de Kostrowiski s’engageant en 1914 par gratitude envers la France qui l’avait accueilli sans savoir qu’elle en serait plus tard honorée ? Apollinaire était mort dans son lit, chez lui, vrai également, mais il eût probablement résisté à la grippe qui l’emporta sans sa blessure et la trépanation qui suivit. Mort le jour où la guerre finissait, deux jours avant exactement, le 9 novembre 1918, à cinq heures, la victoire était là, quelle tristesse ! Les étudiants en monômes serpentaient en criant leur joie le long du boulevard Saint-Germain ; ils hurlaient : « À bas Guillaume ! Conspuez Guillaume ! conspuez ! » en passant sous les fenêtres du 202. L’Empereur d’Allemagne, lui, était vivant, il n’avait pas été blessé, la grippe espagnole n’était pas pour lui, ni d’ailleurs la potence que Lloyd George lui avait promise à la Tour de Londres.
— Apollinaire ! le poète complet pour moi, décrète Léautaud. Et l’homme : un mélange de charme, d’autorité, avec des dessous de bouffonnerie savoureuse.
Tout à l’heure, en prétendant ne point lire de poèmes, allant plus loin : disant que la poésie lui était indifférente, il plaisantait. Très satisfait au contraire d’avoir découvert La Chanson du Mal-Aimé et d’en avoir imposé à Vallette la publication dans le Mercure. Il ajouta avec une sorte de fierté, comme si c’était lui qui avait eu l’idée de cette collaboration :
— Apollinaire faisait La Vie anecdotique12 !
Chaque fois qu’il apportait sa copie, c’était toujours « un excellent moment », un moment qui, on suppose, ne sera pas perdu. Léautaud tient son journal depuis 1893. Ce sera son dernier grand homme. Il l’a beaucoup vu après qu’Apollinaire, sous-lieutenant retour du front et de l’hôpital, eut été affecté à Paris, à la Censure.
Jean Cassou, par Paul Léautaud
La première fois que Paul Léautaud cite le nom de Jean Cassou dans son Journal littéraire13 est le 24 février 1921. À cette époque, Jean Cassou est employé au Mercure et partage le bureau de Jacques Bernard.
Je vois en conversation avec Jean Cassou un cousin de Roger Martin du Gard14. Il me raconte que celui-ci est en train d’écrire l’Histoire d’un médecin, qui aura 10 ou 12 volumes15.
Le cinq octobre, Paul Léautaud demande une semaine de congés à Alfred Vallette pour rejoindre Anne Cayssac à Pornic. Alfred Vallette renâcle, craignant le mauvais exemple :
[…] il y a les deux autres…, me désignant encore du doigt le bureau de Cassou et de Bernard.
[…] J’avais parlé hier à Cassou de l’argument de Vallette consistant à me les opposer, lui et Bernard, sur la question de mes vacances, qui, plus longues que les leurs, pourraient les faire se plaindre. Cassou avait trouvé cet argument un peu froissant, en ce sens qu’il n’aurait jamais eu l’idée de se mêler de quoi que ce soit me regardant. J’en ai reparlé aujourd’hui avec lui et Bernard, de son avis également. Tous deux me l’ont dit : autant par camaraderie que par caractère, et tout ce que vous êtes dans la maison s’y ajoutant, jamais nous ne nous permettrions de juger quoi que ce soit vous concernant.
Ce même six octobre 1921 se produit un incident déplorable.
Cassou me racontait tantôt un fait dont il a été écœuré. Il y a quelque temps, Robert Mortier16 et Fels17, le directeur de la revue Action, sont venus voir Rachilde pour lui parler du projet d’un monument d’Apollinaire18 et lui dire qu’il serait convenable que le Mercure en soit et en parle. Vallette et Rachilde demandèrent s’il n’y avait pas trop de gens bizarres dans le comité : des métèques, des cubistes, des bolchevistes, des dadaïstes et autres sortes de Boches. Mortier et Fels lui dirent qu’il y avait les amis d’Apollinaire, comme Salmon19, et naturellement les Cubistes, Picasso et autres. Rachilde ne dit trop rien, ne répondit rien de catégorique, dit seulement qu’on exagérait pour Apollinaire, enfin des bêtises sans importance. Mortier et Fels partis, et restant dans le bureau de Vallette, elle éclate : « J’avais envie de les gifler tous les deux. Ils nous rasent, avec leur Apollinaire. Moi, quand il est mort, cela m’a été. J’ai dit : Tant mieux. Nous en sommes débarrassés. »
Ce même mois octobre, le 25 :
L’autre matin, Rachilde vient trouver Vallette. Une revue qui vient de se fonder, mi-espagnole mi-française, lui a demandé d’écrire un article sur Ruben Dario20. Elle demande à Vallette de lui indiquer des documents. Il lui dit que Cassou, très au courant de la littérature espagnole, la renseignera à merveille. Cassou arrive. Elle lui parle de son article. Elle parle du bon prix qu’on le lui paie. Cassou, qui connaît la revue et dont le secrétaire est un de ses amis, lui dit : « 400 francs ? C’est le prix qu’on paie les articles. » Rachilde répond : « On me donne 500, parce que c’est moi. »
Le lendemain Cassou me dit : « J’ai pris la patronne en flagrant délit de mensonge. J’ai demandé à mon ami pour son article. On lui donne 400 francs comme à tout le monde. »
Le premier décembre va paraître à La NRF la troisième chronique dramatique de Paul Léautaud. Il n’est pas content de la fin.
Rendant compte de la nouvelle édition d’Ubu-Roi, je voulais finir par une comparaison entre le Mercure d’autrefois21 et celui d’aujourd’hui. Je ne trouvais pas le ton amusé que je voulais pour faire passer la chose aux yeux de Vallette s’il la voyait, car tout de même, je suis employé au Mercure et je dois penser à cela. Je ne trouvais qu’un ton amer et sarcastique. Je me suis arrêté, sans finir. C’est du joli.
Le quinze novembre il en parle à ses deux collègues.
J’étais tout de même ennuyé ce matin de laisser inachevée ma prochaine chronique de la Nouvelle Revue Française. J’ai soumis à Roux22 et à Cassou les quelques lignes qui la terminaient et que j’ai retirées, en leur demandant leur avis, eu égard à ma situation d’employé au Mercure. Ils ont été d’avis l’un et l’autre que je maintienne la suppression, l’effet ne pouvant être que très mauvais sur Vallette. Je me suis rangé à cet avis, alors !
Paul Léautaud, nous venons de le voir, vient de porter ses chroniques dramatiques à La NRF. C’est Rachilde qui ne voulait plus de ces chroniques au Mercure. C’est Henri Béraud qui l’a remplacé à partir du quinze janvier de cette année 1921, pour 56 numéros. Il ne semble pas que Rachilde ait eu à se féliciter de l’échange, même si Henri Béraud était un excellent chroniqueur. Le quinze décembre, nous lisons :
Béraud est venu ce soir voir Vallette au sujet de l’assignation Gandéra23. Rachilde est arrivée pendant la conversation. Assise devant la cheminée, elle a eu ce mot : « Hum ! hum ! nous avons décidément changé notre cheval borgne pour un aveugle » faisant allusion à moi et à ma succession par Béraud. Je lui ai répondu : « C’est d’autant mieux à un moment où le Mercure est devenu si radouci ! »
Béraud, il y a quelque temps, a aussi traité Croisset24 de façon un peu vive25. À ce propos il nous racontait ce soir ceci : Un ami de Béraud rencontre Croisset. Celui-ci lui dit : « Vous savez que je vais lui envoyer des témoins. » L’ami répond : « Cela vous regarde. » Et d’un air indifférent : « Vous savez que Béraud est maître d’armes au Xe régiment d’infanterie. » Croisset dit alors : « Sans doute, après une telle guerre, le duel est un peu déplacé. Si je le rencontre, je lui flanquerai des claques. » L’ami répond du même ton indifférent : « Vous savez qu’il pèse 163 kilogs. » Croisset dit alors : « Évidemment ce sont là des manières de portefaix qu’il vaut mieux éviter. J’écrirai une lettre au Mercure. » En effet, il se contenta d’envoyer une lettre à Vallette26.
Cassou me disait ce matin que Rachilde n’aime pas plus Béraud qu’elle ne m’aimait. Je disais du mal de toutes ses amies. Il dit du mal de tous ses amis. C’est bien amusant.
La journée du 18 février 1922 n’existe pas dans l’édition papier du Journal littéraire, on ne la trouve que dans le tapuscrit de Grenoble. et c’est pourquoi elle est intégralement reproduite ici, où Jean Cassou a une place prépondérante, bien qu’il y soit surtout question du couple Régnier27.
Cassou est secrétaire de Pierre Louÿs et sait différentes choses sur le ménage d’Henri de Régnier. Des vers de Régnier que nous venions de lire ensemble nous a amenés ce matin à en parler. Je disais à Cassou combien je serais curieux d’être renseigné sur la manière dont Régnier a supporté la conduite de sa femme, qui l’a eue les premiers jours de son mariage. Voici différentes choses que Cassou m’a racontées.
Il paraît bien que Régnier a adoré et adore encore sa femme et qu’il a dû beaucoup souffrir.
Il paraît qu’elle a rompu avec Bernstein28, son dernier amant connu, et déclare maintenant qu’elle n’a jamais aimé son mari.
Lui-même d’ailleurs, et je le savais, ne s’est jamais privé de se consoler ailleurs. On a assez parlé de sa liaison avec Mme Muhlfeld29, fort jolie, paraît-il.
Cassou dit que Mme de Régnier, qui n’est pas, sous tous les rapports, une créature ordinaire, s’est toujours moquée de Régnier. Il en était ainsi avant leur mariage, quand Régnier, comme d’autres jeunes écrivains, fréquentait le salon d’Heredia. Un jour, il avait été question de faire un voyage. Elle s’était récriée, à l’idée de la société de Régnier. « Non, je ne veux pas aller avec lui. Il est trop bête, il est trop laid, avec sa vilaine moustache tombante, il est trop triste, il n’a pas assez de talent. J’aime mieux aller avec Pierre Louÿs. » Il paraît que ce pauvre Régnier ne savait où se mettre et riait doucement, gentiment, pour se donner une contenance.

Henri de Régnier jeune
Cassou dit que Tigre30 Régnier est en réalité le fils de Pierre Louÿs. Car elle a été la maîtresse de Pierre Louÿs, qui ne parle jamais d’elle qu’avec une sorte de réserve et de rêverie aussi, qui ne disent rien mais laissent entendre bien des choses. Tigre, du reste, ressemblerait assez à Louÿs, Mme de Régnier est d’ailleurs assez cynique sur ce point. Quand Tigre était tout enfant, un jour, dans un dîner, qu’on l’avait placé à côté de Louÿs, il ne cessait de s’adresse à lui en criant : « Papa, papa ! » Mme de Régnier disait en riant d’un air malicieux : « Comme il est intelligent ! hein ? » Un autre exemple de son cynisme est celui-ci. Dans un grand dîner, placée un peu loin de Régnier, elle ne cessait de le regarder en souriant et en disant entre ses dents : « Pauvre cocu, pauvre cocu ! ».
Il paraît que Louÿs l’a beaucoup aimée. Cassou dit que le poème qu’il a écrit : Psyché, est inspiré par elle et qu’elle en est le sujet. Elle s’appelle Marie, et tout comme elle a inspiré à Régnier des sonnets, sous l’invocation des Sonnets. Cassou me disait que Louÿs, quand il avait vingt ans, était allé en Touraine faire un pèlerinage aux lieux où vécut Ronsard, ayant en sa poche un vieux Ronsard qu’il a encore, tout couvert de notes, et qu’il associait alors au culte de Ronsard son amour pour Marie de Heredia.
Il paraît que Louÿs parle toujours avec assez de sympathie de Régnier, quoique ses sentiments à son égard aient un peu changé depuis le jour que Régnier a commencé à penser à l’Académie.
Il faut dire toutefois ce qui est vrai que Régnier ne semble pas être un homme émerveillé de lui-même et de sa réussite. Il faut l’entendre parler, le voir, pour se rendre compte combien il est simple, clairvoyant, presque modeste, et lire ses vers de ces dernières années, pour sentir sa mélancolie et combien il juge tout à sa valeur. S’il est vrai qu’il ait toujours adoré sa femme au point qu’on dit, il n’a peut-être voulu conquérir certains honneurs que pour la conquérir davantage ?
Cassou dit que Tigre Régnier est tout à fait un jeune homme dernier bateau31, insupportable de fatuité, d’étalage, de néant, de frivolité. Il paraît qu’il déteste son père32, qu’il n’appelle jamais autrement que : le patron, et qu’il a horreur de son œuvre, — alors qu’il a une adoration pour sa mère et pour tout ce qu’elle écrit.
Ce qui est encore à l’honneur de Régnier, c’est qu’il paraît bien n’être pas un homme d’argent. Pour son roman la Pécheresse33 un fort beau livre, il aurait pu le passer à la Revue de Paris, ou à la Revue de Marcel Prévost. Il aurait touché là un bon prix. Mais on lui aurait demandé des coupures — la Pécheresse a des passages un peu lestes. Il a préféré le donner au Mercure, où il était payé beaucoup moins mais où le roman était publié sans un mot de moins.
En mai dernier (1921) est paru une nouvelle version d’In Memoriam dans le mensuel Les Cahiers d’aujourd’hui de George Besson34. La suite en juillet et novembre. Comme d’habitude, Paul Léautaud est très inquiet. Nous sommes le 21 février suivant :
Il faut que je note ceci :
Régismanset35 m’a demandé de lui faire lire In Memoriam. Je lui ai donné le troisième morceau (dernier no des Cahiers d’Aujourd’hui). Quand je l’ai revu quelques jours après, il m’a dit seulement : « J’ai lu. Je vous remercie. »
Cassou a lu ce même 3e morceau dans le no des Cahiers arrivé au Mercure pour la rubrique des revues. Il ne m’en a pas dit un mot.
Je ne sais que penser de ce silence. Je l’interprète plutôt comme défavorable. Je veux dire que ni Régismanset ni Cassou n’ont trouvé bien ce 3e morceau ? Je voudrais pourtant bien savoir leurs critiques et je n’ose pas les leur demander.
Le 22 mai (toujours 1922).
Cassou nous apprend que Louÿs a été mené hier matin par Farrère36, son neveu (le fils de Georges Louis37 l’ambassadeur décédé) et lui Cassou à la maison de santé de la Malmaison, la même qui reçut Deschanel38 et Feydeau. Il commence à n’avoir plus sa tête à lui. Depuis plusieurs années, il n’est pas sorti de chez lui. Depuis plusieurs mois il vit au lit, se nourrissant de liquides : en moyenne chaque jour 2 bouteilles de champagne, 3 bouteilles de vin, 1 bouteille de Mariani39. En surplus, morphine et cocaïne. Le résultat était à prévoir. Le médecin est venu. Il a demandé à Louÿs : « Voulez-vous guérir ? » Louÿs a demandé à son tour : « Est-ce bien utile ? » Le médecin a répondu : « Certainement. » Louÿs s’est alors laissé emmener. Une voiture pour lui et le médecin. Une autre voiture pour Farrère, le neveu et Cassou. Louÿs a voulu à toutes forces que sa maîtresse le suive et qu’on lui donne une chambre voisine de la sienne. On a eu l’air d’y souscrire, mais lui aussitôt enfermé, cette dame est rentrée au hameau de Boulainvilliers40.
Le lendemain 23 mai :
Cassou nous dit ce matin que le déménagement d’esprit de Louÿs se confirme. Il m’apprend que Louÿs a un petit garçon de deux ans et demi de sa maîtresse actuelle41. Il aurait fait en faveur de celle-ci un testament, il y a quelques années, à propos d’une opération qu’il eut à subir.
À la fin de l’année 1922, Jean Cassou ne semble plus être employé par le Mercure. Le sept décembre nous lisons :
Aujourd’hui, visite de Cassou au Mercure. Je lui demande des nouvelles de Pierre Louÿs. Il m’apprend que Pierre Louÿs est maintenant à Neuilly chez sa belle-sœur, la veuve de l’ambassadeur Paul Louis42. Son propriétaire a obtenu son expulsion et il a dû quitter le hameau de Boulainvilliers. Je demande à Cassou ce que vont devenir les chats qu’il avait. On ne sait trop. Ils resteront là comme ils pourront. Je dis à Cassou que ce farceur de Gregh43 pourrait bien les accueillir. Pour une fois, il ferait quelque chose de bien. Quant à la santé de Pierre Louÿs, pas meilleure. Cassou dit qu’il continue à déménager. Il passe son temps à demander l’heure, oublie la réponse, et demande de nouveau. Son intelligence ne se retrouve que lorsqu’on lui parle de Mallarmé ou de Heredia. Il redit alors tout ce qu’il a dit cent fois, clairement, puis sorti de là, est complètement gâteux. Cassou dit que c’est la cocaïne qui l’a amené à cet état44.
Silhouettes parisiennes — Maurice Boissard
Dans le numéro du six janvier 1923 paraît un texte de Jean Cassou page trois des Nouvelles littéraires, « Silhouettes parisiennes — Un spectateur : Maurice Boissard », que voici :
On rencontre, dans les salles des premières et des générales, un personnage dont l’aspect est souvent plus théâtral que celui des pantins qui s’exhibent sur la scène. C’est M. Boissard. Il porte des lunettes, un foulard de soie blanc, une veste de velours, un singulier chapeau rond à damier et un visage qui ressemble à un La Tour. D’ailleurs tout le monde — et lui le premier — sait qu’il date du dix-huitième siècle.
Maurice Boissard, qui s’appelle aussi Paul Léautaud, s’est condamné depuis longtemps déjà à la chronique dramatique. Il va au théâtre, toujours à contre-cœur, se laisse placer par l’ouvreuse sans protester, parce qu’il est très timide. Mais s’il proteste, c’est de la façon la plus désagréable du monde et avec une voix dont les ressorts grincent et dont les soufflets tonitruent. C’est cette voix que l’on entend lorsqu’on lit ses chroniques dramatiques. Au contraire, lorsqu’il adresse la parole à un chien ou à un chat, Paul Léautaud se découvre un organe séducteur et n’use plus que d’épithètes suaves et amoureuses.
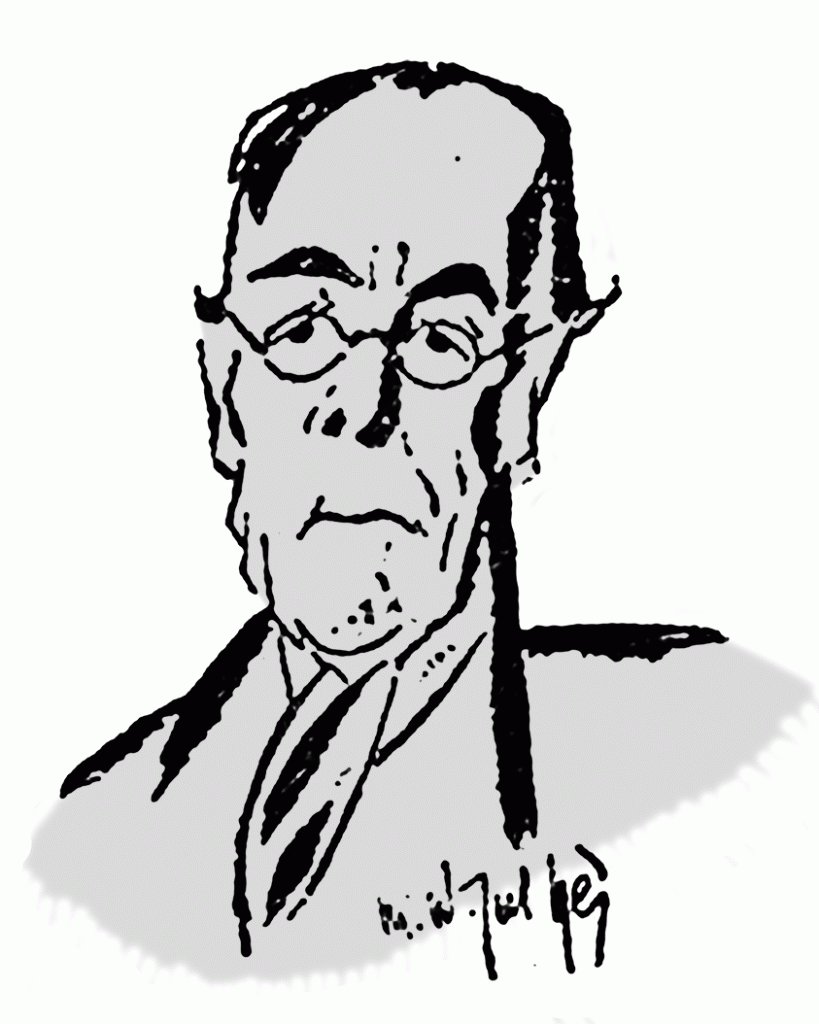
Portrait de Maurice Boissard par M.-W. Julhès tel qu’il est paru dans cette colonne des Nouvelles littéraires
Ces chroniques dramatiques sont devenues illustres, dans un petit monde de lecteurs raffinés, par leur impertinence, leurs rosseries et cette aisance avec laquelle leur auteur parle de tout autre chose que des pièces qu’il a vu jouer. Paul Léautaud est aussi l’auteur d’un livre aujourd’hui rare, Le Petit Ami, que certains estiment un chef d’œuvre, et qu’il recommence perpétuellement : de temps en temps, Paul Léautaud publie dans une revue quelques pages où il se raconte et qui sont comme des suppléments du Petit Ami. Sur chaque événement de sa vie, Paul Léautaud garde ainsi en réserve deux ou trois anecdotes et il se confesse à petites doses, mais toujours avec un ton de sincérité qui surprend. Ces confessions sont en effet d’une ingénuité troublante. Si Léautaud plaît tant à notre époque, c’est qu’il a l’originalité d’être un esprit simple. Ses chroniques défendent une esthétique extraordinairement ordinaire : il y a du M. Sarcey45 chez M. Boissard. Quant à ses souvenirs, ils sont cyniques à la façon enfantine de Restif de la Bretonne46. On peut être sûr que Léautaud n’invente rien. Il manque totalement d’imagination. Il est d’un temps qui est aussi celui de Jean-Jacques, où l’on avait d’autre prétention que de s’étaler soi-même le plus naturellement possible.
Les goûts de Léautaud se limitent à La Rochefoucauld, Diderot, Chamfort, Stendhal… Comme il est forcé d’aller au théâtre, il préfère s’y amuser que s’y ennuyer. Il aime les bêtes. Il est sobre. Il est paresseux. Il a écrit : « Les devoirs ? Les leçons ? Les examens ? J’ai connu une chose plus haute : le plaisir. » C’est le plaisir qu’il proclame comme étant sa seule loi. Cela est fort stendhalien, mais on se demande un peu ce que, dans notre siècle à autobus, il appelle ainsi, cet honnête citoyen de Fontenay, dont le tempérament a toujours été refroidi par la crainte de paraître dupe et dont les inquiétudes sont si peu diverses. On sent qu’il adorerait passer pour un individu dangereux, méchant, féroce, noir et dénué de tous scrupules.
Il écrit ce qu’il pense, comme il le pense. Dernièrement, il s’est comparé au Misanthrope47 : il en a la candeur et la mauvaise éducation. Il n’imagine pas que l’on puisse écrire autre chose que ce que l’on a vu ou pensé ; c’est là un raffinement et un artifice qui le dépassent. Au bout de sa phrase, il met un point et passe à une autre phrase. Car le point-et-virgule est une de ses haines. C’est un personnage très curieux.
Jean Cassou
Le cinq janvier Paul Léautaud lui écrit, ce qui est un autre indice que Jean Cassou ne travaille plus au Mercure. Le cinq janvier, c’est-à-dire immédiatement puisque ce numéro des Nouvelles littéraires est daté du six. Il s’agit de la date de parution dans les kiosques mais les revues et journaux reçoivent les numéros de leurs confrères directement depuis l’imprimerie, par coursier. Il est rare — il sera de plus en plus rare — que Paul Léautaud écrive immédiatement à un auteur pour le remercier. Le plus souvent ça traîne…
Cher enfant,
Je viens de lire les Nouvelles littéraires, cet article que vous avez osé écrire sur ma personne, mon talent et mes travaux. Vous vous vengez, misérable, de toutes les vérités que je vous ai dites. Je suis même étonné de trouver cet article au recto d’une page. Le verso semblait mieux dans vos goûts48. Il est vrai que dans recto, il y a49… S’il est vrai, comme vous voulez bien le reconnaître, que je dispose de quelque malice, soyez sûr que je vous revaudrai cela. Je suis pourtant obligé, de vous faire un compliment, qui en est un pour moi aussi, car il est la preuve que vous avez été assez malin pour profiter des leçons que je me suis tué à vous donner pendant tout le temps que vous avez passé à cabrioler dans les bureaux du Mercure. Vous savez si j’aime, apprécie, loue et conseille le style bref. Vous avez réussi ce prodige — de votre part ! — que celui de ce perfide article a toutes ces qualités. Je crois même, ma parole, que vous avez su vous hausser jusqu’à l’absence de tout point et virgule. Si je ne peux vous faire de compliments que sur ce point, du moins je vous les fais avec plaisir. Vous vous montrez un bon élève. Il ne vous reste plus qu’à acquérir quelques qualités de cœur, cette candeur, cette ingénuité, cette simplicité d’esprit qui brillent en moi — jaloux !
Mille épithètes suaves et amoureuses, vilain chat.
Le portrait qu’on donne de moi au milieu de vos calomnies, a au moins ce mérite qu’il ôtera toute idée de me prêter vos occupations habituelles.
P. Léautaud
Jean Cassou n’apparaîtra plus dans le Journal littéraire pendant trois ans, le quatre mai 1926 :
Ce matin, visite de Cassou. Il me parle de l’article Le Révérend, qu’il trouve très amusant, très bien fait et Le Révérend un garçon d’esprit50. Il me demande ensuite ce que deviennent mes affaires avec les Nouvelles littéraires51. Je le mets en détail au courant de ma rupture. Il me dit : « Somme toute, Martin du Gard s’est conduit avec vous comme un mufle, comme il fait avec tout le monde. » Je trouve le mot mufle, un peu fort. Je dis : procédés singuliers, tout au moins. Cassou me raconte que Martin du Gard a eu les mêmes avec des tas de gens. Avec lui-même, Cassou. Il avait fait la connaissance de Martin du Gard. Martin du Gard lui faisait mille amabilités, lui disant des choses comme celles-ci « Vous me plaisez beaucoup. Il faut nous voir souvent. Vous ne voulez pas être mon ami ? » Ils en étaient même arrivés à se tutoyer. Martin du Gard est entré aux Écrits nouveaux52, comme directeur. Cassou pensait qu’il allait se souvenir de ses protestations d’amitié. Rien. Ils se rencontrent un jour. Martin du Gard lui dit : « Comment se fait-il que tu ne m’apportes jamais rien ? » Cassou me dit qu’il a trouvé la chose un peu forte, que c’était plutôt à Martin du Gard à lui faire signe. Martin du Gard a pris ensuite les Nouvelles littéraires. Il a recommencé la même chose. Cassou lui a donné des articles. Il les a pris ou pas pris, l’a fait attendre, l’a emberlificoté de prétextes. Cassou a fini par ne plus s’en occuper. Quand on dit de lui un mot gentil dans les Nouvelles, il se dit : bon, ça va bien. — Quand on ne dit rien, il s’en fiche.
Martin du Gard s’est conduit de même avec Miomandre53, même avec Jaloux. C’est Jaloux qui l’a raconté à Cassou. À plusieurs reprises, même des choses désagréables. Jaloux a pris son parti de ne plus y faire attention. Comme je parlais à Cassou de la façon dont Martin du Gard est envoûté par Barrès54, il m’a dit que Jaloux en a parlé avec lui, qu’il trouve cela inimaginable, d’avoir choisi justement comme modèle un raté, Barrès n’ayant pas été autre chose en politique, et peut-être même en littérature, au moins à la fin de sa carrière. En politique, il n’a jamais été ministre, jamais chef de parti, il n’a jamais prononcé un vrai discours, il n’était pas le moins du monde orateur, et quant à sa littérature de guerre, elle fera pouffer de rire un jour sur son compte. Je parle à Cassou de l’intention de Martin du Gard de se présenter à la députation du côté de Pau. Il me dit qu’il peut s’attendre à une jolie veste, et même à de beaux déboires quand il ira faire des discours aux Béarnais, gens extrêmement malicieux et moqueurs. Il paraît que Martin du Gard a déjà tenté quelques essais, en disant, pour définir sa nuance politique, qu’il est de « l’extrême centre ». Cassou dit que c’est une trouvaille bien curieuse : l’extrême centre. Rien de plus comique que de voir ces deux mots réunis.
Il y a longtemps que nous avons parlé en riant, Cassou et moi, de me faire décorer (il est à l’Instruction publique). Nous en avons reparlé ce matin. Comme chaque fois, la plaisanterie continuant, il m’a promis de s’en occuper. Je lui ai dit : « N’attendez pas que je publie quelque chose. Je n’aurais plus aucune chance, alors. » Cela nous a fait rire tous les deux.
Dans les années suivantes, le Journal littéraire n’évoque plus Jean Cassou qu’incidemment, pour évoquer des souvenirs de ce que l’on vient de lire, jusqu’à ce 28 octobre 1929 :
Ce soir visite de Cassou. Nous parlons de Fourcade55, le nouvel éditeur installé rue de Condé, tout à côté du Mercure, dans les anciens locaux de la Semaine à Paris et chez lequel lui, Cassou, il est tout le temps fourré. Je lui demande ce qu’il va publier. Il me dit à la fois des ouvrages de luxe et des ouvrages de librairie courante. Pour commencer, Fargue. Je dis : « Ah ! oui. C’est le coup Valéry qui recommence. » Cassou me raconte alors que lorsqu’on a commencé le coup Valéry, on hésitait entre lui et Fargue56. « Tous les deux le même passé, les mêmes belles relations, la même littérature restreinte et difficile, la même réputation de cénacle. Les libraires hésitaient entre l’un et l’autre. »
Ensuite ce sera comme avec Georges Duhamel, comme avec nombre de ses amis, Paul Léautaud après avoir bien apprécié, le détestera mais, fort heureusement, en parlera peu.
Notes
1 À l’évidence, Maurice Martin du Gard n’a pas pris de notes. C’est un an plus tard, le quinze janvier 1921 que paraît la première chronique de « Lettres espagnoles » de Jean Cassou dans le Mercure de France.
2 Chanter pouilles : Accabler quelqu’un de reproches accompagnés d’injures (TLFi).
3 Le père de MMG, Henri (1861-1931), est avoué près la cour d’appel de Nancy.
4 La seule adresse connue de Gérard de Nerval (1808-1855) dans l’arrondissement est le 5, rue des Beaux-Arts, vers 1835. La légende veut que Gérard de Nerval, que l’on a retrouvé pendu à une grille dans la rue, son chapeau sur la tête, soit mort à l’exact endroit où s’est trouvé, plus tard, la boîte du souffleur du théâtre Sarah Bernhardt (ouvert en 1862 mais sous ce nom en 1899). Selon les affirmations de Sarah Bernhardt il n’y a jamais eu de souffleur (et donc de boîte), dans son théâtre, celle-ci exigeant que ses comédiens apprennent leur rôle par cœur. La pratique de l’alternance à la Comédie-Française ne permettait pas cette exigence.
5 Georges Pillement (1898-1984) est auteur de livres d’art et de tourisme. Il est aussi auteur dramatique et romancier. Au début de la guerre de 1939 il a entrepris des publications destinées à la sauvegarde du patrimoine bâti.
6 La revue Les Lettres parisiennes, d’un format à l’italienne, est parue 49 boulevard Magenta (rive droite) pendant deux ou trois années à raison de neuf numéros par an. Cette revue édite aussi des volumes, comme la fable en trois actes de Jean Cassou et Georges Pillement : Le Soleil enchaîné ou La Dame au champignon.
7 Ossip Zadkine (avec deux s, 1890-1967), français d’origine russe, établi en France en 1910 est considéré comme l’un des plus grands maîtres de la sculpture cubiste.
8 Nous verrons cela, en effet, dans le texte de Marie Dormoy : L’Enseignement du maître sculpteur Antoine Bourdelle, paru dans le Mercure du 1er mai 1922.
9 André Suarès (1868-1948), poète et écrivain, est surtout connu pour Le Voyage du Condottière, roman en trois tomes. Dans ces années de guerre, André Suarès est le premier des nombreux conseillers de Jacques Doucet pour la confection de sa bibliothèque, léguée à l’Université à sa mort en 1929. Marie Dormoy en sera la directrice.
10 René Arcos (1880-1959), poète. Réformé, il a été correspondant de guerre du Chicago Daily News durant la Première Guerre mondiale et a fondé en 1918 les Éditions du Sablier à Genève avec Frans Masereel, puis participé avec Romain Rolland à la fondation de la revue Europe dont il est resté le rédacteur en chef jusqu’en 1929.
11 Le vent fait flotter / Du même côté / Les voiles des veuves // Et les pleurs mêlés / Des mille douleurs / Vont au même fleuve. // Serrés les uns contre les autres / Les morts sans haine et sans drapeau, / Cheveux plaqués de sang caillé, / Les morts sont tous d’un seul côté. // Dans l’argile unique où s’allie sans fin / Au monde qui meurt celui qui commence / Les morts fraternels tempe contre tempe / Expient aujourd’hui la même défaite. // Heurtez-vous, ô fils divisés ! / Et déchirez l’Humanité / En vains lambeaux de territoires, / Les morts sont tous d’un seul côté.
12 Titre de la chronique de Guillaume Apollinaire au Mercure.
13 Ne seront pas données ici toutes les occurrences Cassou données dans l’Index d’Étienne Buthaud, beaucoup ne servant que d’introduction à un tout autre sujet : « Jean Cassou me parlait ce matin d’André Germain » ; « Jean Cassou, qui est assez renseigné sur Marcel Proust, probablement par Pierre Louÿs, me racontait ce matin ceci : » ; « [Rachilde] nous disait ce matin, en nous la montrant, à Cassou et à moi »… ; « J’ai soumis à Roux et à Cassou les quelques lignes »… etc.
14 Roger Martin du Gard (1881-1958), écrivain, prix Nobel de littérature en 1937. Le cousin en question est Maurice Martin du Gard, actuellement directeur du mensuel Les Écrits nouveaux (note 52) et futur directeur des Nouvelles littéraires.
15 Il s’agit évidemment des Thibault, qui sera publié de 1922 à 1940 à la NRF. Oscar Thibault a deux fils, Antoine et Jacques, que tout oppose. Antoine sera médecin.
16 Vraisemblablement le peintre Robert Mortier (1878-1940), qu’on ne confondra pas avec un autre peintre, Alfred Mortier, second mari d’Aurel.
17 Florent Fels (Florent Felsenberg, 1891-1977), critique d’art avant-gardiste, fondateur puis codirecteur de la revue Action (cahiers individualistes de philosophie et d’art), nommé directeur artistique de Radio Monte-Carlo en 1945.
18 Guillaume Apollinaire est mort le neuf novembre 1918.
19 André Salmon (1881-1969), poète, romancier, journaliste et critique d’art, défenseur du cubisme au côté de Guillaume Apollinaire.
20 Rubén Darío (Rubén García Sarmiento, 1867-1916), poète du Nicaragua, considéré comme le fondateur de la langue hispano-américaine moderne avec son recueil de poèmes Azul, publié à l’âge de 21 ans.
21 Le « Mercure d’autrefois », c’est-à-dire de l’époque à laquelle parût Ubu-Roi, à la fin du siècle précédent, en 1896.
22 Léon Roux, camarade de jeunesse d’Alfred Vallette et ami de Paul Verlaine, selon une note de la Correspondance générale au 29 mars 1923. Certains signes, comme celui-ci laissent penser que Léon Roux a partagé le bureau de Paul Léautaud. Ainsi nous pourrons lire, au 28 octobre 1925 : « Roux étant malade, je suis tranquille dans mon bureau ».
23 Restons un peu sur cette affaire minuscule autant que mal connue, concernant Félix Gandéra (Félix Pensieri, 1885-1957), comédien, auteur dramatique, producteur de spectacles et réalisateur de films. Henri Béraud, nous venons de le lire, est devenu, à la place de Maurice Boissard, le nouveau titulaire de la rubrique des « Théâtres » du Mercure de France. Quel que soit son farouche antisémitisme, quel que soit le comportement odieux qu’il aura pendant l’Occupation allemande (il sera condamné à mort à la Libération et, comme tout le monde, gracié assez rapidement), il n’en demeure pas moins qu’Henri Béraud montre un puissant talent de polémiste. Et comme Maurice Boissard, il a ses têtes, sur lesquelles il cogne fort. Parmi elles, Félix Gandéra. Dans le Mercure du premier octobre dernier (1921), page 189, il l’a un peu égratigné mais dans le numéro du premier novembre ça a été un massacre : « Vers le 7 octobre, au théâtre des Mathurins, on a joué une saloperie en trois alcôves de M. Gandéra. Les voyeurs se sont paraît-il très abondamment satisfaits. » Henri Béraud ne cite pas le titre de la pièce. Il s’agit de la comédie en trois actes Les Deux Monsieur de Madame, on imagine le sujet. De cette pièce on tournera deux films. Félix Gandéra a porté plainte et l’affaire a été jugée par la douzième chambre correctionnelle de Paris le vingt juin 1922. « Attendu que… (lire les détails dans le Mercure du quinze septembre 1922 page 773)… Condamne Valette et Béraud chacun à vingt-cinq francs d’amende, et, statuant sur les conclusions de la partie civile, condamne Vallette et Béraud, conjointement et solidairement, à payer à Gandéra la somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; / Ordonne à titre de supplément de dommages-intérêts l’insertion du présent jugement dans le Mercure de France en mêmes place et caractères que l’article incriminé […] »
24 Francis de Croisset (Franz Wiener, 1877-1937), auteur dramatique, romancier et librettiste prolifique. Né Belge d’origine allemande, arrivé en France à l’âge de vingt ans et fort désireux de s’intégrer au mieux dans la société, Franz Wiener prit le nom du hameau où vécut Gustave Flaubert et se fit baptiser. Malgré une œuvre conséquente et un succès certain, il ne reste plus guère de Francis de Croisset de nos jours que Ciboulette, opérette écrite en collaboration avec Robert de Flers au printemps 1923 avec une musique de Reynaldo Hahn. Maurice Boissard a chroniqué deux comédies en trois actes de Francis de Croisset, Le Cœur dispose (Mercure du seize avril 1912) et Le Retour, de Robert de Flers et Francis de Croisset (Mercure du quinze novembre 1920).
25 Dans le Mercure du quinze juin 1921, page 755 à propos de Chérubin, en trois actes. En un antisémitisme très affirmé, Henri Béraud attaque l’auteur personnellement.
26 Cette lettre, datée du 18 juin est parue dans les « Échos » du Mercure du premier juillet, page 281.
27 Henri de Régnier (1864-1936), a épousé en 1895 Marie, deuxième fille de José Maria de Heredia. Marie écrit sous le pseudonyme de Gérard d’Houville.
28 Henry Bernstein (1876-1953), auteur dramatique à succès, sera directeur du théâtre du Gymnase en 1926.
29 Jeanne Meyer (1875-1953), a épousé Lucien Muhlfeld (1870-1902), romancier et critique dramatique, mort précocement, Stéphane Mallarmé étant témoin. Jeanne Muhlfeld s’est remariée en 1925 avec Pierre Blanchenay 1884-1958.

Jeanne Muhlfeld par Leonetto Capiello en 1904, dessin sur papier visible au musée Carnavalet
30 Pierre de Régnier, dit « Tigre » (1898-1943).
31 Cette expression bien passée de mode, a deux sens opposés : une personne « du dernier bateau » est au courant de la mode mais « arrivée par le dernier bateau », cette personne est peu au fait des habitudes, comme quelqu’un qui vient de débarquer.
32 Henri-Charles de Régnier (1820-1877), inspecteur des douanes.
33 Henri de Régnier, La Pécheresse, Mercure de France 1920, 350 pages. Le texte de ce roman est d’abord paru dans cinq numéros de la revue, du quinze décembre 1919 au quinze février 1920.
34 George Besson (1882-1971) homme de lettres, collectionneur et critique d’art, militant communiste. En mai 1937, George Besson demandera à PL un texte sur les chats pour la revue Mieux vivre. Voir aussi au six septembre 1953. Cette revue est parue de 1912 à 1924.

Dans ce numéro de mai 1921 on peut dire que Paul Léautaud est bien entouré. Les noms sont ici présentés en ordre alphabétique mais c’est In memoriam qui ouvre ce numéro qui traite plus généralement de la vigne et du vin. Les signatures de Léon Werth et d’Henri Béraud sont récurrentes dans les numéros de cette période.
35 Charles Régismanset (1877-1945), docteur en droit, fonctionnaire de l’administration coloniale. Il sera nommé à l’Académie des sciences coloniales en 1922 et directeur de l’Agence générale des colonies entre 1924 et 1926.
36 Claude Farrère (Frédéric-Charles Bargone, 1876-1957), écrivain voyageur et officier de marine, prix Goncourt 1905 avec Les Civilisés. Le six mai 1932, le Président Doumer qui inaugure le salon annuel des écrivains anciens combattants et s’entretient avec Claude Farrère, président de l’association, tombe sous les balles de Paul Gorgulov. Claude Farrère s’interposant, est blessé au bras, ce qui lui vaudra son élection à l’Académie française en mars 1935 devant Paul Claudel. Un court portrait de Claude Farrère sera dressé par Paul Léautaud à cette date du six mai 1932.
37 Georges Louis (1847-1917), diplomate, ambassadeur de France en Russie (1909-février 1913). Frère aîné de Pierre Louÿs qui mourra en juin 1925. Georges Louis a eu deux enfants dont Philippe né et mort en 1901 et Robert (1903-1924). On ne vit pas longtemps, dans cette famille. Lire aussi note 42.
38 Paul Deschanel (1855-1922), homme d’État français, président de la République du 18 février au 21 septembre 1920. Paul Valéry passera quelques semaines dans cette maison en avril 1940. Voir le Journal littéraire aux 22 et 26 avril 1940.
39 Le Corse Angelo Mariani a fondé la maison Coca Mariani 1863. Le vin Mariani se vendait en pharmacie. On peut encore s’en procurer de nos jours. Cette entreprise a édité plusieurs années depuis 1895 un album de « Figures contemporaines » encore prisés de nos jours pour les portraits de personnalités de l’époque.
40 Après avoir habité au 147 boulevard Malesherbes (près du lycée Carnot) jusqu’en 1902, Pierre Louÿs s’est installé au 129 rue de Boulainvilliers, correspondant à une entrée du hameau de Boulainvilliers, discret pâté de maisons entre la maison de la radio et le lycée Molière. Lire ici comment le jeune Stéphane Mallarmé utilisa ce nom à son profit.
41 Pierre Louÿs a divorcé en 1913 de Louise de Heredia. Il épousera Aline Steenackers en octobre 1923 qui lui donnera ce garçon et peut-être deux filles.
42 Paul Raphaël Armand Louis (1857-1884) mort à 27 ans n’a sans doute pas eu le temps de devenir ambassadeur. Pierre Louÿs a bien un (demi-)frère diplomate : Georges (note 37) (1847-1917), en poste en Égypte en qualité de délégué de la France à la commission de la Dette égyptienne (1893-1903) puis ambassadeur de France en Russie (1909-1913) qui a épousé en mai 1900 Maria Garcia de La Paz de Ortega de Morejon Dominguez (1872-1957).
43 Fernand Gregh (1873-1960), poète, critique littéraire et historien, président de la société des Gens de lettres en 1949-1950, membre de l’Académie française en 1953, à 80 ans, après treize échecs. Les débuts de Fernand Gregh sont décrits par Paul Léautaud dans sa notice des Poètes d’aujourd’hui.
44 Pierre Louÿs, né en 1870, a donc 53 ans. Il mourra en juin 1925.
45 Francisque Sarcey (1827-1899) était un critique dramatique célèbre en même temps que très académique. Introduit par Edmond About, il a donné son premier article dans Le Figaro en 1857. En 1860, il devient critique dramatique au journal L’Opinion nationale. En 1867, il entre au Temps, où il tiendra son feuilleton théâtral pendant 32 ans, tout en collaborant à d’autres journaux.
46 Nicolas Restif de La Bretonne (1734-1806), parfois écrit phonétiquement Rétif. NRLB était typographe et homme de lettres éclectique et particulièrement fécond, surtout connu pour son autobiographie en huit volumes, Monsieur Nicolas, ou le Cœur humain dévoilé, concentré sur le récit de seulement trois années de sa vie (1794 à 97). Paul Léautaud lui sera souvent comparé.
47 Chronique du 1er avril 1922 : « Le Misanthrope, c’est encore ce même quelqu’un que je connais. Il aime la simplicité. Il a horreur des compliments. Il a aussi peu de vanité qu’on en peut avoir. »
48 Jean Cassou ne s’est marié qu’en 1854, à l’âge de 57 ans, avec Ida Jankelevitch (1898-1982). Dans le tapuscrit de Grenoble à la date du 18 octobre 1927 nous lisons pourtant d’après un racontar d’Auriant (qui en était friand) que Jean Cassou aurait été l’amant d’Aline Steenackers, seconde épouse (octobre 1923) d’un Pierre Louÿs agonisant dans la pièce à côté. Le récit est suffisamment sordide pour être mis en doute.
49 Une chronique dramatique signée Lugné-Poe.
50 Gaston Le Révérend (1885-1962), un temps instituteur puis écrivain. Athée et anticlérical. Gaston Le révérend a longtemps mis en avant ses opinions nationalistes et régionalistes (la Normandie, où il est né). L’article en question est paru dans Les Nouvelles littéraires du 24 avril 1926. Un second article est à paraître dans la revue Europe du quinze mai. Ces deux articles ont ensuite été réunis, retravaillés et augmentés pour une publication en volume sous le titre Le Haut-parleur, aux éditions de La Fenêtre ouverte.
51 Depuis le vingt octobre 1923 Paul Léautaud ne publie plus de chroniques dramatiques aux Nouvelles littéraires, propriété de la société Larousse, qui en était peut-être agacée. C’est Fernand Gregh, personnage infiniment plus sérieux, qui a pris la suite. Maurice Martin du Gard, directeur de la revue, acceptait néanmoins des chroniques d’ordre plus général.
52 Le mensuel Les Écrits nouveaux est paru à partir de décembre 1917 chez Émile Paul, jusqu’en décembre 1922. Le premier numéro des Nouvelles littéraires est paru le 21 novembre 1922 sous la direction de Jacques Genne et Maurice Martin du Gard.
53 Francis de Miomandre (Francis Durand, 1880-1959) a reçu le prix Goncourt en 1908 pour Écrit sur de l’eau. En septembre 2013, Rémi Rousselot lui a réservé une biographie : Francis de Miomandre, un Goncourt oublié (La Différence, 2013). Voir aussi l’article de Maurice Martin du Gard en une des Nouvelles littéraires du trois mai 1924 (deux colonnes).
54 Maurice Barrès (1862-1923), écrivain et homme politique, figure de proue du nationalisme français. Maître à penser de sa génération et de ce courant d’idées, sa première œuvre est un triptyque qui paraîtra sous le titre général du Culte du Moi chez Alphonse Lemerre (Sous l’œil des Barbares, 1888, Un homme libre, 1889, et Le Jardin de Bérénice, 1891), tous trois lus et admirés, un temps, par Paul Léautaud.
55 Jacques-Olivier Fourcade (1904-1966), libraire-éditeur. Jean Cassou était son conseiller littéraire au côté d’Henri Michaux. L’adresse évoquée par Paul Léautaud est le 22 rue de condé.
56 Avant de fréquenter les mardis de Rachilde, Léon-Paul Fargue (1876-1947), a été reçu aux mardis de Stéphane Mallarmé (1842-1898), où il a rencontré Paul Claudel, Claude Debussy, André Gide, Marcel Schwob, Paul Valéry… Il est devenu l’ami de Maurice Ravel. En 1924 il fondera avec Valery Larbaud et Paul Valéry, la revue Commerce. Voir aussi son portrait dans le Journal littéraire au 28 décembre 1932 et sa nécrologie dans le Mercure du premier janvier 1948 par Georges Randal (Auriant) (page 185) et « Fargue — Premières rencontres », par Adrienne Monnier dans le Mercure de février 1948 en ouverture de la revue.