Le Mercure de France 1938-1945 — Les années Bernard
Introduction — Acte I : Le poison — Acte II : L’intoxication — Acte III : L’antidote
Notes de l’introduction — Notes de l’acte I — Notes de l’acte II — Notes de l’acte III
Page publiée le quinze mai 2024. Temps de lecture : près de deux heures et trente minutes, vous êtes sur leautaud.com. Les notes sont à la fin des actes.
C’est avec un vif plaisir qu’est publié ici le seul document existant sur Jacques Bernard, « le triste directeur du Mercure de France » ainsi que l’a qualifié Marie Dormoy dans sa précieuse préface « Histoire du Journal littéraire ».
Pour les visiteurs occasionnels de ce site, rappelons la note de bas de page qui lui est généralement attribuée :
« Jacques-Antoine Bernard (1880-1952), est arrivé au Mercure de France en 1907 sans qu’on sache vraiment à quel titre, mais sensiblement à la même époque que Paul Léautaud, qui y a effectivement été embauché le 1er janvier 1908. Jacques Bernard sera administrateur du Mercure en 1935, à la mort d’Alfred Vallette, sous la direction de Georges Duhamel, puis directeur au départ de celui-ci à la fin de février 1938. Avant cela Paul Léautaud et Bernard se sont plutôt bien entendus. Pendant l’occupation, Bernard se livrera à la collaboration et sera jugé à la Libération pour « Intelligence avec l’ennemi » et condamné à cinq ans de prison (mais laissé en liberté), à la privation de ses biens et à l’Indignité nationale. Convoqué comme témoin en juillet 1945, Paul Léautaud, rétif à toute autorité, refusera de l’accuser. Pour l’anecdote, Jacques Bernard était prétendant (sans enthousiasme) au trône de l’éphémère et quasi-inexistant royaume d’Araucanie et de Patagonie. »
Avant le travail de Julien Doussinault que l’on va pouvoir lire ci-après, c’est tout ce que l’honnête homme pouvait savoir sur cet individu. Il ne se posait d’ailleurs pas d’autres questions.
Jusqu’à ce qu’en 2002 surgisse Julien et son mémoire de maîtrise, reproduit ici, à l’exception des annexes.
En 2002, Julien était un bien jeune homme. Il a, depuis, doublé son âge, ce qui est toujours une expérience intéressante. Le Julien de l’époque n’est plus le Julien d’aujourd’hui.
Après avoir été libraire chez les autres, Julien a décidé d’être libraire chez lui, rêve sans doute ancien. Il est maintenant en train de s’installer à son compte, ce qui n’est jamais une expérience de tout repos. Il n’a donc pas eu le temps de procéder aux corrections évidemment entraînés par les années. Pour lui, il s’agit d’un vieux texte oublié dans un placard, dont il n’avait même plus une disquette. Pour quoi faire ? Ainsi sont les modestes. Julien nous a donc fait une confiance totale que nous avons tenté de mériter. Aussi est-ce à pas de chat, en ne touchant qu’à quelques notes, que ce document a été aménagé pour cette publication.
L’ouverture de sa librairie sera évidemment annoncée ici à fortes trompettes. Nous nous précipiterons tous !
Julien Doussinault
Le Mercure de France pendant la Seconde Guerre mondiale.
1938-1945 : les « années Jacques Bernard » ; quand le Mercure devint poison.
Vie, mort et résurrection d’une maison d’édition

Mémoire de maîtrise d’histoire culturelle soutenu sous la direction de Pascal Ory.
Université Paris I (Panthéon – Sorbonne)
Juin 2002
En couverture : Botticelli, Le Printemps, vers 1482. Tempera sur peuplier 203 x 314 cm. Galerie des offices. Florence. Détail.
Julien Doussinault
LE MERCURE DE FRANCE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
1938-1945 : les « années Jacques Bernard » ; quand le Mercure devint poison.
Vie, mort et résurrection d’une maison d’édition
Mémoire de maîtrise d’histoire culturelle soutenu sous la direction de Pascal Ory.
Université Paris I (Panthéon – Sorbonne)
Juin 2002
Remerciements
Nous voulons remercier :
Marie-Louise Heller (épouse de Gerhard Heller) et Romana Severini Brunori (ayant-droit de Rachilde), qui nous ont donné l’autorisation de consulter les dossiers « G. H. » et « Rachilde » à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
Jacqueline Brault, grâce à qui nous avons eu accès à la bibliothèque du Mercure de France, et Nicole Boyer, juriste de la maison d’édition de 1961 à 2000, qui, lors d’un entretien, nous a transmis un certain nombre d’informations précieuses.
Claire Lesage, qui nous a permis de lire sa thèse de l’École des Chartes consacrée au Mercure de France de 1890 à 1914.
Les membres du personnel, anonymes, de la bibliothèque Jacques Doucet et de la BNF, de la mairie de Bouray-sur-Juine, des archives de Paris et des archives de France, même si leur autorisation arrive trop tard.
Pascal Ory. Nous voulions travailler sur une maison d’édition pendant l’Occupation et Pascal Ory nous a suggéré de nous intéresser au Mercure de France, sachant que très peu d’études avaient été entreprises sur cette maison à ce moment précis de l’Histoire ; et comme vous allez pouvoir le constater, il avait raison.
« Il me semble que je ne sais encore rien auprès de tout ce que je voudrais savoir. »
Paul Léautaud1.
« Vous croyez peut-être que c’est facile
de faire un livre ? »
Cervantès2.
Introduction
Dimanche 18 juin3. — […] Auriant me raconte : Bernard a reçu la visite d’une Allemande, probablement pour une question de traduction. Il s’est mis à lui dire sa sympathie pour l’Allemagne, son admiration pour Hitler. Cette Allemande lui a dit : « Vous m’autorisez à répéter ? — Mais certainement. » J’espère que si cela4 est publié, et connu, il y aura quelques protestations au Mercure.
Le Mercure de France a collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. « Cela » fut connu. Jacques Bernard, directeur de la maison d’édition de 1938 à 1944, fut jugé pour « intelligences avec l’ennemi » dès 1945 mais le Journal littéraire de Paul Léautaud fut publié pour la première fois en 1959. Et les seules protestations que « cela » suscita furent justement dirigées à l’encontre de Paul Léautaud, « collaborationniste timoré », « fanatique », et dont les mille trois cents pages de journal rédigées de 1940 à la Libération constituent, pour Jeannine Verdès-Leroux, un « document d’un collaborationnisme extrême5 ».
Jacques Bernard, personnage principal de l’histoire, est vite oublié dans les années d’après-guerre et si les chercheurs, en histoire comme en littérature, se sont souvent intéressés au Mercure de France, les années 1938-1945, dites aussi les « années Bernard », sont la plupart du temps absentes, voire volontairement écartées des travaux consacrés à la maison d’édition de la rue de Condé. En 1995 a paru le catalogue d’une exposition à la BnF intitulée : « Le Mercure de France : cent un ans d’édition6 », prétendant retracer l’histoire de la maison d’édition des origines à nos jours. Deux pages, sur cent cinquante et une, évoquent la période de l’occupation allemande. La même année, la revue Digraphe (éditée par le Mercure) rendait hommage au Mercure de France dans un numéro spécial, mais là encore, les années de guerre restent les années sombres, partiellement révélées et, la plupart du temps, rapidement traitées. En 1997, le Mercure de France fait paraître une anthologie de textes publiés dans la revue de 1890 à 1940, année à partir de laquelle la revue cesse de paraître. Les auteurs7 qui ont établi cette édition ont fait une chronologie du Mercure allant jusqu’en 1965, et très peu d’informations ressortent en ce qui concerne notre période. Même dans le livre de Pascal Fouché, L’Édition française sous l’Occupation8, ou dans la monumentale Histoire de l’édition dirigée notamment par Roger Chartier9 (dans lesquels il est pourtant fait plusieurs fois allusion au Mercure de France sous la direction de Jacques Bernard) rien ne permet de définir clairement l’attitude du Mercure pendant ces quatre années d’occupation. Et pour se convaincre définitivement de l’épaisseur du mur devant lequel nous nous sommes trouvés en début d’année et de l’amnésie qui menaçait la maison d’édition, il suffit de se rendre directement au Mercure de France, 26, rue de Condé, à Paris, dans la VIe arrondissement. C’est Jacqueline Brault qui vous accueille, et si vous lui faites entendre que vous vous intéressez aux archives du Mercure pour la période 1938-1945, elle vous répond immédiatement qu’ « il est inutile d’insister », que « des documents ont été égarés par mégarde » mais qu’elle ne peut « ni vous dire quand ni par qui10 ». Il est ici certainement nécessaire de préciser que nous n’avons pas pu obtenir d’entretien avec Isabelle Gallimard, l’actuelle directrice du Mercure de France.
La perte des archives du Mercure est d’ores et déjà à considérer avec sérieux et regret. Elle prive non seulement l’historien de renseignements apportant des précisions sur le fonctionnement interne de la maison, mais elle lui retire aussi les contrats d’édition passés entre l’auteur et l’éditeur, les données chiffrées concernant les ventes de livres, les correspondances, les documents relatifs à la revue (tirage, nombre et identité des abonnés) ; certains livres même. Elle annonce une recherche difficile, contraignant le chercheur à se reporter sur d’autres sources qui nourrissent plus généralement l’histoire littéraire. Mais nous pouvons également la considérer dès à présent comme étant relativement significative, et partir de ce vide pour, peu à peu, pas à pas, lui donner un sens. Ce manque d’informations disponibles au Mercure est une sorte de provocation pour le chercheur en histoire et nous a dans un premier temps poussé à reconstituer le catalogue des titres du Mercure édités de 1939 à 1945, en nous aidant des livres conservés dans la bibliothèque de la rue de Condé, mais aussi en consultant les tomes de la Bibliographie de la France11 et en recoupant ces informations avec d’autres sources, trouvées sur Internet notamment.
Ce catalogue (présenté en annexe sous forme de tableau Excel) n’existait pas et ne concerne que les années de 1939 à 1945. Pourquoi ne pas prendre en compte l’année 1938, dans la mesure où nous savons que Jacques Bernard, qui prend la direction du Mercure cette année-là, adhère à l’idéologie hitlérienne bien avant le début de la guerre, si l’on en croit les propos qu’il adresse à la Propaganda Abteilung12 le 10 mars 1941, dans une lettre où il écrit : « Je peux avec sérieux vous dire que je ne suis pas venu d’hier aux idées qui vous sont chères13. » ? Nous avons jugé préférable, dans le cadre d’une étude sur le catalogue de la maison d’édition permettant de définir les contours d’une politique éditoriale, de ne pas inclure l’année 1938, car cette année est encore marquée par les décisions prises par l’ancien directeur, Georges Duhamel, sur le choix des titres à éditer. De la même manière, nous pouvons imaginer que certains des titres parus en 1945 ont été suggérés par Jacques Bernard, bien qu’il fut relevé de ses fonctions dès septembre 1944, inculpé en février 1945 et arrêté un mois plus tard. Si nous choisissons d’étudier les années 1938-1945, qui correspondent au directorat Bernard ainsi qu’à son arrestation, nous ne retenons donc que la période 1939-1945 pour comprendre l’activité éditoriale du Mercure. Ce catalogue va nous permettre de franchir en grande partie le mur que l’on voyait se dresser devant nous au début de nos recherches.
« Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière14 ? »
Les murs d’une maison d’édition pendant l’occupation allemande ne renferment pas uniquement des auteurs ou des collaborateurs de revue aux prises avec un éditeur dont l’idéologie s’affiche clairement, comme nous le verrons, dans le choix même des titres à publier. Au 26 de la rue de Condé, dans l’ancien hôtel particulier de Beaumarchais, s’affairent également quatorze employés : administrateurs, dactylographe, magasiniers, et se croisent imprimeurs, brocheurs, ainsi que certains personnages de l’administration et de l’armée allemandes. Le Mercure de France tient dans ses fondations grâce à la concurrence et nous nous efforcerons de le situer dans un contexte éditorial particulier, tissé autour des listes de livres interdits et d’ouvrages à promulguer, mais tient aussi grâce à ses lecteurs et à ses abonnés, sur lesquels nous ne disposons malheureusement que de peu d’informations. Pour apercevoir et parfois comprendre tout ce qui se passe derrière cette façade de trois étages qui date de la moitié du XVIIe siècle, nous nous sommes essentiellement basés sur le témoignage de Paul Léautaud (l’un des écrivains les plus importants du Mercure) consigné dans les trois volumes qui constituent son Journal littéraire15, rédigé de 1893 à 1956. Mais Léautaud est renvoyé en 1941, et les renseignements qui concernent directement le Mercure de France dans son Journal se raréfient considérablement à partir de cette année ; or, en 1941, le Mercure entre à peine dans la voie de la collaboration.
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite16 ».
Pour étudier l’histoire du Mercure de France de 1938 à 1945, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous efforcer d’y entrer par la petite porte, d’autant que nous ne savons que peu de choses sur Jacques Bernard17. Accumulées, les informations qui figurent sur le catalogue des éditions du Mercure finissent par prendre sens, permettent de mieux comprendre le sens que le Mercure de France donne à la littérature au cours de cette période, et font ressortir d’éventuelles relations entre le politique et le littéraire, allant dans le sens de la collaboration. Plus qu’un catalogue, nous avons voulu constituer une base de données regroupant le nom des écrivains qui ont publié au Mercure de 1939 à 1945, leur date de naissance, leur nationalité, mais aussi les titres des livres édités ou réédités, l’année de leur publication, leur lieu d’impression. Nous voulions connaître aussi le nombre d’écrivains qui collaboraient dans le même temps à la revue et replacer tous ces éléments dans le cadre d’un traitement informatique de ces données, ce qui doit nous permettre de tirer un certain nombre d’interprétations graphiques et de lire l’histoire autrement. Plus largement, en étudiant le cas d’une maison d’édition qui a collaboré avec les Allemands pendant l’occupation et en suivant la politique éditoriale de cette maison de 1939 à 1945, nous voulons analyser les rapports entre la littérature d’un pays et le régime en vigueur dans ce pays. Peut-on en déduire que le littéraire suit, à une époque donnée, le politique, jusqu’à se mettre au service de celui-ci ? Et si l’on a longtemps parlé d’une « littérature de la Résistance » se réclamant notamment de Vercors et des Éditions de Minuit, peut-on, de la même façon, parler d’une « littérature de la collaboration » ? Au service de la propagande vichyste et nazie, la littérature ne devient-elle pas systématiquement dirigée, détournée, voire « delittérarisée » ? Pour le dire autrement, nous aimerions savoir de quelle littérature se porte garant le Mercure de France sous la direction de Jacques Bernard et nous interroger simplement : que reste-t-il de littéraire au Mercure de France pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Cette question finit par devenir obsédante, surtout si l’on rappelle la tradition littéraire dont peut se recommander le Mercure de France avant que ne commence le Second Conflit mondial.
« Ce n’est pas en vue de prosélytisme au profit d’une esthétique déterminée, du triomphe d’une école, pas même par sympathie de talents que nous nous sommes groupés, mais uniquement et plus modestement pour avoir un coin propre où imprimer, sans craindre les refus, coupures et tripatouillages d’un directeur, ce qui nous plaît d’écrire18. »

Début de l’éditorial d’Alfred Vallette paru dans le premier numéro du Mercure de France de janvier 1890
L’histoire du Mercure se fonde, au début du XXe siècle, sur un sentiment profond et partagé de liberté et d’indépendance. Dans le premier numéro de la revue paru le 1er janvier 1890, Alfred Vallette, son fondateur, précise que « chacun ici est absolument libre, responsable de ses seuls dires, et point solidaire du voisin ». Les principaux collaborateurs de la revue se cristallisent autour d’un « esprit fait d’exigence, d’indépendance vis à vis des autorités établies et d’attachement à l’esthétique symboliste19 », et un certain nombre d’entre eux, élèves au lycée Fontanes de Paris, ont suivi les cours d’anglais de Stéphane Mallarmé.
Car si le Mercure de France devient une maison d’édition à partir de 1894, il s’agit avant tout d’une revue depuis 1890(20) qui reprend un nom célèbre abandonné depuis 1825. Les premières publications et les premiers articles parus dans la revue ont d’abord contribué au développement, en France, du symbolisme, ou, pour être tout à fait précis, du néo-symbolisme, grâce, notamment, aux poèmes d’Albert Samain ou de Henri de Régnier. La revue compte alors peut-être plus que les éditions : ses rédacteurs sont de jeunes gens qui, pour reprendre Remy de Gourmont, sont « sans relations, sans notoriété, sans argent21» mais des écrivains connaisseurs et expérimentés, conscients de la difficulté de lancer une nouvelle revue à une époque où l’on en compte plus de trois cents, et qui permettent au Mercure, en pleine croissance, de devenir bimensuel le 1er janvier 1905. Si la revue est obligée de s’interrompre en 1914, elle reprend dès l’année suivante et poursuit jusqu’en 1940 son combat pour la liberté d’opinion, ayant pour but de « publier des œuvres purement artistiques et des conceptions assez hétérodoxes22 », de « démasquer la vérité refoulée de la littérature. »
Jusqu’en 1935, Alfred Vallette contribue largement au succès et à la notoriété, au prestige devrait-on dire, du Mercure de France, et beaucoup de jeunes inconnus deviendront célèbres au fil des ans : Alfred Jarry, Gide, Rimbaud, Claudel, Apollinaire, Colette, Francis Jammes, Léon Bloy ou encore Paul Léautaud. Bien d’autres encore, mais qui, comme le dit Claire Lesage23, ont échappé « au panthéon de la critique littéraire contemporaine ». C’est le cas de Rachilde et de Remy de Gourmont, qui, l’un grâce à un livre, Monsieur Vénus (1884), qui lui vaut une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs, l’autre grâce à un article, Le Joujou patriotisme24 (1891), montrent qu’ils tiennent la liberté entre leurs mains.
À la mort de Vallette, en 1935, Georges Duhamel (écrivain confirmé qui obtient le prix Goncourt en 1918 et qui est élu en 1935 à l’Académie française) prend la direction de la revue et des éditions du Mercure. La revue bat de l’aile depuis la création de La NRF (qui draine à partir de 1911 tous les nouveaux talents et débauche ceux qui sont déjà confirmés) et la concurrence des nouvelles éditions Grasset, mais la maison reste prospère, Duhamel s’efforçant de suivre les pas déjà tracés par Vallette25. Très sollicité et très occupé (ne serait-ce que parce qu’il doit poursuivre son œuvre), il est obligé d’abandonner ses fonctions de directeur de la maison d’édition en 1938. Il n’aura de cesse de répéter que le Mercure de France ne doit défendre alors « d’autres intérêts que ceux des lettres et de l’intelligence. » « Pour accomplir une telle besogne, pour mener un si généreux combat, le Mercure de France n’est soutenu, je l’ai dit souvent et il faut y revenir, ni par un groupement politique, ni par une puissance financière26. » Et Duhamel de conclure en réaffirmant l’idée première de Vallette : « Le Mercure de France est vraiment la maison des esprits libres27.
Nous verrons que Duhamel continuera à jouer un rôle important pendant la période qui nous intéresse, mais nous pouvons constater que les limites de la conclusion de Claire Lesage s’étendent jusqu’en 1938, le Mercure de France ayant bien « rempli son rôle de moteur de la vie littéraire28 », même pendant les « années Duhamel ». Car, de 1938 à 1945, tout se passe comme si le Mercure de France, présent sur la scène politique, se retrouvait exclu de la vie littéraire. C’est effectivement l’histoire d’un déclin que nous allons tenter de retracer et qui met un terme à près de cinquante ans d’expansion et d’indépendance, d’attachement à une esthétique et à une éthique littéraires.
« Le Mercure est, en petit, l’image de la France : manque de direction, manque d’autorité29. »
En 1995, Jean Favier, dans la préface au catalogue de l’exposition sur « Cent un ans d’édition », parle du Mercure comme d’une maison au « passé prestigieux » et au « présent prometteur ». On ne peut lire dans cette transition qu’une régression, une perte de « prestige » qui appartient au passé et qui devient aujourd’hui seulement la « promesse » d’un prestige à reconquérir. Nous pensons que les « années Jacques Bernard » correspondent à cette perte d’influence dont parle Jean Favier, à une période où, comme nous le verrons, le Mercure perd aussi sa revue, certains de ses auteurs et de ses titres, des employés — éventuellement une partie de son chiffre d’affaire, mais nous n’avons eu en notre possession aucun document permettant de confirmer une telle hypothèse —, mais surtout une image, une réputation… son esprit ? Tout cela revient finalement à analyser les différentes formes d’un déclin évident et nous fait nous interroger sur ce que représente le Mercure de France pendant l’occupation, ainsi que sur la façon dont le Mercure pense et se représente la collaboration. Prétendre que le Mercure de France a collaboré pendant la guerre, est-ce avancer que tous les auteurs sont des collaborateurs, est-ce reconnaître leur adhésion systématique, même implicite, aux idées et à l’attitude de son directeur, Jacques Bernard, oscillant entre collaboration et collaborationnisme ? Autrement dit, est-ce l’esprit de la maison qu’on a empoisonné, ou a-t-on seulement touché à sa structure, son corps, ses fondations. Georges Duhamel nous donne dès 1937 un élément de réponse quand il déclare : « La disparition d’une revue, à l’heure actuelle, serait un malheur pour l’intelligence menacée dans son exercice et dans ses truchements. Il n’est plus question d’école, d’ailleurs il n’y a plus d’école. Il n’y a plus qu’une seule cause, celle de l’esprit libre qui garde ses trésors et défend ses positions30. » Or, l’événement marquant du mois de juin 1940 au Mercure, ce n’est pas tant l’entrée des Allemands dans Paris que la disparition soudaine de la revue.
« Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? » Édith Silve, dans un ouvrage qu’elle a consacré à Paul Léautaud31, nous répond en faisant ressortir le vide intellectuel dans lequel s’enlisent les éditions du Mercure : « Au Mercure, on ne parle que d’occupation des locaux vides et des appartements par les Allemands et on y commente la situation politique. La vie littéraire du Mercure s’est éteinte ; on ne vient, semble-t-il, rue de Condé, que pour extorquer un appui, une faveur auprès de l’occupant par l’intermédiaire de Bernard. » Nous verrons jusqu’à quel point le Mercure, incarné au cours de cette période par Jacques Bernard, s’est brûlé les ailes en décidant de collaborer avec l’occupant, en nous demandant notamment s’il prend conscience, en pleine guerre, de son propre déclin. Un déclin qui, précisons-le, n’est pas quantifiable dans la mesure où il est avant tout immatériel, littéraire. Car au bout du compte, le Mercure de France n’est pas une grande maison d’édition : ses livres sont le plus souvent tirés à peu d’exemplaires (entre cinq cents et mille), les éditions publient peu de titres nouveaux chaque année, et la revue ne concerne qu’un nombre limité de lecteurs32. Son déclin pourrait paraître à ce titre relatif et de faible portée. Nous aurions pu douter de l’importance d’une telle maison d’édition, refuser d’en faire un objet d’histoire, si nous n’avions pas été convaincus du service rendu par le Mercure à la Littérature et à la culture en général pendant la première moitié du XXe siècle. Le Mercure de France est le premier en effet à publier Alcools et les Calligrammes d’Apollinaire, les poèmes de Rimbaud, et d’attirer l’attention sur Van Gogh, Nietzsche, H. G. Wells, Marinetti ou bien encore Kipling, jusque-là inconnus en France33 et dont ce sont les premières traductions.
C’est en étant si intimement lié à la littérature et à l’art, et malgré la disparition de Louis Pergaud34 sur le front en 1915, que le Mercure de France a pu traverser sans trop de heurts la Première Guerre mondiale, la revue publiant des articles ou des extraits de François Mauriac, W. Whitman, Pierre Louÿs, Paul Valéry, Paul Morand, Paul Claudel, Oscar Wilde, Jean Giraudoux, Jules Supervielle ou encore Blaise Cendrars. Pour comprendre la différence d’attitude et de comportement du Mercure de France d’une guerre mondiale à l’autre, il ne faut pas négliger le rôle primordial joué par le directeur d’une maison d’édition. C’est ce qui justifie le fait que, pour les historiens de l’édition française, le Mercure de France soit avant tout l’affaire d’un homme, Alfred Vallette, dont les choix professionnels témoignent d’une importante étape dans l’évolution du métier d’éditeur au début du XXe siècle.
Or nous avons tendance à croire que les « années Bernard » méritent autant d’égards, dans la mesure où elles ont été exactement le contraire des années Vallette, le parfait négatif : des années de crise, des années empoisonnées au cours desquelles, pour reprendre la définition que donne Hippocrate du mot « crise », « le sort de la maladie et du malade se décide, où tout va brusquement changer, en mal ou en mieux, ou en autre chose. » Pendant l’occupation, le Mercure de France a perdu ses ailes, cesse d’emprunter au Mercure romain ou à l’Hermès grec son caducée et son casque ailé, autrement dit sa divinité. Mercure n’est plus le messager des dieux, celui qui sait manier le discours, dieu des poètes qui, comme l’écrivait Platon, « sont choses légères, ailées, sacrées ». Malade, en crise, il devient poison, et c’est à partir de ce nouveau référent que nous allons désormais pouvoir lire, en trois actes, la nouvelle tragédie qui se joue rue de Condé de 1938 à 1945.
Nous avons voulu considérer ces années de crise en partant de l’idée que le Mercure de France tombe malade à la veille de la Seconde Guerre mondiale par l’absorption d’un poison (« toute substance capable de troubler gravement ou d’interrompre les fonctions vitales de l’organisme ») dont nous étudierons dans un premier temps la composition et les premiers effets.
L’acte un tient principalement compte de la personnalité de Jacques Bernard et de l’intervention allemande au Mercure de France.
L’acte deux commence alors au moment de l’intoxication, de la contamination du poison dans l’ensemble de la maison d’édition. L’esprit du Mercure, touché, subissant les effets d’un poison mortel, peine à se redresser. Un nouveau catalogue et la disparition de la revue ; c’est le Mercure qui agonise.
Jusqu’à ce que nous trouvions enfin l’antidote, le contrepoison qui, dans le dernier acte, va dans le sens, semble-t-il, d’une guérison spirituelle du Mercure. L’ombre de Vallette plane encore sur les éditions, une résistance s’organise rue de Condé, et Bernard finit par être jugé.
De 1938 à 1945, le Mercure de France a perdu son dieu. Nous nous efforcerons, dans les pages qui suivent, de partir à la recherche de Mercure.
Notes de l’introduction
1 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, Mercure de France, 1986, p. 905, à la date du mercredi 6 octobre 1943.
2 Miguel de Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, t. II, Seuil, collection « Points », 2001, dans le « prologue au lecteur », p. 9.
3 Léautaud Paul, Joumal littéraire, tome Il, Mercure de France, 1986, p. 2072. 1939.
4 C’est nous qui soulignons.
5 Verdes-Leroux J., Refus et violences : politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération, Gallimard, 1996, p. 148, 198 et 249-250. Nous aurons l’occasion de considérer autrement Paul Léautaud et de lire les pages de son Journal sous un autre angle, plus nuancé.
6 Le Mercure de France : cent un ans d’édition, catalogue de l’exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France du 13 juin au 20 juillet 1995, sous la direction de Marie Françoise Quignard, Paris, 1995.
7 Kerbellec (Philippe G.) et Cerisier (Alban), Mercure de France : anthologie. 1890-1940, Mercure de France, 1997.
8 Fouché P., L’Édition française sous l’Occupation. 1940-1944, en deux tomes, Paris, Bibliothèque de littérature française contemporaine, 1987, 453 et 447 pages.
9 Martin H.-J., Chartier R., Vivet J.-P. (dir.), Histoire de l’édition française, t. IV : Le livre concurrencé, 1900-1950, Promodis, 1986, 610 pages.
10 Propos recueillis lors de notre première visite au Mercure de France, le mardi 30 octobre 2001.
11 Années 1939, 1940, 1941, 1943 et 1944.
12 Installée à l’Hôtel Majestic, une des trois administrations allemandes qui s’occupent de la presse et de l’édition françaises. En rivalité directe avec l’Ambassade d’Allemagne et le Gruppe-Schrifftum, ce dernier dépendant de la Propaganda-Staffel.
13 Déjà cité dans l’article d’Antoine de Gaudemar, « Plongée dans le Mercure », revue Digraphe : « Hommage au Mercure », mars 1995, numéro 3, Mercure de France.

Couverture du numéro 73 de mars 1995.
On peut remarquer que le nom de Georges Duhamel apparaît exactement entre les ailes. Ce n’est sans doute pas un hasard.
14 Question posée par Jean Tardieu et reprise dans la préface à La Vie mode d’emploi, Georges Perec, Hachette, 1978.
15 L’édition du Journal littéraire à laquelle nous nous référerons tout au long de ce mémoire est celle du Mercure de France, publiée en trois tomes et qui date de 1986.
16 Luc, XIII, 24.
17 Le Mercure de France n’étant pas en mesure de nous communiquer des informations relatives à son état civil, et les archives de France ne nous permettant pas de consulter le dossier de procédure instruite par la Cour de justice du département de la Seine contre Jacques Bernard avant le mois de juillet 2002.
18 Citation d’Alfred Vallette prenant la défense de Remy de Gourmont après l’affaire du Joujou patriotisme, dans un article du no 17 de la revue, intitulé Malveillance, paru en mai 1891 et cité par Kerbellec P. et Cerisier A., in Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 105-106.
19 Alfred Vallette cité par Robert Chartier (dir.), Histoire de l’édition : le livre concurrencé, p. 165.
20 La première assemblée de fondation du Mercure de France se tient véritablement le 25 décembre 1889, au Café François 1er. La revue est installée dans un trois-pièces au 15, rue de l’Échaudé-Saint-Germain à Paris, à l’adresse de la mère d’Alfred Vallette.
21 Remy de Gourmont, Promenades littéraires, Paris, Mercure de France, 1923-1929, nouv. éd., 1963.
22 Dans l’article d’Alfred Vallette paru en tête du numéro 1 de la revue (janvier 1890) et reproduit en annexe.
23 Auteur d’une thèse sur le Mercure de France, Le Mercure de France de 1890 à 1914, publiée en 3 tomes, École nationale des Chartes, 1984.
24 Dans lequel il dénonce l’idée de patriotisme (« Mourir pour la patrie : […] nous cultivons un autre genre de poésie ».) ce qui lui vaut d’être renvoyé de la Bibliothèque nationale.
25 Dans le no 925 du Mercure qui paraît le 1er janvier 1937, Duhamel écrit, à propos de Vallette : « Nous voulons, aujourd’hui, saluer une fois de plus sa mémoire, dire ce que nous avons fait pour continuer son œuvre, mesurer ce que nous devons faire encore et justifier notre persévérance ».
26 C’est nous qui soulignons.
27 Citations de Georges Duhamel tirées de l’article Aux lecteurs du « Mercure de France », publié dans le no 925 de la revue du 1er janvier 1937, et reproduit dans Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 467-471.
28 Claire Lesage, op. cit. p. 458.
29 Paul Léautaud à Jacques Bernard, in Journal littéraire, tome III, p. 23, à la date du vendredi 22 mars 1940.
30 Georges Duhamel dans un article déjà cité, publié dans le no 925 de la revue du 1er janvier 1937.
31 Silve É., Paul Léautaud et le Mercure de France, Mercure de France, 1985, p. 312.
32 Juillet 1919 : 3 000 lecteurs du Mercure dont 1 000 abonnés, d’après Philippe G. Kerbellec et Alban Cerisier, in Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 500. Nous ne disposons d’aucune autre donnée chiffrée plus « récente » mais pouvons supposer, au regard du nombre croissant des revues concurrentes et de la crise des années trente, que l’état du Mercure reste à peu près le même jusqu’en 1940.
33 Le rôle du Mercure de France dans la diffusion des littératures étrangères en France n’est pas négligeable. Marcel Coulon a caractérisé l’attitude des rédacteurs du Mercure de la manière suivante, s’adressant à Vallette en 1911 : « Vous ne vous contentez pas d’ouvrir aux écrivains étrangers et à leurs rhapsodes le corps de votre revue. Vous consacrez aux littératures étrangères un bon tiers de votre partie analytique. Lettres allemandes, anglaises, espagnoles, italiennes jusqu’aux tchèques et néerlandaises, et celles des Amériques ont leur rubrique attitrée. Vous en présentez un tableau suivi. Entreprise qui n’avait pas cette teinte avant vous et dont vos imitateurs démontrent que vous en êtes seul capables », cité par Liliana Samurovic-Pavlovic, in Les Lettres Hispano-américaines au Mercure de France (1897-1915), thèse pour le doctorat d’université, soutenue le 25 juin 1966 devant la Faculté des Lettres & Sciences-Humaines de l’Université de Paris, Centre de Recherches hispaniques- Institut d’études hispaniques, Paris, 1966.
34 Premier prix Goncourt du Mercure en 1910 pour De Goupil à Margot.
Acte I : Le poison
Chapitre un :
Jacques Bernard, nouveau directeur du Mercure de France. 1938-1940
Le 3 août 1933, Alfred Vallette écrit à André-Ferdinand Herold, auteur et traducteur au Mercure de France, mais aussi principal actionnaire de la société : « Pour Bernard, c’est évidemment lui qui me succéderait dans la plupart des affaires « d’en haut ». Il connaît les auteurs, il fabrique les livres, et maintenant il assume une partie de ce que faisait Dumur35. Je crois que c’est lui que le conseil d’administration choisirait pour, sous sa surveillance, conduire la barque […]36. » Jacques Bernard est employé au Mercure depuis 1907. Il a été chef de la fabrication pendant les années qui ont suivi la guerre et vient d’assumer les fonctions de rédacteur en chef et de secrétaire général. En 1933, il reçoit toute la considération et toute l’estime du fondateur de la maison d’édition, à tel point qu’on lui laisse augurer d’une prochaine place de directeur, à la mort de Vallette. Il a déjà fait ses preuves ; il n’a plus qu’à attendre.
Le 25 septembre 1935, à sept heures du matin, Alfred Vallette agonise et meurt d’un cancer en début d’après-midi. Jacques Bernard, à qui l’on avait laissé supposer qu’il allait lui succéder, se rend le jour même à son chevet, au 26, rue de Condé, et, accompagné de Léautaud, lui fait sa toilette et l’étend sur son lit37. Fidélité exemplaire ou zèle excessif, nous pouvons nous demander ce qu’il attend ce jour-là, à quoi il pense, si ce n’est à la transmission de pouvoir, au passage de témoin, visant du coin de l’œil le caducée et le casque ailé du Mercure, son nouveau sceptre, sa nouvelle couronne. « Le roi est mort, vive le roi ! » Bernard prépare son règne, mais en 1935, c’est Georges Duhamel, « le gros, le très gros pilier de la maison38 » qui prend la direction du Mercure.
Jacques Bernard perd alors toutes ses illusions. Il devient l’un des administrateurs du Mercure et remplit les fonctions de sous-directeur, mais son esprit est ailleurs, son regard dirigé sur le deuxième étage de la maison d’édition, à l’endroit où se tient la rédaction et où se trouve l’ancien bureau de Vallette. Il avait tant fait pour le Mercure et pour Vallette, allant même jusqu’à le sortir d’une syncope un après-midi de juin 1934(39). La désignation de Duhamel, nouveau directeur du Mercure de France, achève de le décourager, dans la mesure où il considère l’écrivain des Pasquier comme étant « un bonhomme pas sûr, tout en façade de phrases généreuses et de bon sentiment, au fond un simple Tartuffe ». Il ne cache rien de ses sentiments et dit clairement à Léautaud « Je déteste Duhamel. Je le déteste. Je déteste cet homme40. »
L’accident
Jacques Bernard n’est pas encore directeur du Mercure de France quand survient son accident de moto le vendredi 11 septembre 1936, mais cet événement, qui pourrait paraître anecdotique, aura de sérieuses conséquences, de l’avis même des employés de la maison d’édition, sur son comportement et ses décisions pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nous ne savons pas ce qu’il avait en tête ce jour-là, s’il pensait encore à l’injuste nomination de Duhamel survenue un an auparavant, ou si, comme le laisse entendre Paul Léautaud, l’alcool fut en grande partie responsable de cet accident41. Toujours est-il que l’état de Bernard est jugé « grave » et qu’il est transporté à la clinique de Domfront, en Basse-Normandie. Bernard souffre d’une fracture de la base du crâne. Dans ses lettres qu’il envoie à Marie Dormoy42, Paul Léautaud rend régulièrement compte de ce qui se passe à la clinique. « Mardi, failli mourir ». Le lendemain, « on ne le considère plus comme perdu, mais on ne peut rien dire de sûr ». Au Mercure, les nouvelles de l’administrateur arrivent par bribes. Son fils, Jacques-André Bernard, rassure les employés de la rue de Condé : il est vivant, mais si la première ponction lombaire a été bonne, trois autres depuis ont laissé apparaître des filets de sang. De plus, Bernard, quand il parle, dit des mots sans suite, et reconnaît à peine les gens. Sa santé concerne tout le monde au Mercure, car Duhamel est en Amérique ; tout repose donc sur lui. On s’inquiète bien sûr : « Pas un mot sur le Mercure ». Bernard semble ne plus se soucier de ce qui se passe rue de Condé. « Il faut qu’il y ait un trouble mental, que certaines choses soient disparues pour lui », ajoute Léautaud. « Quel pétrin, un pétrin monstre, préjudiciable à tous ». L’accident paralyse non seulement Bernard mais aussi tout l’immeuble du VIe arrondissement. Cinq jours après sa chute de moto, le Mercure décide d’envoyer un chirurgien de Paris examiner Bernard. Ce dernier finit par sortir de la clinique sans jamais avoir été opéré de sa fracture du crâne. Pendant plusieurs semaines, tous ses réflexes sont supprimés. Duhamel, de retour, compare son état à celui « d’un enfant de six mois43 ».
Évidemment, la dégénérescence de Jacques Bernard, provoquée par cet accident, ne doit pas expliquer à elle seule son attitude et justifier tous ses actes pendant l’occupation. Elle lui a cependant servi de circonstance atténuante lors de son procès en 1945, et doit donc être considérée avec sérieux.
D’autant que tout le monde au Mercure s’accorde, dans les années qui suivent, pour évoquer un changement brutal de comportement et d’aspirations. Jacques Bernard n’est pas complètement remis de cet accident quand il succède à Georges Duhamel le 25 février 1938, et Paul Léautaud, qui reconnaît que Bernard le fait « éclater de rire » au cours de ses séances de lecture, doit de plus en plus subir « ses accès de mauvaises humeurs et ses grossièretés de langage44 ». Léautaud ne peut plus supporter sa vanité sur le plan littéraire et sa versatilité en ce qui concerne les relations humaines : il engage Léo Porteret comme assistant, n’arrête pas d’en faire des éloges, puis le traite d’« imbécile» et finira par le renvoyer ; s’engoue d’Yves Florenne (en qui il voit le prix Goncourt 1934) puis le dénigre aussitôt45. Jacques Bernard devient fou, devient sot et se retrouve rapidement déconsidéré par tous ses employés. En 1938, Paul Léautaud se demande « ce que sera la revue aux mains de ce garçon illettré, autoritaire, impératif et versatile à l’extrême » et constate, accablé : « Nous allons donc être maintenant, jusqu’à nouvel ordre, sous le régime de l’ignorance, de l’infatuation, du fanatisme et de l’autoritarisme de Bernard. Avec Duhamel, lettré, intelligent, compréhensif, on pouvait discuter, s’arranger, concilier. La vanité sans bornes de Bernard ne permettra guère cela46. »
Jacques Bernard donne alors l’impression de n’y plus rien comprendre à l’édition et de régresser rapidement. Quelque chose a changé. Auriant raconte qu’il sort des cafés en titubant et se répand auprès des consommateurs en discours aussi catégoriques qu’interminables. Il décide aussi d’acheter une moto plus puissante que celle qui lui a causé son accident et se justifie, le 16 mars 1938, auprès de Porteret, Falgairolle, Mlle Naudy et Léautaud : « Évidemment, je suis diminué physiquement. Si, si, je le sais. Mais par contre, mon accident m’a donné une valeur intellectuelle supérieure. Je m’en rends compte tous les jours. C’est très curieux, n’est-ce pas47 ? »
Jacques Bernard prend donc dès l’année 1938 conscience de sa « valeur intellectuelle supérieure ».
« Je suis un hitlérien »
En 1939, Jacques Bernard trouve un moyen de politiser sa supériorité intellectuelle et choisit de ne pas dissimuler ses positions en faveur de l’Allemagne nazie. La France vient juste de déclarer la guerre à l’Allemagne et le directeur du Mercure de France commence à prendre des mesures de circonstance, au moment où Paul Léautaud relate la scène suivante, survenue le 6 octobre 1939 : « Il a pas mal supprimé, à cause de la guerre, avec raison, pas mal [sic] de services gratuits. Il voulait aussi supprimer l’envoi du Mercure aux abonnés de Russie. Je lui explique : des abonnés qui ont payé pour recevoir la revue, la Russie pays ouvert, auquel on peut accéder par le nord ou par le sud. Il maintient. Je répète mon explication, j’insiste. Il maintient toujours, en me disant : « Je vais vous dire. Vous êtes un honnête homme… » Je n’ai pu retenir ma réponse, sur le ton de la plaisanterie, devant Porteret et Mlle Naudy : « C’est ce qui me différencie d’avec vous. » Il me répond : « Moi, je suis un hitlérien48. »
Son appartenance à l’idéologie hitlérienne transperce comme nous le verrons sa politique éditoriale mais modèle aussi sa personnalité, son comportement journalier. Il faut d’ailleurs préciser que sa femme, Ingrid Bernard (née Möller), danoise et germanophile, est également « responsable en très grande partie de la conduite de son mari49 ». Jacques Bernard a donc choisi son camp bien avant les débuts de la guerre et répand partout où il le peut ses propos anglophobes et antisémites. Charles-Henry Hirsch, collaborateur à la revue depuis 1892, est l’un des premiers à en subir les conséquences. Il est juif et compte parmi ses relations Léon Blum de retour au gouvernement. En 1938 il veut publier une nouvelle, Monsieur Batule et ses amis, qui reproduit de façon à peine déguisée la vie de Paul Léautaud et que ce dernier considère comme étant « agressive à son égard ». Bernard et Léautaud se liguent alors contre Hirsch. Bernard avoue à Léautaud que « Hirsch est un homme qu’il voudrait voir vider du Mercure et qu’il y a trois hommes dont il souhaite et attend la mort » ; Hirsch est sur la liste50, non pas parce qu’il est mauvais écrivain, comme pouvait le penser Vallette51, mais parce qu’il est juif. C. H. Hirsch ne meurt pas mais tombe gravement malade en décembre 1939, et ne remet plus les pieds au Mercure jusqu’en 1945.
Si l’antisémitisme de Bernard n’est pas à démontrer, nous préférons nuancer l’attitude de Léautaud à l’égard des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans Paul Léautaud et le Mercure de France, Édith Silve écrit : « La sorte de répulsion quasi physique que Léautaud éprouve pour tout ce qui est « peuple » et pour ceux qui le représentent, et la xénophobie qu’il manifeste envers les Juifs, se cristallisent dans la personne de Hirsch52 ». Effectivement, Léautaud, dans ses écrits, s’en prend plus à la race qu’à Hirsch et rapporte, dans ses conversations, « les défauts, les travers, l’influence souvent mauvaise qu’ils ont53. » À plusieurs reprises également, Paul Léautaud pourrait se faire passer pour un hitlérien partageant les valeurs antisémites de son directeur. N’a-t-il pas souhaité la victoire de l’Allemagne, et ne pourrions-nous pas nous servir de ce qu’il a écrit en 1935(54) pour abonder dans ce sens ? Nous sommes plus réservés et ne savons ni ne pouvons conclure autrement qu’en citant Paul Léautaud lui-même : Marie Dormoy « me dit que je deviens d’un chauvinisme et d’une susceptibilité sur ce point qui m’aurait bien fait rire en 1914, que je deviens aussi antisémite, ce qui est un comble. En quoi elle se trompe : nullement chauvin, puisque je reconnais les abominations et les erreurs du traité de Versailles, nullement antisémite, puisque j’ai été bouleversé par le pillage du magasin Lipschutz et que je n’accepterais pas un centime sur la vente des biens pris aux Juifs. » C’est un comble dans la mesure où Léautaud se déclare fortement « dreyfusard » en 1898, et où il ne peut supporter la fermeture de la librairie Lipschutz tenu par un juif55. Mais Marie Dormoy ne se trompe pas autant qu’il voudrait le croire, Léautaud reconnaissant que vingt ans auparavant, il était « déjà quelque peu xénophobe, pour tous les étrangers d’allure douteuse qu’on voyait déjà dans Paris, quelque peu antisémite (littérairement) et pas mal antidémocrate, en même temps qu’antisocial et antipatriote56. »
Inutile d’en dire davantage. Paul Léautaud ne se réclame pas du même antisémitisme que Jacques Bernard et ne peut être totalement intégré dans la même perspective collaborationniste que celui-ci. Aussi difficile et délicat soit-il de relativiser l’antisémitisme d’un écrivain français pendant la guerre, force est de constater qu’il se dilue ici dans une haine globale et généralisée de l’autre, de l’« étranger » au sens misanthropique du terme. Paul Léautaud partage finalement la même haine du juif, de l’Allemand, du catholique et du Français, de Blum et de Dostoïevski, et se reconnaît parfaitement dans le portait d’Alceste57. Il ne le répétera jamais assez : « Vraiment, il n’y a que les bêtes qui touchent mon cœur58 ».
Jacques Bernard n’entretient quant à lui pas la même confusion, clame partout qu’il est férocement antisémite après la visite d’un journaliste des Dernières Nouvelles qui vient de paraître un article sur l’abolition du décret Crémieux59. Il ne cache rien de son admiration pour Hitler ni pour les articles d’Alphonse de Chateaubriant parus dans La Gerbe, « remarquables, célébrant le grand homme comme il convient60 ». Une manière d’être et de penser à laquelle ne souscrit pas Paul Léautaud : « Au no 38 de la rue Jacob. Une boutique de crémerie. Les volets mis. Avec cet écriteau : « Fermé pour répondre M… à Hitler. Vive la France ! »
Je me proposais de raconter cela à Bernard61. »
Jacques Bernard assume parfaitement ses idéaux politiques mais nous aimerions mieux connaître ses exigences en matière littéraire.
Première ligne éditoriale
Georges Duhamel démissionne de son poste de directeur du Mercure de France le 25 février 1938 pour plusieurs raisons : il est élu à l’Académie française en novembre 1935, président de l’Alliance nationale du Livre et de l’Alliance française en 1937, se consacre à la rédaction de nombreux articles dans la presse et doit poursuivre son œuvre. Il dit aussi à Léautaud « qu’il se sent qu’il s’est fait partout des ennemis chez les gens auxquels il a dû refuser des manuscrits, des jaloux aussi certainement à le voir, lui, publier tous les livres qu’il veut dans la maison62 ». La seule chose bonne qui résulte de ce départ est, pour l’auteur du Petit Ami, « le retrait des éléments académiques et sorbonnards qui commençaient à s’introduire dans la maison63». Georges Duhamel et Paul Léautaud ne partagent pas la même conception de la littérature, l’un privilégiant le travail et la réécriture, l’autre la spontanéité et le premier jet. L’ancien directeur du Mercure siège encore au conseil d’administration et, au cours d’une séance du 4 octobre 1939, décide de limiter Bernard dans ses pouvoirs, pensant que le Mercure pourrait finir par le redouter. Jacques Bernard ne pourra donc plus signer un chèque ni engager aucune dépense, décider l’édition d’un ouvrage ou d’une réimpression, accepter les articles pour la revue sans avoir consulté préalablement Duhamel et Herold64.
En matière de littérature et de politique éditoriale, Jacques Bernard ne laisse pourtant, au premier abord, rien deviner de quelconques remaniements et trahisons. Il est avant tout soucieux de continuer l’œuvre de Vallette et de respecter la tradition littéraire de la maison. C’est ce qu’il explique à une journaliste de Toute l’édition65 venue l’interroger dans le cadre d’une série d’articles consacrée aux « grandes maisons d’édition parisiennes » : « Nous continuerons la maison d’Alfred Vallette ; c’est notre seule raison d’être […] Comme les gens heureux, le Mercure n’a pas d’histoire, le Mercure est une vieille maison qui n’a nullement l’intention de se moderniser, une vieille maison qui en fait sans doute peu et qui n’a pas l’ambition d’en faire plus ; le Mercure est bâti sur un ancien modèle et se complait dans cet état. […]. Nous, retardataires, nous en sommes restés à l’édition pure et simple, ce qui signifie, naturellement, que nous ne faisons pas de bonnes affaires. Cependant nous nous en contentons, car ce qui nous tient au cœur c’est de maintenir la vieille tradition de sagesse que nous a léguée Vallette […]. Et pour finir, M. Bernard me dit l’indépendance absolue du Mercure, sa complète liberté d’opinion : « Nous nous sommes maintenus en dehors de toutes les choses officielles, ce qui nous permet de nous conduire comme bon nous semble. » Ce langage, qui contredit parfaitement la prochaine subordination du Mercure à la France de Vichy et aux recommandations nazies, n’est pas réservé à la seule presse. Quand il propose à Léautaud de récupérer66 sa chronique dramatique qui contribuait au succès de la revue, Bernard s’y prend de la même manière, habilement détournée : « Si vous repreniez la rubrique ? Ce serait très bien. Ce serait très Mercure. Vous savez que je dis toujours que je retourne à M. Vallette. On verrait pour le coup que j’y retourne67 ».
Jacques Bernard se montre donc très attaché au fonds du Mercure qui a fait la réputation et contribué au prestige de la maison. Un fonds essentiellement constitué des ouvrages de Duhamel68 (en 1939 sort le huitième volume de la Chronique des Pasquier : Le Combat contre les ombres), de l’indémodable Livre de la Jungle de Kipling, des écrits de Mark Twain et des poèmes de Francis Jammes. Jacques Bernard voudrait incarner ce fonds prestigieux et ne s’égare pas en publicités tapageuses comme son confrère Grasset. Fidèle à l’ascèse traditionnelle69 de Vallette, il choisit de faire connaître le Mercure en partant de ce fonds : une des rares publicités des éditions du Mercure que nous avons trouvée (mise en annexe) joue sur ce « sage » héritage, une page sur laquelle figure une liste exhaustive d’auteurs qui ont fait la renommée de la maison et qui ne manque pas de présenter un rapide historique inspiré des « années Vallette » ainsi que l’état actuel du fonds justement : « En 1940, son catalogue groupe mille quarante-neuf titres (1049) et 360 auteurs ». Ce catalogue permet au Mercure de France de publier trente à trente-cinq titres par an en 1938, ce qui est peu, mais comme le dit Bernard, le Mercure est « une vieille maison qui accepte de rester à l’écart70 ».
Nous ne pouvons bien évidemment pas croire Jacques Bernard, si bien intentionné soit-il. Depuis son accident, ce qui le caractérise le plus, ce sont ses changements d’humeur. Dès le mois de décembre 1938 il se confie à Léautaud : « Un autre propos de Bernard, qu’il m’a tenu ce matin. Il a depuis quelque temps diminué beaucoup les droits d’auteur, surtout pour les nouveaux venus. Il voudrait bien faire de même pour les auteurs de la maison. Alors, ce matin : “M. Vallette avait trop d’admiration pour les gens de lettres. Il leur donnait beaucoup trop d’argent.” J’ai essayé de lui rappeler que Vallette avait ce principe : publier autant que possible de bons ouvrages (la maison avait acquis solidement cette réputation), ne pas faire de publicité et payer honnêtement les auteurs, la maison ayant encore son bénéfice. Peine perdue. Vallette, dont il réprouve ainsi la manière de faire, n’en a pas moins mené sa maison à la prospérité71. » Bien sûr, nous devons nous méfier des paroles, parfois excessives, rapportées dans le Journal littéraire de Léautaud, d’autant qu’il est lui-même impliqué dans les affaires du Mercure. La citation se poursuit d’ailleurs : « Quand je pense que je peux être exposé à ce que ce sot, ce vaniteux, ce goujat, cet impulsif détraqué, me donne un jour, dans un mouvement d’humeur, mon congé de mon emploi. Moi, écrivain au Mercure depuis 1895, dont les écrits ont servi la réputation du Mercure en faisant la mienne, qui suis actionnaire de la maison, et qui occupe mon emploi depuis le 1er janvier 1908. C’est à la fois bouffon et pitoyable ». Nous devons donc prendre avec précaution tout ce que Léautaud tient pour « dit au Mercure », mais nous devons également admettre qu’il reste assez bon juge de la situation et de son directeur, à tel point qu’il parvient à prophétiser son propre renvoi trois ans avant que cela ne se produise.
Léautaud nous renseigne et nous montre que Bernard fait souvent volte-face, même lorsqu’il fait référence au fondateur du Mercure. À la fin du mois de juillet 1939, la France s’apprête à entrer en guerre et Paul Léautaud est convoqué aux Affaires étrangères pour un article sur le Pape Pie XII publié dans la revue s’avérant être « complètement faux ». Il décide d’aller prévenir Bernard qui lui répond dans un premier temps : « Je m’en fous ». Il insiste, l’erreur pouvant se reproduire prochainement. « Il m’a dit : “Qu’est-ce que faisait M. Vallette dans ce cas ?” Je lui ai répondu : « M. Vallette ? et même M. Dumur ? Quand ils n’étaient pas suffisamment instruits sur un sujet ? Ils donnaient à lire à quelqu’un de compétent. » Et Bernard de répondre à nouveau : « Je m’en fiche72 ». La sagesse de Vallette est vite oubliée et contraste dorénavant avec ce que nous pourrions prendre pour du mépris et de l’incompétence.
Léautaud insiste d’ailleurs lourdement sur l’incompétence de Bernard. Nous avons vu que son jugement littéraire différait déjà de celui de Vallette. Face à Bernard, il se retrouve désarmé comme face à du vide : « Bernard croit que ce qui lui plais est admirable et l’auteur un grand écrivain. Tout son jugement littéraire tient là. Alors que le jugement littéraire, c’est voir les qualités, l’intérêt d’un écrit, même à cent lieues de votre goût et de vos opinions. Ainsi était Dumur. Il acceptait des choses dont il réprouvait tout, mais dont il savait voir l’intérêt et qui cela intéresserait73. » Bernard se fait quant à lui sa propre idée de ce qui doit être édité, mais force est de constater que ses priorités ne sont pas les mêmes que celles de Vallette « le Sage ». Il voudrait parler de littérature, comme en témoigne son appréciation sur le prix Goncourt74 en 1940, mais n’y parvient décidément pas. L’argent reste au cœur de ses décisions éditoriales ; les lettres passent en second. C’est le sentiment qu’il nous donne en offrant à Marcello-Fabri75, inconnu au Mercure, un prêt de 100 000 francs. Déjà, Fabri, quand il s’est présenté pour la première fois rue de Condé en février 1938, avait proposé à Bernard de lui éditer un roman en s’engageant à en acheter 1 500 exemplaires, avec la remise de libraire. Bernard, intéressé, se dit alors que cette affaire pourrait faire gagner 7 500 francs à la maison. « Vous perdrez moralement bien plus que 7 500 francs », conclut Léautaud76, qui sait que si Bernard décide d’éditer Fabri, d’autres s’adresseront au Mercure pour des propositions du même genre. De quel genre s’agit-il ? Nous ne connaissons pas suffisamment Marcello-Fabri pour le savoir et nous nous contentons de suivre le jugement qu’en fait Paul Léautaud. Nous ne devons cependant pas nous y fier exclusivement (Léautaud n’a-t-il pas déjà parlé de « cet abominable Dostoïevski77 » ?) mais pouvons du moins lire dans cette scène l’unique plaisir que prend Bernard à compter l’argent qu’un auteur peut lui rapporter. Jacques Bernard se désintéresse de la littérature en ne considérant que ses vertus pécuniaires. Que dire pourtant de son jugement sur le Goncourt assombri par l’« affaire » que cela représente désormais ? Nous pourrions y voir l’affirmation de ses exigences en matière de littérature. Mais nous pouvons aussi sentir la frustration d’un directeur de maison d’édition qui n’a pas obtenu le prix depuis 1918, l’année où il fut attribué à… Georges Duhamel78. Ses prochains choix de publication, détaillés dans le chapitre suivant, nous en dirons sans doute davantage, mais nous pouvons d’ores et déjà tracer les premières grandes lignes éditoriales de Jacques Bernard : le nouveau directeur du Mercure de France se sert encore sur le fonds de la maison d’édition, tout en rompant, bien qu’il pense et dise le contraire, avec les choix et les priorités de son ancien modèle, Alfred Vallette, pour qui la grande édition signifiait la plupart du temps le petit profit, et qui tenait particulièrement à faire s’exprimer toutes les idées du moment. À partir de 1938, l’argent l’emporte sur les lettres.
Quelque chose va mal au Mercure et Léautaud s’en aperçoit dès le mois de mai 1938 : « Édité chez Albin Michel, cela ne me séduit nullement […]. Je préférerais le Mercure. Mais Bernard a de telles prétentions de connaisseur, de conseiller, de protecteur, de censeur (alors que Vallette me prenait un livre les yeux fermés), que cela m’enlève toute envie de lui proposer ce petit livre79. » L’histoire concerne la réédition du Petit Ami ; quand un auteur ne fait plus confiance en son éditeur, que se passe-t-il ?
« J’ai dit à Bernard de faire attention à la réputation du Mercure et de ne pas la compromettre, si ce n’est même la détruire, en se mettant à publier des livres dans ces conditions, ce qui ne tardera pas être connu80. » En 1938, Paul Léautaud sait qu’il pourrait se passer quelque chose de préjudiciable voire de grave au Mercure. Le Mercure de France serait-il en train de s’empoisonner ?
Chapitre deux : Les débuts de la collaboration
L’été 1940 est bien sûr marqué par l’entrée de Hitler et des troupes allemandes dans Paris, le renvoi, le 17 juin, du gouvernement de Paul Reynaud et la mise en place du gouvernement militaire dirigé par Pétain. Une ligne de démarcation sépare désormais les Français « libres » des Français « occupés ». Le 18 juin, de Gaulle lance, de Londres, un appel aux résistants, mais à Paris, les Allemands ont déjà mis la croix gammée au sommet de la Tour Eiffel et à l’Hôtel de Ville ; c’est la France qu’on empoisonne.
La vie culturelle, nouvel enjeu pour les Allemands comme pour le régime de Vichy, ne s’éteint pas pour autant mais ce qu’elle propose est dorénavant à forte teneur idéologique. L’édition en général et le Mercure de France en particulier n’échappent pas à cet asservissement. Passées les contraintes de la mobilisation et des débuts de la guerre, les maisons d’édition parisiennes doivent se plier à de nouvelles règles imposées par l’occupant allemand.
L’édition sous contraintes
« Drôle de guerre » et drôle de période pour le Mercure de France. Paris a le visage d’une ville inanimée aux boutiques fermées et dans laquelle circulent peu de voitures. Les maisons ont les volets clos, une grande partie de ses habitants est dans l’exode ou mobilisée81. Sur la ligne Maginot, les combattants attendent et réclament de la lecture. Le besoin de lire pour s’occuper, se distraire, mais aussi pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde est du reste assez vif partout en France :
« On lit beaucoup. On lit à la ville, à la campagne, aux armées. Dans les heures graves, aujourd’hui comme hier, on a besoin de ce muet départ de la pensée, de ce recueillement et de cette évasion que donne le roman, l’étude, l’analyse, les mémoires ou les souvenirs d’autrefois ; bref, une page d’un texte qu’on aime, c’est un instant d’oubli, et comment ne songerait-on pas à fuir un monde où la barbarie, la rage de détruire et le mépris de tout ce qui nous est cher, élevés au rang de doctrine, nous imposent les plus durs sacrifices82 ? »
Les Français lisent mais le Mercure est loin d’enregistrer pareille demande de lecture dans les premiers jours qui suivent la déclaration de guerre et est obligé de fermer ses portes le 8 septembre 1939. Jacques Bernard annonce une première fermeture jusqu’au 18 septembre, puis s’apprête, devant l’effondrement financier de la maison d’édition, à fermer définitivement dès la fin du mois de septembre. Le Mercure de France ne compte en effet plus que cent mille francs en caisse quand il en restait près d’un million à la mort de Vallette. C’est tout le personnel qui se trouve alors menacé de renvoi, la maison ne parvenant pas à maintenir le montant des appointements de ses employés. Paul Léautaud le premier s’insurge contre ce nouvel état de fait, conséquence semble-t-il de la mauvaise gestion mais aussi d’un nouveau caprice de son directeur : « Et le personnel ? Vous allez mettre quatorze personnes sur le pavé. Que voulez-vous qu’elles deviennent ? » — « Ils crèveront », lui répond froidement Bernard83.
Le lendemain, mardi 19 septembre 1939, Léautaud veut prévenir Duhamel et s’entendre avec lui d’un moyen d’action mais aussi de réaction, comptant sur son influence auprès de Bernard en tant qu’auteur le plus lu du Mercure et en tant qu’homme de lettres reconnu par ses pairs, aussi bien à l’Académie qu’au Figaro. L’hypothèse avancée par Léautaud — qui voudrait mieux comprendre la décision de son directeur — est celle d’un affaiblissement volontaire de la maison pour qu’elle soit rachetée par la librairie de Bernard, Les Libertés françaises, qui se trouve justement deux immeubles à côté du Mercure. « Il ne la rachètera jamais », déclare alors Duhamel, « le visage résolu84 ». Mais trois jours plus tard, sans attendre l’intervention de Duhamel, Bernard ne veut déjà plus fermer et considère autrement ses perspectives d’avenir. « Il trouve que le Mercure peut très bien marcher85 ». Ce dernier constat se fonde sur la bonne vente des livres du Mercure ainsi que sur le nombre, toujours croissant, des abonnés à la revue. Cependant, avant que ne commence la collaboration et au cours des six premiers mois de guerre, la maison rencontre bien des difficultés : la plupart des rédacteurs du Mercure rejoint l’exode et un certain nombre de ses employés est mobilisé, le fils de Bernard notamment. Les éditions sont paralysées par la mise en place d’une censure instaurée en vertu de la morale du pays, de la moralité publique et de la Défense nationale86, cette décision ayant été prise par le Commissariat général à l’Information et rendue publique le 15 septembre 1939. Au mois d’octobre 1939, Jacques Bernard est interrogé par un journaliste de Toute l’édition87 et doit se rendre à l’évidence : « Les frais d’une maison d’édition, et particulièrement d’une maison d’édition qui a une revue, sont si élevés que les événements actuels donnent à réfléchir. Je me demande si ce n’est pas M. Vallette qui était dans le vrai, quand, en 1914, il ferma sa maison durant six mois : les dépenses sont constantes, répétées, rapides, les rentrées seront incertaines et lentes ; que va devenir l’édition ? ». Le 15 mai 1940, le Mercure doit également tenir face à un décret portant sur la restriction de la fabrication et de la consommation des papiers et cartons, limitant forcément la liberté d’impression pour les maisons d’édition. À cela s’ajoutent des délais toujours plus longs pour publier les volumes de la revue (dont l’impression est confiée depuis 1931 à l’imprimerie Firmin-Didot, caractérisée par sa lenteur88) ou les ouvrages du Mercure. D’autant que les liaisons téléphoniques avec l’imprimerie Firmin-Didot (à Mesnil-sur-l’Estrée, dans l’Eure) sont interrompues début juin 1940, après les bombardements sur la ville de Dreux89. Les retards s’accumulent.
Au 26, rue de Condé, ces nouvelles contraintes coïncident avec une production littéraire médiocre si l’on en croit le jugement qu’en fait Paul Léautaud dans son Journal : « […] tout ce qu’on présente au Mercure, (je le vois dans les manuscrits que j’ai à rendre à leurs auteurs) est au-dessous de tout. Tout le monde aujourd’hui écrit, sans avoir la moindre personnalité, le moindre don naturel, en se figurant qu’il n’y a qu’à écrire (au sens simplement matériel) et sans savoir un mot de ce que c’est qu’écrire90 ».
L’édition sous contraintes dans les mois qui précèdent la défaite, la littérature en suspens… Jacques Bernard peine à faire se redresser le Mercure de France. Au mois de juin 1940, tandis que les Allemands réquisitionnent les Messageries puis la librairie Hachette, procèdent aux premières aryanisations et apposent des scellés chez certains éditeurs, il doit décider du prochain sort du Mercure. Nous avons vu Paul Léautaud hésiter91, mais Jacques Bernard, s’il décide de fermer le 11 juin pour réfléchir au comportement qu’il va devoir adopter avec le nouvel occupant, rouvre les éditions du Mercure le 1er août 1940(92), et devient par la même occasion favorable à la collaboration allemande, convaincu du parti qu’il a à prendre.
Intelligences avec l’ennemi
C’est désormais l’ennemi qui dicte au Mercure la marche à suivre et qui prend de manière générale le contrôle de l’édition. Le 28 septembre 1940, le syndicat des Éditeurs signe une Convention de censure avec les autorités d’occupation qui stipule que chaque éditeur est entièrement responsable de sa propre production, à condition toutefois qu’elle ne nuise ni au prestige ni aux intérêts allemands, et qu’elle rejette les « ouvrages indésirables » d’auteurs juifs, anglais ou de réfugiés politiques, ainsi que ceux des écrivains déjà interdits en Allemagne. Les éditeurs doivent en échange accepter la diffusion de la première liste Otto93. Jacques Bernard doit donc faire attention à ce qu’il publie et se soucie dès lors exclusivement des bonnes relations qu’il doit entretenir avec les Allemands, sachant pertinemment que le Mercure de France a longtemps été hostile à l’Allemagne. Or, comme le rappelle Léautaud, « ils [les Allemands] sont […] au courant, avec pièces en mains, de tout ce qui a été écrit en France pour eux ou contre eux depuis vingt ans, et dans tous les genres : théâtre, livres, revues, journaux, dont ils ont constitué une bibliothèque, des archives, des fiches94. » Les écrits95 d’Apollinaire pendant la Première Guerre mondiale pourraient à eux seuls compromettre sérieusement l’image du Mercure ; Bernard le sait et doit se rattraper en affirmant toujours plus clairement son appartenance à l’idéologie hitlérienne et en échangeant ses vues sur sa valeur intellectuelle supérieure avec les administrateurs et les militaires allemands chargés du contrôle de l’édition. Servile, dans l’attente d’un bon traitement de sa maison d’édition par l’occupant, il va jusqu’à déposer à la porte du Mercure un petit écriteau avisant que « le directeur de la maison est visible tous les matins de neuf heures à midi, sauf le samedi96 ». Jacques Bernard s’attend à la visite d’un officier allemand dans les premiers mois de l’occupation et ne veut surtout pas laisser une mauvaise impression : « Il se dit si sûr de conquérir ledit fonctionnaire qu’il s’en ira avec lui presque comme des camarades97. » Il se met lui aussi dans un esprit de conquête pour gagner une amitié allemande, pour garantir sa volonté de collaborer, pour faire fusionner son intelligence avec celle de l’ennemi, devenu ami.
Jacques Bernard doit donc séduire pour mieux convaincre et choisit de s’adresser dans un premier temps à Gerhard Heller98, lieutenant censeur de la littérature française durant l’occupation et, peut-être, « le plus sympathique99 » des Nazis. Fasciné par la culture française (il se choisit Paulhan comme maître spirituel), il est aussi très fier de ne jamais avoir prêté serment à Hitler. Nul doute que Bernard ignorait certain des agissements de cet Allemand à Paris, et s’il l’invite régulièrement dans sa maison de Bouray (Seine et Oise), c’est parce qu’il est chargé de contrôler la conformité de la littérature française à l’idéologie des nouveaux maîtres et d’interdire ou d’autoriser la publication des livres. Autrement dit, c’est essentiellement lui qui applique la politique culturelle de l’occupant et c’est en sa qualité de censeur que Bernard l’invite chez lui deux fois par semaine, avec deux de ses officiers. Bernard agit par intérêt, veut se placer et se protéger. Il dit à Bachelin100, auteur au Mercure, qu’il va faire jouer ses relations pour lui faire gagner de l’argent101. Il devient rapidement suffisant et arrogant, « se réjouit à l’avance des extrêmes privations alimentaires » que les employés du Mercure vont bientôt avoir à subir, « lui, avec ses amitiés allemandes, se tenant pour assuré de ne manquer de rien102 ». Gerhard Heller rend compte dans son livre103 des après-midi passés avec Bernard et sa femme dans sa résidence secondaire, près de Brétigny : « […] j’y retournai assez souvent, toujours le samedi, pendant l’année 1941, avec nos deux secrétaires, ma future femme et son amie autrichienne. La table était fort bien servie et l’hôtesse fort aimable. Bernard nous choquait par sa germanophilie excessive et la véritable haine qu’il portait à tous ceux chez qui il découvrait un esprit de résistance. […] Je reste cependant reconnaissant à Jacques Bernard et à sa femme d’avoir été les premiers Français à nous ouvrir leur maison et à nous recevoir à leur table, où nous avons pu, malgré tout, parler de littérature et même de politique, assez librement, allant jusqu’à lui reprocher ses excès de germanophilie. » Bernard compte effectivement sur sa femme Ingrid, danoise, pour parler allemand avec ses invités, et Paul Léautaud, qui reconnaît le charme du lieutenant Heller, ne peut s’empêcher d’ironiser dans les pages de son Journal : « […] il se pourrait bien que N., à recevoir chez lui deux ou trois fois par semaine ses trois officiers, soit cocu. Si l’un d’eux est si bel homme, cela se pourrait encore mieux. Depuis son accident, N. est complètement fini comme mari. Mme N. est encore une jeune femme104. » L’intelligence avec l’ennemi révèlerait l’impuissance du mari ; cette idée plaît beaucoup à Léautaud qui n’en peut plus de sa mégalomanie politique autant que littéraire, et qui doit faire face, sans rien dire, à l’étroitesse d’esprit de son directeur, à son intolérance, souvent honteuse, parfois absurde quand il voudrait avoir le monopole : « C’est indigne. Il y a des gens qui font des courbettes aux Allemands, qui s’aplatissent devant eux. Je viens d’apprendre que S. déjeune demain avec le lieutenant Heller105 ». Jacques Bernard, aveuglé par son avilissement, ne se préoccupe plus que de la bonne image que doit avoir le Mercure de France auprès des Allemands. Tous les moyens sont bons pour que le rapport106 d’activité de l’édition signé par le lieutenant Heller au mois de juillet 1941 (mis en annexe) soit irréprochable ; tous, même la délation, comme nous l’explique Paul Léautaud : « […] il rencontre rarement des opinions d’accord avec les siennes, si doucement que son interlocuteur le lui fasse sentir. Celui-ci parti, aussitôt, sur sa carte de visite, qu’il envoie à la propagande allemande, son nom et les propos qu’il a tenus107 ». Jacques Bernard, en collaborant toujours plus près avec l’Allemagne, et en établissant des liens toujours plus serrés avec les grandes figures de l’administration ou de l’armée allemande, finit par mettre le Mercure de France au service de la propagande nazie.
Une littérature de plus en plus dirigée
La littérature change de sens au Mercure de France dès 1939 et nous pouvons parler d’une littérature dirigée dans la mesure où le catalogue de la maison d’édition affiche un net parti pris en faveur d’une idéologie. Ce changement de direction n’est perceptible que si nous l’analysons sous l’angle de la rupture dans la continuité ; le contraste devient alors saisissant. Sur quarante-cinq titres édités en 1939, Jacques Bernard choisit de publier d’anciens auteurs comme Barbey d’Aurevilly, Wilde, Andersen ou Nerval, ainsi que d’autres valeurs sûres de la maison plus contemporaines (Duhamel, Léautaud, Pergaud), des poètes également (Samain, Le Cardonnel, Kahn, Jammes), ce qui n’est pas étonnant si l’on rappelle qu’à la fin de l’année 1939, les éditions d’ouvrages nouveaux sont provisoirement suspendues108. Toutes ces publications restent fidèles à ce qui se faisait déjà au Mercure avant l’arrivée de son nouveau directeur en 1938. Mais celui-ci insère dans son catalogue de la maison d’édition de nouveaux essais politiques plus proches semble-t-il de ses convictions. Le Mercure accueille donc dès l’année 1939 Le déclin des grandes démocraties et le retour à l’autorité de Jean Jacoby, pro-allemand, hitlérien ; c’est lui qui, d’après Paul Léautaud109, aurait « converti » Bernard avant la guerre. Léon de Poncins se consacre quant à lui au Péril rouge : le plan communiste d’insurrection armée, qui s’inscrit dans le cadre de ses précédents travaux sur les mouvements révolutionnaires modernes mais dont nous pouvons deviner l’orientation politique. Le Docteur René Martial, dans Vie et constance des races, propose ses leçons d’anthropo-biologie professées à la Faculté de Médecine de Paris, et nous pouvons aussi remarquer la présence, dans ce catalogue, d’auteurs comme Vanderpyl, Edmond Pilon, M. Brian-Chaninov, tous germanophiles et figurant sur la liste des « écrivains coupables à divers degrés sur le plan national » dressée par le Comité national des Écrivains au mois d’octobre 1944(110). À leurs côtés, notons la dernière publication de Charles-Henry Hirsch, Margot la marine, avant qu’il ne tombe malade et soit définitivement chassé du Mercure.
Dans la région parisienne, les alertes ne cessent de retentir pour prévenir d’éventuels bombardements, mais au 26, rue de Condé, tout se passe comme si les murs de la maison d’édition absorbaient le bruit des sirènes et ne rendaient pas compte de la situation alarmante de la France. Le Mercure de France collabore sans remords, et, en 1940, maintient sa nouvelle ligne éditoriale en faveur de l’occupant nazi, malgré la longue fermeture de la maison pendant près de trois mois et malgré la nouvelle constitution qui rétablit la censure le 8 juillet 1940. Le Mercure se sort sans dommages de ces nouvelles contraintes, ses publications allant dans le sens que choisit la France et le maréchal Pétain pendant la guerre. Si l’on se réfère au catalogue de la maison d’édition, l’année 1940 est la moins riche en titres édités (nous en avons dénombré six au total, tout en étant conscient du caractère imparfait de notre recensement) mais une des plus intéressante : Francis Jammes et Remy de Gourmont sont désormais les seuls à défendre l’héritage de Vallette ; Georges Duhamel publie deux livres, Positions françaises et Lieu d’Asile, mais nous verrons que les Allemands vont en faire l’un de leurs principaux ennemis. Il figure d’ailleurs dans la première liste Otto111 aux côtés de Joseph Kessel, Aragon, André Malraux, Paul Claudel ou encore Thomas Mann. Jacques Bernard continue, autant qu’il le peut, la publication de ses livres ; c’est l’auteur qui rapporte le plus d’argent au Mercure112.
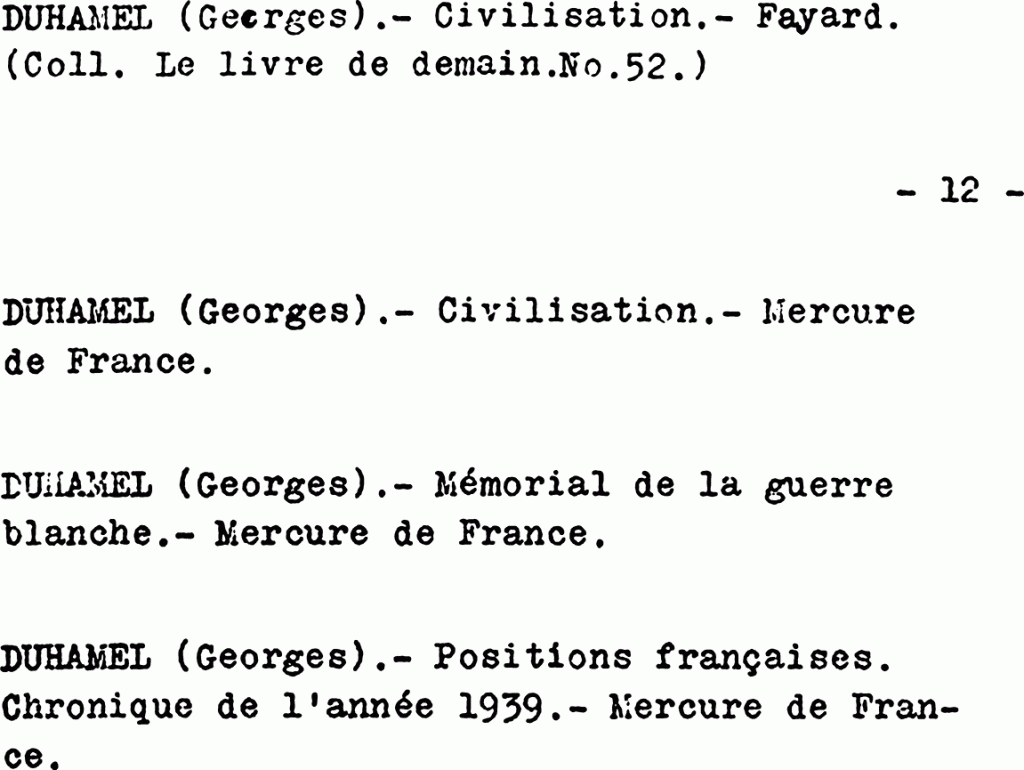
Les quatre livres de Georges Duhamel figurant sur la liste Otto de 1940 (bas de la page onze et haut de la page douze)
Le Mercure de France se place dans le cadre de l’importation des modèles culturels allemands et de la Révolution nationale113, privilégie l’idée d’une réforme intellectuelle et d’un retour aux anciennes traditions. C’est ce que nous suggèrent les titres des livres de Jean Jacoby, Scènes de la vie de Jeanne d’Arc, et de Christian de Carbon, Les aventures d’un jeune Français à la découverte de l’Allemagne hitlérienne. Des titres qui œuvrent pour la propagande vichyste et nazie, édités dans le but d’exercer une action sur l’opinion pour l’amener à se faire une certaine idée du nouveau régime de la France. Nous aurons l’occasion de revenir sur la démarche propagandiste du Mercure de France en nous demandant si elle n’agit pas à contre-courant de la littérature, mais nous pouvons déjà mesurer la nouvelle dose de poison que s’injecte le Mercure en collaborant dès les débuts de l’occupation. Une injection dont Jacques Bernard ne peut certainement pas ressortir indemne.
Chapitre trois : Premiers signes de démence
Quand le Mercure de France rouvre le 1er août 1940, Jacques Bernard n’est plus limité dans ses pouvoirs. La veille, Georges Duhamel, voulant se vouer tout entier à ses travaux, lui a annoncé, par lettre114, sa démission de son poste d’administrateur qu’il avait conservé après son départ en 1938. Nul doute que l’auteur des Pasquier ne veuille plus faire partie d’une maison d’édition qui décide de collaborer avec l’ennemi. Bernard règne donc en « maître115 » sur le Mercure avec l’appui des autorités allemandes, gouverne en souverain sur une maison où il est éditeur de la librairie et directeur de la revue. Mais il se donne aussi des allures de chef des armées et vise dans un premier temps une diminution des effectifs lui permettant d’asseoir son autorité sur les membres du personnel qu’il dirige. C’est la structure générale de la maison d’édition qu’il veut réorganiser en tentant de prendre le contrôle financier rue de Condé, mais ce sont surtout les fonctions vitales du Mercure qui sont touchées.
Le sort réservé aux employés
Jacques Bernard n’a jamais entretenu de relations saines avec ses employés, tous se plaignant de ses sautes d’humeur et du mauvais traitement qu’il leur a longtemps infligé. En janvier 1940, Georges Duhamel rend justement visite à Bernard pour le prier d’être un peu plus civil avec le personnel du Mercure, lui disant qu’il est arrivé à s’en faire détester116. Nous avons déjà entendu Jacques Bernard se réjouir de l’extrême précarité qui toucherait ses employés si jamais la maison d’édition venait à fermer. S’il décide finalement de maintenir la maison en activité pendant la guerre, sans qu’il ne soit question pour le moment de licenciements, il reste préoccupé par les économies qu’il doit faire et choisit dans un premier temps de réduire la rémunération du personnel de moitié117. Une mesure à laquelle refuse de se rendre le personnel féminin de la maison qui réclame l’aide de son ancien directeur et menace d’une prochaine grève si la situation ne s’arrange pas. Grâce à l’intervention de Duhamel, la réduction des appointements sera seulement118 d’un quart quand les employés reprendront le travail au mois d’août 1940. Mais cette baisse des salaires est de mauvais augure quand on songe aux prochaines pénuries et à la hausse des prix qui touchent la zone occupée à partir de 1941, et choque si l’on pense que Bernard n’a jamais respecté les augmentations de salaire fixées selon décret du gouvernement119.
Jacques Bernard s’en prend aussi bien aux membres du personnel qu’aux principaux collaborateurs à la revue, invoquant différentes raisons pour les mettre à la porte. Nous avions déjà assisté à la mise au pas de Hirsch. C’est aussi le cas de Jules de Gaultier, rédacteur au Mercure depuis 1893, dont Bernard aimerait se débarrasser, ne lui trouvant pas sur la guerre, les Allemands ou l’occupation des opinions conformes aux siennes. Jules de Gaultier, face à cet affront et découvrant le nouveau visage du Mercure de France, aurait alors dit à ses amis : « Je ne collaborerai plus jamais au Mercure120 », jouant sur le double sens du verbe « collaborer ». D’autres n’auront malheureusement pas à prendre l’initiative de leur départ.
Mlle Naudy121, une amie de grands amis à Duhamel, la dactylographe du Mercure depuis 1935 devenue secrétaire, n’échappe pas à la goujaterie de Bernard et reçoit son congé en juillet 1940. Le directeur du Mercure de France prétend ne rien ignorer de ses agissements contre lui auprès de Duhamel et l’accuse d’avoir remis à son désormais rival les états des ventes de la maison d’édition, autrement dit d’agir comme espion et agent de Duhamel. Un renvoi qui révèle donc un délire paranoïaque mais qui est aussi pure méchanceté dans la mesure où Bernard lui reproche également d’être allée se mettre à l’abri avec sa mère à Caen au mois de mai 1940(122). Paul Léautaud, dans son Journal littéraire123, rapporte la scène suivante : « Il paraît qu’il [Bernard] a raillé Mlle Naudy, en lui donnant son congé, du changement qu’elle va trouver en perdant sa place, qu’elle ne pourra plus faire des obsèques coûteuses comme elle a faîte à son père, qu’il ne lui sera pas facile de conserver son appartement de 7 000 Francs, qu’il va falloir qu’elle devienne modeste. Il paraît qu’elle en était outrée, effondrée et en larmes en le quittant. Un goujat par-dessus le marché. »
Bernard s’en prend ensuite à son assistant, Léo Porteret, dont il a longtemps vanté les mérites avant d’envisager de le « débarquer ». Celui-ci remplace d’abord Mlle Naudy mais Bernard ne le prévient plus de ses décisions. Il est pourtant constamment aux côtés de son directeur, même s’il confie à Léautaud qu’il peine à vivre toutes ses journées avec lui et à entendre ses propos, qu’il est exposé à toutes les violences de caractère qui peuvent le prendre, à ses grossièretés de langage et même à la possibilité de recevoir son congé « par simple saute de brutalité d’humeur124 ». Peu de temps après, il est effectivement renvoyé et entre au Cercle de la Librairie dans le service de la Censure des Manuscrits. Jacques Bernard semble agir de la même façon avec « T. », chef de la fabrication, qu’il avait lui-même introduit au Mercure dix ans auparavant125 et dont il souhaite le renvoi pour avoir fait, pendant près de deux mois, des rapports contre lui à Duhamel. L’arme absolue de Bernard, c’est le contrat collectif du Mercure (« règlement qui fait des employés d’une maison un vrai petit Soviet126 », aux dires de Léautaud), qui lui permet de renvoyer quiconque enfreindrait le moindre alinéa. Il aurait aimé s’en servir contre le magasinier Maurice Désert127 en mars 1940, mais en vain.
Nous le voyons, Jacques Bernard renvoie ses employés de façon arbitraire et peine à justifier clairement ses motifs de licenciement. Il n’est pris d’aucune pitié face à ceux qui travaillent dans la maison depuis déjà plusieurs années, bien au contraire. Soucieux de donner au Mercure un esprit nouveau et de prendre le contrôle total de la maison d’édition après le départ de Duhamel, il n’a d’autres ambitions que d’évincer les personnages les plus influents de la maison, sans oublier Paul Léautaud.
Le renvoi de Paul Léautaud
« Passé au Mercure »… Dans les années qui suivent son renvoi, Paul Léautaud n’est plus qu’un « passant » de la rue de Condé, lui qui, il y a peu, passait pour la « mascotte du Mercure128 ». Son licenciement, il l’avait prévu, mais peut difficilement se rendre à l’évidence129. Il est écrivain au Mercure depuis 1895, actionnaire depuis 1903, secrétaire depuis le 1er janvier 1908, chargé des relations et de la correspondance avec la presse et les auteurs et responsable des services de presse, qu’il adresse tant aux critiques français qu’aux critiques étrangers. À la fin du mois de septembre 1941, Paul Léautaud, l’« homme aux quatre cents lecteurs » mais qui a donné son nom ainsi que son pseudonyme130 au Mercure de France, est renvoyé par Bernard, qui lui retire tout de son service, les manuscrits, l’annonce à la Bibliographie, les services de presse, les nouveautés… « Je ne sais plus rien de tout ce à quoi j’avais une part importante du temps de Vallette131 ». Il est accablé, bientôt neurasthénique ; le Mercure était la maison de sa carrière, comme le montre cette histoire, en 1929 : Léautaud manque son train et arrive en retard, ce qui met fortement en colère Alfred Vallette. Bernard, déjà, lui conseille alors de quitter la maison : « Non, non, il me faut le Mercure132 », répond rageusement l’auteur du Petit Ami.
Il est difficile de se défaire d’une seconde peau et peut-être plus encore d’une seconde maison. Paul Léautaud ne fait plus que « passer » rue de Condé en se récitant certainement les vers de Verlaine qui lui reviennent quelquefois :
« Beau cavalier qui chevauche en silence
Le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance133. »
Le malheur, Paul Léautaud le côtoie, l’apprivoise depuis sa naissance en 1872. Enfant illégitime (son père, souffleur à la Comédie française, avait la réputation d’être un séducteur), il commence à travailler à quinze ans, juste après le certificat d’études. En 1914, il a de gros soucis d’argent et doit vendre les livres de sa bibliothèque. Deux ans plus tard, il apprend la mort de sa mère, en lisant le journal. Le malheur, il a finalement appris à vivre avec, parvenant à se consoler malgré tout. C’est à cela que lui sert son Journal qu’il rédige depuis l’âge de vingt et un ans, et c’est aussi à cela que lui servent ses bêtes134, Stendhal135… ses rêves136 aussi. Mais lui est-il possible de se faire véritablement une raison, quand, à presque soixante-dix ans, Bernard lui annonce son congé et le renvoie à son anonymat ? Car Paul Léautaud, en 1941, est connu mais n’est pas reconnu, lui qui pourtant a « toujours vécu littérairement137 ». Il l’écrit lui-même : « Avec […] la guerre et tout ce que je suis obligé d’entendre à droite et à gauche à ce sujet, je ne pense pas du tout, ou si peu, à ma littérature et que je suis un écrivain français publiant dans une revue le « journal » de sa vie littéraire. J’aurais bien tout ignoré, par moi-même, et par l’extérieur, des jouissances de la notoriété138. » Cette situation est d’autant plus frustrante qu’il vient tout juste de publier les premières pages de son Journal dans la revue du Mercure (qui, comme nous le verrons, disparaît en juin 1940) et qu’il n’aura plus désormais l’occasion de livrer l’inédit de son récit à la maison d’édition qu’il a toujours connue. Paul Léautaud se sent exclu, dépossédé de sa vie comme de ses vices. Quelques mois plus tôt, mardi 27 mai 1941, il doit déjà faire face à l’annonce de sa propre mort, de sa fausse mort annoncée par Radio-Vichy puis reprise par Radio-Paris. Elle ne lui permet malheureusement pas de faire vendre ses livres et provoque sans le vouloir la deuxième fausse mort de Léautaud, à laquelle il assiste en consultant la feuille des tirages concernant l’année 1940-1941 : « Arrivé à la feuille de Passe-Temps, je vois L’indication : 248 ex. détruits à Montrouge. C’est la première fois que des exemplaires d’un livre de moi sont détruits139 » Une mort prématurée, un autodafé, auxquels s’ajoutent la pénurie de café et la hausse du prix du tabac (« J’aurai eu trois vices dans ma vie : le café, les cigarettes et faire minette à la femme que j’aime140. »), Léautaud n’en finit plus de mourir sans jamais espérer atteindre la résurrection, sans prétendre une seule fois au Salut, sans qu’il ne lui soit vraiment possible de se consoler. Il ne confie d’ailleurs rien à son journal quand il est renvoyé, ou si peu, rend seulement compte du fait accompli « Le concierge du Mercure, à midi, en pleurait. Tous les employés n’en reviennent pas, crient à l’abomination. Il n’y a que moi qui rie141. » Paul Léautaud ne nous dit plus que les larmes et les cris, le rire aussi ; le motif, les raisons, les conditions du renvoi, il les avait déjà annoncées, prophétisées depuis l’accident de Bernard. Le jour de sa « mort », il n’a plus d’illusions : « […] Bernard aurait été enchanté que je sois mort pour de bon. Il paraît en effet avoir pris en haine tous les anciens de la maison142. » Et nous savons que dès septembre 1939, quand le Mercure, fermé, est sur le point de se faire racheter par les Libertés françaises, Bernard envisage déjà une ou deux suppressions d’emploi comme autre solution, sans cacher à Duhamel qu’il commencerait par Léautaud143. Que peut-il lui reprocher ? Son admiration pour l’Angleterre à une période où il n’est pas de bon ton de soutenir Churchill ? Nous ne pouvons pas nous contenter de cette hypothèse et pensons voir dans ce renvoi la folle obsession d’un directeur qui voudrait incarner, seul, les nouvelles éditions du Mercure de France.
Paul Léautaud, soutenu par l’ensemble du personnel de la rue de Condé, et parce qu’il ne supporte pas d’être considéré comme ayant quitté la maison (c’est Bernard qui l’a « mis dehors »), rompt symboliquement avec le Mercure quelques jours après son renvoi en proposant son nouveau manuscrit du Petit-Ami à Gallimard, chez qui il s’était déjà rendu en mars pour l’édition de son Journal, « en cas de congé par Bernard144 ».
Dans les jours qui suivent son licenciement, Paul Léautaud avoue se sentir en excellentes dispositions pour travailler et reçoit plusieurs propositions pour se faire éditer par Gallimard, Albin Michel et Lubineau. Il se consacre aussi à sa défense et fait citer son ex-directeur au Conseil des Prud’hommes, estimant que ce que lui verse Jacques Bernard en indemnités est au plus la moitié de ce qu’il lui devait, et ne pouvant tolérer « le procédé et les injures145 » qui ont accompagné son renvoi. Lors des deux séances de conciliation, le 10 puis le 27 juillet 1942, Paul Léautaud rappelle qu’on ne lui a pas versé les majorations d’appointements prescrites de 1937 à 1939 qui augmentent pourtant le chiffre des appointements sur lesquels ont été calculés ses trois mois de préavis de congé et ses six mois d’indemnités de licenciement. La défense de Bernard est jugée « pitoyable » et il sait bien qu’il va devoir payer. L’affaire se termine sur un compromis : Paul Léautaud accepte d’annuler l’affaire à condition que lui soit transmise l’intégralité du règlement, soit 10 536,75 francs. Il finit par obtenir gain de cause, Bernard ayant été impressionné par l’éditeur Rousseau146 qui présidait le Conseil des Prud’hommes pour la section édition147. Mais au cours de cette affaire, Bernard, excédé, avoue aussi regretter de ne pas avoir renouvelé tout le personnel148.
Mme Izambart, la concierge du Mercure, tient à conclure le chapitre en hasardant, à la fin du procès : « Vous êtes redevenus amis149 ! », ce qui, bien sûr, est loin d’être le cas. Jacques Bernard, après s’être débarrassé d’un certain nombre de ses employés, envisage de prendre le contrôle financier de la maison pour mettre définitivement la main sur le Mercure de France, sous la pression des Allemands. Jacques Bernard présente encore quelques signes de démence ; le chapitre se poursuit donc.
La tentative de putsch financier
En 1943, l’Allemagne hitlérienne subit ses premiers revers devant l’avancée de l’armée rouge, et l’Italie capitule le 8 septembre. Au Mercure de France, Jacques Bernard et les Allemands cherchent à prendre le contrôle total de la maison d’édition et une sorte de guerre éclate au 26, rue de Condé. L’ancien hôtel particulier de Beaumarchais sert de champ de bataille ; Georges Duhamel personnifie l’ennemi ; l’arme financière, la seule requise, fait s’affronter les deux opposants dans un combat qui semble, au premier abord, équitable. Au cours du procès de Jacques Bernard en 1945, Georges Duhamel réclame que la lumière soit faite sur cette affaire qu’il juge « très grave et préparée avec astuce ». Tous les éléments d’appréciation sont dans un dossier que possède le tribunal mais que nous n’avons malheureusement pas pu consulter. Les témoignages qui nous ont malgré tout aidés à comprendre un peu mieux la situation font ressortir les faits suivants :
Pour obtenir la majorité à l’assemblée générale des actionnaires du 29 décembre 1943, Jacques Bernard vend une partie de ses actions à des amis à lui en octobre 1943. Car dans les statuts de la société, chaque action possédée donne une voix à l’assemblée, un actionnaire ne pouvant toutefois réunir plus de dix voix. Multiplier les actionnaires, c’est donc multiplier les voix, et augmenter ses chances de devenir propriétaire principal du Mercure. Jacques Bernard vend ainsi 413 actions et sa femme 50(150). Pour contrecarrer ce plan, Georges Duhamel, nommé Secrétaire perpétuel provisoire à l’Académie française depuis 1942 et retiré des affaires de la maison, vend 177 de ses actions à ses fils et belles-filles. Duhamel veut, comme il l’explique à Paul Léautaud, tenter une « action énergique151 » contre le directeur du Mercure, en transférant des actions à des tiers pour se faire des voix favorables et mettre Bernard en minorité, autrement dit en adoptant la même tactique que lui.
Georges Duhamel refuse donc cette tentative de putsch financier et fait figure, comme nous aurons l’occasion de le voir par la suite, de résistant152. Il analyse en effet la situation sous plusieurs angles et combat finalement sur trois fronts.
Son principal adversaire reste Jacques Bernard, l’homme qui, selon lui, a ruiné l’équilibre administratif de la maison en changeant le système de vote (il élève à cinq le nombre des administrateurs, fixé par les statuts à trois) et en faisant des transferts à la dernière minute pour se procurer des voix. « Monsieur Jacques Bernard a la maladie de l’autorité. Il veut transformer en une monarchie le Mercure qui est une société par actions153 » Nous le savons, Duhamel veut sauvegarder l’héritage d’Alfred Vallette, en préservant notamment un cercle d’action large et fraternel qui permet à la maison d’édition de s’autofinancer depuis 1894(154). Mais il veut surtout contrer les élans mégalomanes et parfois hystériques de son ancien collègue ; il se souvient encore du jour où, avec Herold155, il avait exigé de Bernard — incapable — qu’il ôte sur le Mercure sa qualité de directeur, et où Bernard, entrant en fureur, avait pris des encriers pour les leur jeter à la tête156.
Bernard est finalement moins à craindre que les Allemands eux-mêmes. Ils influencent considérablement le directeur du Mercure et veulent que la maison soit entièrement contrôlée par quelqu’un qui leur soit fidèle. Ils veulent surtout se débarrasser de Duhamel, qui publie des livres jugés « impardonnables » et qui pourrait, s’il est suivi par d’autres membres du personnel, déclencher une vague de résistance nuisible aux intérêts des Allemands. Dans cette affaire, il doit donc moins lutter contre Bernard que contre les occupants allemands.
Or, en 1943, un nouveau figurant sert d’intermédiaire entre Georges Duhamel et les Allemands. Déjà auteur au Mercure depuis 1941 (c’est d’ailleurs l’un des neuf auteurs traduits en allemand pour la période 1941-1943), Louis Thomas tente d’amadouer l’écrivain de Civilisation et de le rallier à la cause allemande. « C’est à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires que M. Louis Thomas a fait une apparition remarquable dans les affaires du Mercure de France. » Georges Duhamel n’a pas assisté à l’assemblée du 29 décembre mais s’était arrangé pour que dix actionnaires demandent une nouvelle assemblée trois mois plus tard afin de gagner du temps. Au cours de la période qui sépare les deux assemblées, Louis Thomas envoie une lettre à Georges Duhamel qui contient, « avec diverses propositions et menaces plus ou moins voilées, une invraisemblable offre de cent actions du Mercure de France pour l’Académie française ». Les deux hommes se rencontrent le lundi 14 février 1944, à 10 heures 30 du matin, dans le cabinet personnel de Georges Duhamel au palais de l’Institut157. Louis Thomas parle au nom de l’Allemagne et des Allemands, qui veulent « assurer la paix au Mercure de France ». Il propose à l’académicien que ses actions, qui valent 100 francs, soient rachetées 250 francs par les Allemands, et lui offre une indemnité en plus qui pourrait s’élever à un demi-million de francs. Beaucoup d’argent en échange donc, mais aussi un certain nombre de privilèges : la réimpression de tous les livres de Duhamel et une dizaine d’actions pour qu’il ait des voix dans les assemblées générales. Face au silence de Duhamel, Louis Thomas surenchérit et propose de le nommer directeur du Mercure, Jacques Bernard restant alors président du conseil d’administration158. Georges Duhamel récuse enfin toutes les propositions de son adversaire : il n’est pas intéressé par l’argent, n’a aucune envie de reprendre la direction de cette « malheureuse maison », et ne peut accepter les cents actions proposées à l’Académie dans la mesure où, celle-ci distribuant des prix littéraires, elle serait à la fois juge et partie.
Louis Thomas tente une dernière fois d’intimider Duhamel en lui rappelant qu’il est l’ennemi des Allemands et qu’ils pourraient s’attaquer directement à lui s’il refuse de coopérer. Même face aux menaces, Georges Duhamel a le dernier mot : « Je m’estime inattaquable : le Secrétaire perpétuel de l’Académie française ne peut pas faire de politique et il n’en fait pas. Si les Allemands se portent à quelques excès sur ma personne, ils auront tort et je ne crois pas qu’ils le feront ». Cela fait d’ailleurs près de quatre ans qu’ils auraient pu le faire, ce qui lui donne une autre raison d’espérer.
Les Allemands comptaient pourtant sur Louis Thomas qu’ils avaient déjà nommé directeur littéraire de la maison Calmann-Lévy, aryanisée159 en 1941 et qu’il aurait aimé racheter s’il ne s’était pas fait licencier en 1943 par Jean Flory160. Mais Duhamel se montre incorruptible face à ce marchand de biens qui tire aussi profit du marché noir, et l’affaire se conclut sur une nouvelle crise de Jacques Bernard qui apprend au mois d’avril 1944 que Louis Thomas, son complice, a essayé de faire cavalier seul en voulant racheter les actions de Duhamel et devenir ainsi propriétaire du Mercure de France.
Du bruit, encore du bruit, et de la fureur, au 26, rue de Condé. C’est la démence de Jacques Bernard, le récit d’un idiot à contre-sens, qui fait perdre au Mercure tout son sens.
Chapitre quatre : Le Mercure a perdu ses ailes
L’argent, le chantage, la corruption, les bonnes relations… Jacques Bernard, casque ailé sur son crâne fêlé en guise de couronne et caducée-sceptre en main, est directeur de droit divin, mais ses nouvelles directives ont du mal à s’accorder avec la littérature — jusque-là reconnue — du Mercure. Le dieu Mercure, empoisonné, perd ses ailes et ne se reconnaît plus. Défiguré, obéissant à un nouvel ordre propagandiste, il assiste à la disparition progressive des libertés, du littéraire considéré sous un angle immatériel, sensible. La censure imposée par la Propaganda-Abteilung est la dernière dose de poison qu’il absorbe, avant de se voir parfaitement désintégré.
La fin des libertés
« Le but du monde est le développement de l’esprit, et la première condition du développement de l’esprit, c’est sa liberté161 ».
La liberté de toutes les opinions, tous les genres, toutes les idées. Ce n’est pas ce vers quoi tend le Mercure de France quand il décide de collaborer avec les Allemands. Autorité, ordre, discipline, voilà ce qui doit désormais contribuer au redressement et à la régénération de la France. Voilà ce que Paul Léautaud doit comprendre, lui qui crie pourtant depuis de longues années : « Jamais, à aucun prix, je ne céderai sur ma liberté d’écrire ce que je veux écrire. » La liberté pour l’écrivain au Mercure de France remonte au temps où la maison d’édition honorait les lettres françaises, au temps de Remy de Gourmont, d’Alfred Vallette et de Georges Duhamel. Quand Jacques Bernard devient directeur du Mercure, la liberté n’est plus qu’une chimère. Léautaud, malgré tout, y pense encore au moment où Bernard lui propose de reprendre sa chronique dramatique, accompagnée d’une augmentation : « “Et n’est-ce pas, entière liberté ? Vous savez comme je fais une chronique ?” Il m’a assuré : entière liberté162. » Force est d’interpréter que la liberté, pour Bernard, en 1939, c’est laisser ses auteurs tenir les pires propos antisémites, comme Léautaud l’avait fait concernant Hirsch.
On ne peut plus écrire ni éditer librement au Mercure à partir de 1940. À la fin du mois de mai, Bernard fait d’ailleurs mettre au pilon tous les romans qu’il a pris à C.-H. Hirsch, H. Bachelin, F. Fleuret, G. Brunet ou encore L.-F. Herold163. Et Léautaud ne se sentira jamais aussi libre que quand il sera renvoyé du Mercure : « Mon renvoi du Mercure me donne toute liberté pour travailler164» ; le Petit-Ami, la seconde version de Passe-Temps, son Journal, « c’est de l’argent en perspective », mais c’est aussi l’occasion pour lui de revenir à ses premières aspirations… c’est redevenir écrivain.
Or le Mercure de France, pendant la guerre et en choisissant de collaborer, cherche plus à promouvoir les auteurs que les écrivains, s’intéresse davantage à publier qu’à ce qui pourrait être publié. Jacques Bernard, dans son nouveau costume de Hitler165, semble n’y pas prêter la moindre attention, et pourtant dans l’édition, on interdit, on décrète166, on quantifie ; on vide le littéraire, on égruge l’écrivain. Les Allemands font des saisies167 chez les particuliers, une deuxième puis une troisième listes Otto des ouvrages « non-désirables en France » sont diffusées en 1942 et 1943. On interdit même Tartuffe en zone libre, Tartuffe que Louis XIV laissa représenter. Au 26, rue de Condé, Georges Duhamel est l’un des premiers à être condamné au silence.
La censure et l’« affaire » Lieu d’Asile
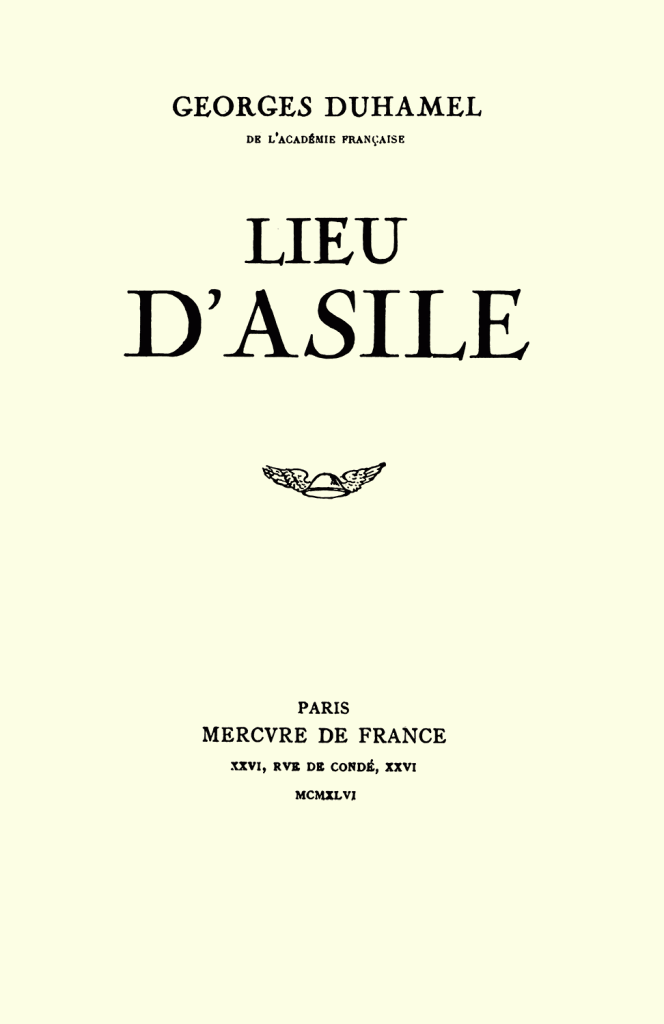
Le lundi 2 décembre 1940, le lieutenant Heller, accompagné de deux officiers, fait saisir le dernier livre de Georges Duhamel, Lieu d’Asile. Le lendemain, un soldat allemand arrive à cinq heures au Mercure avec un marchand de vieux papiers et son camion pour enlever tous les exemplaires de Lieu d’Asile, empaquetés au dernier étage de la maison. « Les paquets ont été jetés à la dégringolade tout Le long des trois étages. On ne pouvait plus passer dans l’escalier168 ». Tout le stock (y compris les soixante exemplaires que Duhamel avait chez lui, 31, rue de Liège, à Paris) est ensuite conduit avenue de la Grande armée, dans un garage servant d’entrepôt, dernière étape avant le pilon. C’est la première mesure prise par le Dr Kaiser169 au Mercure de France. Les Allemands combattent les hommes mais aussi les livres, tout ce qui n’adore pas ni n’adhère à l’idéologie hitlérienne. « Vous êtes notre ennemi. Cela suffit pour nous dicter notre conduite170 », auraient dit deux officiers allemands à Duhamel lors d’un interrogatoire.
Georges Duhamel est considéré comme étant l’un des adversaires de l’Allemagne et ses livres comme « la plus dangereuse contre-offensive déclenchée contre la propagande hitlérienne171 », de l’aveu même des Nazis. Dès le mois de septembre 1940, Civilisation172, son livre capital, figure sur la première liste Otto. Mais quand l’ironie de l’histoire s’en mêle, nous nous rendons compte que Duhamel, un des écrivains les plus lus en France avant la guerre (on vend au Mercure 500 exemplaires par jour de son dernier roman, Cécile parmi nous, en 1939), est également bien connu et apprécié des Allemands. C’est ce que confie Lucien Descaves173 à Paul Léautaud un jour de septembre 1940. Descaves doit loger trois Allemands dans sa propriété de Senonches, des professeurs (soldats), heureux de trouver dans sa bibliothèque de quoi lire. Il regarde alors ce qu’ils prennent pour leur lecture du soir : « rien que des Duhamel ».
Lieu d’Asile est un livre qui, au premier abord, ne présente aucune marque d’hostilité envers l’Allemagne. Duhamel s’est rendu à Rennes au mois de juin 1940 pour rejoindre ses fils et, en raison du manque de médecins dans la région, offre au médecin chef de l’hôpital ses services, lui qui fut chirurgien chef de l’autochir XVI sur le front de 14-18. Plus de six cents blessés sont ainsi soignés et opérés par ses soins. Lieu d’Asile est le récit de ses jours passés en Bretagne auprès des victimes des bombardements aériens et ne semble pas prêter à la moindre critique, d’autant que le mot « allemand » n’y est jamais prononcé, comme l’a déjà remarqué Claude Santelli dans un livre qu’il a consacré à l’ancien directeur du Mercure de France174. Georges Duhamel est pourtant convoqué à la Propaganda-Staffel et fortement réprouvé pour ce livre : « Pourquoi n’avez-vous pas mentionné dans votre livre les services rendus par les troupes allemandes aux réfugiés ? Vous auriez dû signaler que nos soldats ont ravitaillé les populations françaises sur les routes de l’exode ». Bremer, chargé de l’interroger, lui reproche finalement de n’être pas suffisamment engagé auprès des Allemands, de ne pas œuvrer pour la propagande nazie ; de faire de la littérature. Duhamel est inflexible et le restera pendant toute la durée de l’occupation, sans jamais céder au chantage et aux menaces de l’occupant : « Je n’ai strictement rapporté que ce que j’ai vu, et je n’ai jamais assisté au spectacle auquel vous faîtes allusion », répond-il dans un premier temps, avant d’affirmer vigoureusement : « Moi aussi, j’occupe la France ». Les Allemands lui feront payer cet affront en lui interdisant toutes publications ou signatures dans des journaux, ce contre quoi il finira par s’opposer.
Le 3 décembre 1940, Lieu d’Asile est envoyé au pilon et son auteur doit certainement repenser au 12 mai 1933, le jour où il a participé avec Jean Cassou à la manifestation contre les bûchers allemands175. Georges Duhamel tient surtout à désigner un coupable et ne tarde pas à accuser Jacques Bernard, « responsable des mesures d’interdiction prises par les Allemands à l’égard de [ses] ouvrages et à l’autodafé du premier tirage de [son] livre Lieu d’Asile176 ». Jacques Bernard, qui s’illustre lâchement au cours de cette affaire et démontre une fois encore qu’il n’est pas fait pour être éditeur. En effet, Porteret, son assistant, lui avait dit tenir de source sûre que les Allemands ne laisseraient pas paraître Lieu d’Asile177. Bernard ne veut pas l’écouter, croit dans un premier temps que ce livre, « qui va faire répandre des flots de larmes178 », va pouvoir être tiré à cent mille exemplaires et donc faire rapporter beaucoup d’argent au Mercure. Mais les Allemands interviennent, interdisent la mise en vente, envoient tout le tirage au pilon. C’est 40 000 francs de perdus pour la maison d’édition et son directeur est lui aussi convoqué le 26 novembre 1940 par le Dr Kaiser qui lui fait part de sa déception. Comment ne pas penser alors au trait de Bernard décrit par Léautaud au moment de sa citation aux Prud’hommes en 1942 : « Quand il est devant les gens et qu’on lui parle ferme, il devient petit garçon179 », et revoir Jacques Bernard devant le lieutenant de la Propaganda-Abteilung, tête penchée, mauvais élève, honteux de ne pas s’être montré plus fort, et soucieux de se rattraper ?
Après la censure exercée sur son livre Lieu d’Asile et les menaces de mort qu’il reçoit (dirigées aussi contre ses trois fils), nous pourrions craindre que Georges Duhamel ne se réfugie dans son silence (« Je suis en deuil, en deuil de mon pays. Le deuil appelle le silence180 »). Mais le silence de Duhamel parle plus en faveur de la Résistance et fait, comme nous le verrons, plus de bruit que tous les haut-parleurs de Goebbels clamant les bienfaits de la collaboration.
Fin de l’acte un
L’absorption d’un poison dont nous venons de décrire les propriétés et d’analyser les premiers effets provoque le déclin du Mercure, qui évolue d’un passé prestigieux à un présent bouleversé par les premiers temps de l’occupation. Les fondations, la structure, le corps du Mercure de France sont touchés : Jacques Bernard, depuis son accident et depuis qu’il affiche clairement ses positions en faveur de l’Allemagne nazie, change radicalement de politique éditoriale et tente de prendre le contrôle de la maison d’édition en renvoyant une partie de son personnel. Avec l’aide de ses nouveaux alliés allemands, il voudrait devenir le principal actionnaire de la maison et étendre toujours plus son influence au 26, rue de Condé. En échange, il met le Mercure de France sur la voie de la collaboration, acceptant d’en faire un instrument de propagande, et la censure de certains titres que cela implique. La diffusion de ce poison sur l’ensemble de la maison d’édition tire le Mercure vers le bas, l’entraîne dans une chute symbolisée par la dégringolade des livres de Duhamel dans les escaliers de la rue de Condé.
Le Mercure de France est en crise, c’est à dire qu’il traverse une période où, comme nous l’avons vu en introduction, « le sort du malade se décide, où tout va brusquement changer, en mal ou en mieux, ou en autre chose ». En pire.
Entracte
L’escalier à colimaçon de la rue de Condé : « On a touché aux Lettres181 »
« […] sur les marches duquel la légende veut que Beaumarchais ait été roué de coups de bâton sur l’ordre d’un grand seigneur ».
in Revue des deux mondes, « Le Mercure de France entre les deux guerres », août 1971.
« Mardi 3 décembre 1940. — […] Un soldat allemand est arrivé à 5 heures au Mercure avec un marchand de vieux papiers et son camion, pour enlever tous les exemplaires de Lieu d’Asile si bien relégués en paquets à l’étage supérieur de la maison. Les paquets ont été jetés à la dégringolade tout le long des trois étages. On ne pouvait plus passer dans l’escalier. »
in Paul Léautaud, Journal littéraire, Tome III, février 1940 — février 1956, Mercure de France, Paris, 1986, p. 232.

L’escalier à colimaçon de la rue de Condé
Notes de l’acte I
35 Louis Dumur (1863-1933) fut le précepteur du fils du comte Warpakhovsky puis du grand-duc Michel de Russie de 1888 à 1890 à Saint-Pétersbourg. C’est l’un des fondateurs du Mercure de France. Il devient secrétaire général et rédacteur en chef en 1903.
36 La correspondance de A.-F. Herold (note 155) avec Alfred Vallette a été publiée en 1992 aux Éditions du Fourneau. Le passage cité ici est extrait de Mercure de France. Anthologie 1890-1940, partie chronologique, p. 504.
37 La scène est rapportée dans une lettre datée du 25 septembre 1935, que Paul Léautaud écrit à Marie Dormoy. Paul Léautaud, Lettres à Marie Dormoy, Albin Michel, 1966, p. 117.
38 Cité par Alfred Vallette dans la lettre qu’il écrit à A.-F. Herold déjà présentée dans la note no 36.
39 Le malaise de Vallette survient le lundi 4 juin 1934 au Mercure. Paul Léautaud présente la situation de la façon suivante : « Vallette était renversé dans son fauteuil, sans connaissance, les yeux révulsés, très pâle, le visage couvert de sueur ». « Bernard était remarquable tantôt dans sa façon de lui parler, de le réconforter, de le rassurer. Je ne saurais pas du tout être aussi adroit, avoir de ces façons secourables. », in Journal littéraire, t. II, pp. 1395-1397.
40 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. II, p. 1378 et p. 1466.
41 Ibid., t. II, p. 1926 : Jacques Bernard est décrit comme étant fin amateur d’ « apéritifs » et s’élançant, « les beaux jours venus », dans « l’ivresse de la vitesse ».
42 Paul Léautaud, Lettres à Marie Dormoy, Albin Michel, 1966, pp. 153-160.
43 Georges Duhamel est aussi médecin-chirurgien, et peut juger convenablement la démence de Jacques Bernard après son accident. Paul Léautaud, dans le tome II de son Journal littéraire, ajoute, p. 1926, en mars 1938, soit plus d’un an et demi après l’accident, qu’« il s’en est tiré, sans avoir été opéré, assez atteint physiquement, de son propre aveu : rapide fatigue au travail, troubles de la vue, mauvaises jambes (avec une blessure, à l’une, qui n’arrive pas à se fermer), perte des moyens sexuels et quelques autres petites choses. »
44 À plusieurs reprises, Léautaud déplore les « goujateries inouïes de Bernard » ; « le malheureux a bien le crâne fêlé. J’avais jusqu’ici échappé à ses grossièretés, par lesquelles tout le monde a passé au Mercure, y compris la dactylographe. », 13 décembre 1938 p. 2007, et 26 décembre 1938, p. 2011 : « il me faut encaisser les goujateries de ce sot vaniteux au crâne fêlé. » In Journal littéraire, tome II.
45 Paul Léautaud, Journal littéraire, 28 octobre 1937, t. II, p. 1888 : « Florenne apporta un nouveau roman : Les Bâtisseurs. Bernard se fit lecteur. Il déclara à qui voulait l’entendre que cela ne valait rien. Il fit supprimer la valeur de soixante pages à Florenne. […] S’emballer ainsi sur un débutant, l’accabler d’éloges, l’assurer qu’il est plein de talent, que la plus belle carrière lui est assurée, et moins de trois ans après le traiter ainsi ! »
46 Paul Léautaud, Journal littéraire, 27 février 1938, t. II, pp. 1915-1917.
47 Paul Léautaud, ibid., 16 mars 1938, p. 1926. Porteret est l’assistant de Bernard et Mlle Naudy la dactylographe du Mercure. Adolphe de Falgairolle est chroniqueur pour des journaux et revues espagnols et publie des livres plutôt médiocres au Mercure. Vallette, cité p. 320, l’inclus dans la définition qu’il donne du terme « sagouin ».
48 Et Paul Léautaud de poursuivre ainsi : « Je lui ai répliqué : « Oh ! vous savez, cela tourne à la bouffonnerie. Vous devriez faire attention. Il n’y a que la rue à traverser. » (Le bureau de police est en face du Mercure.), in Journal littéraire, 6 octobre 1939, t. II, p. 2125-2126.
49 C’est du moins ce que Georges Duhamel révèle ne pas avoir dit au cours du procès de Jacques Bernard, dans Le Livre de l’amertume, Journal 1925-1956, Mercure de France, 1983, p. 316.
50 Paul Léautaud, Journal littéraire, 1er mai 1939, t. II, p. 2045. L’identité des deux autres personnes n’est pas révélée.
51 Même page que pour la note précédente. Vallette est cité par Léautaud et aurait déclaré : « Hirsch est pour moi le type accompli de l’homme de lettres qui a travaillé toute sa vie comme un forçat, pour un résultat zéro. »
52 Léautaud pousse parfois l’antisémitisme jusqu’au sadisme : « Hirsch devait venir tantôt […]. Un peu avant son arrivée, je suis monté tenant en main deux numéros de l’Action française, grands ouverts, montrant bien les titres. Je pensais qu’il me dirait : « Comment ? Léautaud ! Vous lisez ce journal ? » Ma réponse était prête : « Mais, mon cher, c’est le seul journal lisible aujourd’hui et le seul qui prenne vraiment les intérêts de notre France. » Il est arrivé, m’a dit bonjour très cordialement, à son habitude, pas un mot sur mes journaux. J’en ai été pour mon étalage. » Journal littéraire, 28 mars 1938, t. II, p. 1930. Cela en réaction à une dédicace de C.-H. Hirsch adressée à Léon Blum en lui envoyant son Œil du ministre paru au Mercure en mars 1938 : « Au président Léon Blum en souvenir de nos années d’apprentissage à la Revue Blanche en témoignage de mon admiration pour son œuvre et pour son dévouement à notre France, son ami. »
53 D’une conversation avec Mme Paulhan le 17 novembre 1938. « Je cite les traits juifs de Charles-Henry Hirsch, de Benda, de Kadmi-Cohen. », in Journal littéraire, 17 novembre 1938, t. II, p. 2000.
54 Paul Léautaud, Journal littéraire, 29 janvier 1935, t. II, p. 1459 : « D’où il semblerait qu’il s’est fait en Allemagne, sous plus ou moins les doctrines sociales d’Hitler, une réhabilitation des professions manuelles, une diminution du faux prestige du savoir quand on n’est pas vraiment doué pour l’acquérir, ce qui est loin d’être une mauvaise chose. Autant de dévoyés en moins. »
55 25 juillet 1940, fermeture par les Allemands de la librairie Lipschutz : « J’en ai eu un moment d’une tristesse, d’une désolation, d’une pitié. Juif, c’est entendu, mais si charmant, si courtois, si obligeant, si désintéressé. […] Qu’un État prenne les mesures qu’il veut, justes ou injustes, à l’égard des Juifs (qui, hélas ! ont beaucoup fait pour cela), bon, mais qu’il ne les dépossède pas, qu’il ne les chasse pas en leur enlevant tout. C’est abominable. Encore plus abominable quand c’est le fait d’étrangers, parce qu’ils sont plus ou moins les maîtres provisoires. Jamais je ne pourrai approuver de pareilles choses. », Journal littéraire, t. III, p. 138.
56 Paul Léautaud, ibid., 26 juin 1942, p. 634.
57 Paul Léautaud, ibid., 7 août 1940, p. 153. Alceste est « un satirique, un homme d’une gaieté mauvaise, aux plaisanteries mordantes, aux vérités cruelles dites avec des éclats de rire, l’excès de clairvoyance et de désenchantement aboutissant à une sorte de moquerie féroce avec bonne humeur. Ce que je suis. »
58 Paul Léautaud, ibid., 10 novembre 1943, p. 935. Les bêtes, mais aussi les Anglais !
59 Autrement dit le refoulement, par étapes, du territoire français, de tous les juifs naturalisés depuis 1900. Ce décret date du 24 octobre 1870 et fut inspiré par Adolphe Isaac Crémieux, député de Paris en 1869 et ministre de la Justice dans le gouvernement de la Défense nationale (1870).
60 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, 11 juillet 1940, p. 127.
61 Paul Léautaud, Journal littéraire, 6 octobre 1939, t. II, p. 2126.
62 Ibid., 28 février 1938, p. 1916.
63 Ibid., 25 février 1938 ; p. 1915.
64 Ibid., 6 octobre 1938, p. 2125. Cette mesure ne tiendra que peu de temps.
65 Toute l’édition, 16e année, no 418, 30 avril 1938. Enquête de Janine Bouissounouse, « Les grandes maisons d’édition parisiennes ».
66 Paul Léautaud avait quitté sa chronique du Mercure après avoir obtenu de meilleures conditions de rédaction et un meilleur salaire à La NRF. Puis vient le moment où il s’en prend à Hirsch dans le numéro du 1er mai 1939 de La NRF (« Cela a suffi pour que la race parle en M. Charles-Henry Hirsch ») et tombe sous le coup du nouveau décret-loi visant l’injure ou la diffamation à l’égard des personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée. Paulhan, Gallimard et Roger Caillois protestent contre l’attitude de Léautaud (« Je suis écœuré de la Nouvelle Revue Française »). Celui-ci quitte La NRF le 17 avril 1939 et finit par s’en remettre à Bernard.
67 Paul Léautaud, Journal littéraire, 1er mai 1939, t. II, p. 2045.
68 Jacques Bernard dans Toute l’édition du 30 avril 1938 : « C’est grâce à Duhamel, dont le nom nous a préservés, que notre tirage n’a pas diminué, même au plus durs moments ».
69 Ni téléphone, ni électricité, ni standard au Mercure de France avant la mort de Vallette. Quant à la publicité, Vallette refuse d’en faire, ce qui lui permet de « rester un des rares endroits où la critique soit totalement indépendante ».
70 Toute l’édition, 16e année, no 418, 30 avril 1938.
71 Paul Léautaud, Journal littéraire, 26 décembre 1938, t. II, p. 2011.
72 Paul Léautaud, Journal littéraire, 27 juillet 1939, t. II, pp. 2098-2099.
73 Paul Léautaud, ibid., p. 2157, mercredi 10 janvier 1940.
74 « Le Goncourt, ça existe encore ? En tout cas, il a bien perdu de son prestige et ne répond plus à grand’chose. Le Goncourt ? Mais c’est l’illustration des errements de notre temps ; il donne la mesure de la confusion présente ; c’est un signe éclatant du désarroi des gens et de la fausseté des choses. C’est une affaire pour l’éditeur qui l’obtient, bien sûr. Ce n’est même que cela : une affaire. Quelle affaire ! Quelles affaires autour ! La littérature n’a plus rien à voir là-dedans. Ici, nous nous désintéressons du Goncourt que nous avons eu l’occasion d’avoir comme d’autres maisons. » in Pascal Fouché, Histoire de l’édition sous l’occupation, t. 1, p. 94.
75 Paul Léautaud, Journal littéraire, 11 février 1938, t. II, p. 1980. Marcello-Fabri est le pseudonyme de Marcel-Louis Faivre, « un homme qui a dépassé la cinquantaine sans s’être fait le moindre nom littéraire ! », selon l’appréciation de P. Léautaud le onze février 1938, p. 1909.
76 Paul Léautaud, Journal littéraire, 11 février 1938, t. II, p. 1909.
77 Jeudi 18 juillet 1935 : « C’est de la littérature de malade, d’épileptique, de taré… C’est une hygiène intellectuelle de s’en tenir éloigné, de ne pas vouloir la connaître. C’est de la littérature de cabanon, bien faite pour les Russes, ces cerveaux malades, faibles, résignés, fatalistes, fuyants. Cette littérature est à fuir, pour un esprit clair, hardi, libre. Non seulement à fuir, mais à détester », in Paul Léautaud, Journal littéraire, choix de pages par P. Pia et M. Guyot, Mercure de France, 1998, p. 560.
78 Sous le pseudonyme de Denis Thevenin, pour Civilisation.
79 Paul Léautaud, Journal littéraire, 4 mai 1938, t. II, p. 1940.
80 Paul Léautaud, Journal littéraire, 4 mars 1938, p. 1909.
81 Vendredi 6 octobre 1939 : « Que Paris est agréable. […] On dirait une ville de province, où les gens restent chez eux. », écrit Paul Léautaud dans son Journal littéraire, t. II., p. 2125.
82 In Toute l’édition, no 490, 17e année, 15 mars 1940.
83 Paul Léautaud, Journal littéraire, 18 septembre 1939, t. II, p. 2118.
84 Ibid., p. 2119.
85 Ibid., p. 2120.
86 Une censure qui interdit les livres qui font appel à la désertion, à l’antimilitarisme ou qui font référence à l’Europe centrale, au Traité de Versailles ou bien encore au bolchevisme présenté sous un jour sympathique. Les réimpressions doivent l’emporter sur les nouveautés.
87 In Toute l’édition, no 481, 17e année, octobre 1939. Enquête de René Groos : « L’Édition française et la guerre ; que vont faire les éditeurs parisiens ? ».
88 Paul Léautaud, Journal littéraire, 3 février 1931, t. II, p. 683 : « La mauvaise opération que je prévoyais devoir résulter, quand Vallette a retiré le Mercure de l’imprimerie Texier à Poitiers, pour en charger l’imprimerie Firmin-Didot, s’est réalisée : […] retards, gaffes, numéros mal brochés, composition défectueuse, nécessité pour nous de nous déranger à chaque instant, tout cela pour coûter au minimum 40 000 francs de plus par an que Poitiers. »
89 Paul Léautaud, Journal littéraire, 11 juin 1940, t. III, p. 73 : « Le téléphone est interrompu. On a bombardé Dreux. On ne sait pas ce qui se passe à l’imprimerie. Le Mercure 1er juillet en panne, probablement. »
90 Paul Léautaud, Journal littéraire, 11 février 1938, t. II, p. 1911. Voir aussi au 8 juin 1938, p. 1952 : « Tout ce qu’on connaît. Tout ce qu’on a cent fois raconté. »
91 Paul Léautaud, Journal littéraire, 6 septembre 1938, t. II, p. 1979 : « Les nouvelles des affaires allemandes-tchéco-slovaques ne sont pas bonnes […]. On craint le pire pour cette semaine. J’ai seize chats, quatre chiens et une guenon. J’ai des papiers auxquels je tiens. J’estime que Fontenay vaudra Paris pour les bombardements par avions. Quel parti aurai-je à prendre ?
92 Profitant du retour des collaborateurs à la revue en fuite : Lucien Descaves de sa propriété de Senonches, Louis Cario de Carcassonne, Georges Bohn de Roscoff, Marcel Boll de Biarritz et Henri Mazel de Nîmes.
93 La première liste Otto vient compléter la liste Bernhard éditée fin août 1940 et regroupant 143 titres interdits. 713 382 livres sont saisis et entreposés au 77, av. de la Grande armée. Une deuxième liste Otto sera diffusée à partir du 24 mars 1942.
94 Paul Léautaud, Journal littéraire, 13 septembre 1940, t. III, p. 169.
95 Apollinaire a collaboré au Mercure de France à partir de 1911 en y publiant des chroniques dans lesquelles il donne souvent l’image d’une Allemagne « délirante ». Ses articles sont publiés dans : Apollinaire G., Œuvres Complètes, édition établie sous la direction de M. Décaudin, t. II, André Ballard et Jacques Lecat, Paris.
96 Paul Léautaud, Journal littéraire, 9 juillet 1940, t. III, p. 123.
97 Paul Léautaud, ibid., 9 juillet 1940, p. 124.
98 Sonderführer à la Propaganda-Staffel jusqu’en 1942, puis rattaché aux services littéraires de l’Ambassade d’Allemagne jusqu’en août 1944.
99 Selon Pascal Ory, in Le Point, no 444, 23 mars 1981.
100 Henri (ou René) Bachelin, écrivain au Mercure et collaborateur au Matin — journal aux tendances hitlériennes —, meurt en septembre 1941 d’une hémorragie cérébrale, à l’âge de 62 ans.
101 Paul Léautaud, Journal littéraire, 19 février 1941, t. III, p. 294.
102 Paul Léautaud, ibid., 5 mars 1941, p. 302.
103 Gerhard Heller, Un Allemand à Paris, 1940-1944, avec le concours de Jean Grand, Seuil, 1981, p. 130-131.

À la gauche de Gerhard Heller nos pouvons reconnaître Drieu la Rochelle
104 Paul Léautaud, Journal littéraire, 27 mars 1941, t. III, p. 314. « N. » désigne Jacques Bernard.
105 Paul Léautaud, ibid., propos de Jacques Bernard rapportés par Paul Léautaud, 7 mars 1941, p. 305.
106 Un rapport qui rend compte du cas de trois maisons : Gallimard, Grasset, le Mercure de France, du 12 au 19 juillet 1941, dans lequel il s’assure de la bonne activité de la NRF depuis qu’elle est présidée par Drieu la Rochelle, et où il se félicite du « parti pris pour la collaboration » de Grasset.
107 Paul Léautaud, Journal littéraire, 5 mars 1941, t. III, p. 302.
108 Paul Léautaud, Journal littéraire, 13 octobre 1939, t. II, p. 2127.
109 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, 23 octobre 1944, p. 1195.
110 Une première liste fut diffusée au mois de septembre 1944 puis annulée. Elle contenait des noms qui ont disparu de la liste définitive, dont Edmond Pilon.
111 Nous tenions simplement à rappeler l’avertissement qui figurait en tête de la première liste Otto : « Désireux de contribuer à la création d’une atmosphère plus saine et dans le souci d’établir les conditions nécessaires à une appréciation plus juste et objective des problèmes européens, les éditeurs français ont décidé de retirer des librairies et de la vente […] les livres qui, par leur esprit mensonger et tendancieux ont systématiquement empoisonné l’opinion publique française ; sont visées en particulier les publications de réfugiés politiques ou d’écrivains juifs qui, trahissant l’hospitalité que la France leur avait accordée, ont sans scrupules, poussé à une guerre dont ils espéraient tirer profit pour leurs buts égoïstes ».
112 « C’est grâce à Duhamel, dont le nom nous a préservés, que notre tirage n’a pas diminué, même aux plus durs moments », in Toute l’édition, no 481, 17e année, octobre 1939.
113 Le message du maréchal Pétain date du 8 octobre 1940.
114 Paul Léautaud, Journal littéraire, 30 juillet 1940, t. III, p. 142. « Sa lettre est parfaite ».
115 « Les vœux de Bernard sont comblés : le voilà maître du Mercure ». Paul Léautaud, cité par É. Silve, Paul Léautaud et le Mercure de France, p. 306.
116 Paul Léautaud, Journal littéraire, 26 janvier 1940, t. II, p. 2166.
117 Paul Léautaud, Journal littéraire, 19 septembre 1939, t. II, p. 2119 : « En rentrant après déjeuner, j’apprends que la résolution de Bernard [fermer définitivement le Mercure] est changée en réduction de 50 % des appointements à partir du 1er octobre ».
118 « J’ai eu grand peur que Bernard laisse la maison fermée et que nous ne touchions plus rien. Mieux vaut être réduit que de ne plus rien avoir du tout », confie Léautaud à Mme Izambart, la concierge, dans son Journal littéraire le trente juillet 1940. t. III, p. 142-143.
119 Un décret qui interdit par ailleurs aux industriels continuant leur commerce de réduire leur personnel dans leurs salaires, et auquel fait référence Paul Léautaud dans Lettres à Marie Dormoy, p. 301, dans sa correspondance du 14 août 1941.
120 Paul Léautaud, Journal littéraire, 17 septembre 1941, t. III, p. 399.
121 « Jeune fille très convenable, nullement à la mode des petites catins actuelles ». Présentation qu’en fait Léautaud dans son Journal littéraire, 12 octobre 1935, t. II, p. 1536.
122 « Il trouve là une bonne raison pour être débarrassé de Mlle Naudy, engagée comme secrétaire par Duhamel et devenue complètement inutile », Paul Léautaud, Journal littéraire, 19 juin 1940, t. III, p. 98.
123 Ibid., 2 août 1940, p. 146.
124 Ibid., cinq mars 1941, p. 302-303.
125 « “Quelle bêtise j’ai faite ce jour-là”, m’a dit un jour Bernard », in Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 98. Note de 2024 : « T. » est Léo Porteret.
126 Journal littéraire au 22 mars 1940.
127 Au Mercure depuis 1929. Bernard n’apprécie pas sa nonchalance.
128 20 septembre 1939.
129 « Il est inadmissible qu’un homme comme moi, attaché au Mercure depuis quarante-cinq ans, soit traité de cette façon », Paul Léautaud, Journal littéraire, 25 septembre 1941, t. III, p. 411.
130 Paul Léautaud avait l’habitude de signer ses chroniques dramatiques sous le nom de Maurice Boissard : « Maurice », le prénom de son frère, « Boissard », le vrai nom de sa marraine Bianca.
131 Paul Léautaud, Journal littéraire, 22 septembre 1941, t. III, p. 406.
132 Paul Léautaud, Journal littéraire, 9 novembre 1929, t II p. 424.
133 Ibid., p. 466. Il leur trouve, le 28 mars 1931, une « beauté singulière. »
134 Sa ménagerie à la mobilisation de 1914 : 38 chats, 22 chiens, 1 chèvre, 1 oie. En 1945, il ne lui reste plus que sa chatte Minette, son fils le Chinois et sa guenon.
135 Paul Léautaud se rend régulièrement sur la tombe de Stendhal, au cimetière Montmartre, « pour le remercier de Lucien Leuwen ».
136 « Je rêve beaucoup en dormant. Quand je me couche, le soir, je me dis souvent : “Mes rêves, donnez-moi ce que la réalité me refuse”, Paul Léautaud, Journal littéraire, 25 mars 1942, t. III, p. 544.
137 Ibid., derniers mots de la longue journée du 11 juin 1940, p. 74.
138 Ibid., trois juin 1940, p. 65.
139 Ibid., 28 août 1941, p. 387.
140 Ibid., 22 juin 1942, p. 628.
141 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 412. Avec cette précision : « [Sur le renvoi du Mercure, aucun autre document.] »
142 Ibid., Lettre au « Fléau » du 4 juin 1941 reproduite dans la journée du 6 juin 1941, p. 351.
143 Paul Léautaud, Journal littéraire, 20 septembre 1939, t. II, p. 2119.
144 Paul Léautaud, Journal littéraire, 13 mars 1941, t. III, p. 310. Dans son bureau du Mercure, Paul Léautaud reçoit la visite de Jean Paulhan, qui a perdu la direction de La NRF depuis juin 1940, mais qui reste en relation avec le nouveau directeur, Drieu la Rochelle.
145 Auxquels il fait allusion dans la lettre invitant Jacques Bernard à comparaître aux Prud’hommes qu’il adresse à son ancien directeur le 8 juillet 1942.
146 Jacques Rodolphe-Rousseau (1893-1973), éditeur en 1920, président du syndicat national des Éditeurs et président du cercle de la librairie, vice-président du Conseil des Prud’hommes de la Seine (de 1932 à 1950). Voir dans la Correspondance générale la lettre que lui écrit Paul Léautaud le seize juillet 1942.
147 L’affaire « Léautaud – Mercure de France » traitée aux Prud’hommes est mentionnée dans Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, pp. 624-664. Nous n’avons malheureusement pas pu consulter les archives des Prud’hommes, les délais autorisant la consultation étant trop longs.
148 Ibid., 9 juin 1942, p. 618. Léautaud surenchérit « Le fait est que s’il s’était mis dehors, ce n’aurait pas été mauvais ».
149 Ibid., 25 août 1942, p. 683.
150 Cette nouvelle stratégie suit la première proposition de Bernard faite à Duhamel de lui racheter 640 actions, ce qu’il refuse catégoriquement.
151 Paul Léautaud, Journal littéraire, 26 décembre 1943, t. III, p. 972.
152 Ibid., 28 décembre 1943, p. 975 : « Vous comprenez, mon cher Léautaud, je représente un Français qui n’accepte pas le tort fait à son pays. »
153 Georges Duhamel, Le Livre de l’amertume, Mercure de France, Paris, 1983, p. 318.
154 Sur les débuts du Mercure devenu société anonyme par actions, voir Claire Lesage, Le Mercure de France de 1890 à 1914, t. II, École nationale des Chartes, 1984, p. 320.
155 André-Ferdinand Herold (1865-1940). Collabore au Mercure depuis 1891. Président de la Ligue des Droits de l’Homme, il devient administrateur du Mercure après la démission de Duhamel et meurt la même année.
156 Paul Léautaud, Journal littéraire, 28 décembre 1943, t. III, p. 975 mais l’action se déroule avant juin 1940.
157 L’entretien entre les deux hommes est rapporté dans Georges Duhamel, Le livre de l’amertume, Mercure de France, 1986, pp. 316-321.
158 « Mais ça, ne dites à personne que je vous l’ai dit », Louis Thomas à Georges Duhamel, ibid., p. 321.
159 L’aryanisation des maisons d’édition consiste à renvoyer les administrateurs juifs de ces maisons et à vendre ensuite les sociétés à des non-juifs ou des aryens. Elles deviennent alors des instruments de propagande capables d’éditer et de diffuser des ouvrages qui soient favorables aux Allemands. Pendant la guerre, les trois principales maisons visées furent Calmann-Lévy, Nathan et Ferenczi.
160 Jean Flory (1903-1961), libraire, puis éditeur à la fin des années 1930. « Aryanisé », Calmann-Lévy pris pour nom Éditions Balzac. La mauvaise volonté la maison face aux pressions allemandes valut à Jean Flory d’être arrêté en mars 1943 et de passer quarante jours à Fresnes.
161 Ernest Renan, cité par Paul Léautaud, dans son Journal littéraire, 5 janvier 1942, t. III, p. 489.
162 Paul Léautaud, Journal littéraire, 2 et 3 mai 1939, t. II, p. 2045-2047.
163 D’après Édith Silve, Paul Léautaud et le Mercure de France, Mercure de France, 1985, dans un chapitre intitulé « Le Mercure sous l’œil des Barbares », page 300.
164 Paul Léautaud, Journal littéraire, 27 octobre 1941, t. III, p. 421_
165 Pendant la guerre, les Allemands ont parachuté leurs hommes costumés pour mieux se fondre dans la population, ce qui fait dire à Léautaud, s’adressant à Bernard : « Mon cher, avec toutes ces histoires de parachutistes, on ne sait plus à qui se fier. Il se peut très bien qu’un matin je me demande si c’est bien vous qui êtes là ou un sosie hitlérien qui a pris votre place », ibid., 24 mai 1940, p. 54.
166 Une série de décrets régit désormais le monde de l’édition : l’un institue une Commission d’étude des livres scolaires qui peut interdire certains ouvrages, l’autre porte sur la création d’un Conseil du livre français chargé de toutes les questions concernant l’orientation intellectuelle à donner à la production des livres, un autre encore précisant l’interdiction de l’édition, de la diffusion et de la vente des imprimés, chants ou poèmes d’inspiration communiste ou anarchiste. Voir in Pascal Fouché, Essai de chronologie de l’édition française contemporaine.1918-1945, Université Paris I, 1984.
167 D’une saisie de livres chez le professeur Vermeil par les Allemands : « Je n’aurais pas cru que I’« occupation » pouvait comporter cela. Somme toute, les Allemands sont les maîtres absolus dans la partie du territoire occupée. On a de la peine à se faire à cela, à ne pas trouver là un “excès” », in Paul Léautaud, Journal littéraire, 2 juillet 1940, t. III, p. 114.
168 Paul Léautaud, Journal littéraire, 3 décembre 1940, t. III, pp. 232-233.
169 Sonderfûhrer à la Propaganda-Staffel. Le 28 novembre 1940, le rapport qu’il présente au service littéraire (Gruppe-Schrifftum) concernant Lieu d’Asile établit ce qui suit : « Un livre de l’ennemi de l’Allemagne, Georges Duhamel, qui avait été imprimé sous la propre responsabilité de l’éditeur, a été confisqué avant même d’être parvenu au public et sera détruit. Ce livre est une nouvelle preuve de l’hostilité à l’Allemagne de l’auteur, qui a d’ailleurs été établie par un entretien de contrôle avec lui. »
170 Paul Léautaud, op. cit., 25 novembre 1940, p. 227.
171 Georges Duhamel, Le Livre de l’amertume, Mercure de France, 1983, p. 292.
172 « Si la civilisation n’est pas dans le cœur de l’homme, eh bien ! elle n’est nulle part ». Georges Duhamel, Civilisation, Mercure de France, 1925, p. 248.
173 Lucien Descaves (1861-1949) : écrivain et journaliste, membre puis président de l’académie Goncourt. L’histoire est rapportée dans Paul Léautaud, Journal littéraire, 18 septembre 1940, t. III, p. 171.
174 Claude Santelli, Georges Duhamel, l’Homme, l’Œuvre, Bordas, Paris, 1947 ; cité dans Georges Duhamel, Le livre de l’amertume, Mercure de France, 1983, p. 292.
175 4 000 participants, selon les organisateurs, qui s’engagent à « n’avoir de cesse et de repos tant que le monde entier ne connaîtra pas la vérité sur le régime sanguinaire » au pouvoir en Allemagne, et à « contribuer de toutes leurs forces à arracher son masque au régime hitlérien ». Éclairer sans brûler, Salon du livre antifasciste de Gardanne, textes réunis par Simone Laroche et édités par Actes Sud, 1997.
176 Sentence qu’il a volontairement tue au procès de Jacques Bernard et qu’il délivre dans Le Livre de l’amertume, p. 316.
177 La scène est rapportée par Paul Léautaud, in Journal littéraire, le 24 juin 1941 t. III, p. 360. Paul Léautaud considère également Bernard responsable et lui reproche de n’être pas intervenu davantage. Le 4 décembre 1940, page 233, il lui suggère le plaidoyer suivant : « Est-ce que Bernard, comme éditeur, n’aurait pas dû expliquer aux Allemands : “Vous reconnaissez que ce n’est pas au nouveau livre de Duhamel que vous en avez. Vous dîtes que c’est à l’homme lui-même. Je n’ai pas à intervenir à ce sujet. Mais je suis éditeur. J’ai fait imprimer ce livre. Les frais d’impression, de brochage, les prix du papier, les frais d’expédition de l’imprimerie de Poitiers à Paris. C’est une perte fort élevée que vous me causez, dans ma situation qui n’est pas déjà brillante. Ai-je à supporter ce résultat de votre rancune pour M. Duhamel ? Ne trouvez-vous pas juste que je sois indemnisé ?” »
178 Jacques Bernard cité par Paul Léautaud le 23 octobre 1940, ibid., p. 198.
179 Ibid., 10 juillet 1942, p. 650.
180 Georges Duhamel, Le Livre de l’amertume, Mercure de France, 1983, p. 294.
181 Mallarmé, voulant dénoncer les méfaits de la prose sur la poésie, avait déclaré : « On a touché au vers ».
Acte II : L’intoxication
Chapitre cinq : Les nouvelles ailes du Mercure : le « Mercure d’extrême droite »
Le « Mercure d’extrême droite » est une expression de Georges Duhamel182 qu’il applique à l’origine à la revue mais qui peut tout aussi bien s’étendre à l’ensemble de la maison d’édition. Les services de propagande allemands en ont fait un refuge de l’antisémitisme, de l’anglophobie et de l’antibolchevisme, une maison qui répand clairement dans les ouvrages qu’elle publie l’idée d’un sentiment national à préserver en vertu d’une race déterminée. Le Mercure ne se ressemble plus et se charge de nouvelles ailes qui l’éloignent toujours plus de l’esprit de liberté revendiqué par Vallette et Duhamel, les deux anciens directeurs, et qui le rattachent bientôt à un groupement politique et à une puissance financière dont le Mercure n’a jamais voulu depuis sa création183.
Nous verrons pourquoi la disparition de la revue peut être rendue responsable de la métamorphose du Mercure de France et si elle est à l’origine du nouvel esprit qui hante le 26, rue de Condé, à partir de 1940. Mais nous tenons avant tout à étudier plus en détail le catalogue de la maison d’édition pour mieux comprendre la nouvelle orientation éditoriale que Jacques Bernard donne au Mercure dans les années d’occupation.
Un nouveau catalogue
Deux présentations du catalogue des éditions du Mercure sont mises en annexe, l’une proposant une liste des auteurs classés par ordre alphabétique, l’autre une liste des titres de livre classés par année. C’est cette dernière version que nous allons privilégier pour commenter et interpréter les choix éditoriaux de Jacques Bernard pendant la collaboration.
Si nous n’avons pas pu avoir accès au registre des ventes et aux indications chiffrées précisant le nombre d’exemplaires publiés de chaque ouvrage (ce qui réduit fortement, malheureusement, notre champ d’étude), nous pouvons prétendre de la bonne activité du Mercure pendant toute la durée de la guerre, ainsi que de l’édition en général. À ce titre, les témoignages de Paul Léautaud et de Louis Thomas convergent parfaitement. L’auteur de Passe-Temps remarque que pendant l’année 1941, « on vend au Mercure les livres par ballots, comme chez tous les éditeurs184 » et se réjouit des « affaires que font tous les éditeurs185 » l’année suivante. Le 18 mai 1943, il note dans son Journal : « Passé tantôt au Mercure. Il n’y a plus de Poètes d’aujourd’hui, qu’on ne cesse de vendre. On va réimprimer. La librairie marche bien186 ». L’année 1944 semble s’annoncer sous les mêmes auspices : « En ce moment, tout se vend. Vous pouvez éditer n’importe quoi. Au bout de quinze jours il n’y en a plus. On n’a même pas besoin de mettre en vente. Des courtiers enlèvent les livres par ballots pour la province187 », déclare Louis Thomas, apparemment peu consciencieux, à la fin de l’année 1943.
Jacques Bernard n’a donc pas trop à se plaindre de l’état des ventes de livres depuis les débuts de sa collaboration. L’argent rentre dans les caisses du Mercure mais la littérature en sort, ce qui préoccupe peu le directeur des éditions comme nous avons déjà eu l’occasion de nous en rendre compte. Peu importe, du moment qu’il obtient les autorisations du Comité d’organisation du Livre188 de publier les titres susceptibles de bien se vendre, et ne desservant ni le prestige ni les intérêts allemands.
« [Bernard] m’a aussi parlé de ses projets d’édition, qui ne me paraissent pas brillants189 ! »
Paul Léautaud fustige les choix éditoriaux de son ancien directeur et dénonce la nouvelle « littérature alimentaire190 », bien trop souvent rudimentaire, du Mercure. Mais les Allemands n’offrent guère plus d’une alternative à Jacques Bernard : il édite ce qu’on lui dit être bon d’éditer, sinon la totalité de la production ira au pilon et la maison aura perdu beaucoup d’argent, le papier étant devenu rare, donc cher. Jacques Bernard doit se mettre au service de l’Allemagne s’il veut éviter la faillite ; il ira parfois jusqu’à anticiper les exigences allemandes en matière de production littéraire.
Et pour mieux comprendre la production littéraire du Mercure de France de 1939 à 1945, nous avons fait une typologie des ouvrages publiés au cours de cette période. Trois grands axes ressortent de cette tentative de classification : les titres servant les intérêts hitlériens ou favorables à l’Allemagne en général, les ouvrages allant dans le sens de la Révolution nationale proposée par Vichy et les livres d’auteurs fidèles au Mercure de France, les « classiques » pourrait-on dire, ceux qui restent présents dans le catalogue quelle que soit la conjoncture politique de la France (ce dernier axe sera développé dans la dernière partie de notre mémoire).
Nous avons déjà remarqué que certains des titres du Mercure, figurant sur les listes Otto, ont disparu du catalogue, frappés d’interdiction par les autorités allemandes. C’est le cas de Hirsch191, qui, parce qu’il est juif, ne peut désormais plus paraître aux éditions du Mercure. Mais si certains livres sont interdits, d’autres sont au contraire encouragés par les Allemands et une liste globale de la littérature à promouvoir (dite aussi Gesamliste des foederswerten Schrifftums) est éditée par les services de la propagande allemande à la fin de l’année 1942, augmentée en mars 1944. Sur ces listes figurent trois auteurs du Mercure sur lesquels les Allemands comptent pour qu’ils orientent et éclairent l’opinion française : A. Piola Caselli, considéré comme étant anti-américain, Fritz R. Van der Pyji (dit Vanderpyl, classé dans la rubrique Antijuedisches Schrifftum : écrivain anti-juif) et Joseph-Marie Rouault, pour son livre intitulé La troisième République vue par le comte de Gobineau.
Piola Caselli est remarqué en 1942 pour son livre : Conflit dans le Pacifique, dont l’avant-propos nous dit que l’auteur « montre le déclin anglo-saxon et l’inexorable expansion japonaise » au cours de la guerre du Pacifique. La stratégie du Mercure de France — qui signe cet avant-propos — est de nous présenter l’ouvrage comme un essai sérieux et l’auteur comme un parfait connaisseur de son sujet192, ce qui doit donner d’autant plus de valeur et de crédibilité à son livre. Un livre de propagande dans la mesure où, l’avant-propos le dit lui-même, « l’auteur ne porte pas les anglo-saxons dans son cœur » et « ne cache pas sa sympathie pour le Japon dont il a suivi, des années durant, avec un intérêt passionné, la patiente ascension et où il compte de nombreux amis. » Pour s’en convaincre définitivement, nous pouvons voir au dos de la couverture du livre la photographie de l’auteur en habit traditionnel, ce qui illustre sans doute la vraisemblance de ce qu’il écrit.
Vanderpyl est un cas un peu plus particulier. Il figure bien sur la liste des ouvrages à promouvoir pour son livre : L’art sans patrie, un mensonge193 (il est aussi inscrit sur la liste des écrivains « pestiférés » dressée par le CNE en 1944). D’autre part, Paul Léautaud nous révèle dans son Journal que Fritz Vanderpyl (ancien collaborateur à la revue) est juif194, et que dès le mois de mai 1940, Jacques Bernard décide d’envoyer au pilon toutes ses publications, ce qui semble contredire une éventuelle promotion de l’ouvrage par les Allemands.
Joseph-Marie Rouault, quant à lui, participe bien à la propagande nazie en publiant un livre sur le comte de Gobineau. Ce dernier, né un 14 juillet 1816, était passionné par l’Allemagne depuis qu’il y effectua son premier voyage en 1828. Dans son Essai sur l’inégalité des races humaines, il accorde un rôle prééminent à la race aryenne et se déclare adepte d’un gouvernement fort pour assurer la sécurité d’un peuple trop porté selon lui à encourager tous les désordres. La hiérarchie qu’il établit entre les races a servi de thèse originelle aux théoriciens du pangermanisme. Il est souvent considéré comme étant « l’inventeur du racisme » et ne peut que plaider en faveur de l’idéologie hitlérienne195.
Louis Thomas, d’ailleurs, reprend la figure du comte de Gobineau dans un livre196 qu’il publie au Mercure de France en 1941 dans la collection « Les Précurseurs ». Louis Thomas avait déjà signé pour le Mercure un autre livre de la même collection197 consacré à Alphonse Toussenel198, dont la couverture nous dit sans fausse pudeur qu’il est « socialiste national et antisémite ». Dans la préface de son livre sur Gobineau, il revient sur les raisons qui l’ont poussé à écrire un tel ouvrage : « Si c’est un Français qui a inventé l’idée, la théorie raciste, cette vue de l’esprit, n’est pas un phantasme strictement allemand et nazi, ainsi que le prétendaient les juifs installés à Paris : c’est, au contraire, une idée française. Il n’y a donc aucun crime contre notre patrie à professer des théories racistes : ces idées sont, avant tout, françaises, ayant été émises par un Français de cœur et d’esprit très nobles. » L’auteur de Nancy-Münster199, officier pendant la Première Guerre mondiale et fait prisonnier dans un camp de regroupement près de Nancy le 22 juin 1940, est donc un fervent défenseur des idées hitlériennes et fait savoir dans ses écrits qu’il collabore librement pendant l’occupation, étant lui-même partisan d’une nouvelle Europe. Germanophile, il est soutenu par Jacques Bernard qui publie plusieurs de ses livres au Mercure de France pendant la guerre : en 1943, l’ancien directeur de Calmann-Lévy fait paraître un ouvrage sur Fréderic le Play200, et l’année suivante, il propose Soixante questions pour donner à réfléchir aux Français. Jusqu’à ce qu’il tente de prendre le contrôle du Mercure et se désengage de Bernard en avril 1944.
Parmi les auteurs germanophiles œuvrant pour la propagande allemande et publiés au Mercure, nous pouvons retenir Jean Jacoby201, Léon de Poncins et Christian de Carbon (déjà présents sur le catalogue de la maison d’édition en 1939) mais aussi Jean de Beaulieu et André Dinar. Tous ont en commun une appartenance aux idées d’extrême droite et un antisémitisme jamais dissimulé, dans les livres de Léon de Poncins notamment : Israël, destructeur d’Empires (1942) et Les Forces occultes dans le monde moderne (1943).
La liste des écrivains reconnus coupables d’avoir collaboré pendant la guerre recense d’autres auteurs publiés au Mercure et jugés d’indignité nationale : Édouard Dujardin202, Alphonse Séché et Edmond Pilon203 sont inscrits aux côtés de Jacoby, Vanderpyl et Louis Thomas.
Sur 156 titres édités de 1939 à 1944 au Mercure de France (rappelons que notre dénombrement est sans doute incomplet), 27 sont attribués à ces écrivains d’« extrême droite », ce qui représente près du cinquième de la production littéraire de la maison. Mais d’autres types de publications viennent, comme nous allons le voir, alourdir ce compte, et nous sommes tentés de croire qu’il existe bel et bien, au 26, rue de Condé, une littérature de la collaboration.
De nouvelles icônes
L’idée d’une littérature de la collaboration fait apparaître un nouveau genre de références dans les ouvrages publiés par le Mercure de France, directement importées d’Allemagne et inspirées également par la Révolution nationale du maréchal Pétain. Le Mercure célèbre l’avènement d’un dieu nouveau et lui consacre de nouveaux rites204, de nouvelles icônes. Les maîtres et les dieux de la vie littéraire ont changé et réclament un tout autre nectar.
Le Mercure de France, si l’on se réfère à ce qu’il publie de 1940 à 1944, se met, nous l’avons vu, au service de l’Allemagne, mais se dévoue aussi à la pensée allemande dont la force et la puissance, en ces temps de supériorité raciale, sont symbolisés par Wagner et Nietzsche, tous deux antisémites (et lecteurs, paraît-il, de Gobineau).
Richard Wagner a toujours inspiré, en mal205 ou en bien, les écrivains du Mercure et les collaborateurs à la revue, son œuvre étant jusqu’alors au centre de toutes les critiques. Pendant la guerre, les Allemands, relayés par Jacques Bernard, en font un instrument de propagande nazi, destiné à fortifier la « noble alliance206 », comme l’écrivait le compositeur, entre la France et l’Allemagne. En 1941 paraît Quatre poèmes d’opéras, traduit de l’allemand, et, deux ans plus tard, le Mercure publie ses Vues sur la France, suivies d’hommages et de deux conférences sur Wagner et la France. La même année sont réédités les souvenirs de Judith Gautier, Auprès de Richard Wagner, qui fut l’une des premières, en France, à le découvrir, l’ayant vu à plusieurs reprises auprès de son père, Théophile Gautier. Wagner, génial et antisémite207, devient pendant la guerre le faire-valoir du régime de Hitler : une exposition lui est d’ailleurs consacrée à Meudon, organisée par Charles Léger et à laquelle se rend l’ambassadeur Abetz208 et de nombreux officiers allemands209.
Friedrich Nietzsche est lui aussi instrumentalisé par la propagande nazie et largement publié par le Mercure pendant les années d’occupation : Ainsi parlait Zarathoustra est réédité en 1942 et 1944, et l’on compte sur le catalogue quatre publications du philosophe pour la seule année 1943, auxquelles s’ajoute l’étude de Denis de Keredern, Bréviaire nietzschéen. Le Mercure de France d’Alfred Vallette avait déjà contribué au grandissement de Nietzsche en France, grâce, notamment, aux traductions de Henri Albert210. Mais à partir de 1940, c’est du mythe du surhomme dont s’empare la maison d’édition, facile à détourner en faveur de l’occupant nazi.
Les nouvelles icônes du Mercure font donc l’apologie de l’Allemagne hitlérienne mais renforcent aussi l’idée d’un resserrement national autour des valeurs pétainistes (« famille, terre, hiérarchies naturelles »). Au Mercure de France, le Dr René Martial flatte la race française dans les trois livres qu’il publie en 1939 et en 1943. Dans La Race française, il propose de « montrer […] avec des moyens nouveaux comment le peuple français s’est formé et pourquoi il n’est pas déplacé, même au vingtième siècle, de parler de race ». Chargé de cours d’immigration à l’Institut d’hygiène de la Faculté de médecine de Paris et professeur du cours libre d’anthropobiologie des races, il nous donne d’abord l’impression de vouloir aborder le sujet avec toutes les précautions qu’il impose. Mais dans son avant-propos, il ne tarde pas à analyser la race sous un angle purement passionnel en intégrant dans son étude des éléments politiques d’une crédibilité et surtout d’une objectivité douteuse : « Il n’est pas inutile, il est même nécessaire, de montrer en outre aux Français qu’ils peuvent être aussi fiers de leur race que quiconque et que la position d’humilité morale que leur a donnée notre politique étrangère depuis 1870, confirmée à partir de 1919, est aussi injuste que néfaste.
« Qu’un peuple ne cherche pas à en dominer un autre, passe encore, mais qu’il coure lui-même au-devant de la sujétion en diminuant sa valeur, en masquant ses qualités, en exposant ses défauts, en n’apportant pas dans sa vie extérieure toute la vigueur dont il est capable, en laissant les faibles et les incompétents parler pour lui, c’est trop, et c’est trop dangereux, cela confine à l’abdication, au suicide moral de la nation, du peuple. La nation, le peuple, la race française valent mieux que cela. Ce livre le leur rappellera211 ».
L’étude du Dr Martial ne se limite donc pas aux « Esquimaux » et aux « Peaux-Rouges » ; elle appelle au redressement de la France, à l’affirmation d’une puissance française capable de « s’affranchir notamment de la tutelle anglo-saxonne ». Cette étude sur la race212 est donc moins un travail à visée scientifique qu’un simple ouvrage de propagande orienté contre l’Angleterre et qui a du mal à dissimuler un net parti pris antisémite.
L’Angleterre, qui résiste aux bombardements et continue la guerre aux côtés des Américains, devient l’ennemi principal de Hitler et un fort courant anglophobe se répand dès lors dans les couloirs de la maison d’édition de la rue de Condé, rangée du côté allemand. Seul Paul Léautaud voudrait croire à une victoire de l’Angleterre213. Car la nouvelle icône du Mercure, c’est Jeanne d’Arc, sainte Jeanne qui, un 8 mai 1429, délivra Orléans des Anglais mais qu’ils brûlèrent à Rouen deux ans plus tard. Elle figure en effet dans de nombreux essais édités par le Mercure de France, et en particulier dans Les Autels de la peur d’Edmond Pilon, qui lui donne l’occasion d’être d’actualité plus de cinq cents ans après sa mort : « Cette animation vindicative, cette haine que les Anglais nourrissaient voilà cinq cents années contre Jeanne, c’est maintenant contre nos cités et nos ports sans défense qu’ils en exercent la fureur. » Et Edmond Pilon, à peine remis de l’épisode de Mers-el-kébir, d’ajouter à l’adresse des « gens de Londres » : « La France, prévenue, pas plus que Jeanne dans son cachot de Rouen, ne cédera aux violences et ne pliera sous vos coups214 ! » Le Mercure fait donc campagne contre les Anglais tout en tirant sa fortune d’un écrivain anglais, Rudyard Kipling215, et de son Livre de la jungle. Dans une enquête de Hubert Forestier216 pour Les Cahiers du livre, Jacques Bernard révèle d’ailleurs que si les Allemands le retiraient des ventes du Mercure, il « n’aurait plus qu’à fermer ».
Le Mercure semble sacrifier toute sa littérature à la propagande nazie : contre l’Anglais, le Russe et le juif (Gustave Kahn, juif, est publié pour la dernière fois en 1939), la maison d’édition donne désormais son nom aux ouvrages qui vont dans le sens de la collaboration et de la victoire allemande, et qui stimulent l’esprit national… national socialiste : en 1941, Henri Bachelin publie un livre sur Proudhon217, que nous n’avons pas pu consulter mais qui doit rappeler la position du philosophe sur le statut des Juifs en France. Citons, à titre indicatif, ce qu’il écrivit dans ses Carnets en décembre 1847 « Juifs. Faire un article contre cette race, qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple. Demander son expulsion de France, à l’exception des individus mariés avec des françaises ; abolir les synagogues, ne les admettre à aucun emploi, poursuivre enfin l’abolition de ce culte. Ce n’est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le juif est l’ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l’exterminer… Par le fer ou par le feu, ou par l’expulsion, il faut que le juif disparaisse… Tolérer les vieillards qui n’engendrent plus. Travail à faire. Ce que les peuples du Moyen-Âge haïssaient d’instinct, je le hais avec réflexion et irrévocablement. La haine du juif comme de l’Anglais doit être notre premier article de foi politique. » Bernard s’explique en partie sur cette publication en confiant à Léautaud qu’il l’avait d’abord commandée à Louis Thomas, dont il avait apprécié les précédents livres sur Gobineau et Toussenel. Mais Bachelin, un jour, s’est interposé : « Il s’est mis à pleurer. […] Voir pleurer Bachelin !… Je lui ai donné le Proudhon. C’est très mauvais. C’est sans aucun intérêt218 ».
Nous pouvons donc lire en grande partie, dans la politique éditoriale de Jacques Bernard, la conversion du directeur du Mercure de France à l’idéologie nazie. Mais le catalogue du Mercure ne nous permet pas de connaître les projets, jamais réalisés, de Bernard, qui ne cache plus son admiration pour Hitler et ne craint pas l’intoxication de sa maison d’édition.
Éditer Mein Kampf

La première édition française de Mein Kampf, en 1934
Le Mercure de France, comme René Julliard, Denoël ou Bernard Grasset, collabore et n’hésite pas à se mettre au service de l’Allemagne mais ses propositions tendent de plus en plus vers un collaborationnisme avoué. Jacques Bernard envisage dès le 9 juillet 1940 une édition à bon marché de la partie biographique de Mein Kampf « pour montrer les origines, le développement du grand homme219 ». Bernard écrit à ce propos aux autorités allemandes et projette déjà une préface signée par Hitler lui-même. C’est la Kommandantur220 qui fournit les autorisations de publier une traduction du livre du Führer et les refus sont fréquents. En mars 1934, Hitler avait fait saisir221 le livre en France, traduit contre son gré et sans son autorisation. Il se méfie depuis des traductions de son Combat222 que les éditeurs pourraient proposer aux Français. Bernard sait déjà qu’une telle publication représente un enjeu considérable pour le Mercure à cette époque. Mein Kampf est en effet un très gros succès éditorial : dans les pays envahis, « la lecture de la Bible nationale-socialiste est désormais obligatoire223 », et un million d’exemplaires a été vendu en Autriche depuis l’Anschluss. Dans un article paru dans Toute l’édition en 1939, Mein Kampf est « le livre le plus lu au XXe siècle » et tend à devenir « le best-seller » de l’époque. Jacques Bernard peut donc mesurer le profit qu’il pourrait tirer d’un livre comme celui-ci et se donne pour mission de le diffuser aussi largement que possible, en espérant qu’on lui en donne la permission. Brian-Chaninov224, un des auteurs du Mercure, se dit d’ailleurs prêt à envoyer son dernier ouvrage à Hitler et à son entourage (Goering, Ribbentrop et Goebbels) pour qu’ils puissent mieux juger de la soumission du Mercure aux idées hitlériennes et décider de lui confier la traduction de l’ouvrage tant désiré. Vain effort ; le Mercure de France ne reçoit aucune réponse de la Kommandantur mais affirme toujours plus clairement sa volonté de répandre grâce aux livres une pensée nouvelle garantissant pour l’avenir un nouvel ordre mondial.
Pour Bernard, cette nouvelle orientation éditoriale ne vient pas compromettre la littérature du Mercure, jamais oubliée et toujours vivante. Il en parle à Hubert Forestier venu l’interroger en 1941 au 26, rue de Condé : « La Littérature est ici », déclare-t-il avant de développer : « […] ce qui nous anime ce n’est pas tant le souci d’une vente, qui est souvent fonction d’une réclame tapageuse, que la qualité de l’œuvre. Et c’est peut-être pourquoi nous ne connaissons la jalousie de personne. »
Si le directeur du Mercure de France ne fait pas de jaloux dans le monde de l’édition, il se fait pourtant des ennemis qui s’inquiètent de la forme et du contenu de son catalogue. En 1941, un comité des éditeurs de littérature, composé de Grasset, Gallimard, Albin Michel, Stock et Fayard se réunit dans le but de ranimer la publication d’ouvrages littéraires, mais Bernard n’est pas invité à en faire partie. Pour la majorité des éditeurs parisiens, le Mercure de France s’est perdu en décidant d’adopter un tel comportement avec l’occupant. La littérature n’est plus comprise dans l’appréciation qu’ils font de la maison d’édition. Seules comptent l’attitude de Jacques Bernard et la folie qui le caractérise depuis son accident : « J’ai aussi parlé à Gallimard de Bernard, sur lequel on commence à se demander dans le monde des éditeurs quel individu il est225 ». Le Mercure de France, en crise, doit donc seul assumer son nouveau parti pris et défendre sa nouvelle conception de la littérature.
Jacques Bernard ne trompe plus personne et nous allons voir que le sort de la maison, intoxiquée par un nouveau courant d’idées nazies, change considérablement, en mal, quand disparaît la revue du Mercure au mois de juin 1940. Le glas sonne alors pour l’ancienne maison d’Alfred Vallette226.
Chapitre six : La fin de la revue
« Faire paraître, fut-ce avec des retards, un numéro de revue, cela n’a l’air que d’une opération de bibliophile ; c’est une manière de victoire contre les puissances de mort227 ».
Le dernier numéro du Mercure paraît le 1er juin 1940. C’est la deuxième fois que le Mercure est obligé de s’interrompre, mais il faudra cette fois attendre la fin de la guerre pour que la revue retrouve ses lecteurs et ses abonnés228. En 1940, cette disparition est un événement qui nous renseigne sur la crise que traverse le Mercure et sur l’état de sa maladie. Georges Duhamel, en 1937, avait déjà prédit : « La disparition d’une revue, à l’heure actuelle, serait un malheur pour l’intelligence menacée dans son exercice et dans ses truchements. Il n’est plus question d’école, d’ailleurs il n’y a plus d’école. Il n’y a plus qu’une seule cause, celle de l’esprit libre qui garde ses trésors et défend ses positions. » Il engageait la revue et ses collaborateurs à « persévérer, pour le bien et le salut des lettres » et à « engager le combat pour lequel [ils étaient] armés] ». Jacques Bernard n’envisage pas le combat des lettres sous le même angle et s’il s’arme, c’est contre son camp, défenseur de la pensée unique et peu conscient du trésor que représentait jusqu’alors la revue dans ce qu’elle offrait d’éclectique et d’insolent, exigeant seulement une parfaite liberté d’expression. Le Mercure s’arrête donc au numéro 998 et reparaît le 1er décembre 1946 sous le numéro 999-1000. C’est alors, pour la revue, l’exemplaire de la consécration, un titre de noblesse, et ce millième numéro doit montrer que le Mercure continue à la Libération. Les six années qui séparent les deux tirages vont nous dire à quel prix.
« Bernard va mettre le Mercure mensuel229 ».
La revue du Mercure de France, passés les débuts de la guerre et la mobilisation, devient mensuelle à partir du 1er octobre 1939. Jacques Bernard, au cours d’un entretien avec un journaliste de Toute l’édition, s’explique : « Qui pouvait lire, en quinze jours, ses 256 pages compactes ? En le publiant mensuellement, nous ferons d’ailleurs passer le nombre de pages à 288 — ce qui nous permettra de développer encore davantage cette « revue de la quinzaine » (devenue alors « revue du mois ») qui est un phénomène unique dans la presse, et que je voudrais voir traduire de plus en plus dans la vie générale de notre temps230 » Bernard veut donc privilégier le confort de lecture et recentrer la revue sur sa deuxième partie « critique », dite aussi « revue de la quinzaine », la plus importante dans la mesure où c’est elle qui, en publiant les chroniques de ses collaborateurs, reflète toutes les activités spirituelles de l’époque et lui vaut son nom de revue (la première partie, anthologique, publiant des extraits de poèmes, d’essais, de romans ou de nouvelles lui donne plus des allures de recueil). La « Revue de la quinzaine » traite de sujets aussi nombreux que variés, étudie les courants littéraires de chaque pays (lettres russes, danoises, portugaises, hongroises, néo-grecques…) mais s’intéresse aussi à l’histoire, au folklore, à l’hagiographie, au théâtre ou au cinéma. Bernard sait en outre que la guerre va sûrement provoquer une diminution des abonnements en France et à l’étranger, et qu’il ne pourra plus assumer les frais d’une revue bimensuelle. Même si le Mercure augmente son nombre de pages, la mensualisation de la revue est enfin un moyen d’économiser du papier (dont la fabrication et la consommation sont réduites à partir du 15 mai 1940) et de l’argent, les rédacteurs étant deux fois moins payés qu’avant.
Tout cela ne justifie cependant pas totalement la décision de Jacques Bernard, qui, dès le mois de mai 1938, pense déjà à réorganiser la revue d’Alfred Vallette « Une découverte qu’il a faite et dont il m’a fait part il y a deux jours, c’est de mettre le Mercure mensuel. Je lui ai dit : « Faites attention. Vous êtes très changeant. Laissez passer un peu de temps, que les réflexions vous viennent, que l’inconscient travaille. Une revue qui est bimensuelle depuis plus de quarante ans, la mettre mensuelle ? Vous risquez de lui porter un tort considérable231 ». Nous pouvons nous demander si Bernard ne cherche pas justement à « porter un tort » au Mercure quand il devient directeur de la maison d’édition et de la revue, ou, pour le dire autrement, s’il ne veut pas faire du Mercure une revue plus à son image et rompre de ce fait avec la revue de Vallette et de Duhamel. Car mettre le Mercure mensuel n’est pas un petit changement mais bel et bien un grand bouleversement au 26, rue de Condé. La périodicité de la revue a son importance et prend sens dans l’image que son directeur veut donner d’elle. Par exemple, en proposant deux numéros du Mercure par mois, Vallette voulait « combler les vides d’une presse d’où l’omnipotente réclame et l’actualité ont chassé tout le reste232 », recentrer la revue sur ce qu’elle offre de typiquement littéraire en en confiant la rédaction à des « esprits libres ».
Jacques Bernard veut-il « développer », comme il le prétend, la revue, ou la transformer ? La guerre va visiblement lui donner l’occasion de la changer complètement et de faire du Mercure une nouvelle revue plus proche de ses sensibilités — non littéraires. Quand Hirsch tombe malade, Bernard doit trouver quelqu’un pour le remplacer à la rubrique des Revues. Il pense alors à Henri Bachelin. Léautaud ne voit pas cette nouvelle désignation d’un très bon œil, et se risque à lui dire que choisir Achille Ouy233, dont les notes de lecture sont réputées, serait sans doute plus indiqué : « Je voudrais surtout ne pas prendre un homme de lettres. Je veux surtout, aussi, un nationaliste. Je ne veux pas du tout un homme du clan d’Herold234 », lui répond Bernard. Bachelin reste donc le meilleur choix que Bernard pouvait faire : ce n’est pas un littéraire, comme le pensait déjà Vallette235, et il collabore en 1940 au Matin, un journal aux tendances hitlériennes. Jacques Bernard veut donc donner un nouvel esprit à la revue (rappelons qu’il renvoie les plus anciens rédacteurs du Mercure, comme Jules de Gaultier ou Paul Léautaud), et la rattacher au mouvement d’opinion partagé par certains Français collaborateurs pendant la guerre. Jacques Bernard ne pense pas à la disparition de la revue et se dit au contraire, une fois la guerre perdue pour la France, qu’elle pourrait servir de support pour la propagande allemande, à l’inverse de ses concurrentes Confluences, Fontaine ou Poésies (à laquelle collabore Georges Duhamel) qui deviennent les symboles de la résistance littéraire.
Requiem pour une revue.
Jacques Bernard croit à la reparution prochaine de la revue tout au long de l’occupation, mais en vain. Le « cyclone de l’automne 1939(236) » s’abat sur elle comme sur cent cinquante autres revues qui disparaissent entre septembre 1939 et juin 1940. L’armistice et l’occupation allemande n’y sont pour rien ; ces revues sont touchées dès 1939 par la mobilisation, le désordre de la circulation des hommes, des choses et des idées (un certain nombre des collaborateurs au Mercure ont rejoint l’exode), les dégâts causés par les bombardements sur les imprimeries (l’imprimerie Firmin Didot qui se charge de la revue ne donne plus de nouvelles depuis les bombardements sur Dreux) et, bien sûr, la pénurie de papier237. Le Mercure survit jusqu’en juin 1940 mais doit encore affronter les deux obstacles que sont l’autorisation préalable (le décret-loi du 24 mai 1940 soumet à autorisation préalable les journaux et les périodiques et les contraint à une réduction de moitié du poids, par la réduction du format, de la pagination ou de la périodicité) et l’attribution du papier.
Jacques Bernard ne se rend pas facilement à la décision des autorités allemandes d’interrompre sa revue. Le numéro qui devait paraître le 1er juillet 1940 est déjà prêt. Il décide donc d’aller au-devant de la censure allemande en allant régulièrement, depuis le 20 juillet, dans les locaux de la Kommandantur pour demander une autorisation de reparaître. Il écrit deux lettres aussi qui restent sans réponse. Paul Léautaud, dans son Journal littéraire, hasarde une explication : « Bernard n’a toujours pas de réponse de la Kommandantur pour la réapparition du Mercure. Je me demande si, avec son nom, et même son physique, un peu, on ne l’a pas pris pour un juif238. » Plus sérieusement, il semblerait que le refus des Allemands ait été déterminé par ce qu’a publié le Mercure pendant et après la Première Guerre mondiale. Ils n’ont certainement pas oublié en effet les vues de Guillaume Apollinaire sur l’Allemagne « Je pense partir pour le front vers février. Je suis heureux au possible qu’on m’ait trouvé digne d’être soldat dans cette bagarre titanique et je ne céderais pas ma place pour un empire, surtout celui d’Allemagne239. ») ou la série anonyme sur l’Allemagne publiée dans la revue à partir de 1934(240), et ce malgré les opinions toujours réaffirmées du nouveau directeur du Mercure en faveur de l’Allemagne nazie. Bernard sait également que la revue est malheureusement un des seuls moyens de faire de la publicité pour sa maison d’édition, et redoute, si la revue disparaît, une diminution trop importante des ventes de ses livres.
Paul Léautaud est particulièrement concerné par la fin de la revue, lui qui venait d’y faire paraître les premières pages de son Journal littéraire, jamais encore édité. Le 25 novembre 1939, il s’était entendu avec Bernard sur la prochaine publication de son journal dans chaque numéro de la revue (devenue mensuelle) pendant un an, ce qui devait le mener jusqu’en 1910. Au mois d’avril 1940, Léautaud se réjouit : « Il y a quelques abonnements pour le Journal littéraire. Excellent effet sur Bernard241 », avant qu’il ne se désillusionne : malgré les nouveaux abonnements, le Mercure est obligé de s’interrompre : « tout de même choisi un fichu moment pour publier mon journal242 ».
Léautaud, donc, ayant intérêt à ce que la revue se maintienne, donne à Bernard des conseils pour qu’il s’y prenne autrement. Il doit, suivant l’exemple de Drieu la Rochelle243, s’adresser à l’ambassadeur Abetz et non aux autorités militaires comme il le faisait jusqu’à présent. L’espoir renaît mais avec lui se précise l’orientation propagandiste privilégiée par Bernard si le Mercure venait à reparaître : « J’ai ensuite abordé la question de mon Journal. Quand le Mercure reparaîtra, pourrai-je y continuer sa publication ? Réponse : « Oui » —, avec cette réserve effarante : à condition qu’il n’y ait pas un mot offensant ni maladroit à l’égard des Allemands244 ». Mais les difficultés persistent. Bernard ne parvient pas à s’entendre avec Abetz. Il se dirige alors vers le lieutenant Heller qu’il connaît bien et qu’il invite régulièrement à déjeuner chez lui. Il lui propose de faire reparaître la revue en s’alliant avec lui, mais Heller refuse la co-direction du Mercure.
La disparition de la revue peut surprendre si l’on pense au service qu’elle aurait pu rendre aux Allemands. Elle reste une énigme pour l’historien qui recherche les raisons d’un tel refus provenant des autorités allemandes. Pascal Fouché245 lit dans les demandes répétées et insistantes de Bernard une des raisons qui ont conduit à l’arrêt définitif de sa parution. La Propaganda, voulant pénétrer la culture française en douceur, se serait méfiée de ce « germanophile extrémiste ».
La préparation du no 999-1000.
Jacques Bernard n’arrivera jamais, malgré ses sympathies pro-allemandes, à obtenir l’autorisation de publier ne serait-ce que le no 1 000 du Mercure, qu’il annonçait pourtant à cor et à cri comme le grand bilan d’« un demi-siècle de littérature ». La parution de ce numéro était prévue depuis longtemps et pensée à l’origine comme étant un hommage à rendre à Alfred Vallette, un retour à la vieille tradition littéraire du Mercure. Le no 1 000 devait comporter trois parties : la première consacrée aux fondateurs, la deuxième à tous ceux qui leur ont succédé (les collaborateurs de 1895 à 1940), et la dernière, enfin, réservée aux collaborateurs mobilisés et prisonniers. Le tout formant « un véritable monument littéraire à la gloire de la vieille maison246 ». Jacques Bernard, depuis qu’il est arrivé à la tête du Mercure de France, réfléchit à l’élaboration de ce numéro spécial. Le 30 novembre 1938(247), il prévoit déjà la sortie du millième numéro du Mercure pour le 1er février 1940 (la date anniversaire des cinquante ans de la revue) et mobilise auteurs et collaborateurs pour qu’ils préparent des articles sur les années Vallette. En 1942(248), tout semble prêt. Il ne lui reste plus qu’à résoudre un problème de papier : Jacques Bernard veut y intégrer le n°999 jamais paru, ce qui offrirait un volume assez considérable d’un millier de pages formant l’anthologie des auteurs du Mercure de 1890 à 1942.
Le n°999-1000, resté en instance d’autorisation pendant toute la durée de la guerre, ne paraîtra qu’à la Libération. Il s’agit d’un numéro « bilan » en quatre parties, comprenant un rappel des principes d’Alfred Vallette et de nombreux textes, témoignages et lettres d’écrivains fidèles ou admirés depuis 1890. Il est donc assez proche de l’idée que s’en était fait Jacques Bernard, mais rien n’est signalé du projet initial, ni même de ce que devint la revue pendant l’occupation. En 1946, seul compte « la réapparition d’une revue libre, où les écrivains sont libres, et dont le besoin commence à se faire sentir249 », et tout le monde au 26, rue de Condé, se réjouit de cette interruption pendant la guerre qui a évité au Mercure de se compromettre davantage, rejoignant l’idée que Duhamel formulait à Léautaud en 1943 : « […] mieux vaudra que le Mercure ne reparaisse pas, plutôt que de reparaître amoindri, faussé, dénaturé, émasculé, n’ayant plus rien de ce qui faisait le Mercure. Cette revue, qui a vraiment été pendant des années le réceptacle de l’intelligence française250… »
Survivance et errance du Mercure de France.
Cette dernière appréciation de Duhamel nous a poussé à aller vérifier la forme et la tonalité des articles publiés de 1938 à 1940 pour mieux comprendre son appréhension, en consultant les tables alphabétiques des noms d’auteurs qui ont collaboré à la revue ainsi que les tables des sommaires et de la revue de la quinzaine des numéros de revue parus pendant cette période.
Sur cent dix auteurs publiés aux éditions du Mercure de 1939 à 1945, soixante-six ont collaboré au moins une fois à la revue depuis sa création ou vu leurs textes traduits dans un des numéros du Mercure. Le rôle de la revue est considérable dans la mesure où elle sert de tremplin pour les auteurs qui, ensuite, ont la possibilité de se faire éditer. C’est donc la revue qui fait naître la littérature au Mercure de France, et nous pouvons nous interroger sur le sens des éditions sans le moteur que représente pour elles la revue. C’est cette dernière qui introduit le littéraire dans la maison d’édition. Mais nous allons voir que ce n’est plus vraiment le cas de 1938 à 1940, au moment où survit la revue et où elle se perd parfois dans des égarements suspects.
En 1938, l’errance mercurielle est essentiellement littéraire. Elle le restera jusqu’en juin 1940 mais en changeant de direction, toujours plus proche et bientôt rattachée aux opinions politiques de Jacques Bernard. Le Mercure se politise et la revue s’engage sur la même voie que les éditions : collaboratrice. Les rédacteurs de 1938 à 1940 sont d’ailleurs les mêmes que ceux que la maison choisit de publier pendant la guerre et dont nous avons déjà parlé : Bachelin, Brian-Chaninov, Jacoby, Martial, Pilon, Poncins ou encore Vanderpyl, tous partageant des vues sur le conflit en cours à peu près similaires ou jamais très éloignées de celles de leur directeur. La crainte de Duhamel se légitime donc en partie : ces auteurs ne sont sans doute pas les garants de l’intelligence française mais sont ceux que le Mercure de France choisit de mettre en avant, dont la pensée compte pour Jacques Bernard dans la mesure où elle ressemble à la sienne.
La liberté d’expression et la pluralité des opinions exprimées, toujours revendiquées, sont encore respectées au Mercure. En 1939, Louis Mandin propose une « Étude shakespearienne251 » et André Villiers se consacre au « Mal de Musset252 » ; le docteur René Martial rédige quinze pages sur « Les étrangers et les métis253 » et R. de Grandmaison s’interroge sur « Une mystique en action. Le National-Socialisme254 » ; Jean Jacoby passe « Vingt-quatre heures de la vie de Jeanne d’Arc255 » quand Kadmi-Cohen256 fait partager sa vision du judaïsme. Toutes les idées se confrontent et le Mercure conserve en apparence son parti pris affiché pour la diversité. Mais plus la défaite française approche, plus la revue s’épuise, de sorte qu’il ne reste rien du Mercure quand la revue s’arrête. En 1940, les lettres allemandes, anglo-américaines, brésiliennes, canadiennes, catalanes, danoises, japonaises, portugaises et romanes ne figurent plus au sommaire de la « Revue de la quinzaine » ; on n’y parle plus des ouvrages sur la guerre de 1914. Le Mercure de France renvoie certains de ses collaborateurs et se change en une revue dont les errances ressemblent de plus en plus à celles du jeune français de Christian de Carbon, « à la découverte de l’Allemagne hitlérienne ». Le Mercure paraît bel et bien « amoindri, faussé, dénaturé » ; il ne lui reste donc plus qu’à se taire.
Fin de l’acte deux
Le poison continue sa lente progression dans le corps et jusque dans l’esprit du Mercure de France les éditions mais aussi la revue sont touchées. Les éditeurs sont tous conscients que quelque chose a changé au 26, rue de Condé. Hitler et les Allemands sont les nouveaux maîtres des lieux, imposent des nouvelles règles et font de la littérature un moyen de soutenir la nouvelle politique nationaliste de la France : donner à lire les ouvrages du docteur René Martial aux Français, c’est une première étape avant de lire Mein Kampf. S’ils refusent de faire reparaître la revue et empêchent la sortie du numéro-événement 999-1000 pendant l’occupation, c’est justement par crainte de voir renaître l’esprit du Mercure et que ne s’adoucissent les effets du poison. Les éditions ne sont rien sans la revue, perdent le sens que Vallette leur avait donné et sont donc plus facilement contrôlables. Jacques Bernard se satisfait de ce nouveau contrôle des Allemands qui lui permettent de garder par la même occasion son poste de directeur. Il se défend lors de son procès en précisant néanmoins : « Si j’avais été si bien qu’on le dit avec les Allemands, j’aurais fait reparaître la revue. Or, malgré les invitations, jamais elle n’a paru257 ». Nous doutons cependant que l’essentiel ait été pour lui la reparution de la revue pendant la guerre, malgré tous les efforts qu’il a fait dans ce sens. L’essentiel, ce fut la diffusion d’une nouvelle pensée au Mercure, hitlérienne et collaboratrice, l’adhésion unanime et partagée par certains des auteurs de la maison d’édition à une Nouvelle Europe, le sacre d’une nouvelle littérature devant servir avant tout les intérêts politiques de l’occupant, la nouvelle ère du littéraire comme instrument d’une idéologie et comme négation de l’art, d’un art, la propagation toujours plus vive du poison dans le monde de l’édition.
L’essentiel, ce fut qu’on ait trouvé l’antidote.
Entracte
Appuis de fenêtres en fer forgé. Vue sur la rue de Condé »
« Les Allemands défilent en chantant devant les fenêtres du Mercure, en sortant du Sénat qui est devenu le quartier général de l’aviation allemande, et cela l’accable258. »
In Jean Grenier, Sous l’Occupation, Éditions Claire Paulhan, 1997, p. 126.
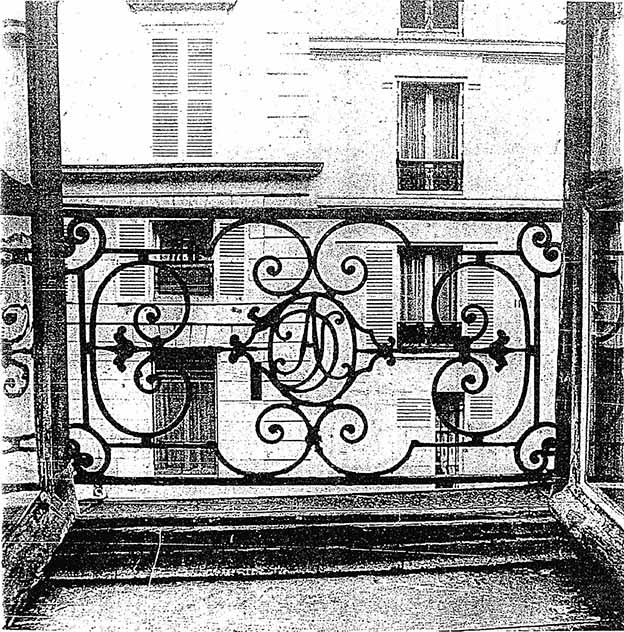
Fenêtre ouverte sur les troupes allemandes ; vue sans issue
Notes de l’acte II
182 Paul Léautaud, Journal littéraire, 24 janvier 1939, t. II, p. 2021. « “Pourquoi d’extrême droite ?”, demande Bernard, “il suffit de ne pas être d’extrême gauche”, poursuit-il. »
183 Georges Duhamel, « Aux lecteurs du Mercure de France », Mercure de France no 925, 1er janvier 1937. Déjà cité en introduction.
184 Paul Léautaud, Journal littéraire, 28 août 1941, t. III, p. 387.
185 Ibid., 25 août 1942, p. 683.
186 Ibid., 18 mai 1943, p. 837.
187 Cité par Paul Léautaud, ibid., 3 novembre 1943, pp. 923-924.
188 Présidé par Marcel Rives, et chargé de la réorganisation de toutes les professions du livre et des négociations avec les autorités d’occupation. C’est René Philippon qui dirige le groupe « édition ».
189 Paul Léautaud, op. cit. 27 juillet 1942, p. 664
190 Paul Léautaud, Journal littéraire, 18 octobre 1937, t. II, p. 1883.
191 Pour la publication d’un roman de C.-H. Hirsch, Bernard se prononce en 1941 en ces termes : « Il ne paraîtra pas. Voyez-vous : faire paraître le roman d’un juif… », in Paul Léautaud, Journal littéraire, 21 avril 1941, t. III, p. 327.
192 « Fils et petit-fils d’officiers de marine et marin lui-même, M. Piola Caselli a longuement parcouru ces mers, longuement séjourné dans ces pays et c’est le résultat d’observations exactes et attentives que les lecteurs trouveront ici », in A. Piola Caselli, Conflit dans le Pacifique, Mercure de France, 1942, p. 10.
193 Fritz Vanderpyl, L’Art sans patrie, un mensonge — Le Pinceau d’Israël, Mercure 1942, 75 pages. Dans le Mercure du 15 juillet 1925, pages 386-396, Vanderpyl avait déjà abordé le sujet dans « Existe-t-il une peinture juive ? »
194 Paul Léautaud, Journal littéraire, 2 novembre 1943, t. III, p. 921 : « Aujourd’hui, déjeuner chez Galtier-Boissière, […] pour la tombola qu’il organise au profit de ce pauvre Vanderpyl, retiré en Dordogne et tombé dans un état voisin de la misère, aggravé d’assez fortes dettes. Appris à ce propos que Vanderpyl est demi-juif. »
195 Jean Gaulmier, dans un article qu’il consacre à Joseph Arthur de Gobineau dans l’Encyclopédie Universalis, nous met en garde sans toutefois nous convaincre : « Ses boutades contre la France du Second Empire, prises au pied de la lettre, l’ont rendu suspect de pangermanisme, alors que, jusque dans ses défauts, il est insolemment français. […] Les thèses de son Essai sur l’inégalité des races humaines, mal interprétées, accréditant l’idée qu’il fut l’un des inspirateurs du racisme, lui ont valu une réputation de mauvais aloi dont on commence seulement à le décharger ».
196 Louis Thomas, Arthur de Gobineau, inventeur du racisme (1816-1882), Mercure de France, 1941.
197 D’après Louis Thomas, cette collection a pour but « de faire comprendre aux Français, et particulièrement à nos jeunes compatriotes, qu’il est des idées utiles à un relèvement de notre patrie », in Louis Thomas, ibid., p. 8.
198 Alphonse Toussenel (1803-1885) est l’auteur de Les Juifs, rois de l’époque — Histoire de la féodalité financière (1845) dans lequel il écrit notamment : « J’appelle de ce nom méprisé de juif tout trafiquant d’espèces, tout parasite improductif, vivant de la substance et du travail d’autrui… Et qui dit juif dit protestant, et il est fatal que l’Anglais, que le Hollandais et le Genevois, qui apprennent à lire la volonté de Dieu dans le même livre que le juif, professent pour les lois de l’équité et pour les droits des travailleurs le même mépris que le juif. »
199 Nancy-Münster : six mois de captivité, Stock 1941, 242 pages, traduit en allemand en 1943 sous le titre : Nancy-Münster : un Français se déclare partisan de la collaboration européenne.
200 Frédéric le Play (1806-1882), peut-être le plus méconnu des fondateurs de la sociologie. Dans La Réforme sociale (1864), il soutient la nécessité de l’autorité, tant sur le plan de l’entreprise, de l’Église et de l’État que sur celui de la famille, mais une autorité conçue sur l’amour et non sur la coercition.
201 Dans Le Front populaire en France et les égarements du socialisme moderne, paru en 1938, il écrit : « Il paraît difficile de ne pas reconnaître au peuple juif des indices purement physiques d’une race déterminée », p. 80.
202 Édouard Dujardin (1861-1949) est par ailleurs le fondateur de l’Académie Mallarmé.
203 Edmond Pilon figure en fait dans la première liste diffusée en septembre 1944 mais n’apparaît plus dans celle publiée par Les Lettres françaises le 23 octobre 1944.
204 Cette section de chapitre pourrait s’intituler « des nouveaux rites » et s’inscrire dans la continuité du chapitre « Rites et coutumes » de Claire Lesage qui fait référence aux rites qui fortifient, de 1890 à 1914, la cohésion interne du Mercure. À l’époque : la mode, le duel et le verbe.
205 « J’ai horreur du vacarme de Wagner », Paul Léautaud, Journal littéraire, 20 juin 1942, t. III, p. 626.
206 « On peut avancer qu’en fait de musique dramatique, l’Allemand et le Français n’en ont qu’une, que les productions aient vu le jour dans l’un ou l’autre pays, ce qui est plutôt une question de lieu qu’une différence fondamentale. De cette intime union entre les deux nations, et de l’échange habituel de leurs talents les plus distingués, il est résulté pour l’art en général une double inspiration et une fécondité magnifique dont nous avons déjà d’éclatants témoignages. Il nous reste à souhaiter que cette noble alliance se consolide de plus en plus. Car où trouver deux peuples, deux pays, dont l’accord et la fraternité puissent présager à l’art des destinées plus brillantes, sinon l’Allemagne et la France », Richard Wagner, Vues sur la France, Mercure de France, 1943.
207 Wagner, deux ans après sa dispute avec le compositeur juif Meyerbeer, écrit Le Judaïsme dans la musique (1850), dans lequel on peut lire : « Songez bien qu’une seule chose peut vous [les Juifs] sauver de la malédiction qui pèse sur vous : la rédemption d’Ahasvérus, l’anéantissement ».
208 Otto Abetz (1903-1958) est ambassadeur d’Allemagne à Paris pendant la guerre, chargé de la sécurité, de la propagande et de la collaboration économique dans la zone occupée. Voir B. Lambauer, Otto Abetz et les Français, ou l’envers de la collaboration, Fayard, 2001.
209 Paul Léautaud, Journal littéraire, 26 janvier 1945, t. III, p. 1261, se remémore Marie Dormoy qui l’accompagnait à cette exposition, s’éloignant au moment de servir le champagne, « ne voulant pas prendre part à cette libation avec l’ennemi ».
210 Henri Albert (1868-1921), traducteur, critique et essayiste, spécialiste des lettres allemandes et particulièrement de l’œuvre de Nietzsche, tant comme traducteur que comme commentateur. Voir Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 15-20.
211 Dr René Martial, La Race française, Mercure de France, 1943, p. 9.
212 Du même auteur, publiés au Mercure de France : Vie et constance des races ; Race, hérédité, folie ; Français, qui es-tu ?
213 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 138, 24 juillet 1940 : « L’attitude de l’Angleterre, seule contre l’Allemagne, est admirable. […] Elle est le dernier refuge d’une certaine civilisation. »
214 Edmond Pilon, Les Autels de la peur, Mercure de France, 1944, p. 136.
215 Prix Nobel de littérature en 1907.
216 Hubert Forestier, « Cent éditeurs vous parlent. L’édition française en 1941 », Livres et lectures, Issy-les-Moulineaux, 1947, 2e fascicule.
217 Henri Bachelin, P. J. Proudhon. Socialiste national (1809-1865), Mercure de France, 1941.
218 Paul Léautaud, Journal littéraire, 24 juin 1941, t. III, p. 360. Léautaud reconnaît dans le comportement de Bachelin « une ruse de paysan. Il devait aussi être pas mal saoul ce jour-là. Bernard s’est laissé rouler ». Bernard qui auparavant avait jugé le Toussenel de Louis Thomas : « C’est bien fait. Louis Thomas est très habile. Il voulait faire aussi un Proudhon. Je lui avais dit oui. Je lui ai dit non ensuite ».
219 Jacques Bernard cité par Paul Léautaud, Journal littéraire, 9 juillet 1940, t. III, p. 124.
220 Kommandantur : Services et locaux d’un commandant d’armes allemand. Commandement militaire local situé en région occupée.
221 Tribunal de commerce de la Seine, 18 juin 1934. L’ouvrage était paru la même année aux Nouvelles éditions latines de Fernand Sorlot. Malgré le jugement, de nombreux exemplaires ont continué d’être vendus.
222 « Je ne sais toujours pas ce que signifie ce titre. Mon… mon programme, sans doute ? », Paul Léautaud, Journal littéraire, 3 juillet 1940, t. III, p. 142.
223 Toute l’édition, no 465, 17e année, 22 avril 1939 : l’article fait référence à une édition de luxe de Mein Kampf, publiée pour les cinquante ans d’Adolf Hitler.
224 N. Brian-Chaninov, La Tragédie des lettres russes, Mercure de France, 1939. « Très hitlérien d’opinions. C’est certainement lui qui influence Bernard, hitlérien lui aussi », d’après Paul Léautaud, Journal littéraire, 9 juillet 1940, t. III, p. 125.
225 Paul Léautaud, Journal littéraire, 3 juillet 1942, t. III, p. 640. Paul Léautaud ajoute : « Il [l’éditeur Rousseau, chargé de juger son affaire aux Prud’hommes] connaissait l’histoire de la fracture du crâne de Bernard. Je ne serai pas étonné que Bernard soit connu dans le monde des éditeurs pour ce qu’il est », 15 juillet 1942, p. 653.
226 « À l’occasion du cinquantième anniversaire du Mercure de France, Gaston Picard nous rappelle d’anciens propos tenus par son fondateur : “Le Mercure de France est né à son heure, juste à temps pour empêcher la dispersion d’un mouvement littéraire très actif, tout à fait ignoré du public et peu connu même de certains lettrés. […] La liberté d’opinion ayant toujours été chez lui totale, il fut ainsi représentatif d’une époque. Il a concentré presque tout l’effort poétique qui suivit l’école parnassienne. Beaucoup d’esprits dont l’influence sur les contemporains est manifeste sont de chez lui. Il a été le premier à émettre ou à formuler bien des idées maintenant admises. Par la suite, réalisant le miracle de se garder libre en prenant de l’âge, continuant à ne redouter ni les idées même hardies, ni les mots même un peu vifs, il est resté accueillant aux “nouveaux”, de sorte qu’il est aujourd’hui l’expression multiple de plusieurs générations d’écrivains” », in Toute l’édition, no 487, 18e année, Ier février 1940.
227 Henri Hauser, lettre inédite à Lucien Febvre, 2 juin 1941, cité dans Revue des revues, no 27, 1997, p. 2.
228 La revue avait cessé de paraître le 1er août 1914 (no 411) mais sa publication avait finalement repris à un rythme mensuel dès le 1er avril 1915.
229 Paul Léautaud, Journal littéraire, fin de la journée du 5 septembre 1939, t. II, p. 2114.
230 Toute l’édition, no 481, 17e année, octobre 1939.
231 Paul Léautaud, op. cit., 6 mai 1948, p. 1943.
232 Alfred Vallette, « Le Mercure de France bimensuel », Mercure de France, no 181, 1er janvier 1905.
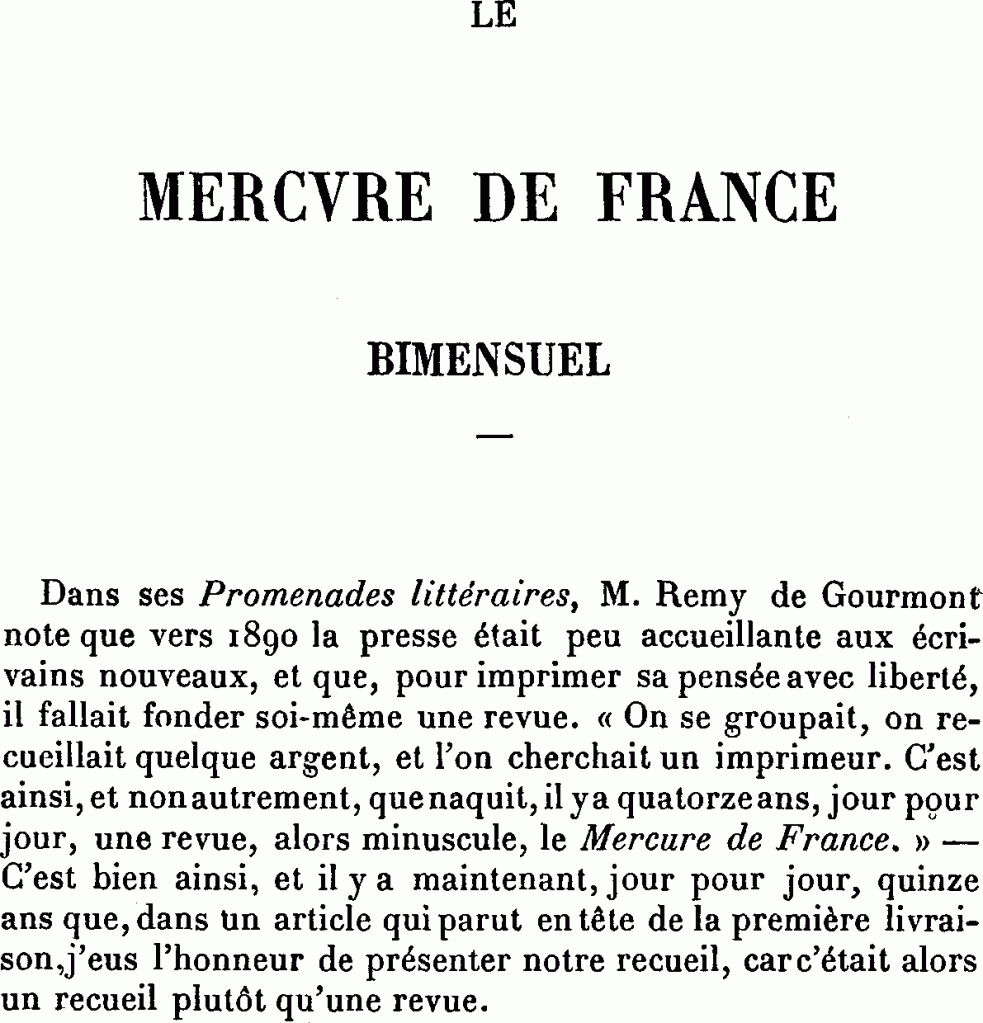
Éditorial d’Alfred Vallette dans le Mercure de France du premier janvier 1905
233 Achille Ouy, philosophe, est le lecteur du Mercure et devient administrateur en novembre 1940 en remplacement de Herold. C’est un proche de Duhamel.
234 Jacques Bernard cité par Paul Léautaud, Journal littéraire, 10 janvier 1940, t. II, p. 2156-2157.
235 Vallette disait à ce sujet : « Que voulez-vous ! Il ne se vend pas. Un éditeur qui ne le connaît pas lui prend un roman. Il lui en prend un second. Après, il n’en veut plus », in Paul Léautaud, ibid., même date, p. 2157.
236 Voir Michel Trebitsch, « Nécrologie ; les revues qui s’arrêtent en 1939-1940 », Revue des revues, no 24, 1997, p. 20.
237 Sensible pour les petites revues dès 1939. En 1941, la situation est préoccupante : il n’y a plus d’importations en bois et les importations en pâtes ont baissé de 90 %. La France consommait 1 000 000 de tonnes de papier par an avant la guerre et n’en dispose plus que de 280 000 tonnes, qui doivent servir comme papiers de presse, d’édition, d’impression, d’écriture (à 63 %) et comme papiers d’emballages, spéciaux et cartons (à 37 %). Par exemple, l’édition n’a droit qu’à 175 000 tonnes de papier au lieu de 630 000 avant la guerre.
238 Paul Léautaud, Journal littéraire, 23 août 1940, t. III, p. 156.
239 Guillaume Apollinaire dans une lettre du 19 octobre 1914 à Alfred Vallette et reproduite dans Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 400.
240 Une série qui débute le 1er février 1934, intitulée : « Comment l’Allemagne prépare le désarmement », avec : « La motorisation de l’armée allemande », « Les Milices hitlériennes », « La Reichsheer et les Milices » et « L’accroissement des forces militaires » (du no 855 au no 859).
241 Paul Léautaud, Journal littéraire, 30 avril 1940, t. III, p. 33.
242 Paul Léautaud, ibid., dernière phrase de la longue journée du 21 mai 1940, p. 51.
243 « Drieu la Rochelle expliquait à Abetz, l’ambassadeur de Hitler en France, le programme de La Nouvelle Revue Française sous sa direction : « Nous sommes pour la collaboration avec l’Allemagne. Nous voulons créer un courant dans ce sens, expliquer, informer, démontrer », in Paul Léautaud, ibid., 14 novembre 1940, p. 215.
244 Paul Léautaud, ibid., 21 novembre 1940 p. 220.
245 Pascal Fouché, L’Édition française sous l’occupation, 1940-1944, Paris, Bibliothèque de littérature française contemporaine, 1987, p. 205.
246 Hubert Forestier, « Cent éditeurs vous parlent. L’Édition française en 1941 », Livres et lectures, Issy-les-Moulineaux, 1947, 2e fascicule.
247 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. II, p. 2003.
248 Le Figaro littéraire, no 195, 15-16 août 1942.
249 Paul Léautaud, Journal littéraire, 7 février 1947, t. III, p. 1537.
250 244 Paul Léautaud, ibid. 23 février 1943, p. 807.
251 Louis Mandin, « Étude shakespearienne. Le Mystère de la perle et du Judéen », Mercure de France no 977, 1er mars 1939, p. 257.
252 André Villiers, « Le Mal de Musset », Mercure de France no 982, 15 mai 1939, p. 51.
253 René Martial, « Étrangers et métis », Mercure de France no 990, 15 septembre 1939, p. 513
254 R. de Grandmaison, « Une mystique en action. Le National-Socialisme », Mercure de France no 975, 1er février 1939, p. 513.
255 Jean Jacoby, « Vingt-quatre heures dans la vie de Jeanne d’Arc », Mercure de France no 986, 15 juillet 1939, p. 357.
256 Kadmi-Cohen, « Un Sionisme est mort », Mercure de France no 984, 15 juin 1939, p. 513.
257 Pascal Fouché, L’Édition française sous l’occupation, 1940-1944, Paris, Bibliothèque de littérature française contemporaine, 1987, p. 205.
258 « L » Désigne Paul Léautaud.
Acte III : L’antidote
Chapitre sept : Le spectre de Vallette
La guérison spirituelle du Mercure de France est envisageable. Pour remédier à la mauvaise direction de Jacques Bernard, pour contrer les visées collaborationnistes du directeur de la maison d’édition et empêcher la « délittérarisation » du Mercure, il existe un antidote, un contrepoison capable de combattre et de neutraliser les effets du poison dont nous connaissons maintenant les désastres causés par sa contamination.
Il faut aller dans le sens contraire de la collaboration : résister au régime hitlérien et à la nouvelle politique éditoriale du Mercure de France, mais s’en remettre aussi à l’ancien catalogue de la maison, rester fidèle, autant que possible, à l’esprit Mercure tel qu’il a été défini par Alfred Vallette : « […] et si d’aventure, en morale, il se rencontrait dans nos pages une vérité neuve ou quelque idée d’avant-garde, nous aurions justifié notre titre — un peu prétentieux sans doute, mais dont l’archaïsme nous plaît259 » La maison d’édition du 26, rue de Condé, doit retrouver un nom, une place dans le paysage éditorial français qu’elle a perdu le jour où elle a décidé de se rendre aux décisions des autorités allemandes. Le Mercure de France doit donc renouer avec son « archaïsme » pour retrouver le sens de la morale et de l’honneur, phagocyté de 1938 à 1944 par les ambitions et la servilité de Jacques Bernard.
L’ombre de Vallette plane toujours sur les murs de la rue de Condé et finit par éclipser la récente production littéraire du Mercure. En 1945, Paul Hartmann succède à Jacques Bernard.
L’ombre du symbolisme
« Le visage d’Alfred Vallette est sans ombre, comme son caractère260 ».
Le symbolisme est, essentiellement, l’idéalisme appliqué à la littérature et devient, pendant la Seconde Guerre mondiale, le symbole de la dignité préservée du Mercure, l’espoir de voir renaître l’idéal éditorial d’Alfred Vallette. Les auteurs, les employés et les lecteurs du Mercure de France rêvent d’une réalité transcendante qui viendrait se raccorder à l’immatériel figuré dans Le Manifeste du symbolisme de Jean Moréas261, au sensible que la littérature du Mercure ne produit plus si l’on sort du registre établi par l’École symboliste.
Au regard des essais et des auteurs édités de 1939 à 1945, nous pouvons remarquer en effet un attachement assez fort à l’esthétique symboliste. En 1943, André Dinar publie La Croisade symboliste, suivi du Symbolisme dans l’art religieux de René Gilles et de Aux bons temps du symbolisme, de Henri Mazel. Les symbolistes se sont souvenus des suggestions de Baudelaire concernant le jeu des correspondances : en 1942, Albert Fleury fait paraître Huit ans de lutte pour le buste de Baudelaire. Le chef de file du mouvement reste cependant Stéphane Mallarmé, à qui le Mercure rend hommage en 1941, avec Une amitié exemplaire. Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane Mallarmé de Gérard Jean-Aubry. La correspondance et les poèmes en prose de Mallarmé sont réédités en 1941 et 1942. Mais les symbolistes se retrouvent aussi autour de Francis Vielé-Griffin, Gustave Kahn, André Villiers ou Émile Verhaeren, tous publiés par le Mercure pendant la guerre. C’est en prenant appui sur le symbolisme que le Mercure de France a bâti sa réputation, et c’est cette réputation qui fait vendre les livres dont souhaite tirer profit Jacques Bernard. Nous l’avons vu, Jacques Bernard aimerait faire du Mercure une maison d’édition qui soit plus à son image, n’ayant pas peur de la défigurer. Mais il est avant tout préoccupé par le bon état de ses ventes et compte sur ce fonds pour s’enrichir toujours plus, conscient de la nécessité et de l’importance d’être constant. Sans qu’il l’ait réellement voulu, c’est le visage de Vallette qui se dessine en filigrane dans le catalogue du Mercure pendant la Seconde Guerre mondiale et c’est l’ombre du fondateur qui protège le patrimoine littéraire de la maison d’édition et lui rend l’esprit dans lequel elle se reconnaissait depuis sa création. L’ombre de Vallette nous éclaire finalement sur le comportement de Bernard, obsédé par le profit et dont l’éternel besoin reste l’argent.
Francis Jammes, Rudyard Kipling, Georges Duhamel
Ces trois figures emblématiques du Mercure de France sont aussi ceux dont les ouvrages se vendent le mieux et que Bernard choisit de faire figurer en bonne place sur son catalogue des éditions. Ils publient chacun six titres de 1939 à 1945 et font perdurer l’esprit « Mercure » malgré la collaboration.
En 1895, André Gide publie dans la revue le poème Un jour de Francis Jammes et provoque la mode du « jammisme ». Pendant la guerre, l’œuvre poétique de Francis Jammes est encore largement célébrée, en 1939, 1940, 1942 et 1944. C’est la trente-sixième édition du Rosaire au soleil que le Mercure de France publie en 1942. Jacques Bernard se souvient certainement des vingt-cinq titres de cet auteur paru entre 1914 et 1939(262) et peut compter sur sa mort récente (1938) pour voir les ventes de ses livres augmenter.
De la même façon, les livres de Rudyard Kipling ont toujours permis au Mercure d’équilibrer ses comptes, grâce à son livre-vedette Le livre de la jungle, publié pour la première fois en 1894 et en 1895 pour le second volume, et réédité en 1941 et en 1944. Kipling est très populaire en France et s’adresse surtout aux enfants. Kim, qui ressort en 1941, est une série de contes pour enfants écrits après la mort de sa fille aînée, en 1902.
Enfin, Georges Duhamel, dont les livres sont interdits de vente pendant l’occupation à cause de ses opinions politiques, est encore publié par le Mercure au cours de la période qui nous intéresse. En 1939 paraît le tome VIII de sa Chronique des Pasquier, Le Combat contre les ombres, suivi de Positions françaises, puis de Lieu d’Asile (saisi par les Allemands avant qu’il ne soit diffusé), puis Biographie de mes fantômes en 1944, Le Mémorial de la guerre blanche et à nouveau Lieu d’Asile à la Libération. Jacques Bernard est terriblement gêné par l’interdiction allemande qu’il ne peut discuter, car Georges Duhamel, qui a publié plus de quarante titres de 1914 à 1939(263), est une des plus grosse vente de la maison d’édition et particulièrement aimé du public et de la critique. En 1942, Jacques Bernard demande au Comité de publication l’autorisation d’éditer les Scènes de la vie future (qui, lors de sa première sortie, atteint en trois mois la 150e édition), ce qui lui est bien entendu refusé264.
Toutes ces œuvres culturelles redressent, presque imperceptiblement, le prestige du Mercure de France mais sont autant d’œuvres commerciales qui font aussi la fortune de Bernard.
Paul Hartmann ou le Mercure libéré
Le jeudi 21 septembre 1944, Paul Léautaud reçoit une lettre de Georges Duhamel qui lui fait part de l’exclusion de Bernard du Syndicat des Éditeurs, destitué également de ses fonctions de directeur et d’administrateur du Mercure. Marcel Roland devient administrateur provisoire et une nouvelle équipe se met en place au 26, rue de Condé, composée d’Achille Ouy, de Pierre Herold et de Robert Fort265. « Ce petit comité a décidé que, s’il me plaît de revenir au Mercure et d’y reprendre la place que j’y ai occupée depuis si longtemps, tout le monde sera heureux de m’y revoir, et il [Duhamel] a été chargé personnellement de me faire part de cette décision266. » Il s’agit donc pour les nouveaux administrateurs de reconquérir le prestige de la maison d’édition et d’en confier la direction à un nouvel homme, Paul Hartmann267, fils d’éditeur et éditeur indépendant lui-même. Léautaud refuse, dans un premier temps, l’emploi qu’on lui propose et se méfie de ce nouvel arrivant : « Travailler sous la direction d’un homme que je ne connais pas et qui ne me connaît pas n’est pas engageant268. » Mais il se reprend rapidement lors de sa première rencontre avec lui : « Accueil merveilleux, courtois, cordial, déférent, charmant de tous points. Je croyais devoir me trouver devant un homme ne me connaissant pas du tout. Je me suis trouvé devant un homme me connaissant parfaitement, depuis longtemps, comme écrivain, comme très ancien et fidèle collaborateur de la revue, touchant de très près Vallette par mes longs et anciens rapports avec lui269. »
Paul Hartmann affiche clairement sa volonté de continuer le Mercure d’Alfred Vallette et de considérer les « années Bernard » comme faisant déjà partie du passé. Le personnel du Mercure est donc augmenté, les heures de travail aussi. Hartmann annonce également la reparution de la revue, une fois réglés le problème du papier et l’ouverture sur l’étranger, qui représentait la plus grande clientèle. Paul Hartmann a trente-huit ans quand il prend la direction du Mercure et nombreux sont ceux qui apprécient l’arrivée de ce jeune directeur270, dont la situation n’est pas encore régularisée en novembre 1944 : quand il sera actionnaire, on pourra le nommer administrateur et il pourra occuper ses fonctions de directeur.
Au même moment, Les Lettres françaises publient les listes des écrivains frappés d’indignité nationale dressées par le CNE, et le Mercure de France doit réfléchir à un nouveau catalogue, exprimant à la fois une rupture avec la politique éditoriale de Jacques Bernard et une continuité avec celle de Vallette et de Duhamel. En 1945, les publications du Mercure font figure de symboles et se réfèrent essentiellement au passé prestigieux de la maison d’édition. Kipling, Pergaud, mais aussi Gide et Moréas sont célébrés. Le Mercure de France, en éditant trois livres d’André Gide271, publié habituellement chez Gallimard, veut montrer qu’il est toujours le concurrent des grandes maisons d’édition littéraires et qu’il n’a pas l’intention de se faire rattraper par le mépris, voire l’oubli, qui pourraient être la conséquence de sa récente collaboration. Paul Hartmann récupère d’ailleurs Pierre-Jean Jouve, un ancien de chez Gallimard, « sans éditeur fixe » en 1945.
La sortie de Lieu d’Asile de Duhamel est un événement marquant de cette même année qui montre que le poison ne produit plus d’effets à la Libération. Le lieutenant Heller et le capitaine Jünger, qui avaient participé à la saisie du livre, sont déjà partis depuis l’été 1944. L’auteur, dans une nouvelle préface, revient sur cette publication : « J’ai hésité quelque temps à publier Lieu d’Asile, en 1944, dans une France délivrée. C’est que nous avons, depuis, enduré bien d’autres souffrances. Cette misère des premiers jours nous semble, à distance, humainement simple, pure des farouches ressentiments, des justes ressentiments qui ont, depuis, corrompu, gangrené notre vie et même toute vie. Mais quoi ! des témoignages de cette sorte peuvent instruire et guider ceux qui rédigeront, un jour, l’histoire de ces temps maudits. » La découverte des camps de concentration et d’extermination nazis fait presque oublier les blessés sur les routes de l’exode en 1940, mais Duhamel doit malgré tout proposer ce témoignage sauvé des flammes par une poignée de résistants au Mercure, dont nous reparlerons dans le prochain chapitre.
Le Mercure se libère de ses anciens fantômes, publie Les ex-hommes de Maxime Gorki272, et réaffirme l’héritage d’Alfred Vallette dans le numéro 1 000 de la revue qui lui est entièrement consacré : « Alfred Vallette et son groupe ont voulu, tenté et réussi un effort qui est resté unique. Ils ont laissé rue de Condé une tradition qui mérite tout le respect de leurs successeurs et dont les mots de liberté et de culture donnent, semble-t-il, les deux traits essentiels. À cette tradition le Mercure demeurera fidèle273. » Paul Hartmann précise qu’il n’y a pas un « ancien » et un « nouveau » Mercure, mais simplement le Mercure qui continue. Les années Bernard forment donc plus une parenthèse qu’une bissectrice.
Le Mercure se sent à nouveau maître chez lui.
Le 23 août 1944, Paris est libéré mais les soldats allemands, sur les toits des immeubles, tirent une dernière fois sur la foule. ; Sacha Guitry est arrêté, chez lui, par de jeunes F.F.I. Les journaux reparaissent, on danse, on jubile… on juge. Paul Léautaud, renvoyé par Bernard, sait que le Mercure n’est pas complètement libéré : « J’ai trouvé ce matin, sur le plat du mur de soubassement de ma grille, cette nouvelle inscription : Ici habite un collaborateur274. » Paul Léautaud connaissait bien avant l’issue de la guerre le traitement des écrivains et des intellectuels coupables d’avoir collaboré ou de n’avoir pas résisté. Le mercredi 11 août 1943, il écrit dans son Journal : « Je me vois comparaissant devant un nouveau « Tribunal révolutionnaire populaire ». « Vous étiez collaborateur ? — En action, non. En esprit, oui. — Vous aviez des compères ? — Très peu. — Combien ? — Tous les Français intelligents275. » Paul Léautaud n’a ni résisté, ni collaboré. Il a travaillé au Mercure de France jusqu’en 1941 et c’est ce que lui reproche finalement l’inscription devant sa porte. Le Mercure ne se sort pas facilement des six années au cours desquelles Jacques Bernard essaya d’imposer son autorité sur les lettres françaises, avec l’aide des autorités allemandes.
Paul Hartmann renoue donc avec la tradition littéraire du Mercure mais ne peut pas faire oublier seul les effets de la collaboration.
Chapitre huit : Trois figures de la résistance
La vie quotidienne des employés au Mercure de France pendant la Seconde Guerre mondiale n’est pas seulement rythmée par les humeurs, changeantes, de son directeur ; au 26 de la rue de Condé, les hivers sont rigoureux, personne ne vient livrer le charbon pour se chauffer et Bernard n’y prête malheureusement aucune attention. En 1942, Paul Léautaud écrit dans son journal : « On se couche, on crève de faim. On se lève, on crève de faim. Au milieu de la journée, on crève de faim. Voilà le régime actuel276 ». La maison d’édition devient rapidement un lieu de troc et d’échange, d’assistance et de soutien mutuel. Un lieu où il faut résister au mauvais traitement du personnel, aux conditions de travail, aux injures de Jacques Bernard et aux mauvais regards des officiers allemands. Le Mercure de France est occupé et collabore ; il résiste aussi, de différentes manières, et à différents types d’agression.
Georges Duhamel, le héros
« Il a bien maigri, un tout petit visage, et bien vieilli, le visage strié de petites lignes aux tempes et de chaque côté de la bouche. Il a l’air bien affecté des circonstances actuelles. On ne vend plus ses livres au Mercure. Interdiction par les Allemands. Même pour les réimpressions. Traitement unique pour lui. Toute son œuvre ainsi supprimée. 45 volumes. L’œuvre de toute sa vie. « Il n’y a qu’à attendre, me dit-il en forme de conclusion, il n’y a qu’à attendre277. »
Attendre et espérer ; toute la sagesse humaine est dans ces deux mots et se lit sur le visage de Georges Duhamel pendant la Seconde Guerre mondiale. « Il n’y a qu’à attendre » que la parenthèse se ferme, l’arrivée des Américains, le réveil, en France, de la Résistance, les ordres du Général de Gaulle… Mais si attendre, c’est se taire, Duhamel préfère bientôt rompre avec le silence et résister. Il sait que si les Allemands l’ont déjà menacé et intimidé (en interdisant la publication et la parution de ses livres, et en le déclarant ouvertement « ennemi de l’Allemagne »), ils ne peuvent toucher à sa personne : son statut d’écrivain d’envergure mondiale et de Secrétaire perpétuel provisoire de l’Académie française lui confère un trop grand bénéfice moral en cas d’arrestation par les Allemands qui seraient obligés de le relâcher. Duhamel profite donc de cette immunité pour « récompenser le silence des autres », autrement dit pour encourager dans son entourage les élans et les œuvres des résistants. Il n’attribue des prix littéraires qu’aux écrivains résistants. Dans son bureau à l’Institut, il réfléchit sur le moyen d’aider et de subventionner certaines revues légales comme Messages, Poésie et Résurrection ; il devient président de l’association « Au service de la pensée française », fondée pour aider l’intelligence française et lui permettre de persévérer dans l’épreuve. Duhamel est en contact avec tous les écrivains et intervient en faveur de bon nombre de prisonniers. Mais ses actions ne sont pas toujours bien entendues. Le 8 juin 1944, soit deux jours après le débarquement, les académiciens tiennent leur séance hebdomadaire. Ils décernent, imperturbables, diverses récompenses dont le prix Née à Paul Léautaud (sur proposition de Duhamel, qui connaissait bien la précarité de l’existence de Léautaud) pour « l’œuvre la plus originale de l’année ». Léautaud refuse, exaspéré par l’excès d’entraide et de générosité de Duhamel, et bougonne contre son « ami-ennemi intime278 », membre de la « République des camarades » : « Je crois bien que me voilà brouillé avec Duhamel. Ce sera comme il voudra279. » Duhamel connaît la personnalité de Léautaud et ne peut lui en tenir rigueur.
Il confirme ses opinions en collaborant au Domaine français en 1942. Cette collection des éditions des Trois collines réunit les textes de plus de soixante écrivains et doit être l’un des événements les plus marquants de l’histoire des lettres clandestines. Des écrivains collabos, il disait : « Je tâcherai d’en sauver quelques-uns ». Il passe véritablement pour un homme et un écrivain de la Résistance : quand Le Silence de la mer sort en France et circule sous le manteau, tout Paris cherche à identifier Vercors. On parle de Gide, de Roger Martin du Gard… mais aussi de Georges Duhamel280.
Au Mercure, il est le principal adversaire de Jacques Bernard et l’empêche à plusieurs reprises de compromettre toujours plus la maison d’édition. Nous l’avons déjà vu résister à la tentative de putsch financier lancée par Bernard et appuyée par Louis Thomas et les Allemands. Nous l’avons vu également s’entretenir avec Jacques Bernard de la basse considération avec laquelle il traite le personnel du Mercure, et remédier seul à la situation : « Quand nos appointements, au Mercure, ont été réduits de moitié — ce qui, ensuite, n’a pas été maintenu —, Duhamel a annoncé que lors de la publication de son nouveau volume des Pasquier : Le Combat contre les ombres, il ferait, sur ses droits d’auteurs, comme une compensation, un cadeau personnel. J’ai déclaré, le jour même, à Bernard, que je n’accepterais rien, que je n’avais pas à recevoir la charité de Duhamel, que je n’étais pas son employé, qu’il ne me devait rien et que je n’avais pas à recevoir de l’argent de lui. Cette générosité a été distribuée ce matin au personnel, sauf Bernard, Mandin qui lui aussi a refusé, et moi. 500 francs pour chacun des autres. J’ai regretté le parti que j’avais pris. J’aurais donné ces 500 francs à Auriant. Mon amour-propre aurait été sauf puisque je ne profitais pas de cet argent, et j’aurais rendu service à un garçon qui le mérite281. » Ses nouvelles allures de grand seigneur énervent Léautaud, mais c’est bien Léautaud qui se rend au bureau de Duhamel pour qu’il empêche Bernard de fermer le Mercure, en septembre 1939. Duhamel est un homme d’influence qui peut servir d’antidote au poison absorbé par le Mercure pendant la guerre. À partir de 1940, il n’est plus administrateur de la maison d’édition et ne peut plus s’occuper des affaires internes à la maison, même s’il reste actionnaire. Il ne peut plus contrôler ce qui se passe au 26, rue de Condé depuis le renvoi de ses deux « agents », Mlle Naudy et Léo Porteret. Mais en novembre 1940, Achille Ouy, un des proches de Duhamel, devient administrateur du Mercure de France. Paul Léautaud s’étonne du choix de Bernard, reconnaissant toutefois l’homme « très cultivé, spirituel, à l’esprit vif et malicieux, sans aucun pédantisme282 ». Il note dans son Journal : « Il [Bernard] me raconte qu’il a choisi Achille Ouy comme administrateur en remplacement de Herold, et qu’il a appris, après coup, que Achille Ouy, professeur à Fontainebleau, est un rouge tout ce qu’il y a de plus rouge. Je lui ai fait mes compliments : « Vous avez eu vos vœux comblés par la démission d’administrateur de Duhamel, ancien bolcheviste. Puis par la mort d’Herold, président de la Ligue des Droits de l’Homme. Vous brûliez d’être débarrassé d’eux. Et vous choisissez Achille Ouy ! Vous introduisez l’œil de Moscou dans les affaires de la maison ! Et Achille Ouy, vous le savez, sera ici le regard de Duhamel. Eh bien, on peut dire que vous avez du flair. Et Ouy est un homme extrêmement fin, intelligent. Non, c’est vraiment réussi ! Mandin et Porteret riaient sans trop le montrer. Bernard n’a trouvé à me répondre que : “J’en serai quitte pour le débarquer283 !” » Achille Ouy et Marcel Roland, qui font partie de la nouvelle équipe du Mercure en 1945 avec Paul Hartmann, sont donc restés en contact avec Duhamel pendant toute la durée de la guerre et lui ont permis de se tenir informé des projets de Bernard concernant la maison d’édition : « Duhamel a un homme de confiance dans la place, en la personne d’Achille Ouy, devenu administrateur, et rangé de son côté. Roland, l’auteur des ouvrages sur les insectes, également administrateur, le renseigne également sur les faits et gestes de Bernard284. » Marcel Roland a par ailleurs publié six titres au Mercure pendant la guerre, de 1939 à 1945, tous consacrés à la vie des bêtes et des insectes, offrant ainsi ses vues sur le monde animal.
Duhamel peut donc faire figure de héros : opprimé par le régime nazi et par Jacques Bernard (il ouvrait toutes ses lettres au rasoir « avec une habileté de policier285 », dans l’espoir de découvrir quelque chose de compromettant), il l’emporte finalement en rejoignant la Résistance, une résistance, qui est aussi celle du Mercure. Le 25 août 1944, de Gaulle défile sur les Champs-Élysées. La veille, Duhamel a fait une arrivée triomphale à la séance de l’Académie, reconnaissante. Le 12 octobre 1945, il n’est plus Secrétaire perpétuel provisoire et devient le Secrétaire perpétuel de l’Académie française.
« Il a bien mérité son nom d’immortel286 ».
Louis Mandin, le martyre
Louis Mandin est mort, déporté en Allemagne, en 1944, à soixante-douze ans. Secrétaire du Mercure de France, il passait ses journées à rédiger des poèmes anti-allemands sous forme de tracts qu’il tapait à la machine et que sa femme distribuait dans tout le quartier.
Je veux mourir debout, être enterré debout
Dans un cercueil aussi muré que fut ma vie287.
L’auteur de ce vœu terrible devait être récompensé.
Quand il arrive pour la première fois au Mercure de France en 1930, Louis Mandin collabore à la revue avant de proposer aux éditions ses recueils de poèmes. Il vit retiré des réunions et des discussions littéraires et préfère visiblement la solitude et l’isolement à l’agitation et à l’effusion des écrivains pendant la guerre. « Je trouve enfin en lui quelqu’un qui comprend mon état d’esprit288 », écrit d’ailleurs Paul Léautaud dans son Journal littéraire. La politique l’intéresse depuis toujours et il n’a jamais caché ses sentiments anti-allemands : en 1914, bien qu’ayant passé l’âge, il voulait être envoyé au front. Il évite toutefois d’en parler à Bernard.
Le jeudi 27 novembre 1941, Paul Léautaud apprend l’arrestation par les Allemands de Louis Mandin et de sa femme, accusés de propagande gaulliste en pleine occupation. Au Mercure, Jacques Bernard s’agite et dit à Duhamel : « Mandin vient d’être arrêté. Moi, je ne veux pas d’histoires. Je suis monté dans le bureau de Mandin. J’ai pris tout ce que j’ai trouvé comme papiers sur la table et dans le bureau. J’en ai fait un paquet et j’ai porté tout ça à la Gestapo. Je ne veux pas d’histoires ». « Le visage du bonhomme était horrible à voir », ajoute Duhamel, mais Bernard n’hésite pas pour autant à dénoncer son employé et fournir aux services de renseignement allemands les pièces susceptibles d’incriminer davantage Mandin et de provoquer son exécution. Les Allemands prétendent avoir d’autres preuves qui leur permettent d’inculper Louis Mandin et sa femme et saisissent la machine à écrire pour voir si les tracts qu’ils sont accusés d’avoir rédigés ou répandus correspondent à ses caractères. Louis Mandin est condamné à mort, sa femme à cinq ans de prison.
Leurs amis restent confiants et se souviennent de l’arrestation de Paulhan, suspecté, sur une dénonciation anonyme, d’avoir propagé des tracts favorables à l’Angleterre. Il fut relâché quatre jours après, rien ne pouvant finalement être retenu contre lui. Le médecin Saltas se rend même à la Kommandantur pour garantir de l’innocence de son ami et explique que « la machine à écrire a été fournie à Mme Mandin par un parent, chimiste de son état, qui habite Versailles, et pour lequel elle faisait des copies pour ajouter un peu d’argent dans le ménage289 ». Georges Duhamel et Paul Valéry se prononcent en faveur de sa libération, une pétition est lancée… Tout le monde compte aussi sur le recours en grâce signé par Bernard et appuyé par quelques notabilités littéraires.
En attendant de ses nouvelles et malgré son absence, Jacques Bernard décide de renvoyer Mandin du Mercure. Les Allemands pourraient croire en effet, après le départ de Duhamel, que la maison d’édition sert de refuge aux résistants, et changer leur rapport d’entente avec le directeur en un rapport de méfiance. Rue de Condé, personne ne sait si Mandin a été fusillé. Quand son beau-frère vient au Mercure réclamer à Bernard sa carte de tabac, on croit d’abord qu’il est mort290, avant d’avoir obtenu d’autres nouvelles contredisant les précédentes. Mais à la Libération, personne ne le voit revenir des camps.
Louis Mandin était chargé de la correction des articles de la revue avant leur envoi à l’imprimerie ; sa déportation et sa mort sont le triste signe de sa résistance au Mercure et nous pouvons croire qu’il corrigeât dans une certaine mesure les fautes de plusieurs collaborateurs.
Rachilde et les femmes du Mercure
Ni héroïnes, ni martyres… les femmes du Mercure de France tiennent pourtant à résister aux décisions de leur directeur, dont elles ne supportent plus les changements d’humeur et l’hégémonie partagée avec les autorités allemandes. C’est leur emploi qu’elles entendent préserver dans un premier temps, quand, en 1939, Jacques Bernard veut réduire leurs appointements de moitié. « Le personnel féminin du Mercure s’est tellement rebiffé, a tellement assailli Duhamel de réclamations et presque de menaces d’une sorte de grève dans le travail, qu’à la suite d’une lettre de lui à Bernard la réduction de nos appointements sera seulement d’un quart291 », observe alors Paul Léautaud.
Mais leur action ne se limite pas seulement à ce genre de considération. Elles organisent, au 26, rue de Condé transformé en une sorte de plaque tournante, un réseau de troc et d’échange pendant l’occupation allemande. Mme Battaiellie, l’employée aux abonnements et surnommée « la Poularde » par Paul Léautaud, participe au ravitaillement. Sa fille Gilberte travaille chez un marchand de café en gros, ce qui lui permet d’avoir du café (qui est une denrée rare pendant la guerre) à échanger contre des œufs, des dattes ou du cake. Mme Genest, la comptable du Mercure, approvisionne le personnel en viandes et en pommes de terre. Au Mercure, chacun réclame et se sert en fonction de ses besoins alimentaires.
Au mois de décembre 1940, la saisie de Lieu d’Asile leur donne l’occasion de s’engager dans une résistance qui ne passe pas les murs de la rue de Condé mais qui affirme leur volonté de se démarquer de la politique éditoriale de Jacques Bernard. Quand Gerhard Heller met sous scellés les derniers exemplaires du livre de Duhamel, Mlle Blaizot, employée à la librairie, s’empare discrètement de trois exemplaires pour en donner un à sa collègue, Mlle Baschet, et un autre à Paul Léautaud, sous le regard complice de Mme Izambart, la concierge de la maison d’édition. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules à vouloir sauver ce livre. Le lieutenant Heller, souvent considéré comme étant un « intoxiqué de culture française292 », déclare, dans ses mémoires, avoir agi de la même manière : « Je demande à l’employée de m’ouvrir un des paquets contenant les exemplaires de l’édition originale, d’en prendre douze, de bien les envelopper, de ficeler et d’écrire dessus : « Propriété du lieutenant Heller. » Je voulais que soit gardé un souvenir, un témoignage de l’édition de ce livre pour qu’on puisse, plus tard, le réimprimer. Je pensais avant tout à sauvegarder un patrimoine culturel que des imbéciles allaient détruire inconsidérément293. » Au Mercure, même les officiers allemands font de la résistance, pour le bien et le salut des lettres.
Rachilde294 reste à l’écart de cette mobilisation féminine mais ne tait pas pour autant son désir de voir le Mercure, fondé par son mari Alfred Vallette, débarrassé de ses occupants allemands et de son directeur incompétent. Depuis la mort de Vallette, elle vit toujours au 26, rue de Condé, mais plus personne ne fait réellement attention à elle. En 1942, elle publie un livre, Face à la peur, dans lequel elle dit ne plus se faire d’illusions : « Je ne renie pas Dieu et je n’ai pas peur de ses prêtres, je me sens simplement d’une autre espèce que l’espèce humaine qui a créé les religions sous la pression tenace de la peur, et n’ayant jamais eu peur, j’ignore complètement qu’on puisse se faire un devoir de s’agenouiller pour prier quelqu’un ou quelque chose d’invisible295. » Rachilde ne craint rien des débordements nazis et continue de sortir au bras de son Arménien dans les rues de Paris. Elle a vécu d’autres temps, elle a été celle par qui le scandale est arrivé au moment de la sortie de son Monsieur Vénus, en 1884, qui lui a valu une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. C’est elle qui, tous les mardis, recevait les artistes, les écrivains et les intellectuels de Paris dans son salon, participant à la vie littéraire de la première moitié du vingtième siècle. Et la seule occasion qui lui fut donnée de se mettre à genoux devant un homme, de se prosterner devant un demi-dieu, ce fut lors de sa rencontre avec Victor Hugo, en 1875(296).
Rachilde refuse malgré tout la présence de Jacques Bernard au Mercure, dont le bureau communique directement avec son salon. Elle y passe donc de moins en moins de temps, et « si on entre dans l’ancien salon de Rachilde, on ne trouve plus qu’une pièce transformée en débarras », note Paul Léautaud dans son journal297. Ce qui la caractérise surtout, c’est sa haine de l’occupant, ayant été longtemps obsédée par la défaite de 1870 pendant sa jeunesse. Quand, sous l’occupation, on lui dérobe des documents auxquels elle attachait un grand prix (essentiellement des autographes de Victor Hugo, de Verlaine et de Barbey d’Aurevilly), elle décide de porter plainte mais apprend que son voleur n’est pas aryen et se précipite alors au commissariat de police pour déclarer : « Je retire ma plainte. Vous pensez ! Cela ferait trop plaisir à l’ennemi298 ». Les Allemands s’en sont souvent pris à Rachilde et font figurer son nom sur la liste des écrivains juifs dont les publications sont interdites et qui sont susceptibles également d’être envoyés dans des camps de déportés. Nous avons retrouvé les brouillons des lettres qu’elle envoya au Cercle de la Librairie et au Syndicat des éditeurs pour se défendre d’une telle accusation. Nous les présentons en annexe, accompagnées des réponses qui lui furent retournées et dans lesquelles on lui demande, pour mettre définitivement un terme à cette histoire, de se procurer un « certificat d’origine aryenne » délivré par le Commissariat des Affaires Juives, 1, place des Petits Pères, à Paris. Mais Rachilde ne se laisse pas convaincre et répond, dans une lettre adressée à M. Bucchini, commissaire à Saint-Germain-des-Prés, datée du 26 octobre 1943 : « Je ne crois pas à l’ordre français dans les actuelles administrations et j’en ai trop la peine à obtenir les pièces réglementaires que je possède pour risquer de les perdre299. »
Rachilde ne veut pas se rendre au nouvel ordre imposé par les autorités allemandes et veut croire en la résurrection prochaine de la France. Dans Face à la peur, nous pouvons lire, en guise de conclusion :
« Ô terre immortelle de nos aïeux ! Terre qu’on peut bouleverser, effondrer, creuser pour les tombes de nos soldats, terre qui se féconde sous les cendres, tu renaîtras plus belle et plus jeune : la France est morte ?… Vive la France300 ! »
Chapitre neuf : Le procès de Jacques Bernard
Le lundi 16 juillet 1945, Jacques Bernard est convoqué par la dixième chambre correctionnelle du Palais de Justice de Paris, à une heure de l’après-midi. Il est accusé d’ « intelligences avec l’ennemi », le même motif que pour Robert Brasillach, jugé six mois plus tôt et exécuté le 6 février 1945. Le crime de ce dernier repose alors sur ses actes, et non sur ses idées. Or l’écriture, au cours de l’épuration, est considérée comme un acte ; elle est même, pour reprendre l’expression de Sartre, « la forme suprême de l’action ». La condamnation de Robert Brasillach montre qu’il existe une responsabilité pénale de l’écrivain, régulièrement contestée par la suite mais qui, en 1945, peut conduire à la mort.
Si, à la Libération, l’écrivain est jugé responsable de ses actes, qu’en est-il pour l’éditeur, dont la responsabilité est clairement contenue dans la définition même de sa profession301 ? Qu’en est-il pour Jacques Bernard, directeur du Mercure de France de 1938 à 1944, hitlérien, collaborateur, au service de l’Allemagne nazie pendant toute la durée de l’occupation ?
La responsabilité de l’éditeur
Ses dîners à la campagne302 avec certains hauts dignitaires de l’Allemagne hitlérienne, ses renvois arbitraires, ses tentatives de prises de contrôle illégales, sa politique éditoriale… Jacques Bernard, en 1945, est responsable d’un certain nombre de ses actes que nous avons déjà eu l’occasion de présenter et parfois d’étudier (rappelons qu’il a signé, avec le syndicat des Éditeurs, la Convention de censure qui confie à l’éditeur la responsabilité de ses publications). Remplit-il encore les fonctions d’éditeur ? Oui, si nous tolérons la définition qu’en fait Philippe de Zara dans les Cahiers du Livre en 1942, et que nous pourrions appliquer au directeur du Mercure de France.
« De même qu’il peut empêcher un bel ouvrage de paraître, de même l’éditeur peut encourager et susciter la publication d’œuvres néfastes. […]. Il est, suivant le cas, le complice ou le collaborateur de l’écrivain ; il assume avec lui, plus que lui la plupart du temps, la responsabilité de la pensée écrite. […] Jadis, l’éditeur était, avant tout, un homme instruit, un homme de goût et de culture, participant à l’activité intellectuelle des auteurs de sa maison. Mais il y a longtemps que cette haute conception de la mission spirituelle de l’éditeur a fait place, chez certains, à un affairisme qui n’a rien à envier aux pires excès des forbans du commerce ou de la finance303. »
Nous regrettons de ne pas avoir eu accès aux archives du Mercure de France, d’autant que nous savons304 qu’il doit s’y trouver le double des lettres que Bernard écrivit aux Allemands pendant la guerre, ce qui nous aurait permis de mieux appréhender l’« affairisme » de Bernard et les arrangements financiers qu’il passait avec l’occupant, mais aussi de mieux comprendre la mentalité et les responsabilités de l’éditeur.
Jacques Bernard est jugé responsable de ses actes dès le 8 septembre 1944, le jour où il est relevé de ses fonctions de directeur de la maison d’édition. Le lendemain, il est exclu du comité du syndicat des Éditeurs, considéré comme coupable par ses pairs. Le 16 février 1945, il est interrogé et inculpé d’« intelligences avec l’ennemi » (ce qui revient à dire qu’il est accusé d’avoir porté préjudice non aux Lettres, mais à l’État, ayant entretenu des relations avec les agents d’une puissance ennemie. Pour la Justice, il s’agit d’un crime d’attentat contre la sûreté de l’État, passible de la peine de mort), avant d’être placé en liberté provisoire. Le 24 mars, il est à nouveau interrogé et cette fois arrêté, détenu à la prison de Fresnes jusqu’à l’ouverture de son procès.
Si nous ne connaissons pas précisément tous les chefs d’inculpation retenus contre Jacques Bernard lors de son procès, nous pouvons malgré tout nous aider du compte-rendu de la séance décrite par Georges Duhamel dans son Livre de l’amertume305.
Marcel Roland, Georges Duhamel et Paul Léautaud ont chacun reçu une assignation comme témoin que Maurice Garçon, leur avocat, dut rendre plus attractive en cherchant à les convaincre autrement306 : « Si nul de vous n’y va, ce gaillard-là finira par s’en tirer, ce qui serait tout de même un peu fort. Enfin, vis à vis de la justice, c’est un devoir ». Georges Duhamel, suspecté dans un premier temps d’avoir protégé307 Bernard, accepte finalement de se rendre au procès en précisant toutefois : « Je regardai […] Jacques Bernard et sentant que si je disais certaines choses, il aurait à supporter une condamnation terrible, je prononçai la formule du serment ainsi : “Je jure de dire la vérité et de ne dire que la vérité” ». Duhamel sait qu’il ne va pas dire « toute » la vérité, mais répond aux questions du président concernant les sentiments pro-allemands de Jacques Bernard, les menaces du directeur du Mercure dirigées contre ses trois fils (si Duhamel refusait d’écrire une déclaration en faveur du maréchal Pétain) et l’affaire du rachat de ses actions par Jacques Bernard ou par Louis Thomas sous la menace, une fois encore, de quelques pressions allemandes. Pour finir, Georges Duhamel dit ce qu’il pense du prévenu, qu’il le considère principalement comme un « malade » et un « alcoolique ». Mais il ne dit rien du rôle « plus que trouble » joué par la femme de Bernard pendant l’occupation ni de la responsabilité de celui-ci dans l’arrestation de Louis Mandin et dans la saisie de Lieu d’Asile.
Paul Léautaud partage, ce jour-là, la même clémence et se montre indulgent, pris de pitié : « Il avait assez l’air d’une loque dans son box d’accusé, à la cour de Justice. Il n’avait encore que quatre mois d’emprisonnement : tout blanc, tout pâle, quatre-vingts ans sur le visage. Le voir ainsi, et sa condamnation à cinq ans de réclusion, si je l’avais chargé, je ne me le serais pas pardonné de ma vie. Aux obsèques de Valéry, à la sortie de l’église, quand Mme Herold s’est précipitée vers moi, et d’un ton triomphant : « Eh bien ! Nous l’avons fait condamner ! » Je ne me suis pas gêné pour protester à haute voix : « Pas moi, Madame, pas moi. »
« C’est dans ma nature : je n’ai pas le goût du châtiment, même si je suis victime, comme je l’ai été de Bernard, mis par lui hors du Mercure, fin septembre 1941, après 45 ans de collaboration à la revue et 33 ans dans mon bureau, et actionnaire et auteur de la maison, sans autre motif que celui qu’il m’a exprimé : le plaisir de ne plus vous voir. Il est vrai que cela m’a peut-être bien servi. Je sais ce que je veux dire308. »
Les témoins au procès de Jacques Bernard ont donc tenu à faire la différence entre la trahison et la sottise, le crime et la faiblesse. L’accident de Bernard en 1936 a servi de circonstance atténuante et orienté le verdict du jury : Jacques Bernard n’est plus condamné pour intelligences avec l’ennemi mais pour indignité nationale à cinq ans de réclusion, avec confiscation de ses biens.
La responsabilité de l’éditeur seul est reconnue lors de ce procès qui épargne les auteurs et les collaborateurs à la revue du Mercure. Rien de ce qui se trouve sur le contrat d’édition (dont une reproduction figure en annexe) ne peut être effectivement reproché à l’écrivain. Certains ont cependant vendu leur plume pour de l’argent ou pour se mettre au service de l’idéologie hitlérienne. Ces auteurs figurent sur la liste des écrivains coupables d’indignité nationale dès le mois de septembre 1944 et nous avons déjà vu qu’un certain nombre d’entre eux était édité au Mercure. Au mois de juillet 1945, François-Paul Raynal et sa femme sont remis en liberté après deux mois de prison (sur dénonciation309). Lui tenait au Mercure la rubrique sur le « régionalisme », mais nous ne connaissons pas véritablement les raisons de leur arrestation.
En France, en 1945, quarante mille Français sont tués et quatre cent mille sont incarcérés au cours de l’épuration. Est responsable et jugé coupable celui qui a collaboré, d’une manière ou d’une autre, avec l’ennemi. Paul Léautaud se sait menacé et préfère se taire (« mon Journal depuis la Libération me ferait fusiller, assassiner au coin d’une rue310 »). Il assume parfaitement sa relation avec certains membres de l’administration allemande, Gerhard Heller311 en particulier. Mais il tient à préciser malgré tout : « Personne pendant l’Occupation ne connaissait, même ne se doutait de ce qui se passait en Allemagne dans les camps de déportés français, ni cette sorte de plan d’extermination presque générale conçu par Hitler. On ne peut donc incriminer des Français de leurs relations avec des Allemands pendant l’Occupation en faisant état, dans cette incrimination, de tout ce qu’on a révélé, et la découverte de ce qui se passait dans lesdits camps, et le procès de Nuremberg312. »
Chacun prend soudainement conscience de la force et de l’influence de l’écrit en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Si le silence fut considéré parfois comme un acte de résistance, le catalogue des éditions du Mercure (ce qu’il a donné à lire pendant l’occupation) fit acte de collaboration, mais il est encore difficile de connaître et de comprendre la responsabilité des auteurs de la maison.
En prison
« Comme je b… bien, ce matin, au petit jour, dans mon lit, – seul. Dans Combat, aujourd’hui, annonce de l’arrestation de Jacques Bernard, d’ordre du juge d’instruction313. »
Jacques Bernard est incarcéré dans un premier temps à Fresnes, avec Louis Thomas. Ils sont logés au rez-de-chaussée, pour être à l’abri d’autres détenus qui ne manqueraient pas de s’en prendre à eux, en leur qualité de dénonciateurs. L’ancien directeur du Mercure de France a désormais tout le loisir de se consacrer à son projet d’écriture : une sorte de nouveau Robinson qu’il a commencé dans sa maison de campagne et dont il avait parlé à Léautaud au moment des Prud’hommes314. Mais il ne peut supporter bien longtemps sa nouvelle résidence et tombe à plusieurs reprises en syncope ; les cellules de la prison de Fresnes n’offrent effectivement pas des conditions de confort optimales, si l’on en croit l’article, assez suggestif, de Stanislas Fumet, paru dans le supplément littéraire du Figaro : « On vous y conduit sans parole et l’on vous y jette sans explication. Si c’est la nuit, sans lumière. Débrouillez-vous dans ces « froides ténèbres ». Trois mètres sur trois sur deux cinquante de hauteur. Une fenêtre aux verres opaques. Un lit de fer contre le mur. Une petite table de bois qui se rabat aussi contre le mur, en face. Une petite chaise fer et bois ; une petite planchette pour les affaires. Mais tout cela n’est rien ; tout cela compte peu. La fierté de Fresnes, son originalité, son honneur, c’est le symbole du confort. Il préside à la vie du prisonnier. Il est surmonté d’un robinet, et les rares fois où elle n’est pas cassée, il y a une chaîne pour le tout à l’égout315 ».
Il est parfois difficile d’assumer sa « valeur intellectuelle supérieure »…
Jacques Bernard parvient cependant à être transféré dans l’est de la France dans une maison de force, où il n’a droit qu’à une visite par mois.
« Cela aura une fin316 », avait prévenu Mlle Naudy.
Fin de l’acte trois
L’archaïsme et la résistance du Mercure de France constituent le meilleur antidote et permettent à la maison d’édition de se désintoxiquer rapidement à la Libération. Les éditions peuvent continuer ; la revue reparaître. L’esprit du Mercure renaît à partir de 1945. Paul Hartmann revivifie le fonds du catalogue, publie de nouveaux auteurs (Bonnefoy, Michaux, Jouve, Reverdy…) et fait revivre la revue grâce à Samuel de Sacy, revenu d’Indochine et devenu directeur littéraire, nouvel administrateur de la rue de Condé.
Le Mercure retrouve son dieu (rendu maléfique au Moyen-Âge, et psychopompe de 1938 à 1945) tel que Botticelli l’a représenté, dissipant les nuages de l’esprit, jouant avec eux et remuant de légers voiles pour que le ciel filtre la vérité, afin qu’elle pénètre jusqu’à nous sans nous aveugler.
Mercurius venit.
— RIDEAU —
Conclusion
Le Mercure convalescent
« Il [Vallette] distinguait deux symptômes de maladie pour une maison d’édition : Le fait d’être emporté par un irrésistible vertige, qui empêche de restreindre la quantité de titres édités, et le fait de ne pouvoir garder sa ligne spirituelle317. »
Le Mercure de France, dirigé par Jacques Bernard de 1938 à 1944, est « malade », en crise, et ses symptômes sont étonnamment proches de ceux diagnostiqués par Vallette en 1920 : les élans mégalomanes de Bernard et sa cupidité chronique donnent au Mercure le vertige, jusqu’à l’étourdissement ; la compromission des éditions auprès de l’occupant allemand et la disparition de la revue lui font perdre sa ligne éditoriale originelle, spirituelle. Le Mercure est donc malade de n’être plus littéraire, de ne plus appartenir au genre « littéraire », de ne plus rechercher, découvrir, présenter de nouveaux écrivains tout en restant fidèles aux anciens ; en crise, dans la mesure où la maison d’édition publie de plus en plus de documents et de moins en moins d’œuvres littéraires. Au 26 de la rue de Condé, les belles lettres empruntent finalement les mêmes canaux que les sciences politiques, se sacrifient au profit d’une entreprise propagandiste imposée par Vichy et l’Allemagne nazie. Quand le littéraire suit le politique et se détourne de son cours naturel, quand l’opposition entre l’action et l’abstraction, l’esthétique et le pratique se dissipe, nous ne pouvons nous empêcher de conclure sur la « délittérarisation » du Mercure de France, ou sur la naissance d’une nouvelle littérature, dirigée ; une littérature de la collaboration. La valeur artistique de l’écrit disparaît quasiment du catalogue des éditions du Mercure. Servir le régime en vigueur dans le pays devient la seule préoccupation de Jacques Bernard, qui préfère publier les théories raciales et racistes du Dr René Martial, les biographies d’antisémites de Louis Thomas, les éloges de l’Allemagne et du Japon, et qui projette aussi d’éditer Mein Kampf. Jacques Bernard garde les auteurs et renvoie les écrivains, compte sur la renommée des écrivains morts pour gagner de l’argent, désireux, depuis son accident, de prendre le contrôle de la maison d’édition.
À la Libération, le Mercure, convalescent, tente de retrouver son honneur perdu pendant la guerre et doit reconquérir le prestige de la maison d’édition d’Alfred Vallette. Nous connaissons désormais l’antidote, mais nous pouvons nous demander s’il est suffisamment puissant pour vaincre le poison et permettre au Mercure de recouvrer parfaitement son esprit. Depuis 1945, le Mercure de France a regagné le champ littéraire, s’est régulièrement imposé comme étant une maison d’édition digne des plus grandes maisons d’édition parisiennes et a remporté plusieurs succès, grâce aux publications de Michel Leiris, Paul Léautaud, Eugène Ionesco, Romain Gary, et plus récemment grâce à Andrei Makine, prix Goncourt et prix Médicis en 1995(318). Le Mercure de France fait des efforts pour découvrir de nouveaux talents, en poésie particulièrement (Alain Veinstein, Anne-Marie Albiach…), mais quel sens donner au silence qui entoure les années d’occupation et de collaboration ? Au cours d’un entretien avec Nicole Boyer, juriste de la maison d’édition de 1961 à 2000, nous avons appris que le Mercure se tait volontairement sur son activité et ses compromissions pendant la Seconde Guerre mondiale et que les archives concernant les « années Bernard » n’ont jamais été véritablement disponibles, rapidement égarées. Ce comportement justifie la présentation du Mercure qu’en a fait Jean Favier, déjà mentionnée en introduction. La maison d’édition au « passé prestigieux » devient celle au « présent prometteur » et ne cessera jamais de l’être si les années de guerre ne sont pas totalement assumées et désamorcées.
« Le jour du cataclysme, je monterai à l’écart sur une éminence pour jouir en paix du spectacle319. »
Cette phrase, citée de mémoire par Paul Léautaud et faussement attribuée à Remy de Gourmont, illustre parfaitement l’état d’esprit avec lequel il a rédigé son Journal littéraire pendant la guerre, détaché de toutes contraintes, dans l’isolement de sa pensée, l’esprit libre et livrant au lecteur le spectacle de Paris sous l’occupation, de l’édition pendant la collaboration, du monde du livre en pleine effusion. Ce journal, dont nous avons emprunté de nombreux extraits au cours de ce mémoire, fut notre principale source d’informations et nous a permis de mieux comprendre la vie quotidienne des Français de 1939 à 1945, les conditions d’occupation imposées par les Allemands, la mentalité d’un directeur de maison d’édition, les liens et les réseaux dans le monde des lettres, le suicide de Drieu la Rochelle, l’assassinat de Denoël — Léautaud fréquente énormément les cimetières pendant la Seconde Guerre mondiale. L’apport historique que nous a fourni son journal a donc été capital, dans la mesure où Léautaud n’incarne pas encore l’histoire littéraire (il faut attendre la diffusion, à la radio, de ses entretiens avec Robert Mallet pour qu’il soit véritablement connu320) et où il est simple acteur du temps présent. Ne faisant pas encore partie de l’histoire, il n’a en effet rien à attendre ni à craindre d’elle, ce qui donne à son témoignage une vraie liberté de ton et d’expression. Certains passages du journal sont cependant censurés, de la volonté même de Léautaud, et ne cachent, paraît-il, que commérages et futilités321. Nous aurions aimé en être parfaitement sûrs…
Paul Léautaud s’est régulièrement demandé quel intérêt auront ses « papiers », et s’est souvent mis à douter : « J’ai tenu pendant ma vie un Journal littéraire. Le diable emporte cette manie écrivante. De quelque côté que je me trouve pour sa publication posthume, si le temps me manque pour le publier moi-même, je ne vois que perspectives de tripatouillages, de suppressions, d’adultérations, de pusillanimités […]. Il me prend par moments l’idée de faire de tout ce papier un beau feu dans mon jardin. Je ris de moi le soir, enfermé seul dans ma chambre, assis à mon petit bureau, devant mes deux bougies allumées, de me mêler d’écrire, pour quels lecteurs, Seigneur ! au temps que nous sommes322 ! » Seul son ami André Billy323 s’est rendu compte de la valeur potentielle de ses écrits, à un moment où on ne fait pourtant plus confiance à ce qui est écrit, où on détourne le littéraire de sa fonction première et où on brûle les livres pour mieux penser.
L’herméneutique du Mercure
Gebelin, en se fondant sur une étymologie celtique, nous propose de lire dans « Mercure » les mots « signes » (merc) et « homme » (cur) : « Ce serait le personnage aux signes, le marqueur, le baliseur — celui qui nous aide à interpréter l’histoire, et notre vie individuelle, en nous fournissant pour cela des repères symboliques324 ». Au cours de la rédaction de ce mémoire, nous avons cherché le sens qu’on pouvait donner au Mercure de France de 1938 à 1945. Si le dieu Mercure donne à l’histoire des repères, échafaude et dessine l’histoire, le poison mercure tend à effacer, brouiller cette vision objective de l’histoire et nous rappelle combien il est difficile de raconter ingénument, en trois actes, comment la chose se passa. Nous n’avons jamais perdu l’impression d’avancer masqué, de ne pas détenir la véracité historique des faits et des événements rapportés, conscients à chaque instant qu’« un acte est moins important que toutes les heures d’un homme325 »…ou d’une maison d’édition.
Ainsi se termine le mémoire de Julien Doussinault. Comme tous les textes de cet ordre, la seconde partie donne de ces nombreuses annexes qui font le bonheur des chercheurs et le malheur des webmestres. Elles ne sont pas reproduites ici mais peuvent être envoyées sur demande.
Notes de l’acte III
259 Alfred Vallette, « Mercure de France », Mercure de France no 1, janvier 1890.
260 André Fontainas, « Rencontre avec Alfred Vallette », Mercure de France no 899, 1er décembre 1935.
261 Jean Moréas (1856-1910), forme avec les poètes de la revue du Chat noir le groupe des « décadents » et rédige en 1886 le « manifeste du symbolisme » publié dans Le Figaro. C’est la première fois que le nom du mouvement se réclamant notamment de Banville, Mallarmé et Verlaine est mentionné. Il s’efforce d’en donner une définition emphatique, mais obscure : « Ennemie de l’enseignement, de la déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie symboliste cherche à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée, demeurerait sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée des somptueuses simarres des analogies extérieures ; car le caractère essentiel de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’Idée en soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des Idées primordiales ».
262 Jennifer Sandler, Les éditions du Mercure de France 1914-1939, maîtrise de Lettres Modernes sous la direction de W. Troubetzkoy et J. Y. Mollier, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, année 1999-2000, p. 54.
263 Ibid., p. 63.
264 Sur une liste de dix-sept ouvrages proposés, on lui en accorde trois. Voir Paul Léautaud, Journal littéraire, fin de la journée du 17 juillet 1942, t. III, p. 665.
265 Robert Fort (1890-1950), neveu de Paul Fort, a épousé en août 1911 Gabrielle Vallette (1889-1984), enfant unique de Rachilde et Alfred Vallette. Rien ne démontre que Pierre Herold, cité précédemment soit le fils d’André-Ferdinand Herold, qui n’a pas de descendance connue.
266 Paul Léautaud, Journal littéraire, 21 septembre 1944, t. III, p. 1156.
267 Paul Hartmann est officiellement chiffonnier pendant la guerre mais assure officieusement la publication de textes clandestins tels que Vers l’armée de métier, de Charles de Gaulle, ou À travers le désastre, de Jacques Maritain et dont une copie est confiée à Vercors, qui le republiera aux éditions de Minuit.
268 Paul Léautaud, op. cit., 3 octobre 1944, p. 1168.
269 Paul Léautaud, ibid. 17 novembre 1944, p. 1213.
270 « D’après certains détails que m’a donnés Mlle Blaizot, il me paraît avoir de réelles qualités d’administrateur dont la maison ne pourra que profiter, après la direction désastreuse de Bernard », in Paul Léautaud, Journal littéraire, 17 septembre 1945, t. III, p. 1330.
271 Des ouvrages déjà publiés au Mercure avant l’existence de La NRF : L’immoraliste (Mercure 1902), Prétextes (Mercure 1903), et Oscar Wilde (Mercure 1903). La Porte étroite et Feuillets d’automne (Mercure 1909) seront publiés au Mercure de France en 1946 et 1949.
272 Maxime Gorki (1868-1936), écrivain et dramaturge russe, marxiste, révolutionnaire, communiste.
273 Dans la note préliminaire au n°999-1 000 du Mercure de France, 1er juillet 1940 – 1er décembre 1946, page cinq.
274 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 1225, 1er décembre 1944.
275 Paul Léautaud, ibid., p. 891.
276 Paul Léautaud, Journal littéraire, 20 avril 1942, t. III, p. 563. Le 20 septembre 1941, page 407, Paul Léautaud écrit déjà : « Dire qu’on en est là : à couper la partie carbonisée de ses bouts de cigarettes pour récupérer le tabac intact, — à manger du pain de maison centrale qui vous démolit les intestins et rationné à ce point que j’en manque dix jours par mois, — à se nourrir de pommes de terres abominables, […], à manquer de vêtements, de chaussures et de linge… »
277 Paul Léautaud, ibid., p. 807, 23 février 1943.
278 Maurice Nadeau, Grâces leur soient rendues, Albin Michel, 1990, p. 229.
279 Paul Léautaud, Journal littéraire, 13 juin 1944, t. III, p. 1076.
280 Louis Parrot, L’Intelligence en guerre, Le Castor astral, 1990, p. 180.
281 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. II, p. 2143, jeudi 30 novembre 1939.
282 Paul Léautaud, ibid., 10 janvier 1940, p. 2156.
283 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 221, jeudi 21 novembre 1940.
284 Paul Léautaud, ibid., p. 995, mardi 11 janvier 1944.
285 Encore une chose que Georges Duhamel révèle ne pas avoir dit au procès de Jacques Bernard, mais qui est signalée dans Georges Duhamel, Le Livre de l’amertume, Mercure de France, 1983, p. 316.
286 Paul Léautaud, op. cit., 25 août 1944, p. 1124, citant Le Figaro. Georges Duhamel démissionne de l’Académie un an plus tard, en 1946, désapprouvant les excès de l’épuration.
287 Vers de Louis Mandin, cité par Georges Duhamel, in Le Temps de la recherche, P. Hartmann, 1947, p. 195.
288 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 55, lundi 27 mai 1940.
289 Paul Léautaud, ibid., 19 décembre 1941, p. 473. Léautaud ajoute : « Le feu, l’ardeur de dévouement avec lesquels Saltas m’a développé tout cela ! Cœur merveilleux, et d’un si parfait désintéressement ! »
290 « Il est obligatoire actuellement, que les cartes de tabac, comme au reste toutes les cartes des décédés, doivent être restituées. Faut-il en conclure que Mandin a été exécuté et que sa famille s’occupe de se mettre en règle ? », s’interroge Paul Léautaud, in Journal littéraire, t. III, p. 648, mercredi 8 juillet 1942.
291 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. II, p. 2131, mercredi 25 octobre 1939.
292 Voir l’article de Pascal Ory publié dans Le Point, no 444, 23 mars 1981.
293 Gerhard Heller, Un Allemand à Paris, Seuil, 1981, p. 130. Il s’agit en fait de souvenirs reconstitués d’un journal enterré en août 1944 sous l’esplanade des Invalides.
294 Rachilde (1860-1953), née Marguerite Eymery, d’un père officier de carrière préoccupé de ses chevaux plus que de sa fille, et d’une mère dépressive autant que mythomane.
295 Rachilde, Face à la peur, Mercure de France, 1942, p. 55.
296 La scène est rapportée dans Quand j’étais jeune (souvenirs littéraires), dont le manuscrit est déposé à la bibliothèque Jacques Doucet, dans le dossier Rachilde : Ms 22 113 — Série Ms. Elle reçut dans un premier temps, en réponse à l’envoi d’un conte intitulé Le Premier amour (qui s’accompagnait d’un témoignage débordant d’admiration), le billet suivant : « Remerciements et applaudissements, courage mademoiselle », et cette phrase était signée : Victor Hugo. Une fois à Paris, elle se rendit chez Victor Hugo et s’agenouilla devant lui, suivant les conseils — farceurs — de Catulle Mendès et de Villiers de l’Isle-Adam, qui lui avaient dit que « femme ou homme devaient […] se mettre à genoux devant lui et lui demander sa bénédiction ». Ce qu’elle fit donc : « Cela me semblait, à moi, tout naturel », avant d’entendre Hugo dire : « Comment avez-vous pu croire ces grands farceurs, mademoiselle ? Je ne suis qu’un pauvre homme et tellement heureux de voir enfin la vie en rose dans votre jolie personne. » Rachilde n’avait alors que quinze ans.
297 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 664, lundi 27 juillet 1942.
298 Déjà cité par André David dans « Le Mercure de France entre les deux guerres », in Revue des deux mondes, août 1971, pp. 297.
299 Bibliothèque Jacques Doucet, dossier Rachilde : Ms 10 043 L. T.
300 Rachilde, Face à la peur, Mercure de France, 1942, p. 170.
301 « Éditeur : personne physique ou morale qui est responsable de l’entreprise d’édition et des choix effectués », in Grand Larousse en cinq volumes, 1993.
302 Jacques Bernard invitait ses amis allemands à Bouray, (Seine-et-Oise). La mairie prétend ne jamais avoir entendu parler de lui, mais n’a pas pu nous ouvrir ses archives, les délais légaux n’étant pas encore atteints. Henri Sineau, « la mémoire de Bouray » (il y vit depuis quatre-vingt-dix ans) et l’auteur de Nos villages pendant la guerre. 1939-1945 Bouray-Lardy-Janville, ne dispose, lui non plus, d’aucune information concernant Jacques Bernard et la maison dans laquelle il vécut.
303 Philippe de Zara, « La responsabilité de l’éditeur », Les Cahiers du livre, « Livres et lectures », 7e fascicule, 1942/12, Issy-les-Moulineaux, 1947, p. 5.
304 D’après Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 1202, vendredi 27 octobre 1944 : « Le caissier Vallet m’a raconté ce matin qu’il a trouvé, en mettant de l’ordre dans les papiers de Bernard, le double des lettres écrites par lui aux Allemands, — il en était si satisfait qu’il en prenait des doubles. »
305 Georges Duhamel, Le livre de l’amertume, Mercure de France, 1983, pp. 314-316.
306 « Cela est une corvée », déclare Léautaud. Duhamel avoue quant à lui : « Je n’avais pas l’intention d’y aller tout d’abord et il m’eût été facile de me dérober ».
307 « Il [anonyme] s’étonne qu’il [Bernard] ne soit pas arrêté, me dit qu’il paraît qu’un académicien illustre le protège — décidément, cela se répand — et me demande si je sais quel il est. Je lui ai répondu : « C’est Duhamel, ce ne peut être que lui » », et « [le dessinateur Jean] Oberlé me demande ce que devient Bernard, pour le Mercure, ce qu’on fait de lui, qu’on dit qu’un académicien célèbre le protège, si je sais lequel c’est. Décidément, tout se sait », in Paul Léautaud, Journal littéraire, 18 et 26 octobre 1943, t. III, p. 1188 et p. 1196.
308 Paul Léautaud, Journal littéraire, 21 novembre 1945, t. III, p. 1358.
309 Voir Paul Léautaud, ibid., 2 juillet 1945, p. 1312. Contrairement à ce pense se souvenir Paul Léautaud, François-Paul Raynal ne tenait pas une rubrique sur le « Régionalisme » mais sur les « Lettres romanes », de juillet 1933 à avril 1939.
310 Paul Léautaud, ibid., 7 janvier 1945, p. 1251.
311 « Au moins, un Français et un Allemand auront “collaboré” », écrit-il dans son Journal, t. III, p. 1114.
312 Paul Léautaud, ibid., p. 1386, mardi 25 décembre 1945. Au mois de mars 1945, avant la libération des camps, Léautaud-misanthrope, usé, vieilli, cynique et désespéré (il envisage de plus en plus de se tuer) notait, p. 1281 : « On peut ajouter que chaque guerre a sa nouveauté. Celle de celle-ci aura été le marché noir. […] Quelle pourra bien être la nouveauté de la prochaine guerre ? L’extermination du genre humain ? Hélas ! C’est une chimère. »
313 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 1288, dimanche 25 mars 1945. Léautaud peut se consoler, lui qui s’étonnait, le 23 décembre 1943, p. 966 : « C’est une curieuse chose que la disparition de toute érection. C’est vraiment comme une sorte de mort localisée. Les souvenirs des moments amoureux les plus chauds, la représentation des images les plus vives du plaisir, ce qu’on revoit, qu’on entend encore, des poses, des gestes, des propos, des caresses réciproques les plus intimes […], aucun effet ».
314 Paul Léautaud, ibid., 27 juillet 1942, p. 664.
315 Le Figaro (supplément littéraire), no 11, 2-3 septembre 1944, 118e année : « Les écrivains en prison. Trois mois à Fresnes », par Stanislas Fumet.
316 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, p. 65, lundi 3 juin 1940 : « En revenant au Mercure à deux heures, faisant allusion à l’alerte qu’il y a eu, suivie d’une canonnade assez vive, il [Bernard] a dit devant Mlle Naudy avec un air satisfait : « Je pense qu’Orly a dû prendre un bon coup. » Des propos de ce genre ne cessent pas de sa part. Mlle Naudy est indignée, mais se garde bien de répondre. Elle est venue me raconter cela dans mon bureau. Elle a eu ce mot : “Cela aura une fin” »
317 Gabriel Brunet « Un homme secret », Mercure de France, numéro en hommage à Alfred Vallette, 1er décembre 1935, page 234.
318 Andrei Makine, Le Testament français, Mercure de France, 1995.
319 Paul Léautaud citant une phrase de Remy de Gourmont « écrite quelque part ». In Paul Léautaud, Journal littéraire daté de « fin 1914 », t. I, p. 957.
320 De décembre 1950 à juillet 1951.
321 D’après la personne qui s’est chargée de la publication du Journal littéraire et qui travaille au service « manuscrits » de la bibliothèque Jacques Doucet.
322 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. II, p. 1953, lundi 13 juin 1938.
323 Paul Léautaud, continuateur de Stendhal, et fervent égotiste, a rempli depuis quarante ans je ne sais combien de cahiers qui […] forment une masse considérable. […] Je suis certain que les cahiers de Léautaud constitueront plus tard le document le plus considérable sur la vie littéraire de la première moitié de ce siècle », cité par Paul Léautaud, ibid., p. 2101, samedi 29 juillet 1939.
324 P. Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, nouvelle édition augmentée, Éditions du Rocher, 1988, pp. 734-761.
325 Jorge Luis Borges, « Deutsches requiem », in l’Aleph, Gallimard, 1967, p. 110.