Le Canard du dix septembre 1958
Le Canard du 18 septembre 1963
Notes
À cinq ans et une semaine d’écart Le Canard enchainé a publié deux articles sur Paul Léautaud. Ce ne sont peut-être pas les seuls. Nous les devons à la collection de Maxime Hoffman qui en a autorisé la publication.
Le Canard du dix septembre 1958
L’article de ce numéro traite de Maurice Boissard, critique dramatique :
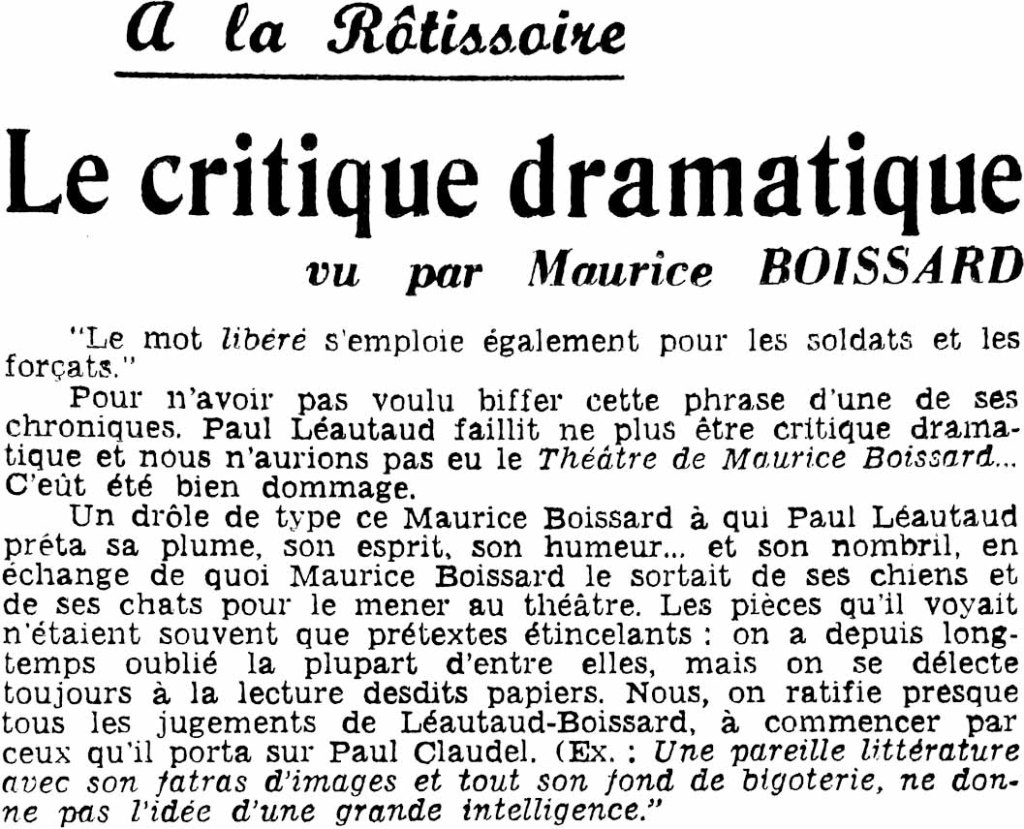
« Le mot libéré s’emploie également pour les soldats et les forçats. »
Pour n’avoir pas voulu biffer cette phrase d’une de ses chroniques. Paul Léautaud faillit ne plus être critique dramatique et nous n’aurions pas eu le Théâtre de Maurice Boissard1… C’eût été bien dommage.
Un drôle de type ce Maurice Boissard à qui Paul Léautaud prêta sa plume, son esprit, son humeur… et son nombril, en échange de quoi Maurice Boissard le sortait de ses chiens et de ses chats pour le mener au théâtre. Les pièces qu’il voyait n’étaient souvent que prétextes étincelants2 : on a depuis longtemps oublié la plupart d’entre elles, mais on se délecte toujours à la lecture desdits papiers. Nous, on ratifie presque tous les jugements de Léautaud-Boissard, à commencer par ceux qu’il porta sur Paul Claudel. (Ex. : Une pareille littérature avec son fatras d’images et tout son fond de bigoterie, ne donne pas l’idée d’une grande intelligence3.”)
Claudel a pris sa revanche, car “les temps sont durs, la vie n’est pas drôle, la bêtise règne, le bon Dieu redevient à la mode4”.
Mais c’est tout de même bon signe qu’on se soit avisé de rééditer ces deux bouquins (N.R.F.), qui constituent le véritable “Journal”, de Paul Léautaud5.
Nous passons la plume à Maurice Boissard pour ce portrait du critique dramatique, auquel il suffirait de très peu de retouches pour le rendre actuel.

NON, les journaux ne sont pas de si mauvaises choses6. On y pratique l’intelligence de la vie, l’ironie aimable. On y a le sens des affaires, en même temps que de la délicatesse. Prenez, par exemple, les articles de critique littéraire, même les simples échos sur les livres, que quelques-uns se plaisent à insérer. Pas un auteur qui n’ait du talent, qui ne soit un grand écrivain. On y pousse même quelquefois l’amour de la littérature jusqu’à faire écrire l’article par l’intéressé lui-même7. Cela fait gagner du temps, et le temps c’est de l’argent, comme on dit. De cette façon, tout le monde est content. Le public, dont l’orgueil national est flatté de cette production ininterrompue d’œuvres de génie, et l’auteur qui connaît la gloire. Quant au journal lui-même, ai-je besoin de dire qu’il n’y perd pas non plus ?
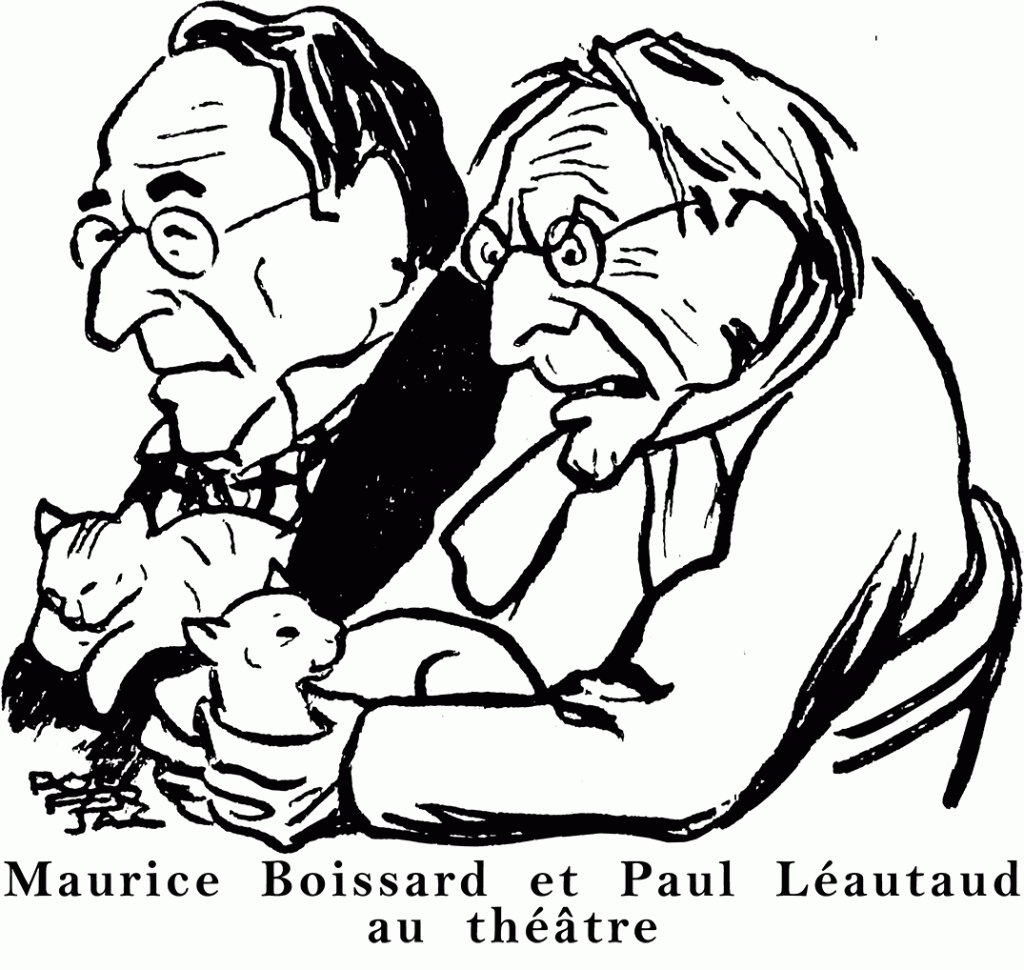
Dessin du Canard enchaîné pour ce texte
La CRITIQUE DRAMATIQUE n’est pas moins désintéressée. Tel critique a une pièce déposée chez un directeur de théâtre : vous ne voudriez pas qu’il dise que celui-ci joue de mauvaises pièces. Tel autre, pour se faire jouer, compte sur un comédien influent : il se met en quatre pour lui trouver un talent incomparable. Celui-ci pense à l’auteur, qui est lui-même critique dramatique, ou homme puissant : on récolte ce qu’on a semé, se dit-il en le couvrant d’éloges. Celui-là, enfin, fait le joli cœur auprès d’une comédienne, et songe avant tout à avancer ses affaires. Quant à dire que tous ces gens-là jugent surtout du talent et de l’esprit dans leur propre mesure, pur préjugé. C’est oublier le talent et le savoir qu’il faut pour écrire dans les journaux.
J’ai là-dessus une petite anecdote que j’ai racontée souvent au cercle. Elle concerne cet article sur la Comédie que j’ai rappelé précédemment8. Je l’avais d’abord offert à M. de Rodays9. M. de Rodays dirigeait en ce temps La Vie parisienne10. C’est un homme charmant, et le modèle des journalistes. Il le disait lui-même : s’occuper de La Vie parisienne, cela lui allait comme de diriger une épicerie. Mais enfin, puisqu’il le fallait, il s’en occupait, et faisait de son mieux. Un article sur la Comédie lui convenait à merveille. C’était parfait. Il le voyait déjà imprimé, en troisième page, après un dialogue léger. Seulement, il tenait à me prévenir : il ne fallait dire du mal de personne. Dire du mal de quelqu’un, dire du mal de Claretie11 (1), par exemple ? Je n’y pensais pas. Claretie était un ami. Et puis, un homme si aimable, et de l’Académie ! Ne pas dire du mal des artistes, non plus, surtout de Sorel12. Ah ! Sorel. Je ne pouvais pas savoir. Il verrait le lendemain arriver Arthur Meyer13 éploré. “Comment, cher ami. Est-il possible ? Vous avez laissé dire du mal de Cécile ! Vous, un vieux camarade. Ce n’est pas sérieux.” À part cela, c’était entendu : je pouvais dire tout ce que je voulais. Pourvu que je ne touche à rien ni à personne ! M. de Rodays était comme nos critiques dramatiques : un philosophe du boulevard. J’ai bien peur qu’elle soit ce qui me manque le plus, cette philosophie, à moi qui ne fais pas de pièces, qui n’ai pas de confrères, qui suis ignoré des journalistes, des directeurs de théâtre et des comédiens, et qui ne m’occupe guère, hélas ! par timidité, par manque de loisir, de plaire aux femmes. Je n’ai guère que mon jugement, un certain amour des belles choses et des habitudes d’esprit assez indépendantes.
(1) Ancien administrateur de la Comédie-Française (N.D.L.R.).
Le Canard du 18 septembre 1963
Dans cet article, l’auteur, peut-être le même, qui signe « Le Cousin Jérôme » et qui semble bien connaître Paul Léautaud, traite du quatorzième volume du Journal littéraire, paru le 31 mai et qui couvre la période du premier juillet 1941 au premier novembre 1942. Cet article a pour titre : Un grand petit Monsieur.

LE “Journal littéraire” (pourquoi “littéraire” ?) de feu Paul Léautaud (Mercure de France) en est à son quatorzième volume. J’avais acheté le premier. J’avais bien l’intention de compléter la série. Mais les ans ont passé. Douze volumes ont paru sans que je m’en soucie. J’ai pensé à autre chose. Et voici que devant le quatorzième — près de quatre cents pages dévorées en trois nuits — ma négligence se sent comme punie. Léautaud, c’est une drogue. Je n’aurais pas dû m’y remettre : maintenant, je souffre du “manque”…
“Juillet 1941 – novembre 1942,” Chaque soir, ou à peu près, à la lueur d’une chandelle, le ricanant misanthrope de Fontenay trempe sa plume d’oie dans la bile, et griffonne ses rognes, ses méfiances, ses amertumes, ses plaintes, ses humeurs, ses naïvetés renversantes, les rares événements et les mille riens de sa vie. C’est la guerre, en ce temps-là. C’est même l’occupation. Paul Léautaud s’en torche immensément, sauf dans la mesure où, personnellement, ça le dérange : “La sagesse, c’est de s’en foutre”14. S’il avait à choisir, il souhaiterait plutôt la victoire des “occupants” qui ont eu l’idée de prescrire un cachet postal, en deux langues, rappelant que la loi punit la cruauté envers les animaux15. Il en reviendra plus tard, quand, naïf comme toujours (lui qui s’est cru le monsieur à qui on ne la fait pas), il s’interrogera en juillet 1942 : “Ai-je bien raison16 ?”

Ce n’est pas cela qui compte. Ce qui compte, c’est le personnage. Irritant, injuste, râleur, mesquin, tatillon, couard, mauvaise langue, pipelet, radin, rancunier, misogyne, fier de son intelligence réelle, de sa culture, de ses mots (souvent faciles) ; mais attachant, timide, pas content de soi, terriblement vivant ; d’une probité, d’une indépendance farouches, avec des repentirs, une tendresse éclair qui parfois ferme le bec à la vacherie toute prête, et des contradictions d’une candeur si sincère qu’elle désarme l’accusation.
Sensible à l’amitié, mais ses amis le font suer ; “Reçu trois cartes de Rouveyre. Il commence à m’excéder avec ses effusions”17.
Hermétiquement bouché à ce qui n’est pas littéraire (et encore ! Quel déchet, s’il fallait adopter tous ses jugements !) ; il râle quand, pour les soustraire à d’éventuelles réquisitions, Mme Marie Dormoy apporte chez lui des objets d’art, dont des statuettes de Maillol, que, dit-il, “je paierais pas trois francs”18…
Fanatiquement puriste quand il s’agit des autres, cela ne le gêne pas d’écrire souvent comme un cochon : “Et moi, par inattention, je mets si trop bien d’eau…” (dans son café)19.
Chassé salement du “Mercure”20, sans emploi, pauvre, sans grands espoirs (il a 70 ans), il refuse une avance de 12 000 francs de l’époque, que lui offre Gallimard pour une réédition du “Petit Ami” : “Je ne prends jamais d’avances”21.
Impossible de le décrire, mais lui s’en charge ! Et le spectacle, long, plein de rabâchages, de queues de cerises, de cheveux coupés en quatre, de bois scié, de trainailleries de savates et d’odeurs tristes, est absolument fascinant. Tel le fumeron de chandelle qui éclairait si mal la table de Fontenay, l’âme de Léautaud palpite, vacille, crépite, se ranime, lance des lueurs. Chaque fois qu’elle faiblit, on en a froid pour elle (11 janvier 1942) : “Le corps entier, je suis glacé assis à écrire. Heureusement, je n’ai pas de thermomètre, je ne connais rien aux questions de température. J’aurais encore plus froid.”
Et finalement, on l’aime, cet homme à certains égards si banal, et pourtant hors-série, qui fit tout et toujours pour n’être pas aimable.
Mme Marie Dormoy, grâce à qui paraît ce “Journal” (cela n’a pas dû être une mince affaire que de vaincre cet Himalaya de griffonnages !) ; Mme Marie Dormoy, envers qui Léautaud (avec acharnement, presque à chaque page), et Rouveyre (plus incidemment), se montre fort cruel et, semble-t-il, injuste, s’est réservée deux pages, en fin de volume, pour remettre discrètement les choses au point22-23.
Mme Marie Dormoy ne répond qu’à Rouveyre. Les flèches empoisonnées dont Léautaud la crible, gentiment, elle les ignore.
Voulez-vous parier qu’elle aussi aime encore l’abominable petit homme des neiges de Fontenay ?
Le Cousin Jérôme.
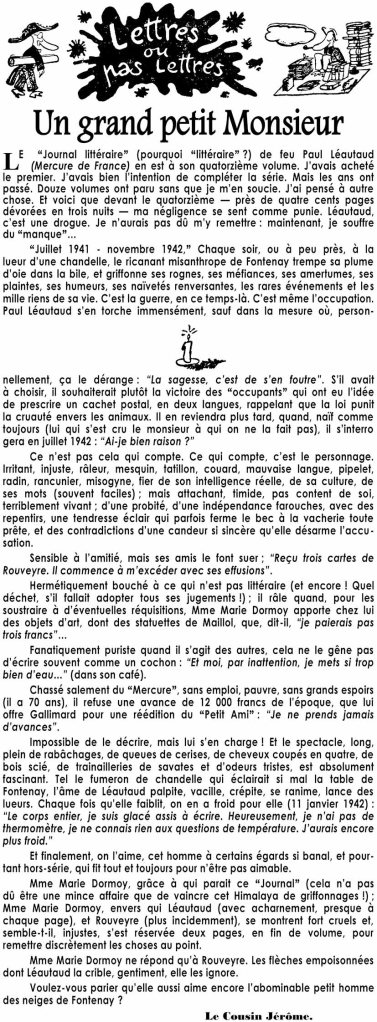
Notes
1 Le journaliste du Canard confond. Cette phrase n’a pas été écrite pour une chronique dramatique mais pour des « Mots, propos et anecdotes » parus dans Les Nouvelles littéraires du seize juin 1923, page cinq. Ce texte est paru en l’état, colonne quatre.
Journal littéraire au 13 juin 1923 : « J’ai fait ma prochaine chronique pour Les Nouvelles littéraires […]. Je vais ce soir corriger mes épreuves et voilà que Maurice Martin du Gard et Jacques Guenne m’entreprennent pour ce mot : Libéré […], avec des considérations civiques, le respect dû au lecteur, les gens qui ont fait la guerre, que la vie de caserne n’est pas du tout comparable au bagne, etc., etc. Enfin un monde de niaiseries et de pusillanimités, d’autant que ce mot, je le leur fais remarquer, ne s’applique en rien aux choses de la guerre. Une nouvelle fois je n’ai pas cédé et je ne céderai pas. Toute ma liberté serait perdue si je cédais. Il me faudrait sans cesse supprimer ceci ou cela. Ou ils tiennent à moi pour leur journal et ils finiront par me ficher la paix. Ou ils ne tiennent pas à moi et dans ce cas c’est moi, s’ils m’ennuient trop, qui partirai. »
2 Le journaliste du Canard écrit le contraire de ce qu’il veut écrire : ces prétextes ne sont pas étincelants, c’est ce qu’ils occasionnent, qui l’est.
3 Chronique dramatique du premier avril 1914, à propos de L’Échange, créée au théâtre du Vieux-Colombier le 22 janvier avec Jacques Copeau et Charles Dullin.
4 Ouverture de la Chronique dramatique du premier novembre 1917 à propos de L’Illusionniste, comédie en trois actes, de Sacha Guitry créée le mardi 28 août 1917 aux Bouffes-parisiens avec Yvonne Printemps.
5 Paul Léautaud, Le Théâtre de Maurice Boissard, NRF 1958 (deux volumes, achevé d’imprimer le 24 mars 1958). Il ne semble pas qu’il y ait eu d’édition ultérieure.
6 Chronique dramatique du premier novembre 1907 à propos de L’Amour veille, comédie en quatre actes de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet créée à la Comédie-Française le premier octobre 1907. Journal littéraire au trois octobre 1907 : « Hier soir, à la deuxième de L’Amour veille, une simple ordure, bête, vulgaire et vide. »
7 Journal Littéraire au deux novembre 1907 : « Quand Danville me complimentait sur mes chroniques Boissard, je me suis retenu pour ne pas lui dire que je pensais justement à lui en écrivant la dernière, quand je parlais des auteurs qui écrivent eux-mêmes leurs articles d’éloges et paient même pour les faire passer dans les journaux. Histoire de l’article écrit par Danville lui-même sur son roman Le parfum de volupté, et inséré à ses propres frais (1 000 frs) dans Le Journal. »
8 Peut-être le texte « À la Comédie-Française » paru dans le Mercure de France du premier février 1905 page 389.
9 Fernand de Rodays (1845-1925), journaliste et homme de lettres. Collabore à La Vie parisienne et au Figaro comme rédacteur (1871) où il fut chargé de la revue des livres et de la chronique des tribunaux, puis directeur (1879) puis rédacteur en chef (1894). Fondateur de Paris-Caprice et à Brest du Peuple breton et la guerre. (Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, 1895).
10 La Vie parisienne, magazine culturel illustré créé en 1863 et publié sans interruption jusqu’en 1970. Il a donné son nom au célèbre opéra-bouffe éponyme de Jacques Offenbach. La Vie parisienne a développé une approche littéraire et critique singulière jusqu’en 1905..
11 Jules Claretie (1840-1913), collabore à de nombreux journaux sous plusieurs pseudonymes, notamment au Figaro et au Temps ; rédige la critique théâtrale à L’Opinion nationale, au Soir, à La Presse et aborde un peu tous les genres de littérature. Comme historien, il écrit une Histoire de la Révolution de 1870-1871 ; comme romancier, Monsieur le ministre, Le Million, Le Prince Zilah. Jules Claretie est aussi conférencier et auteur dramatique ; président de la société des Gens de lettres, et de la société des Auteurs dramatiques. Il est administrateur du Théâtre-Français depuis 1885. Élu à l’Académie française le 26 janvier 1888. (Source : Académie Française).
12 Céline Émilie Seurre, dite Cécile Sorel (1873-1966), comtesse de Ségur par son mariage. Jouissant d’une très grande popularité, elle côtoie les plus grandes personnalités de son temps, au nombre desquelles Georges Clemenceau, Edmond Rostand, Sache Guitry… Reine des planches, ses apparitions publiques, le plus souvent dans des costumes extravagants, font à son époque sensation. Elle fréquente aussi Maurice Barrès, dont Georges Clemenceau dit qu’elle fut très brièvement la maîtresse, et Félix Faure. En 1933, lors de la première de la revue Vive Paris dans laquelle elle interprète Célimène, et après avoir descendu avec succès le grand escalier Dorian du Casino de Paris, elle lance à Mistinguett placée à l’avant-scène le fameux « L’ai-je bien descendu ? ». Phrase qui lui restera pendant longtemps associée.
13 Arthur Meyer (1844-1924), fut le directeur du Gaulois, prestigieux quotidien conservateur. En 1882, Arthur Meyer, qui a embauché deux ans plus tôt Octave Mirbeau comme secrétaire, reprend Le Gaulois et en fait le grand journal mondain de la noblesse et de la grande bourgeoisie, premier quotidien à avoir une chronique sur le cinéma, en mars 1916.
14 Vingt janvier 1942 : « Un moment de conversation entre nous trois [l’éditeur Jacques Haumont pour les Notes retrouvées et un photographe], sur la guerre, ses causes, ses suites, la situation présente, etc., etc. Nous nous sommes trouvés d’accord sur cette attitude expliquée par moi : “Nous ne savons rien. Nous n’y pouvons rien. Nous sommes des zéros. La sagesse, c’est de s’en foutre. Occupons-nous de notre marotte et ne nous mêlons pas de ces histoires-là.” »
15 21 juillet 1941.
16 17 juillet 1942, au lendemain de la rafle du Vél d’Hiv : « Ai-je bien raison d’être pour la victoire des “Occupants” ? Quand je les vois se livrer à ces enlèvements, à ces transfèrements en masse ? S’ils sont vainqueurs au sens complet du mot, à quels excès de force se livreront-ils, peut-être ? »
17 Trois septembre 1941.
18 Sept septembre 1941 : « Elle est partie à 5 heures, moi avec elle, pour commencer à apporter chez moi ses objets d’art, statuettes de Maillol, que je n’achèterais pas 3 francs, et objets de cuivre, pour les mettre à l’abri de la réquisition par les Allemands. »
19 Vingt août 1942 : « Après le déjeuner, je décide de me faire un peu de café, plutôt que de prendre la saleté qu’on trouve dans les cafés. M. D. m’accorde si peu de son café, — du vrai café, — et moi par inattention je mets si bien trop d’eau, que j’obtiens une telle lavasse que je la jette sur l’évier. »
20 Le trente septembre 1941.
21 21 août 1941.
22 Un grosse faute d’accord dans le texte (voir l’image), vraisemblablement due au typographe, a été corrigée ici.
23 Deux pages et un peu plus, qui commencent par « Ce XIVe volume du Journal littéraire de Paul Léautaud contient de telles accusations, formulées par André Rouveyre contre moi, que j’estime indispensable de donner ici quelques précisions. »