Seconde partie, après le deux octobre
Du trois au dix octobre
Le Figaro « Alfred Vallette ou Le Clairvoyant », par Georges Duhamel — La Liberté : « C’est un grand littérateur qui a disparu » — Le Figaro : « Mardi matin, rue de Condé » — Les Nouvelles littéraires : « Un grand serviteur des Lettres » — Le Journal : « Un grand serviteur des Lettres » — Vendémiaire : « Le ménage Vallette-Rachilde »
Le onze octobre et après
Le Temps : « L’Amour du métier — Le Figaro : « Rue Monsieur-le-Prince et rue de Condé », par André Billy — Mercure du quinze octobre : Encadré, par Georges Duhamel — Le Monde illustré : « Alfred Vallette et ses amis » par Gustave Le Rouge — La NRF de novembre : « Un souvenir d’Alfred Vallette », par Adrienne Monnier
Trois au dix octobre
Le Figaro
Ouvrons ce trois octobre par l’article de Georges Duhamel : « Alfred Vallette ou le clairvoyant », en une du Figaro.
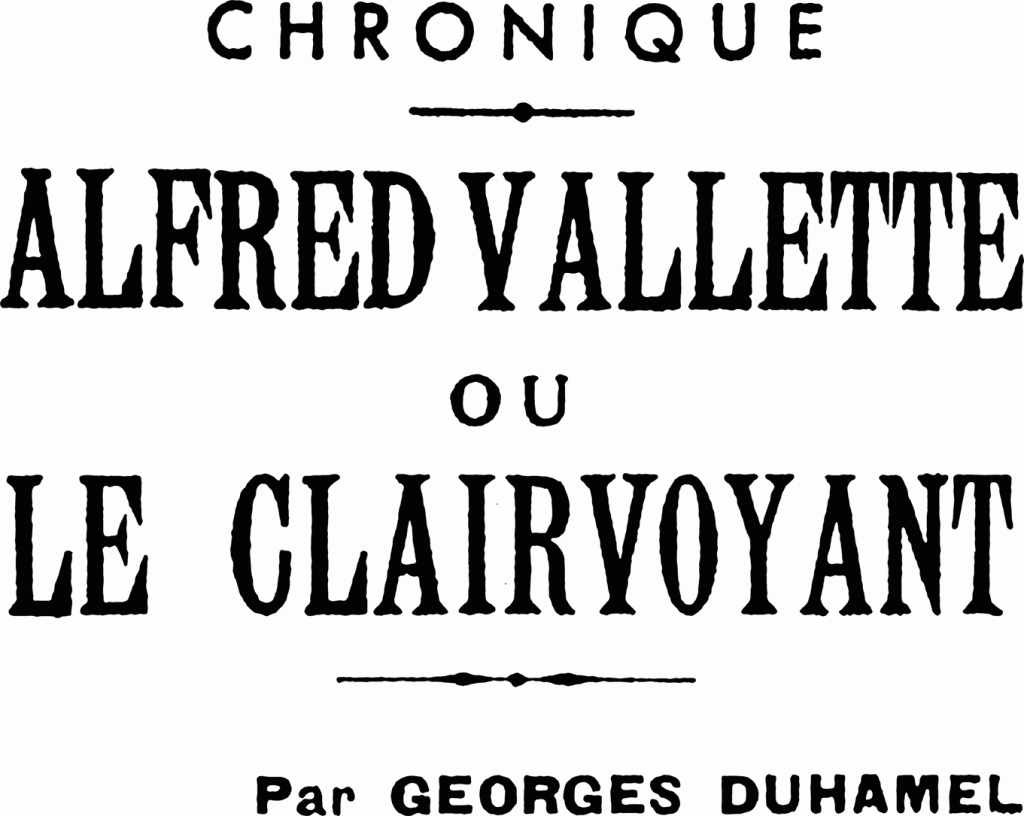
Il était debout dès l’aube et bien avant l’aube en hiver et c’est peut-être pourquoi, réveillé moi-même par maintes pensées tourmenteuses, j’écris cet article à la dernière heure de la nuit. Il me disait : « Rien ne vaut le travail matinal. Je dors un peu après le déjeuner, ce qui me réussit très bien. Comme cela, j’ai deux matins. »
Deux matinées de travail, il ne lui en fallait pas moins pour tout ce qu’il avait à faire.
Assis devant son bureau, sous la flamme ronronnante du bec Auer99, il était à son poste d’observation. Cette lampe démodée que nous allumerons encore ce soir100 éclairant fort bien le siècle. Elle jetait aussi sur le visage des hommes cette honnête et vive clarté dont Alfred Vallette a fait si bon usage.
Le Mercure de France fut et demeure, en effet, pour l’époque, un excellent poste d’observation. C’est une revue littéraire, sans doute, mais aussi une encyclopédie permanente. Tout y est jugé. Tout y laisse trace et témoignage : les événements, les hommes et les ouvrages. Dans aucune autre publication française il n’existe quelque chose de comparable à cette chronique de quinzaine qui touche à toutes les catégories de la connaissance.
Le visiteur de hasard avait sans doute quelque peine à comprendre ce que représentaient, dans le monde de l’esprit, cette étrange maison et ce robuste vieillard. Parce qu’il y avait un peu de poussière sur les rayons des bibliothèques, parce que le téléphone n’avait pas encore fait entendre son appel insolent dans le cabinet d’Alfred Vallette, pour ces raisons et pour plusieurs autres, le passant mal instruit croyait possible de sourire.
Alfred Vallette n’était ni sceptique ni retardataire. Il était le bon sens incarné dans une époque de confusion, de conformisme et d’affolement. Il détestait l’erreur, la sottise, l’à peu près, le hasard. Les grands événements de la guerre et de l’après-guerre, il les a jugés avec une froideur admirable. Il ne refusait pas de marcher : il refusait d’être emporté, roulé, balayé comme un fétu. Je l’approuve de tout cœur, et c’est par hommage exprès qu’en 1930 je lui ai demandé d’accepter la dédicace de mon livre Scènes de la vie future101. Nul mieux que lui ne pouvait comprendre cette critique de la civilisation et en découvrir le sens102.
Si Alfred Vallette était mort en 1928 je l’aurai célébré, du même cœur, mais il m’aurait été plus difficile de démontrer l’excellence de son jugement et de sa méthode. Aujourd’hui, tout proclame cette excellence.
Pendant que le monde s’abandonnait au vertige de la prospérité, Alfred Vallette a gouverné sa maison avec une modération que je tiens pour exemplaire et que l’on a pu dire excessive103. Dois-je déclarer que, pour celui qui a des responsabilités, la modération me semble la plus belle forme de l’audace. Cette maison est restée un refuge d’ordre et de sage économie. Vallette savait très bien que ce qu’on appelait « prospérité » n’était qu’une époque de déséquilibre et que cette époque passerait. Il ne se croyait pas immortel, ainsi que le disait hier Rachilde avec un douloureux sourire. Non, il ne se croyait pas immortel, mais une expérience, même une expérience de dix années ne l’effrayait pas énormément. Quand la crise est venue, quand le désarroi, jour à jour, a gagné le monde, Alfred Vallette a continué de mener sa maison de la même main ferme et prudente : en outre, il a commencé de faire quelques tentatives pour reprendre le rythme de la vie normale. À l’heure où tant de maisons hésitaient et songeaient à fermer leurs porte, Alfred Vallette a tranquillement ouvert la sienne.
Une raison si persévérante ne doit pas paraître glacée. Cette cervelle bien faite était une cervelle humaine.
J’étais un tout jeune homme quand Alfred Vallette me pria de bien vouloir lui faire visite. « Pierre Quillard104 vient de mourir, me dit-il, voulez-vous lui succéder dans ses fonctions de critique littéraire ? Vous n’êtes pas obligé de prononcer l’éloge funèbre du défunt. Ici on n’est pas sentimental. » Cette parole, il m’est arrivé, vingt ans plus tard, de la rappeler à Vallette en ajoutant, instruit que j’étais par une longue fréquentation : « Ici on n’est pas sentimental, mais on est charitable. »
Je viens d’écrire Vallette, tout court. Je n’en ai pas l’habitude. Pour la première fois, hier, devant sa tombe ouverte, je l’ai nommé mon ami. Il était mon ami depuis vingt-cinq ans : un ami à la fois paternel et fraternel. Il m’avait, depuis quelques années, donné part à l’administration de sa maison. Je ne l’ai jamais appelé autrement que Monsieur. Ce simple mot peut contenir beaucoup d’affection et de respect.
Georges Duhamel
Dans les autres journaux on revient aux choses de la vie. Comœdia et L’Œuvre notent que Georges Duhamel devient le directeur du Mercure, qu’André-Ferdinand Herold ancien administrateur, est maintenant président du conseil d’administration, que Jacques Bernard devient administrateur délégué et … que le téléphone va être installé.
La Liberté
La Liberté de ce quatre octobre nous offre un autre article d’un des plus proches collaborateurs de la maison : Henri Mazel.
Journaliste et auteur dramatique, Henri Mazel (1864-1947) est surtout connu pour avoir été, en 1890, le fondateur de la revue L’Ermitage, qui cessera de paraître à la fin de l’année 1906. De 1897 à juin 1940, Henri Mazel a écrit 602 textes au Mercure dont la chronique des « sciences sociales ». Une partie de son œuvre théâtrale en trois volumes édités en 1933 et regroupant huit pièces écrites de 1890 à 1897, était encore disponible en 2021 au Mercure de France mais indisponible de nos jours, le site web de l’éditeur ne proposant « aucun résultat »

Alfred Vallette était une figure éminemment représentative. C’était le Mercure de France, et le Mercure de France c’était le Symbolisme105. Ce pourquoi, sans avoir jamais rien écrit de spécifiquement symboliste. Alfred Vallette c’était le Symbolisme. Et sans doute je force un peu la note, mais, comme disait l’autre, les notes sont faites pour être forcées.
Remontons à la benoîte année 1890 où Vallette, entouré de dix amis (pourquoi pas douze, comme les douze preux, dont il aurait été le bon Charlemagne106 ?), faisait paraître, le 1er janvier, le premier numéro du nouveau Mercure de France, car il y en avait eu déjà un très illustre, aux dix-septième et dix-huitième siècles107. En cette année, Sadi Carnot108 présidait aux destinées de notre troisième République, et tour à tour se succédaient au pouvoir Tirard et Freycinet109. Mais ces événements politiques étaient bien le cadet des soucis des fondateurs du Mercure ! Tous ces vaillants paladins avaient d’autres monstres à pourfendre : le réalisme, le naturalisme, le prosaïsme, le philistinisme. Car c’était la grande invasion des poètes chevauchant sous la bannière de Villiers de l’Isle Adam, de Verlaine, de Mallarmé et sous le signe de Wagner et Gustave Moreau110 !
Comme c’était là un mouvement tout à fait nouveau, rompant en visière111 avec tout ce qui avait alors la faveur du public, les symbolistes durent se créer des tribunes bien à eux, et presque en même temps parurent quatre revues qui eurent chacune leur moment de gloire, le Mercure de France, la Plume, qui l’avait précédé de quelques mois, l’Ermitage, qui le suivit de quelques semaines, et les Entretiens politiques et littéraires. Chose curieuse, les groupes d’écrivains de ces quatre périodiques ne se connaissaient pas ; mais les relations s’établirent vite et, de bon cœur, tous, nous fonçâmes sur les hydres dont je parlais et qui n’en menèrent pas large devant nos glaives flamboyants ! Je dis nous, car je fus de la partie. Et même, ce fut dans le premier numéro de la revue que je fondais alors, l’Ermitage, que l’on pourrait trouver la profession de foi symboliste la plus nette112. Le Mercure de France se contenta, au début, d’être une anthologie de haute littérature, et ce ne fut que peu à peu qu’il devint la grande revue symboliste.
⁂
Comme on le sait, le Mercure de France continue sa glorieuse carrière, alors que Plume, Ermitage, Entretiens113 et bien d’autres ont interrompu la leur ; et cette continuité fait le plus grand honneur d’Alfred Vallette, qui a dirigé jusqu’à sa mort la revue et qui lui a fait franchir, surtout au début, les passages les plus difficiles. C’était un administrateur hors ligne et un directeur littéraire de la plus haute valeur. Pendant près d’un demi-siècle, il a surveillé chaque numéro, encouragé chaque collaborateur, préparé chaque livraison suivante. Buloz114 n’était pas plus identifié à la Revue des Deux Mondes, ou Mme Adam à la Nouvelle Revue115, que Vallette au Mercure. Et notez qu’à la revue, Alfred Vallette avait joint, d’assez bonne heure, une maison d’édition qui, elle aussi, a joué et joue encore un rôle de premier ordre dans la production littéraire française. Il y a des revues et des librairies qui peuvent disparaître sans que rien ne soit changé dans le monde des lettres ; mais songez au désastre que ç’eût été si le Mercure de France, confié à un administrateur moins sérieux, avait été obligé de suspendre ses livraisons ou ses éditions !
Sans doute, le succès du Mercure tient aussi à ses collaborateurs. Rarement on a vu réunie une pareille pléiade de poètes, de penseurs, de prosateurs d’art. Ne parlons que des morts : on ne comprendrait pas le Mercure sans Remy de Gourmont ou sans Louis Dumur. Mis à côté d’eux, Alfred Vallette jouait bien son rôle de pondérateur, d’animateur, de directeur au beau sens complet du mot. Peut-être qu’à sa place Gourmont, quoique une des plus hautes intelligences de son temps, n’aurait pas mené la barque avec autant d’habileté. Jamais on ne rendra assez justice aux très précieuses qualités d’Alfred Vallette.
⁂
Ce n’était pas d’ailleurs simplement un commandant de littérateurs, c’était un littérateur lui-même et sachant manier sa plume comme pas un. S’il n’avait pas été absorbé par sa besogne administrative, vraiment écrasante, il aurait écrit, comme ses amis, des poèmes, des drames, des romans. Que dis-je ? il en a écrit ! Sa Grenouille du jeu de tonneau, qui parut dans un des premiers numéros du Mercure, était un très joli petit poème philosophique à la mode d’alors, et son roman le Vierge mériterait d’être mis à côté des meilleurs du temps présymboliste, car il est assez curieux que beaucoup de futurs symbolistes ont débuté par des œuvres assez réalistes. Au surplus, si Vallette n’a pas écrit la douzaine de romans qu’il aurait pu publier, sa femme l’a remplacé, car on sait que Mme Vallette c’est Rachilde, et que Rachilde est certainement la femme la plus remarquable de notre littérature depuis un demi-siècle.
Et voilà que cet excellent Alfred Vallette n’est plus ! Tous ceux qui l’ont connu le regretteront, car il était impossible de trouver un homme plus honnête, plus loyal, plus sensé, plus courtois ; il vous aurait réconcilié avec la gent parfois discutable des éditeurs et des directeurs. Sur son compte, il n’y a jamais eu qu’une voix et cette voix n’a été que de louange respectueuse et affectueuse. Puisse le Mercure s’inspirer de son souvenir et continuer à être l’admirable revue, d’indépendance souveraine et de probité indéfectible, pour ne pas parler de talent et de science qu’il a été jusqu’ici !
Henri Mazel
Le Figaro du cinq octobre
Mardi matin, rue de Condé
par André Rousseaux
Mardi matin, rue de Condé, le nombre et la qualité du rassemblement parisien que les obsèques d’Alfred Vallette avaient suscité témoignaient que ce n’est pas une œuvre vaine que de vouer sa vie aux lettres. Cette foule d’amis représentait exactement, sous l’aspect de plusieurs centaines de figures diverses, ce que la littérature avait été pour le directeur-fondateur du Mercure de France : une réalité supérieure, qui vaut assez en soi pour que ce qu’il peut s’y ajouter de gloire mondaine soit négligeable. Toute pompe officielle était absente de ces funérailles. Mais les élites qui étaient là s’y trouvaient en tant qu’élites. Tel académicien n’était pas reconnaissable à l’uniforme lauré de vert, car il ne l’avait pas arboré. Mais sous le porche du Mercure, auprès du cercueil où gisait celui qui avait été le maître de la maison du symbolisme, il était tout simplement un des grands poètes de la France contemporaine, ce qui est probablement une plus sûre garantie d’immortalité.
C’est un bien grand mot que celui-là, et tous les efforts que les hommes font pour se survivre ne doivent pas les leurrer sur les chances qu’ils ont d’y parvenir ici-bas. Je pense au mot de Mme Rachilde sur Vallette que M. Georges Duhamel rapportait avant-hier dans ce journal : « Il ne se croyait pas immortel. » Il n’empêche que, mardi matin, l’émotion que les amis d’Alfred Vallette ressentaient de sa mort était accrue du sentiment qu’ils éprouvaient au sujet de son œuvre. Un sentiment où l’espoir et l’anxiété étaient mystérieusement mêlés. Une phrase était sur toutes les lèvres : « C’est toute une époque qui s’en va. » Mais aussitôt, au fond des cœurs, une voix intérieure répondait : non. Une époque, le Mercure ? Une époque, le symbolisme ? Sans doute par l’aspect des choses. Mais les choses qui comptent valent par leur vie profonde. Elles portent en elles quelque chose qui ne vieillit pas, partant qui risque moins de mourir.
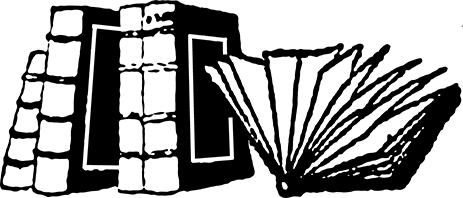
Des hommes de toutes les générations se mêlaient aux contemporains du symbolisme pour suivre les funérailles d’Alfred Vallette. On ne pouvait pas ne pas se souvenir, en les voyant, que le Mercure de France a toujours été lu par la jeunesse intellectuelle, au moins par celle qui est fervente de poésie. Alain Fournier et Jacques Rivière ont dit comment, vers 1905, des étudiants et des lycéens se cotisaient pour en acheter les fascicules. La vieille maison du Mercure ; dont la poussière et les coutumes d’autrefois sont devenues légendaires, possède la jeunesse la plus sûre : la jeunesse d’âme. L’amour de la poésie lui a valu ce privilège. C’est ce que le symbolisme avait au fond d’essentiel, par de-là des procédés et des modes d’expression. C’est le talisman qu’en mourant Alfred Vallette a légué à ses successeurs, et qui fait que son œuvre ne mourra pas avec lui.
C’est bien le moins que les hommes qui ont tout ordonné par rapport aux valeurs de l’esprit — ce qui est l’ordre véritable — aient plus de chance de mettre ce qu’ils ont accompli à l’abri des accidents matériels (leur propre mort étant le plus sûr de tous). Quand l’univers aura achevé de faire faillite, on s’apercevra que les valeurs morales sont encore le placement le plus sûr. Cela apparaît lumineusement, en tout cas, à ce tournant de l’histoire du Mercure, qui est aussi un chapitre important de notre histoire littéraire.
M. Georges Duhamel a dit quel trésor impalpable mais certain Alfred Vallette, avec ses amis, avait ainsi capitalisé dans l’hôtel vétuste de la rue de Condé. Sa modestie ne lui permettait pas d’ajouter que dans ce groupe d’hommes passionnément fidèles à la haute idée qu’ils se sont faite du culte des lettres et des arts, il a mérité depuis longtemps d’occuper une place de choix. Il n’y avait pas de plus haute raison pour qu’il fût appelé à la succession d’Alfred Vallette, à la direction du Mercure de France. On peut dire que la relève se fait du meilleur au meilleur. À l’amour des lettres qu’il tient de l’héritage symboliste, le nouveau directeur joint un sens de son siècle, si je puis ainsi parler, qui n’est pas moins nécessaire, aujourd’hui, à un poste de direction intellectuelle. Que l’auteur de Civilisation et des Scènes de la vie future se trouve à la tête du Mercure, voilà une opération de continuité à peu près parfaite, où la durée est renforcée par le rajeunissement. C’est une des réussites les plus rares dans les choses humaines. Quand tant de choses humaines vont si mal, il est salutaire que ce soit dans un des coins de Paris où depuis cinquante ans le culte de l’esprit est en honneur que cet exemple nous soit donné.
André Rousseaux
Les Nouvelles littéraires du cinq octobre

Le chartiste et poète symboliste Gustave Kahn (1859-1936) a été très actif dans de nombreuses petites revues progressistes. Il a écrit 344 articles dans le Mercure de France entre 1895 et 1939, essentiellement la rubrique d’art. Gustave Kahn a fait partie des Poètes d’aujourd’hui dès la première édition de 1900. Sa notice a été rédigée par Adolphe van Bever.
Où ai-je vu, pour la première fois, au début d’environ cinquante ans d’amitié, Alfred Vallette ? C’était où se rencontrent, le plus souvent, les jeunes hommes, un café de la rive gauche où Victor Margueritte116, alors tout jeune poëte, nous avait réunis un soir, lui, Ponchon117 et moi. Vallette me frappa par son grand aspect de calme et de sérénité. Le regard était doux ; la mise (un complet bleu), plus correcte que celle de la plupart des jeunes écrivains. Je sus qu’il avait un second métier assez absorbant118. Ce qui ne l’empêchait point d’écrire et de publier. Je ne me souviens plus si son roman, Le Vierge, était paru ou allait paraître. Il dirigeait le Scapin, petite revue éphémère aussi spirituelle que les autres petites revues symbolistes étaient graves et hiératiques. Sans doute, il se formait déjà, au Scapin, à son rôle de grand administrateur. Il y apprenait ce qu’il ne fallait pas faire. Vallette, alors, n’était point ce que l’on appelait symboliste. Il eût plutôt compté parmi les décadents. Il y avait, en ce temps lointain, des différences. Un petit groupe de romanciers, dont Rachilde était le talent le plus reconnu, voulait ajouter à la méthode naturaliste plus de fantaisie, de souplesse, de pittoresque, de style, avec des recherches d’observation aiguë et exacte de la vie des âmes et des investigations dans les limbes de la sexualité et de tout l’imprévu humain. Le titre du roman de Vallette indique sa préoccupation esthétique. Mais il arriva qu’un groupe de jeunes gens fort intéressants pensa à fonder une revue, plutôt à en reprendre une qui s’étiolait, La Pléiade. Jules Renard, Louis Denise, Aurier, d’autres encore, connaissaient les qualités de fond de Vallette. Ils le portèrent à la direction. Vinrent Dumur et Gourmont. Le Mercure était fondé.
Aucune des jeunes revues antérieures au Mercure ne se soucia de se choisir un administrateur. Qu’était-ce alors qu’une jeune revue ? Mallarmé la définissait : « Un bolide qui va trouer l’horizon d’une tache lumineuse et proclamer la gloire de quelques nouveaux écrivains ». Le trait de génie d’Alfred Vallette fut de se demander si avec les beaux éléments littéraires dont il disposait, il ne pouvait pas fonder une œuvre d’avenir, de décider que oui, de se mettre tout de suite à la besogne avec une ténacité résolue et un admirable désintéressement. Il y faut insister : le Mercure est né de dévouements obstinés. Quelques cotisations, menues semailles jetées dans un sol avare ont pu, par la force du temps, prendre forme d’opulentes moissons. Ce fut une bonne fortune qu’un ami dévoué de Vallette et de Rachilde, le bon romancier Louis Dumur obtint un préceptorat en Finlande. Il put augmenter ses cotisations, et ce fut pour le Mercure une belle aurore. Je ne sais si Léautaud qui a écrit les petits mémoires du Mercure (à paraître dans un avenir qu’il se réserve de fixer) ne nous fera pas apercevoir l’histoire des difficiles tournants financiers des débuts119, des mauvais moments que Vallette eut à traverser avec sa haute probité, sa résolution de ne jamais s’endetter, ni jamais s’inféoder. Certainement, si Vallette résista à tout et créa tant, son désintéressement et l’absolue simplicité de sa vie y furent pour beaucoup.
Le Mercure, revue, avait pris sa place. Vallette, vers 1895, se décida à tenter l’édition. Son rêve : publier les méconnus (il n’en manquait point alors dans le symbolisme) de façon à pouvoir dire un jour aux autres éditeurs : « Voici la belle collection que vous avez négligé de réunir et que nous avons formée. » II n’y a pas échoué, et son éclectisme a su grouper de beaux livres sur les rayons de sa librairie. Il connut très rapidement la chance, d’abord le premier succès de public d’un poète symboliste, du Jardin de l’Infante, d’Albert Samain, puis le Latin mystique de Remy de Gourmont120 intéressa tous les lettrés, enfin éclata le triomphe d’Aphrodite, en millions d’exemplaires. La maison devenait illustre et solide.
Les idées nouvelles n’effrayaient point Vallette, mais il entendait garder du vieux jeu ce qu’il avait avantage à en conserver. Il n’admettait point qu’un coup de téléphone subit et impérieux le dérangeât de son travail. Il était si précis dans ses engagements et préparations qu’il n’avait jamais besoin de téléphoner.
Il se levait dès l’aube et son travail était assez avancé vers les dix heures pour qu’il pût recevoir des visiteurs. II avait imposé sa ponctualité à tout son entourage. Le Mercure n’attendait personne. La préparation du numéro se poursuivait automatiquement. Les retardataires à envoyer leurs textes étaient ajournés au numéro suivant. Mais cela n’arrivait guère, car on savait que les délais le contristaient et on tenait, amicalement, à ne lui être point désagréable. Cette puissance à éveiller l’affection, chez un homme qui semblait placide et mesuré, est un des traits de son caractère, une expression très forte et quasi-générale de son visage tel qu’il survivra en nos mémoires et apparaîtra par des amis aux lettrés qui viendront et aux biographes qui le compareront, pour l’importance de ce qu’il a fondé, à François Buloz.
Gustave Kahn
Le Journal du six octobre
Un grand serviteur des lettres
Par Georges Le Cardonnel
Ce fut un douloureux deuil pour les lettres que la mort d’Alfred Vallette. Un livre pourra être écrit, un jour, avec ce titre : Alfred Vallette et ses amis ou cinquante ans de lettres françaises. Et tout de suite une comparaison vient à l’esprit : celle d’Alfred Vallette, fondateur du Mercure de France, et de François Buloz, fondateur de la Revue des Deux Mondes121. Il y eut même une certaine similitude entre les naissances de ces deux grandes revues, à près de 60 années d’intervalle. La Revue des Deux Mondes naquit en 1831, d’une revue appelée La Revue des Deux Mondes, journal des voyages, qui se mourait et dont François Buloz releva le titre en le modifiant à peine ; le Mercure de France naquit, lui, d’une revue qui venait de mourir, intitulée la Pléiade.
Jules Renard a raconté, non sans humour dans son « Journal », la fondation de la Pléiade122. Elle n’eut, je crois bien, qu’un numéro123. Sa renaissance, sous le titre de Mercure de France, fut décidée à la suite d’une causerie entre Édouard Dubus, G. Albert Aurier et Louis Dumur, en un café, aujourd’hui disparu du quartier Latin, le Café François Ier(124). Après avoir discuté longtemps sur la question de savoir si la nouvelle revue garderait son ancien titre, ils décidèrent qu’elle ferait revivre l’ancien Mercure de France, pour être l’organe des dernières rénovations littéraires. C’est pourquoi le Mercure de France a porté longtemps sur sa couverture cette mention « fondé en 1672, série moderne125 ». En même temps, Édouard Dubus, G. Albert Aurier et Louis Dumur pensèrent qu’un seul homme était capable de mener à bien cette œuvre en se mettant à sa tête, c’était Alfred Vallette. Il paraît que lors qu’ils lui eurent exposé tous les avantages de cette nouvelle fondation, en même temps que la beauté et l’opportunité de leur projet. Alfred Vallette leur demanda un quart d’heure pour réfléchir après quoi, il accepta. Lui-même s’empressa d’aller conquérir Albert Samain et Louis Denise, lequel, attaché à la Bibliothèque nationale, amena son collègue Remy de Gourmont ; Édouard Dubus, de son côté, attira Jean Court ; G. Albert Aurier rallia Julien Leclercq. : Louis Dumur convainquit Ernest Raynaud aujourd’hui le seul survivant, lequel décida Jules Renard.
Quelques jours après, l’assemblée de fondation avait lieu au Café Français, près de la gare Saint-Lazare ; le 25 décembre 1889, Le Mercure de France paraissait avec la date de janvier 1890 et le premier fascicule qui avait trente-quatre pages annonçait : « Aujourd’hui que La Pléiade devient Le Mercure de France126… »
À partir de ce moment commença pour Alfred Vallette une existence toute nouvelle, consacrée entièrement à sa revue. Il venait de publier un roman Le Vierge, qui avait été très remarqué ; il sacrifia à l’avenir du Mercure de France sa production littéraire. Et le Mercure de France, d’abord mensuel, plus tard bimensuel127, qui eût pu avoir le sort de tant d’autres jeunes revues de ce moment-là, en traversant le ciel littéraire comme un météore plus ou moins brillant, devint avec les années, sous la direction et l’administration d’Alfred Vallette, une revue dépassant en intérêt l’actualité de la quinzaine et du mois, grâce à ses chroniques régulières, une véritable encyclopédie des connaissances et des productions intellectuelles de notre temps en même temps qu’elle découvrait des talents nouveaux.
Si Alfred Vallette connut le bonheur d’avoir près de lui une compagne de luttes admirable en Rachilde, il rencontra en deux hommes. Remy de Gourmont et Louis Dumur, dont la curiosité était universelle, les meilleurs collaborateurs qu’il pouvait souhaiter. Louis Dumur est mort il y aura bientôt deux ans, et les dernières lignes écrites par Alfred Vallette l’auront été pour marquer en tête du dernier numéro du Mercure de France le vingtième anniversaire de la mort de Remy de Gourmont, survenue le 27 septembre 1915. Ainsi Alfred Vallette est mort exactement vingt ans et un jour après son grand ami. Les lignes qu’il aura écrites à l’occasion de cet anniversaire semblent aujourd’hui une sorte de testament. Parlant de la collaboration de Remy de Gourmont au Mercure de France, il dit : « Il y donna le meilleur de son œuvre, jouissant du rare bienfait, comme toute la rédaction d’ailleurs, de pouvoir s’exprimer sans contrainte. Il l’atteste ainsi dans la préface posthume du tome VI des Promenades littéraires « C’est ce principe de liberté qui a permis l’éclosion de ma personnalité. Où je ne suis pas libre, je ne suis plus moi. » « Ce témoignage, a ajouté Alfred Vallette, nous est infiniment précieux. »
Quand on lit ce qu’a écrit Mme Marie-Louise Pailleron128 sur François Buloz dans François Buloz et ses amis129 ; « donnait à tous l’impression de la force tranquille et laborieuse, puis aussi, il avait le don de discerner le talent chez les très jeunes. N’a-t-on pas dit de lui que c’était un « sourcier » ; on pense aussitôt que cet éloge pourrait aussi justement s’appliquer à Alfred Vallette que M. Georges Duhamel, appelé à lui succéder à la direction du Mercure de France, vient de nommer si justement dans Le Figaro : « Alfred Vallette ou le Clairvoyant ».
Georges Le Cardonnel
La « Causerie littéraire » d’Albert Gavy-Bélédin (1892-1972) dans Le Phare de la Loire, intéressante en elle-même, n’apporte plus rien que nous ne connaissions déjà.
« L’Hommage d’Alfred Vallette à Remy de Gourmont » paru dans le Comœdia du huit octobre (page trois), intéressera davantage nos amis les amateurs de Remy de Gourmont, qui l’ont certainement publié.
Dans Le Petit Journal du neuf octobre, page deux, Léon Treich intitule son article « Le Téléphone et l’électricité au Mercure de France » et nous confirme au passage que c’est Alfred Jarry qui a dessiné le Mercure figurant sur les couvertures du Mercure130.

L’article non signé de Marianne du neuf octobre, chronique « Sous la lampe », deux belles demi-colonnes en centre de page, n’apporte aucun renseignement supplémentaire par rapport à ce que nous venons de lire.
Vendémiaire dans La Liberté du dix octobre
De nombreuses revues, rarement sympathiques mais toujours éphémères, portent ce nom, dont une parue sur cinq numéros en 1891. Une autre a duré cinq ans (9 numéros !) sous la direction de Paul Brulat (1866-1940), une troisième, sise à Clermont-Ferrand a duré près de sept années avant la première guerre mondiale. On sait peu de choses de tout cela et moins encore de celle qui nous intéresse, active en 1935, évoquée par le quotidien La Liberté, qui en reproduit des extraits d’un article de Maurice Verne :
Le ménage Vallette-Rachilde
Jolie peinture du foyer de l’éditeur disparu et de la romancière, sa femme, par Maurice Verne131, dans Vendémiaire :
Une porte basse, cachée, menait au foyer qui était farouchement défendu. Le foyer… des petits bouts de couloirs tournants aux degrés successifs, un frais tapis de linoléum blond, une chambre pareille à une cellule. Des livres sur la table, sur les chaises, Rachilde lisait tout. Chambre de jeune fille et cellule de cloître dont la fenêtre s’emplissait d’un air un peu vert réfléchi d’antiques murailles.
Ils se réfugiaient là, Alfred Vallette et Rachilde, l’un et l’autre avertis, cuirassés, blindés, mon Dieu ! oui blindés, nobles et grands comme un ménage d’autrefois. Lui, c’était alors le vieux Plantin132 mais un Plantin quasi monacal dans cette existence de travail qu’il commençait à l’aube. Seuls, ceux — ils ne sont pas beaucoup — qui ont entendu ces éblouissantes conversations du mari et de la femme, dans la petite chambre au jour vert, savent le prix de cette douceur de vivre qui, en plein vertige contemporain, ne reposait que sur la confiance mutuelle, l’enthousiasme, l’intelligence. Pour ma part, je n’ai vécu des heures pareilles que chez Séverine133, cette vieille Française de chez nous, gaie et cultivée, quand, pour deux ou trois amis sûrs, elle ouvrait son cœur sous le manteau de la grande cheminée paysanne de Pierrefonds où de grandes bûches éclairaient seules le hall en le chauffant…
Le foyer d’Alfred Vallette, c’était l’oasis, dans la jungle, qui a remplacé le désordre sentimental et bohème, mais aussi la grande fraternité de la rive gauche d’il y a trente ans.
En partant, Alfred Vallette a emporté dans sa bière les vingt ans généreux de bien des hommes, le meilleur d’eux-mêmes…
Onze octobre et après
Le Temps
L’Amour du métier
par Jacques Boulenger134
On a dit ici en termes excellents tout ce qui convenait sur Alfred Vallette, l’ancien directeur du Mercure de France qui vient de mourir et qui fut un si remarquable animateur. Peut-être serait-il possible d’ajouter, un trait à l’honneur de sa mémoire touchant la passion exclusive qu’il apportait aux choses de son métier.
À une époque où si peu de gens peuvent se flatter de posséder le leur135 et où une plus petite quantité encore se glorifient de l’aimer, ce métier exigeant, un original comme Alfred Vallette s’était consacré à lui à jamais, et ne voulut plus chercher d’autre but à son activité du jour où le hasard le lui fit connaître. Car le piquant de l’aventure est que ce futur éditeur ne le devint, comme on sait, que par occasion, ayant été choisi par ses camarades de lettres pour diriger la petite revue qu’ils s’efforçaient de rédiger en commun.
Fait plus étonnant encore : cet écrivain consentit presque sur-le-champ à abandonner ses ambitions littéraires pour se consacrer à la tâche, plus modeste en apparence, d’éditer ses confrères. C’est un trop joli trait de modestie pour qu’on ne le souligne pas.
Les circonstances mêmes dans lesquelles il abordait cette profession si nouvelle pour lui donnèrent sans doute un tour particulier à son activité et contribuèrent à créer l’originalité de sa figure d’éditeur. On en avait, du moins, l’impression en approchant Alfred Vallette et en causant avec lui. On comprenait qu’il avait réfléchi profondément aux conditions mêmes de ce métier où il avait dû s’improviser patron sans avoir jamais été apprenti. Il y avait pénétré par effraction en quelque sorte, jetant sur ce monde nouveau un regard d’autant plus perspicace que non averti, glanant des observations curieuses, faisant des remarques judicieuses et toujours marquées au coin du plus parfait bon sens. Ainsi il avait tourné et retourné bien des aspects de ces questions familières depuis longtemps aux professionnels, et il avait trouvé souvent des solutions ingénieuses, inattendues à force de simplicité, car nul n’était moins alambiqué que lui et personne, on le sait, n’avait plus horreur des complications de la vie moderne.
Comme tous les gens que possède une passion, il aimait volontiers en parler. On pouvait l’interroger sur sa profession : inlassablement il en discourait. Que de gens seront venus ainsi le consulter, avec fruit, et auront profité de son expérience en bavardant avec lui dans son grand bureau de la rue de Condé ! Alfred Vallette se gardait, du reste, de tout dogmatisme : il avait dans l’esprit trop de scepticisme pour ne pas mêler un grain d’ironie à ses remarques et à ses conseils. Et c’est presque toujours avec un sourire en coin digne des meilleurs sourires de Jules Renard qu’il ponctuait ses observations.
Ainsi, par cet amour exclusif pour son métier, par la claire intelligence avec laquelle il le comprenait, se complète cette physionomie morale de celui qui fut un bel animateur dans le commerce du livre français. Par là aussi sa figure s’apparente à celle de tant d’autres éditeurs du passé.
En peu de professions autant que dans celle-là on a l’orgueil légitime de la tâche : tous ceux qui y ont laissé un nom ont manifesté cette même qualité d’amour-propre poussée, parfois jusqu’à l’excès. Même les amateurs comme Balzac surent se passionner pour un caractère typographique ou la disposition d’une page. Et l’on sait les soucis et les transes d’un Péguy sur ce même thème. Peut-être est-ce le commerce quotidien avec des écrivains — gent assez irritable, comme l’on sait, sur la valeur des signatures, et particulièrement de la leur — qui donne plus ou moins à chaque éditeur l’ambition de représenter par sa firme ce qu’il y a de meilleur dans sa partie. Péché véniel, qui n’est qu’une petite poussée d’amour-propre, bien excusable, après tout, chez quelqu’un dont la signature s’étale au-dessous de celle de l’auteur. Péché pardonnable si l’on songe aux représentants de tant d’autres professions qui n’ont ni le goût de leur travail, ni l’amour-propre de leur rang social. — J. B.
Le Figaro
Dans son « Courrier des lettres » du Figaro du onze octobre, André Billy rapproche la mort d’Antoine Albalat le 21 septembre et celle d’Alfred Vallette, mort huit jours plus tard.
Antoine Albalat (1856-1935), est surtout connu pour ses ouvrages sur la théorie de l’écriture. On lui doit notamment : Le Mal d’écrire et le Roman contemporain, Flammarion début 1895 (dédié à Juliette Adam), son bestseller L’Art d’écrire enseigné en vingt leçons (Armand Colin 1899, 326 pages), La Formation du style par l’assimilation des auteurs, (Armand Colin 1902), etc. Lire dans Le Pont des Saints-Pères, d’André Billy, le chapitre II : « Le Groupe Albalat ». On pourrait être tenté de lire d’Antoine Albalat, Trente ans de quartier latin « nouveaux souvenirs de la vie littéraire » signalé note 136 mais ce n’est pas une si bonne idée que ça.
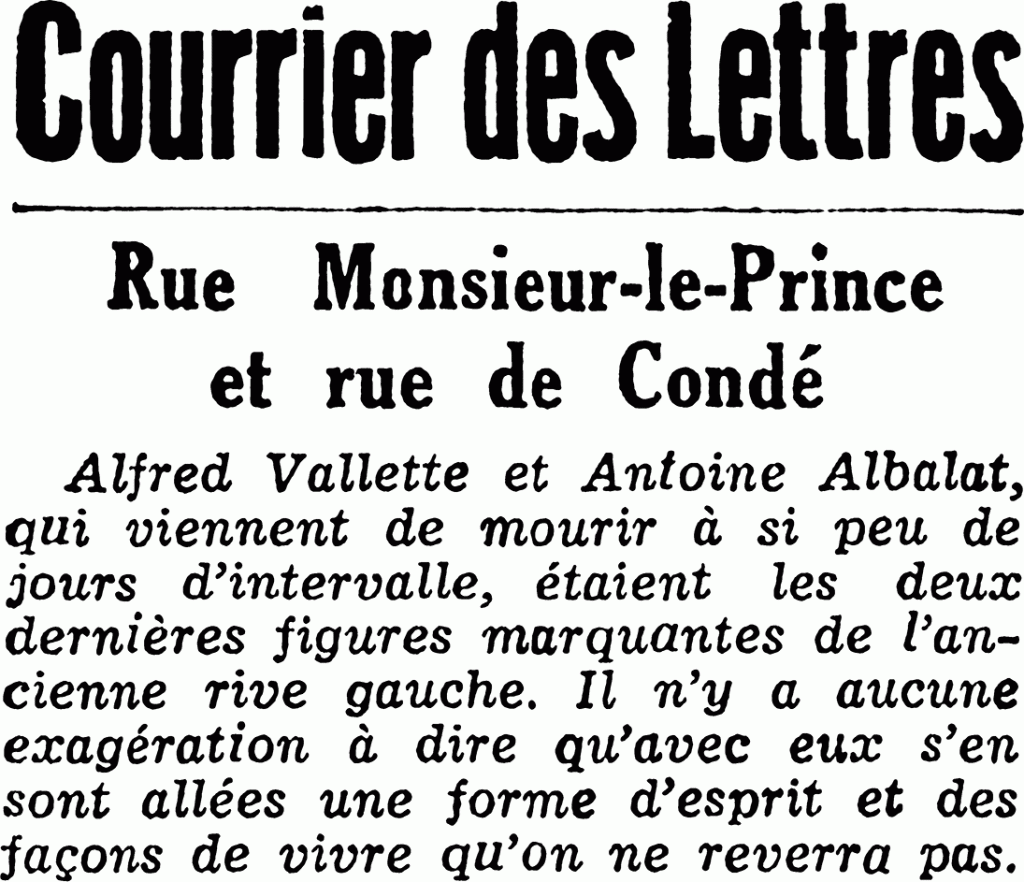
Courrier des Lettres
Rue Monsieur-le-Prince et rue de Condé
Par André Billy
Alfred Vallette et Antoine Albalat, qui viennent de mourir à si peu de jours d’intervalle, étaient les deux dernières figures marquantes de l’ancienne rive gauche. Il n’y a aucune exagération à dire qu’avec eux s’en sont allées une forme d’esprit et des façons de vivre qu’on ne reverra pas. Ils offraient au moins un trait commun ils donnaient l’impression de gens qui « avaient le temps ». Nous n’avons plus le temps. Ils l’avaient encore. Albalat, on était toujours sûr de le rencontrer au café136. Il y passait au moins deux heures par jour. Vallette était, à ce point de vue, plus extraordinaire encore on ne le dérangeait Jamais. Il avait toujours un quart d’heure à vous donner, sinon bien davantage. La porte de ce grand éditeur, de ce grand directeur de revue n’était jamais fermée, jamais gardée. Vous n’aviez qu’à la pousser, vous étiez devant lui il ne vous restait qu’à vous asseoir ou à vous accouder à la tablette de son bureau, dans une attitude que tant d’entre nous se souviendront d’avoir prise ; bien plus pour l’écouter que pour lui parler. Car il parlait beaucoup, et de préférence de sujets totalement étrangers à l’objet de votre visite, lequel avait été tout de suite réglé, liquidé en quelques phrases concises et nettes.
Et pourtant, Vallette et Albalat ont été d’acharnés travailleurs. Mais ils avaient un secret, le même : ils se levaient l’un et l’autre à cinq heures, parfois à quatre heures du matin. Au moment où les autres se lèvent ; leur journée était déjà bien avancée, elle était presque finie : Ils n’avaient plus, pour tuer le temps, qu’à regarder défiler les marionnettes. À propos d’Albalat, on a parlé de noctambulisme, et, en effet, Albalat avait été noctambule, mais il avait bien changé. Après avoir dîné d’une tasse de chocolat, il se couchait à neuf heures. Vallette ne devait pas suivre un régime très différent. L’aube n’était pas encore près de poindre que déjà, dans la rue de Condé et dans la rue Monsieur-le-Prince, qui se font pendant de part et d’autre de la rue de l’Odéon, deux fenêtres s’éclairaient à la façade de deux vieilles maisons la fenêtre de Vallette et la fenêtre d’Albalat. Elles se sont éteintes et je n’y pense pas sans tristesse.
Mais pourquoi faut-il que ces choses ne prennent tout leur prix que lorsque nous les avons perdues ? Pourquoi faut-il qu’ils soient morts pour que nous nous avisions de ce que nos amis représentent d’originalité savoureuse et de valeur humaine, et que notre civilisation affaiblie n’est plus capable de reconstituer ?
André Billy
L’Européen
La page onze de l’hebdomadaire L’Européen « Économique et littéraire » du onze octobre est très en rapport avec ces lignes. La page ouvre avec un article commémorant le centième anniversaire de Juliette Adam, citée ici note 115. Pourquoi évoquer ce centième anniversaire qui n’interviendra que dans un an et que Juliette, à un mois près, ne connaîtra pas ? Suit une colonne sur Alfred Vallette (qui ne nous apprend rien) et une autre sur Remy de Gourmont, nous savons pourquoi.
Mercure du quinze octobre
Le Mercure du quinze octobre ouvre par deux pages encadrées de noir en hommage à Alfred Vallette, rédigées par Georges Duhamel.
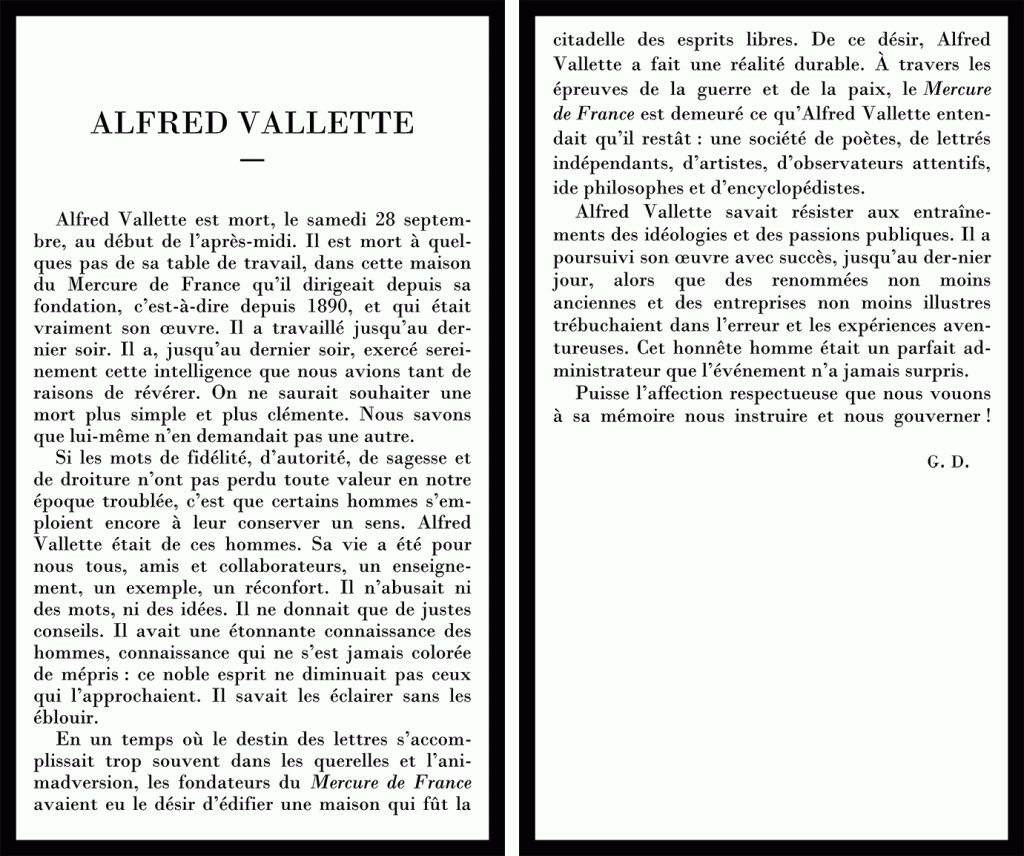
Image très exactement reconstituée ».
Alfred Vallette est mort, le samedi 28 septembre, au début de l’après-midi. Il est mort à quelques pas de sa table de travail, dans cette maison du Mercure de France qu’il dirigeait depuis sa fondation, c’est-à-dire depuis 1890, et qui était vraiment son œuvre. Il a travaillé jusqu’au dernier soir. Il a, jusqu’au dernier soir, exercé sereinement cette intelligence que nous avions tant de raisons de révérer. On ne saurait souhaiter une mort plus simple et plus clémente. Nous savons que lui-même n’en demandait pas une autre.
Si les mots de fidélité, d’autorité, de sagesse et de droiture n’ont pas perdu toute valeur en notre époque troublée, c’est que certains hommes s’emploient encore à leur conserver un sens. Alfred Vallette était de ces hommes. Sa vie a été pour nous tous, amis et collaborateurs, un enseignement, un exemple, un réconfort. Il n’abusait ni des mots, ni des idées. Il ne donnait que de justes conseils. Il avait une étonnante connaissance des hommes, connaissance qui ne s’est jamais colorée de mépris : ce noble esprit ne diminuait pas ceux qui l’approchaient. Il savait les éclairer sans les éblouir.
En un temps où le destin des lettres s’accomplissait trop souvent dans les querelles et l’animadversion137, les fondateurs du Mercure de France avaient eu le désir d’édifier une maison qui fût la citadelle des esprits libres. De ce désir, Alfred Vallette a fait une réalité durable. À travers les épreuves de la guerre et de la paix, le Mercure de France est demeuré ce qu’Alfred Vallette entendait qu’il restât : une société de poètes, de lettrés indépendants, d’artistes, d’observateurs attentifs, de philosophes et d’encyclopédistes.
Alfred Vallette savait résister aux entraînements des idéologies et des passions publiques. Il a poursuivi son œuvre avec succès, jusqu’au dernier jour, alors que des renommées non moins anciennes et des entreprises non moins illustres trébuchaient dans l’erreur et les expériences aventureuses. Cet honnête homme était un parfait administrateur que l’événement n’a jamais surpris.
Puisse l’affection respectueuse que nous vouons à sa mémoire nous instruire et nous gouverner !
G. D.
Le Monde illustré du 19 octobre
Alfred Vallette et ses amis
par Gustave Le Rouge
Gustave Le Rouge (1867-1938) est surtout connu par ses romans d’aventures ou d’anticipation, au nombre de 312, dit-on. On peut avoir en tête des titres comme Le Prisonnier de la planète Mars (Albert Méricant 1912), La Guerre des vampires (même éditeur, 1909) ou Le Mystérieux Docteur Cornélius (Maison du Livre Moderne, 18 fascicules 1912-1913).
Le Monde illustré est un hebdomadaire de vingt pages et a laissé à Gustave Le Rouge la place qu’il a bien voulu prendre, deux pages illustrées de six photographies.
L’Alfred Vallette et ses amis de Gustave Le Rouge arrive bien tardivement et donne une impression de compilation de tout ce qui a été dit précédemment.
L’Action française du 23 octobre
« Carnet des lettres des sciences et des arts »
Alfred Vallette, par Orion
Alfred Vallette, qui mort naguère138 â soixante-dix-huit ans, a grandement mérité, par un don de soi absolu, et si l’on peut dire parfaitement administré aux intérêts de la littérature, que la république des lettres reconnaisse et honore ce qu’on eût appelé autrefois les « services » qu’elle lui doit. Léon Daudet les a dits avec éclat. Orion139 veut joindre modestement à ce magnifique hommage un tribut auquel Alfred Vallette a droit dans toute chronique littéraire.
Né de petits commerçants, à Paris, il était jeune mécanicien, passionné pour son métier, quand son appétit de lecture lui fit rencontrer les œuvres de Flaubert. L’enthousiasme littéraire dont il fut soudain enflammé allait bientôt lui faire quitter, non sans regret, l’étau et l’enclume. Il se mit à hanter des groupes de jeunes écrivains, puis écrivit lui-même des essais pour les journaux et les petites revues. On sait combien, vers 1890, celles-ci pullulaient, la plupart vouées à mourir, jeunes, chacune groupant sa phalange de jeunes auteurs inégalement riches d’avenir, mais parmi lesquels plus d’un était promis à la gloire. L’Ermitage, La Plume, les Chroniques resteront sans doute les plus célèbres ; aucune ne saurait être comparée pour la durée, pour le rôle qu’elle a tenu, pour le nombre des écrivains remarquables dont elle a aidé l’essor, à celle que fonda Alfred Vallette, le Mercure de France.
La première équipe du Mercure de France était ainsi composée : Albert Aurier, Jean Court, Louis Denise, Édouard Dubus, Louis Dumur, Remy de Gourmont, Julien Leclercq140, Ernest Reynaud, Jules Renard, Albert Samain, Alfred Vallette, celui-ci directeur et administrateur, qui devait déployer, quarante-cinq années dans ces fonctions des aptitudes exceptionnelles.
Le nouvel Argo141 tenta la mer le 1er janvier 1890. Les onze nautoniers payèrent d’abord chaque mois cinq francs de cotisation, en même temps qu’ils donnaient de la copie. Cependant, un article qu’Alfred Vallette publiait chaque semaine dans un journal142 lui étant payé soixante-quinze francs, il prenait sur cette richesse pour boucler le modique budget. Par ses soins et son dévouement, la revue prospéra. Il l’abritait chez lui, rue de L’Échaudé-Saint-Germain ; c’était sa chose, auprès de laquelle il vivait nuit et jour.
En 1903, quand le succès exigea qu’elle s’installât plus au large, pour pouvoir loger les éditions qu’elle avait créées, il transporta ses pénates avec elle dans la demeure choisie, vieil hôtel de la rue de Condé, et il devait y mourir en laissant l’entreprise pleine de vie, malgré les temps difficiles. Jusqu’à la fin, il y donna tout son temps, toute sa tête, toutes ses forces, ayant l’œil aux moindres détails et, s’il le fallait, y mettant la main, au point, a dit Remy de Gourmont, qu’il faisait les paquets quand l’heure de l’expédition les trouvait en retard.
Il n’était pas moins admirable directeur. Jamais revue ne fut plus ouverte à tout ce qui fait combat pour l’intelligence. Curieux de tout, lisant tout, sachant tout admettre de ce qui ne lui paraissait point académisme et donc psittacisme143, avec uni souriante tranquillité, une imperturbable bonhomie, une perspicacité toujours en éveil, Alfred Vallette assurait à sa revue l’allant, le mordant, mais aussi la variété, la largeur d’esprit, toujours heureux d’insérer la rectification ou la réfutation des idées auxquelles il venait d’y faire accueil. Son goût en poésie resta fidèle aux audaces du temps de René Ghil, de Vielé-Griffin et de Gustave Kahn ; il y paraissait dans sa revue. Cela ne l’a pas empêché d’éditer Paul Valéry, Charles Guérin, Samain, Paul Fort, Francis Jammes, Le Cardonnel, Moréas, comme Verhaeren et Henri de Régnier, et de les soutenir de toutes manières en un temps où sans lui ils fussent restés confinés dans les petits périodiques et bientôt sans doute découragés. Quant à la prose, il réunissait les extrêmes, du scepticisme corrosif de Remy de Gourmont au fidéisme éperdu de Léon Bloy, il publiait le Romantisme français de Pierre Lasserre144, il lançait Maeterlinck145 ; par des traductions, il introduisait chez nous Nietzsche, Kipling, Ruskin146 et d’autres.
Une de ses initiatives les plus fécondes fut d’instaurer dans sa revue des « chroniques de quinzaine » sur un très grand nombre de matières, les lettres étrangères en particulier. C’était, comme il disait en termes qui montrent son horreur de l’amplification creuse et du verbiage éphémère comme son souci de l’actuel, du journalisme passé au crible. Ces rubriques substantielles, ainsi que l’article immanquable de Remy de Gourmont, qui tour à tour s’appela « Épilogues », « Dialogues de M. Delarue et de M. Desmaisons147 », à Lettres à l’Amazone148, etc., ne contribuèrent pas peu à la grande diffusion de la revue en Europe centrale et dans l’Amérique du Sud.
Il avait épousé Rachilde, que Barres appelait Mlle Baudelaire149 ; elle partageait son dévouement infatigable à la chose littéraire et au Mercure, ses amitiés, son souci de rapprocher dans leurs réceptions hebdomadaires des écrivains fort différents entre lesquels ils voulaient établir la confraternité, sa recherche continuelle de talents nouveaux. Pendant une vingtaine d’années, elle a donné chaque quinzaine au Mercure une chronique des romans admirablement copieuse et vive150.
On ne le verra plus, dans son bureau encombré, un peu poudreux, où il se passait de l’électricité et du téléphone, offrant infatigablement l’aimable accueil aux écrivains de tous les bords, à toute heure du jour, un sourire vraiment bon sur son visage rond et rose, où la vivacité de l’œil bleu démentait l’âge accusé par les cheveux gris. Avec lui s’en va, semble-t-il, presque toute l’âme du Mercure de France. En lui disparaît un homme de grande bonne foi, de noble cœur, une intelligence singulièrement active et sagace, un directeur de revue et de librairie qui a bien mérité des lettres françaises.
Le dernier numéro du Mercure qu’il ait fait, celui du 1er octobre, est consacré pour une grande part à Remy de Gourmont, mort il y a juste vingt ans ; il commence, exceptionnellement, par quelques lignes d’Alfred Vallette, hommage à son célèbre ami. Cet acte suprême le peint.
Orion
La NRF de novembre
La NRF de novembre publie sous forme d’hommage à Alfred Vallette les souvenirs de la libraire Adrienne Monnier, rue de l’Odéon, remontant à l’année 1913, qui sera repris dans son livre de souvenirs Rue de l’Odéon paru en 1960 chez Albin Michel.
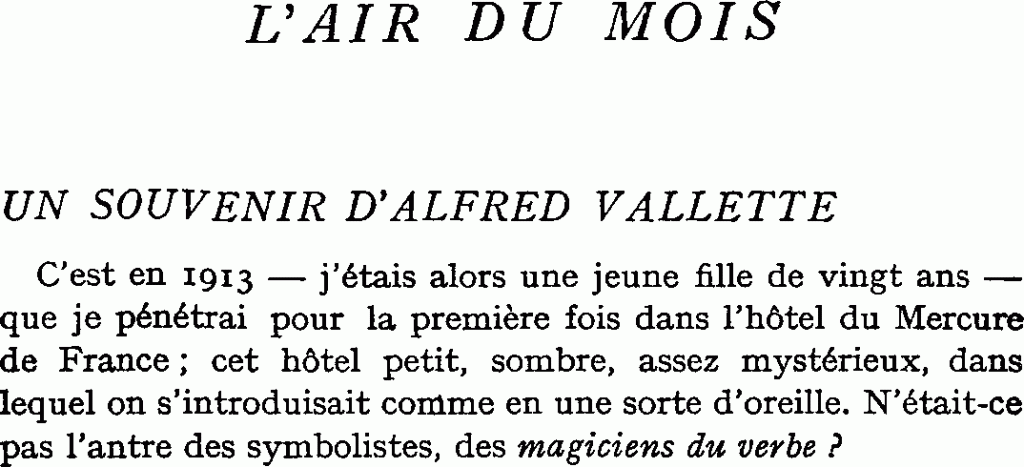
C’est en 1913 — j’étais alors une jeune fille de vingt ans — que je pénétrai pour la première fois dans l’hôtel du Mercure de France ; cet hôtel petit, sombre, assez mystérieux, dans lequel on s’introduisait comme dans une sorte d’oreille. N’était-ce pas l’antre des symbolistes, des magiciens du verbe ?
J’avais écrit à Rachilde. J’étais alors, aux Annales151, secrétaire de Cousine Yvonne152. Mon sort ne me contentait pas. J’aimais pourtant bien la patronne, mais je sentais que ce n’était pas là ma place, que ma vocation était ailleurs.
Comme tous les jeunes gens, j’étais absolue et il me semblait que je trahissais la cause même de la littérature en restant avec les gens arrivés, alors qu’il y avait tant de belle grosse besogne à faire, rive gauche.
J’aurais accepté, je crois, de balayer les bureaux du Mercure. Je racontais tout cela à Rachilde ; elle m’écoutait avec surprise. « Mais, ma petite, me disait-elle, de quoi vous plaignez-vous, vous avez le pied à l’étrier. »
Elle m’avait donné rendez-vous dans son salon, un mardi, un peu avant l’heure de sa réception. Vers la fin de notre conversation, les gens arrivèrent. Il y avait Carco153, Machard154 et le gentil Pergaud155 qui étaient, à ce moment, les enfants de la maison. Il y avait Henriette Charasson156 que mes Annales tentaient aussi vivement que me tentait son Mercure. Il y avait de curieux êtres qui s’étaient fait une image d’eux-mêmes et qui vivaient dedans, contraints et magnifiques : Marie Huot157, Valentine de Saint-Point158, et d’autres dont je n’ai jamais su les noms.
Rachilde me prit par la main (il me semble bien qu’elle me prit par la main) et me conduisit dans la pièce voisine — c’était le bureau d’Alfred Vallette. Son mari se tenait là, assis devant sa table de travail, entouré d’une arrière-garde morose où scintillaient maints binocles et les deux barbes royales d’Herold et de Fontainas. Elle leur conta ma petite histoire, pas un n’eut un sourire, Vallette émit deux phrases couleur du temps. Je me sentis vraiment écrasée de honte. J’étais, pour ces hommes, ce dont ils étaient le plus fatigués et le mieux revenus : l’enthousiasme, l’illusion.
Je retournai souvent au Mercure. Jamais je ne cherchai l’occasion de causer avec Vallette. Je ne m’en sentais pas le droit. Je ne me donnai ce droit que deux ans plus tard, quand je fondai ma librairie. Il nous arriva, alors, d’échanger quelques propos sur les diverses augmentations du prix des livres, sur la mise en valeur des éditions originales, telle que la tentaient les Éditions de la Nouvelle Revue Française ; il disait de cette tentative : « Ils vont tuer la poule aux œufs d’or. »
C’était un homme parfait, un monstre de sagesse, pas si loin de Monsieur Teste159, au fond. Il faut relire le beau portrait que Remy de Gourmont a tracé de lui dans le Deuxième Livre des Masques160. Gourmont le compare à un fondateur d’ordre religieux. Et, en effet, Vallette avait bien les caractères de certains religieux : ceux qui se vouent aux tâches ménagères, ceux qui sont attentifs et patients dans les petits travaux, sans lesquels les grands ne sont pas possibles ; ceux dont la flamme dure longtemps parce qu’ils la recouvrent prudemment de cendre.
Je me souviens de sa voix à petits souffles ; elle ressemblait à celle des mères supérieures à qui les choses de la religion en ont beaucoup fait voir.
1935
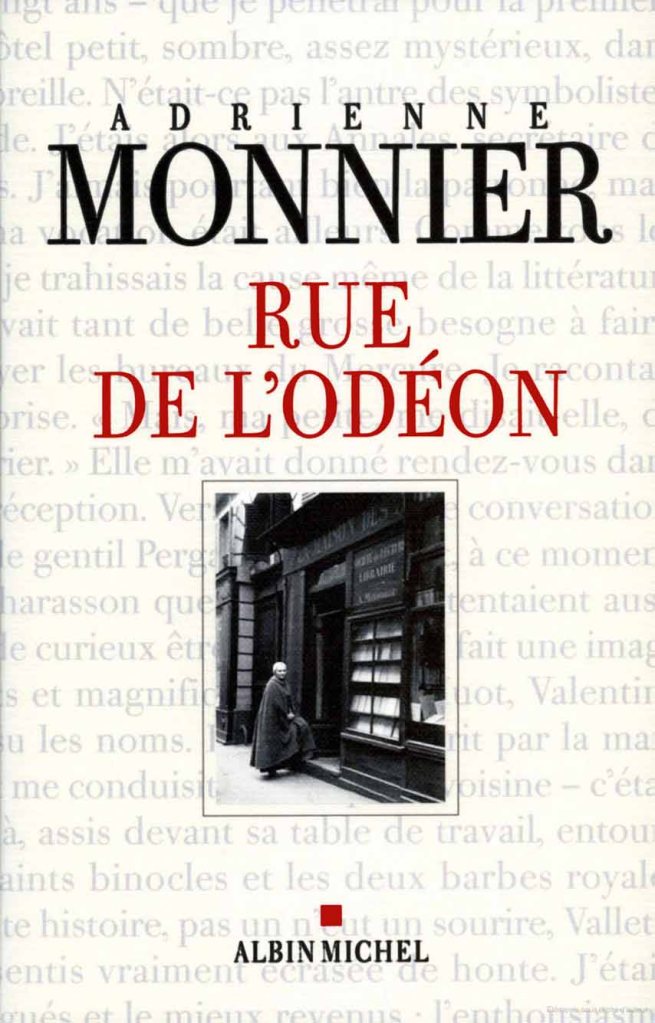
Notes
Les notes poursuivent la numérotation précédente.
99 Au début des années 1890, en même temps que naissait le Mercure de France, l’ingénieur allemand Carl Auer (1858-1929), inventa un manchon contenant des terres rares (déjà !) qui devenait extrêmement lumineux sous la flamme. Malheureusement pour l’inventeur, l’ampoule électrique d’Edison est arrivée simultanément, ce qui fait qu’à la fin du siècle tous les foyers et bureaux étaient éclairés grâce à l’un ou l’autre de ces procédés.
100 Georges Duhamel habitait à cette époque rue de Liège, un immeuble dans lequel l’électricité n’avait donc pas été installée. Cette absence concernait peut-être tout le quartier, voire le IXe arrondissement.
101 Journal littéraire au 23 avril 1930 : « Vallette nous disait ce matin, à Bernard et à moi, qu’il n’attend pas un grand succès pour le livre de Duhamel sur l’Amérique (Scènes de la vie future, qui va paraître en mai). “Il y en a trop…” (de livres sur l’Amérique).
102 Alfred Vallette remerciera Georges Duhamel par une lettre datée du 25 mai 1930 « Que vous, vous m’ayez dédié une de vos autres œuvres, j’en aurais été heureux et honoré ; mais que mon nom s’inscrive au seuil de ce livre-ci, j’y trouve la signification infiniment précieuse qu’il y a encore des hommes jeunes, comme vous, pour ne pas voir des radoteurs dans les vieilles gens, comme moi, qu’afflige la désagrégation rapide et inéluctable de notre civilisation. »
103 Paul Léautaud a toujours reproché à Alfred Vallette une économie extrême.
104 Pierre Quillard (1864-1912, à 48 ans), chartiste, poète symboliste, auteur dramatique, traducteur helléniste et journaliste, anarchiste et dreyfusard. Depuis 1891, Pierre Quillard a été un auteur Mercure fécond. Il a été en charge de la rubrique « Littérature » à partir de 1896 à son retour de Constantinople où il était professeur, puis en même temps de celle des « Poèmes » en 1898. Voir sa nécrologie par André-Ferdinand Herold en ouverture du Mercure du premier mars 1912.
105 Lire, d’Henri Mazel, Aux Beaux temps du symbolisme (1890-1895) rédigé en 1932 mais édité seulement au printemps 1943, conjointement par le Mercure de France et, en Belgique, par la Nouvelle revue Belgique, 199 pages. Cet ouvrage sera publié ici en PDF le quinze avril 2026.
106 Les douze preux de Charlemagne, ou douze pairs, ou chevaliers de la Chanson de Roland sont Roland, bien sûr, et Olivier, Gérin, Gérier, Bérenger, Othon, Samson, Engelier, Ivon, Ivoire, Anséïs, ainsi que Girart de Roussillon.
107 Et davantage encore. Lire ici Trois siècles de Mercure de France.
108 Sadi Carnot (1837-1894, assassiné) Président de la République de décembre 1887 à sa mort.
109 Pierre Tirard (1827-1893) et Charles de Freycinet (1828-1923) ont été présidents du Conseil chacun à leur tour, mais surtout le second, de 1880 à février 1892.
110 Gustave Moreau (1826-1898) peintre et sculpteur académique pas très intéressant mais sa maison de la rue Catherine-de-La Rochefoucauld mérite d’être visitée.
111 Cette expression, complètement inutilisée de nos jours, signifiait « attaquer, contredire quelqu’un en face, brusquement et violemment » (TLFi). Rompre sa lance contre la visière de l’adversaire lors d’un tournoi était un acte volontaire d’une très grande violence.
112 Lire, à partir de la première page du premier numéro de L’Ermitage, (juillet 1890) l’éditorial « Au lecteur », pages une à six, signé « La rédaction ». Après avoir rapidement décrit les périodes romantique puis naturaliste, Henri Mazel écrit : « Enfin notre actuelle période où nous croyons reconnaître les caractéristiques suivantes : prédominance du sentiment altruiste, préoccupations morales, psychologie analytique, esprit religieux, parfois mystique, pessimisme, charité, socialisme, désir de nouveau. […] une poésie curieuse d’une obscurité mystique et tendre ; un roman tourmenté, vibrant de passions affectives et morales, […] une architecture nouvelle, riche d’espérances ; une musique merveilleuse, une peinture étrange… »
113 Les Entretiens politiques et littéraires de Georges Vanor, parus d’abord mensuellement à partir d’avril 1890, puis deux fois par mois en 1893, le dix et le 25, jusqu’en décembre. 57 numéros parus.
114 François Buloz (1803-1877), imprimeur, puis éditeur et ensuite patron de presse, a été directeur de la prestigieuse (à l’époque) Revue des deux mondes pendant quarante ans, de 1831 à 1871. Dans cette période, il a aussi été « commissaire royal » puis administrateur de la Comédie-Française de 1838 à 1848.
115 La Nouvelle revue (bimensuelle) a été fondée en 1879 par Juliette Adam (née Lambert, 1836-1936). Cette revue a perduré jusqu’en 1940. Lire dans Claretie.fr l’amusant récit « Le Bal de Juliette Lambert ».
116 Victor Margueritte (1866-1942), romancier et auteur dramatique, est le cadet de six ans de Paul Margueritte. Victor Margueritte est surtout connu pour son roman La Garçonne, paru en 1922 chez Flammarion et qui lui a fait perdre sa Légion d’honneur, retirée l’année suivante.
117 D’abord peintre bohème, Raoul Ponchon (1848-1937) s’est lié avec Maurice Bouchor et Jean Richepin avant de devenir collaborateur régulier du Courrier Français jusqu’en 1908. En 1893 Raoul Ponchon composait des vers au kilomètre sur l’actualité de la semaine sous le titre de « Gazettes rimées ». Raoul Ponchon a été élu membre de l’académie Goncourt en 1924 en replacement d’Émile Bergerat, sans avoir écrit un seul livre, hors un recueil de quelques-unes de ses « Gazettes rimées ».
118 Alfred Vallette était à l’origine typographe.
119 Gustave Kahn se fourvoie ; Léautaud avait 18 ans à la création du Mercure, le premier janvier 1890. Il y a publié ses premiers vers en juin 1896 et y a été embauché le premier janvier 1908.
120 Remy de Gourmont, Le Latin mystique : les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au Moyen Âge. Préface de J.-K. Huysmans, Mercure 20 septembre 1892, donc avant Albert Samain cité plus haut. Voir les « Échos » du Mercure d’avril 1892 page 273, qui donne le détail des souscriptions.
121 La Revue des deux mondes n’a pas été fondée par François Bulloz mais, à l’été 1829, par le diplomate Pierre de Ségur-Dupeyron (?-1869), dont, aussi curieux que cela paraisse, nous ne connaissons pas la date de naissance. La co-fondation de Prosper Mauroy (que l’on connaît encore moins), semble n’avoir été que financière, apportant peut-être les fonds de son épouse. Sans doute diplomate de talent mais piètre financier, P.S.-D. n’a pas su se maintenir à la tête de sa revue, qui a été rachetée par son imprimeur, François Bulloz.
122 Texte reproduit dans la page « Le Mercure de France (1890) ».
123 La Pléiade est parue sur douze numéros, en deux temps et deux directeurs , en 1886 puis 1889. Voir là encore la page « Le Mercure de France (1890) ».
124 On ne confondra pas le café François Ier du 26 rue Jacob, tenu par la « Mère Clarisse » avec le café Français, près de la gare Saint-Lazare, tous deux concernés.
125 Jusqu’en janvier 1907.
126 Première phrase de la préface d’Alfred Vallette, dans un style un peu ampoulé par l’importance de l’événement : « Peut-être ne messied-il point de redire, alors que La Pléiade devient Mercure de France, ce qui a été répondu naguère aux Imputations d’une Presse mal avertie, et de défendre par avance notre œuvre contre les appréciations erronées ou maladroites… »
127 À partir du numéro de janvier 1905.
128 Marie-Louise Pailleron (1870-1951), petite fille de François Bulloz et fille d’Édouard Pailleron, femme de lettres et historienne du Romantisme, a évidemment beaucoup publié dans la Revue des deux mondes. On lira sa nécrologie dans le numéro de mars 1951 de cette même revue (trois pages).
129 Marie-Louise Pailleron : François Buloz et ses amis, quatre tomes parus de 1919 à 1924 chez Calmann-Lévy (I et II) et Perrin (III et IV), après que les bonnes feuilles en soient largement parues dans la Revue des deux mondes.
130 Certains chercheurs ont pu avancer que ce dessin était de la main de Léon Bloy, qui avait des qualités d’enlumineur. Léon Treich (1889-1974) nomme ce Mercure « caducée ». C’est lors de la reparution après la seconde guerre mondiale que le caducée, présent depuis le début sur la couverture des livres, figurera sur les couvertures de la revue.

Le Mercure ailé d’Alfred Jarry »
131 Maurice Verne (1889-1943), romancier et auteur dramatique, qu’on ne confondra pas avec Maurice Vernes (avec un s) (1845-1923), historien des religions. Voir le Journal littéraire du 14 juin 1929 à propos d’une conversation avec Maurice Verne concernant son livre Aux usines du plaisir : la vie secrète du music-hall, éditions des Portiques, 1929.
132 Allusion vraisemblable à Christophe Plantin (1520-1589), relieur et imprimeur ayant fondé une entreprise qui lui a survécu jusqu’à la fin du XIXe siècle et est aujourd’hui un musée d’Anvers.
133 Séverine (née Caroline Rémy, 1855-1929), écrivaine et journaliste libertaire et féministe. Mariée de force à un employé du gaz qu’elle a quitté rapidement, Séverine s’est ensuite mariée une deuxième fois avec un riche médecin suisse dont elle a rapidement divorcé avant de rencontrer Jules Vallès (note 42 de la première partie) en 1879, de 18 ans son aîné. C’est à ses côtés que Séverine s’est épanouie. Elle a permis à Jules Vallès de relancer Le Cri du peuple, grâce au soutien financier de son ancien mari. Séverine est devenue la directrice du journal après la mort de Jules Vallès en 1885. C’est alors que Séverine a rencontré Georges de Labruyère (1856-1920) avec qui elle a vécu jusqu’à sa mort. Séverine sera une des fondatrices du prix Femina.
134 Les Boulenger sont deux frères. L’aîné, Marcel Boulenger (1873-1932) est romancier, journaliste et escrimeur. On se souvient de lui pour ses biographies de personnages imaginaires, auxquelles beaucoup ont cru. Le cadet, Jacques Boulenger (1879-1944), chartiste, est spécialiste de la littérature médiévale et de la Renaissance. André Billy, dans Le Balcon au bord de l’eau, dressera des portraits de l’un et l’autre frères.
135 Après avoir regretté que les gens ne connaissent pas leur métier, Jacques Boulenger dans les lignes suivantes va présenter l’ignorance d’Alfred Vallette en ce domaine comme une qualité décisive.
136 Et notamment au café Vachette. « Pendant le Premier Empire le café Vachette, à l’angle du boulevard Saint-Michel et de la rue des Écoles, s’appelait alors Café des Grands hommes. À partir de 1880 il est devenu le lieu de rendez-vous de la bohème, de tous les étudiants rêvant de devenir journalistes, écrivains ou poètes. L’un des nombreux cafés littéraires qui fleurissaient dans la capitale. » (Luc Bihl, Des tavernes aux bistrots : histoire des cafés). Dans La Terrasse du Luxembourg, André Billy décrira le café Vachette page 229. Voir également Antoine Albalat : Trente ans de quartier latin — nouveaux souvenirs de la vie littéraire (SFÉLT 1930, 189 pages) dont un extrait est paru dans le Mercure du quinze avril 1930, page 336. C’est, en 2025 une agence de la Société générale.
137 Animadversion : « Désapprobation latente, hostilité sourde, se manifestant occasionnellement dans des paroles, des attitudes ou des actes. » (TLFi)
138 Contrairement à une croyance populaire, naguère fait référence à un passé récent. Le mot aurait dérivé de l’expression « il n’y a guère ». On peut l’opposer à jadis, ainsi que l’a fait Verlaine.
139 Eugène Marsan (1882-1936), a fondé en 1908, avec l’éditeur Jean Rivain la Revue critique des idées et des livres, puis, en janvier 1909, avec le stendhalien Henri Martineau, la revue littéraire Le Divan. Il tiendra la critique littéraire de L’Action française sous le pseudonyme d’Orion. Eugène Marsan, auteur de manuels de savoir-vivre et de romans légers, sera parfois plaisanté pour son dandysme.
140 Julien Leclercq (1865-1901, à 36 ans), dont on parle peu, écrivain, poète symboliste et critique d’art, ami de Gabriel Albert Aurier.
141 La galère Argo à bord de laquelle Jason partit conquérir la Toison d’or, les marins de l’Argo étant bien entendu les Argonautes.
142 Eugène Marsan pense sans doute à L’Écho de Paris (littéraire et illustré) (note 7), mais dans lequel Alfred Vallette n’a écrit qu’à partir d’octobre 1892.
143 Psittacisme : « Trouble du langage consistant à répéter sans raison ce que l’on a entendu ou lu sans même le comprendre. » (TLFi).
144 Pierre Lasserre (1867-1930), critique littéraire, journaliste et essayiste de tendance classique traditionnelle, directeur à l’École pratique des hautes études, collaborateur du quotidien L’Action française.
145 Maurice Maeterlinck (1862-1949), écrivain francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911. Figure de proue du symbolisme belge, Maurice Maeterlinck reste aujourd’hui célèbre pour son mélodrame Pelléas et Mélisande (1892).
146 John Ruskin (1819-1900), écrivain, poète, critique d’art et peintre britannique.
147 Dans les 478 textes de Remy de Gourmont dans le Mercure de France, un seul porte le titre de « Dialogue des amateurs » dans le numéro du seize septembre 1907. 320 sont titrés « Épilogues ». Parmi ces « Épilogues » figurent de nombreux « Dialogues des amateurs ».
148 Remy de Gourmont, Lettres intimes à l’Amazone, La Centaine (de Jacques Bernard) 1926 puis Mercure 1927. Dans sa présentation de l’édition de 1988, Le Mercure écrit : « C’est pendant l’été 1910 que Natalie Clifford Barney et Remy de Gournont se rencontrent. Elle a 34 ans. Il en a 52. Elle est américaine. Il est français. Elle est belle. Il est laid. Elle est riche. Il ne l’est pas. Elle aime les femmes. Il les aime également. Elle est l’auteur d’un recueil de pensées et d’un recueil de poèmes, qui n’ont été appréciés que d’un très petit cercle. Il est au sommet de sa gloire, auteur d’ouvrages connus, et l’un des fondateurs du prestigieux Mercure de France. / Aujourd’hui, au cimetière de Passy, où Natalie repose, on peut lire : / Natalie Clifford Barney / (1876-1972) / Écrivain / Elle fut l’Amazone de Remy de Gourmont ».
149 Surnom que Maurice Barrès avait donné à Rachilde dans un article faisant suite à la publication d’À mort, dans lequel un personnage, Maxime de Bryon, ressemble trait pour trait à Maurice Barrès.
150 Pendant bien plus longtemps. Rachilde a publié ses premiers compte rendus des romans dans le Mercure de juillet 1891 mais régulièrement à partir d’avril 1896 jusqu’en avril 1924, soit 28 années.
151 Les Annales politiques et littéraires, « revue universelle paraissant le dimanche. » Directeur et rédacteur en chef, Adolphe Brisson. Cet hebdomadaire est paru de 1883 à 1971.
152 Yvonne Sarcey (Madeleine Sarcey, 1869-1950), fille de Francisque Sarcey, a épousé en 1889 Adolphe Brisson. Yvonne Sarcey donnait, dans Les Annales politiques et littéraires de son mari, des conseils à la jeunesse sous le pseudonyme de « Cousine Yvonne ». Yvonne Sarcey a écrit ses mémoires sous le titre La Route du bonheur, paru à la librairie des Annales en 1909.
153 Francis Carco (François Carcopino-Tusoli, 1886-1958), romancier du réalisme social dans la veine d’un Mac Orlan, est surtout connu pour son premier roman, Jésus-la-Caille (1914, remanié en 1920) et L’Homme traqué.
154 Alfred Machard (1887-1962), auteur dramatique, poète et romancier, moins connu de nos jours que sa femme, Raymonde Machard (1889-1971), romancière.
155 Louis Pergaud (1882-mort pour la France en 1915), ce qui lui a juste laissé le temps d’écrire quatre livres publiés de son vivant, tous au Mercure : trois recueils de nouvelles animalières, De Goupil à Margot (1910), prix Goncourt, La Revanche du corbeau (1911), Le Roman de Miraut, chien de chasse (1913) et enfin La Guerre des boutons (1913).
156 Henriette Charasson (1884-1972), poétesse et dramaturge d’inspiration catholique secondera Rachilde dans la chronique des « Romans » dans le Mercure à partir de 1914.
157 Marie Huot (1846-1930), poétesse, femme de lettres, journaliste, féministe et militante pour les droits des animaux. Née Ménétrier, Marie a épousé en 1869 Anatole Huot, éditeur de la revue gauchiste parisienne, L’Encyclopédie contemporaine illustrée. On lira dans le Journal de Paul Léautaud un émouvant portrait de Marie Huot le 17 novembre 1922 et un autre au 14 avril 1930, lendemain de sa mort. Par ailleurs Paul Léautaud a écrit, le 23 avril 1930 à Aurel, qui en avait besoin, une lettre retraçant une rapide biographie de Marie Huot.
158 Valentine de Saint-Point, (Anna de Glans de Cessiat-Vercel, 1875-1953), femme de lettres et artiste protéiforme, fut la première femme à traverser l’Atlantique en avion. Veuve en 1899, à 24 ans, Valentine épouse l’année suivante son amant, Charles Dumont (député, sénateur, quatre fois ministre) et sera une amie de Rodin. En 1904 elle divorce. De ce temps datent ces premiers vers, puis, en 1909 sa carrière d’auteur dramatique et de romancière.
159 Allusion à l’essai de Paul Valéry : La Soirée avec monsieur Teste paru en 1896. « Edmond Teste, demi-dieu en pantoufles de petit-bourgeois, génie si clairvoyant qu’il renonce à sortir de l’anonymat. Il est le grand homme authentique, celui qui maîtrise sa pensée dans l’ombre tandis que les baudruches se pavanent en public. »
160 Remy de Gourmont, Le IIe Livre des Masques est sorti au Mercure en 1898, deux ans après le premier Livre des Masques « Portraits symbolistes, Gloses et Documents sur les Écrivains d’hier et d’aujourd’hui ». (Majuscules d’origine).