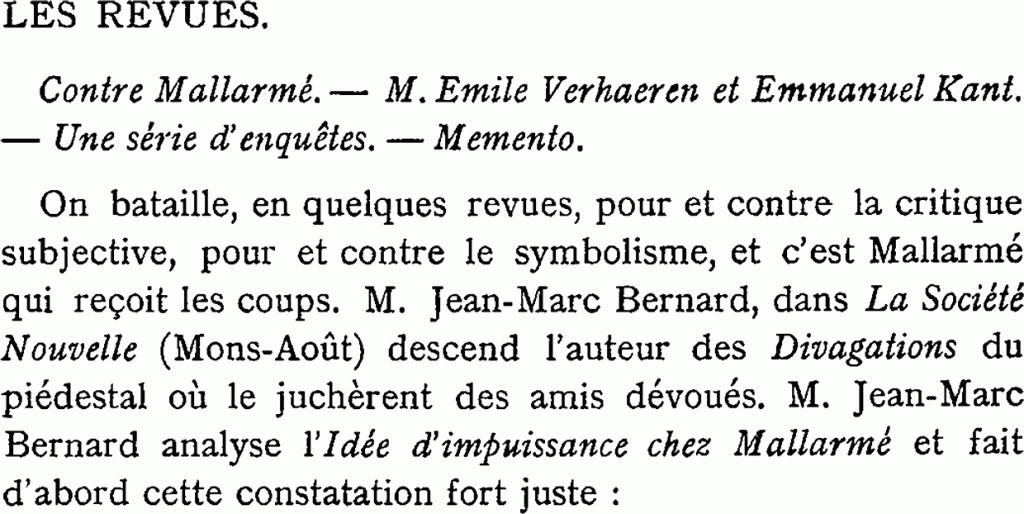Eugène Montfort II (1909-1923) ►
Eugène Montfort III (1924-1933) ►
Page publiée le quinze octobre 2025. Cette page est la première d’une série de quatre. Temps de lecture de cette première partie : 33 minutes. Les trois suivantes seront publiées les premier décembre, quinze janvier et premier mars. Liens dans cette première partie :
1905 — 1906 — Les Petits dessous de la vie littéraire : L’académie Goncourt et son prix — Antée — 1907-1908 — La première NRF — notes
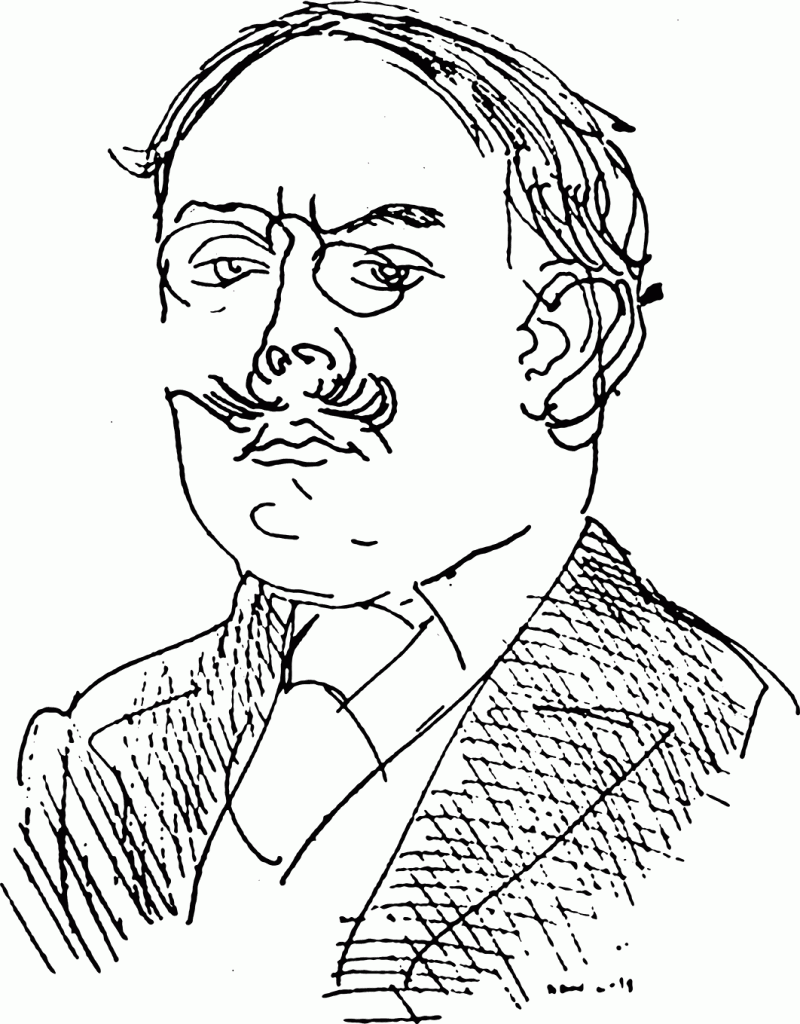
Eugène Montfort, par Raoul Duffy, dessin peut-être réalisé à l’occasion de la publication de La Belle enfant ou l’amour à quarante ans illustré par Raoul Duffy à l’initiative d’Ambroise Vollard en 1930
Depuis un an déjà, le quinze septembre dernier dans une page sur Jean Saltas, a été annoncée la parution d’une page sur Eugène Montfort. C’est que l’affaire n’est pas mince. Eugène Montfort (1877-1936) est de ces personnalités dont le nom seul fait reculer. Un site web montfort.com aurait de quoi publier pendant des années mais personne ne s’y aventure.
L’Index d’Étienne Buthaud relève qu’Eugène Montfort est cité dans 203 pages du Journal. Comme dans tout index méticuleux (et celui-ci l’est particulièrement), ces apparitions relèvent souvent de l’accessoire ou de l’incidence, d’un intérêt modeste. Le volume même de ces références permet — et même oblige — à des choix. En plus de ces modestes négligences, n’ont pas été retenues les occurrences dans lesquelles Eugène Montfort était, via Auriant, relié à ces affaires désagréables de plagiats, réels ou supposés, d’André Maurois.
Par commodité laissons la primeur de la présentation d’Eugène Montfort à une valeur sûre. Voici donc son portrait par André Billy dans La Terrasse du Luxembourg, pages 297-298. Nous sommes au début du siècle, dans la librairie d’Eugène Rey, où André Billy était assidu. Cette librairie illustre se trouvait au huit boulevard des Italiens. Dans les années 1920, le lieu a été démoli pour laisser la place au carrefour Richelieu-Drouot. Les librairies fourmillaient alors. Il ne reste plus de nos jours que deux librairies sur les Grands Boulevards, la très belle librairie Ici (c’est son nom) du 25 Boulevard Poissonnière et le Boulinier du sept boulevard de Bonne-Nouvelle.
Chez Rey, je connus aussi Eugène Montfort, qui me déçut d’abord à un point inimaginable. J’avais lu ses romans et ses Marges1, et je m’étais fait de lui une idée si attrayante et si flatteuse que sa personne, son abord, ses propos auraient pu me faire douter de son identité. Une large aisance, un talent aigu et sensible, le goût des voyages, l’amour du pittoresque extérieur avec la curiosité des âmes, il avait tout ce qui représentait pour moi l’écrivain pur, l’écrivain que j’aurais voulu être. Il habitait rue Chaptal un atelier d’artiste, mais on le savait souvent flânant à Marseille, ou en Espagne, à moins que ce ne fût en Italie, en Algérie, au Maroc… Avec cela, des femmes à ne savoir qu’en faire… Ses Marges me plaisaient par leurs tendances plus encore que n’avait fait Le Censeur2. Il y régnait un esprit moins acerbe, plus détendu, non exempt de désinvolture et d’impertinence. Les Cœurs malades3, La Maîtresse américaine4, Le Chalet dans la montagne5, Montmartre et les Boulevards6 m’évoquaient un genre de vie, libre, paresseux, passionné, artiste, qui était exactement celui que j’aurais voulu vivre. Vous pensez si un pareil ensemble était fait pour me rendre Montfort sympathique. Son nom même m’était agréable : Montfort ! Cela sonnait bien… Et qu’est-ce que je vois ? Un garçon épais, taciturne, à demi chauve, ficelé comme l’as de pique dans des vêtements de confection, mâchonnant un cigare de deux sous et roulant de gros yeux de myope derrière un binocle de pion… Quelle désillusion ! Je montai le voir rue Chaptal et, là, je tombai dans un bric-à-brac poussiéreux, où il me reçut en bras de chemise et en savates et où, loin de me mettre à mon aise selon son devoir d’aîné, il m’examina curieusement, dédaigneusement, en laissant tomber à chaque instant la conversation… L’expérience corrigea par bonheur mes premières réactions. Je découvris peu à peu un Montfort sensible et bon, un Montfort tourmenté, un Montfort profondément malheureux, mais ce ne fut pas tout à fait sans peine.
Voilà notre Eugène carbonisé. Voyons si Paul Léautaud est aussi sévère.
1905
La première fois que le nom d’Eugène Montfort apparaît sous la plume de Paul Léautaud, ce n’est pas dans son Journal mais dans une correspondance, en date du trente octobre 1905. Paul Léautaud n’est pas encore employé au Mercure de France mais déjà, Eugène Montfort lui a fait parvenir son Chalet dans la montagne. Paul Léautaud, nous le savons déteste recevoir des livres parce qu’il déteste écrire des lettres de remerciement. Il s’acquitte pourtant admirablement de l’exercice, en un seul paragraphe.
À Eugène Montfort
Paris le 30 octobre 1905
Monsieur,
Ce m’a été vraiment une grande surprise et un grand plaisir, je ne sais lequel des deux le plus, de recevoir le Chalet dans la montagne, et je ne sais comment vous remercier de ce témoignage de sympathie. J’avais été déjà deux fois pour vous écrire, la première à propos de Marcel Schwob, pour vous dire combien il avait été heureux de votre article sur Claudel7 dans les Marges8, au point de désirer vous connaître — et la seconde pour vous remercier de vos citations de mon article sur Stendhal, dans l’Ermitage. C’est vous dire combien je suis heureux de vous écrire aujourd’hui. Me permettrez-vous cette opinion ? Vous avez bien changé depuis quelques années, et voilà que vous êtes du groupe dont vous étiez le seul qui compte. Vos Marges sont d’une tenue parfaite et d’un vrai intérêt, et pour moi, Parisien si vif, il n’est pas jusqu’à leur couverture où ne m’enchante ce petit détail de rien du tout : Se vend… boulevard des Capucines, près le Café Napolitain9. Quant au Chalet dans la montagne, quand il n’aurait que ce mérite de n’être pas le livre de tous les jours, ce délicieux roman à répétition que vous connaissez comme moi, ce serait déjà beaucoup. Mais vous y montrez de plus cette qualité de n’être pas un phraseur à vide, et si vous tenez à mettre tout de même quelque harmonie dans votre style, au moins ce que vous écrivez dit toujours quelque chose. Le Chalet dans la montagne avec ses seules cent pages, vaut mieux que bien des romans que je connais et dont je ris bien quelquefois, et vos souvenirs de voyages, si évocateurs dans leur brièveté, montrent quelqu’un qui a su voir, et sentir, même imaginer, peut-être ? Mais alors avec une adresse si parfaite qu’elle fait rêver aux choses dont vous parlez tout comme si elles étaient réellement des choses décrites. Mais que vous font tous ces compliments, n’est-ce pas. Ce n’est pas pour les recevoir que vous avez pris cette peine de m’envoyer votre livre, mais surtout pour me marquer votre sympathie. C’était me faire plaisir deux fois, cependant, et c’est de même que je veux vous remercier, en vous assurant très sincèrement de mes sentiments les meilleurs.
P. Léautaud
1906
Un an plus tard c’est aussi une lettre de remerciement qu’écrira Paul Léautaud à Eugène Montfort :
À Eugène Montfort
le 15 novembre 1906
Monsieur,
Je suis bien en retard pour vous remercier de votre petit roman la Maîtresse américaine. Je l’ai lu pourtant dès sa réception, en juillet dernier, et non sans un vrai plaisir, moi qui aime tant les sujets un peu particuliers et la rapidité d’exécution. C’est bien, c’est curieux, fantaisiste et moqueur. Un livre auquel les femmes devraient se plaire, il me semble. Une chose aussi dont je veux vous remercier depuis longtemps, c’est le soin que vous prenez à m’envoyer les Marges. Votre dernier morceau sur Moréas11 était parfait12, bien que j’aie des réserves à faire sur son œuvre, à cet excellent et cordial Moréas. Admirable, cette œuvre, et moi-même je sais ses plus belles stances par cœur et me les récite souvent. Mais que voulez-vous, il est trop grec13. J’aime la beauté plus moderne, plus tremblante, moins guindée, glacée dans la perfection. Vos échos aussi sont vivants, hardis, nets. Celui sur Stendhal-Fouquier14 m’a amusé tout particulièrement, car, pour ce paragraphe de la feue Chronique Stendhalienne, M. Coffe… Il me semble que vous devez trouver à rédiger tout seul ce petit cahier un réel plaisir. Moi, à le recevoir et à le lire, j’y trouve tout à la fois, et chaque fois, la surprise d’une sympathie, et d’une distraction pleine d’intérêt.
Je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs.
P. Léautaud
Vingt jours plus tard, une lettre de remerciements encore, mais le 23 décembre, lors d’une visite à Lucien Descaves, nous comprendrons que cette lettre n’a pas été envoyée. Lisons-là quand-même.
À Eugène Montfort15
Paris, 17, rue Rousselet
le 5 décembre 1906
Monsieur,
Je n’ai encore que de grands compliments à vous faire de la Turque16. Je suis même un peu gêné, à vous parler franchement. J’ai peur que vous ne preniez ma lettre comme une lettre de compliments d’usage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un auteur envoie son livre à un monsieur. Une politesse en vaut une autre, et ledit monsieur ne peut moins faire que de couvrir d’éloges l’expéditeur. Ce n’est pas du tout mon cas vis-à-vis de vous. J’ai lu la Turque plusieurs fois — est-il beaucoup de livres actuels que nous lisions plusieurs fois ? — et à chaque fois davantage je l’ai trouvé un livre vrai, et vrai d’une vérité qui fait qu’on s’arrête de lire, pour rêver à ses souvenirs personnels. Vos personnages, je les ai rencontrés, regardés cent fois. Cent fois j’ai écouté leurs conversations. Quel meilleur éloge vous faire ? Sans vouloir d’ailleurs me faire la moindre réclame, si vous connaissiez des quelques petites choses que j’ai écrites, ce que je vous dis du plaisir que j’ai eu à vous lire et de l’intérêt que je trouve à la Turque ne vous étonnera pas. Si des lecteurs l’ont lu pour s’amuser, je l’ai lu moi comme une aventure familière. Je ne vous dis du reste que le quart de toutes mes réflexions sur ce livre, où il y a de quoi faire prévoir, dans votre Montmartre et les Boulevards, un autre livre plein de son époque. Être de son époque, sans recherche ni effort, naturellement, parce que l’on sent et que l’on est ainsi, cela n’est pas si piquant, quoi qu’on en dise. Regardez autour de vous, tous les livres qui paraissent. Les gens vivent au milieu des livres et ne savent que les piller, ou les imiter… Il n’est pas jusqu’à la dédicace de votre livre qui m’a intéressé « les heures de lassitude et de découragement… »
Mes sentiments bien sympathiques.
P. Léautaud
Je rouvre ma lettre, que je retrouve sur ma table, sous un paquet de livres, alors que je la croyais envoyée depuis longtemps. Quel retard ! Je ne sais comment m’excuser.
Le 14 décembre 1906, Jérôme et Jean Tharaud remportent le prix Goncourt pour Dingley, l’illustre écrivain, par six voix au troisième tour, contre deux voix à André Suarès, et deux voix à Gaston Chérau. C’est à cette occasion que le nom d’Eugène Montfort est cité pour la première fois dans le Journal littéraire, à propos d’un article qui va occuper tout le microcosme littéraire durant toute une semaine.
Cet article, paru en une du Gil Blas du dimanche seize décembre est signé de Charles-Louis Philippe et Eugène Montfort. Lisons-le d’abord.
Les Petits dessous de la vie littéraire —
L’académie Goncourt et son prix

Il y a quelques années, lorsqu’on apprit la fondation de l’Académie Goncourt, ce fut, dans tous les milieux littéraires, une véritable satisfaction. L’idée d’Edmond de Goncourt séduisait tout le monde, elle était généreuse et particulièrement opportune. Faciliter à un jeune romancier17, doué de talent, ses débuts dans la vie littéraire, le faire connaître du public, aujourd’hui que, avec la disparition presque complète de la critique littéraire, cela est devenu à peu près impossible : il y avait là de quoi nous donner beaucoup d’espoir. Nous pensions tous que le vieux Goncourt, qui avait longuement mûri son projet, avait choisi, pour accomplir cette bonne action et assurer la perpétuité de sa renommée, dix écrivains dont il était sûr, non seulement au point de vue du talent, mais au point de vue des qualités morales qui sont nécessaires à des juges. Nous attendions donc avec confiance.
⁂
Le premier prix fut décerné18. Il provoqua bien quelque étonnement, mais nous faisions crédit à l’Académie Goncourt sur sa bonne mine. Nous prîmes patience. Nous nous disions : « Nous verrons la prochaine fois ! »
« La prochaine fois », le prix fut donné à un jeune de quarante ans sonnés. Nous fûmes surpris. Il avait du talent. Cela passa.
Mais l’année dernière, on nous donna M. Farrère19, dont la valeur est contestable, et l’on nous donne cette année les frères Tharaud20 qui ont mis six ans, paraît-il, à écrire une plaquette de 140 pages, où nous ne distinguons pas bien nettement la marque du génie. Cela ne passe plus !
⁂
On rapproche donc tous ces choix. On se dit : « Tiens ! Nau21 et Farrère ne sont pas souvent à Paris ! » On se dit : « Tiens ! Frapié22 n’était plus très jeune ! Il semblait ne pas avoir devant lui une longue carrière à parcourir !… Tiens ! ces deux Tharaud, avec leur difficulté de travail, ne paraissent pas devoir nous étouffer sous le poids de leurs productions !… »
Mais le public pense : « C’est qu’il n’y avait pas d’autres jeunes ! »
Cependant, ceux qui suivent le mouvement littéraire se demandent : « Pourquoi diable cette Académie Goncourt n’a-t-elle pas choisi plutôt Louis Bertrand23, Francis Jammes24, Paul Léautaud, Marius-Ary Leblond25, dont le talent est incontestable et qui, tous, avaient publié des romans pendant ces quatre dernières années. »
On en était là : on se bornait à ne pas comprendre, mais tout cela semblait bizarre. Il s’est produit cette année certains petits faits qui nous ont éclairés quant à nous. Nous croyons utile de les faire connaître au public.
⁂
Le prix Goncourt a été décerné avant-hier après un dîner « de délibération ». Or, nous savons qu’il y a une quinzaine de jours, l’éditeur Pelletan (éditeur du livre des frères Tharaud) a fait photographier un portrait d’Edmond de Goncourt, destiné à figurer sur le volume devant obtenir le prix. Et, hier matin, dès huit heures, soit tout juste la moitié d’une nuit après la délibération des Dix, le volume a fait son apparition chez les libraires, orné du portrait en question et de la mention : Prix Goncourt 1906 !
Que signifient alors ces délibérations ? Le prix était-il donc donné d’avance ? Nous inclinerions à le croire, et nous serions amenés à supposer que tout ne se passe peut-être pas aussi franchement que les notes communiquées par l’Académie Goncourt à la presse voudraient le faire croire au public… Est-ce que vraiment, comme le Figaro l’imprimait hier matin, les frères Tharaud étaient personnellement inconnus à tous les Dix ? Est-ce que, vraiment, comme les jeunes lauréats l’ont déclaré dans plusieurs interviews, ils avaient envoyé leur livre « au petit bonheur » et n’avaient fait aucune visite ?
⁂
Mais laissons cette année et remontons un peu plus haut. Remontons à l’attribution du premier prix dont nous n’avions pas compris les motifs, lorsqu’il fût décerné. Nous les comprenons très bien maintenant.
Le lendemain même de la décision de l’Académie, l’un de nous rencontra M. Lucien Descaves et lui parla du prix Goncourt, qui était l’événement du jour. M. Descaves dit :
— Croyez-vous que c’est drôle ! Qu’est-ce que c’est que ce Nau, en somme ? Nous ne le connaissons ni les uns ni les autres. Où est-il ? Où perche-t-il ? Nous ne savons même pas son adresse pour lui annoncer son succès !…
Or, ce Nau, si inconnu et si mystérieux, était tout simplement le frère de M. Torquet, le secrétaire de M. Maurice Donnay26, dont, comme on le sait, M. Descaves est le collaborateur, l’ami et le familier.
Et tout s’explique. Nous avons, d’ailleurs, depuis, appris par quelqu’un qui fréquente chez M. Descaves, qu’il avait rencontré le mystérieux et inconnu John-Antoine Nau chez M. Descaves lui-même avant l’attribution du prix.
Mon Dieu ! faut-il que ces auteurs dramatiques aient de l’imagination pour transformer des événements si simples en aventures mirobolantes !
⁂
De tout cela, il résulte clairement que ce n’est pas par hasard et seulement à cause de leur valeur littéraire que les Dix ont décerné leur prix aux jeunes romanciers dont nous avons parlé. La faveur et l’intrigue n’ont pas été étrangères à leurs décisions.
Cela nous serait indifférent si cette faveur et cette intrigue avaient donné de bons résultats. Malheureusement, les lettrés paraissent être d’un avis contraire.
On est surpris quand on compare ceux qui sont lauréats à ceux qui ne le sont pas.
Et l’on commence à donner l’explication suivante : Il y a cinq ou six membres de l’Académie Goncourt, ceux qui forment la majorité, qui sont absolument décidés à ne pas favoriser des vrais jeunes écrivains, des vrais jeunes romanciers, des gens moins éloignés et moins gênants que Nau et Farrère, moins âgés que Frapié, plus féconds que les Tharaud. Est-ce que par hasard ils craindraient la concurrence ? Est-ce que, par hasard, le vieux Goncourt se serait trompé ?
Nous regrettons que des gens de talent comme MM. Mirbeau, Huysmans27, J.-H. Rosny28, se soient fourvoyés dans cette galère.
Charles-Louis Philippe.
Eugène Montfort.
Journal de Paul Léautaud daté de ce même dimanche seize décembre 1906 :
Pas été chez Descaves ce matin. En me réveillant, l’idée de me transporter là-bas, derrière la Santé29, m’a assommé et je me suis rendormi. À onze heures je descends pour les commissions. Je trouve dans le Gil Blas un article de polémique contre l’Académie Goncourt et le vote d’hier, article signé Ch.-Louis Philippe et Eugène Montfort, et dans lequel je suis nommé. Que Ch.-L. Philippe ait écrit cet article — pas méchant, d’ailleurs — oui : il a dû dire, comme je l’ai pensé moi-même hier matin, que maintenant c’était bien fini pour lui et qu’il ne perdrait rien. Mais Montfort ! leur attitude du reste fait plutôt sourire : ils avouent une déception, ce qu’on ne doit jamais avouer, et qu’ils ont été piqués. Encore deux qui sont moins forts que moi, et qui n’ont pas su se taire jusqu’au bout — non plus que se payer avec vigueur, car sauf quelques petits détails sur Descaves — et sont-ils exacts ? — tout l’article est bien doux. L’amusant, c’est qu’ils mettent un mot aimable pour Huysmans30. Ils ignorent sans doute que le vote de Huysmans était acquis depuis assez de temps aux Tharaud. Cet article m’a fait regretter de n’être pas allé chez Descaves. Je l’aurais vu tout chaud de l’affaire.
Le 19 décembre, suite inattendue de cette piteuse affaire :
À quatre heures, coup de sonnette. J’étais assis devant le feu, en train de goûter. Je vais ouvrir. Un envoyé du Gil Blas31, pour m’interviewer sur la question du dernier Prix Goncourt. Si jamais je m’y attendais. « C’est M. Montfort qui m’a dit de venir vous voir, ajoute cet envoyé. Il m’a assuré que vous me diriez des choses extraordinaires, des histoires intéressantes. » Je l’ai désabusé tout de suite, lui faisant remarquer que je ne connaissais d’ailleurs aucunement Montfort, ni presque Ch.‑L. Philippe. Cela l’a un peu refroidi.
Puis le 23 décembre :
Ce matin, à neuf heures un quart, visite à Descaves. Rien de bien intéressant. Je me suis expliqué sur l’article du Gil Blas, et que je n’y étais pour rien, ne connaissant pas Montfort et à peine Philippe, etc., etc. Descaves n’a pas l’air très content des deux mécontents, « Ces deux petits voyous ! » m’a-t-il dit de Montfort et de Philippe. Je lui ai dit que tout le monde au Mercure trouve l’article en question niais, ridicule, et déplacé ; il m’a paru satisfait.
[…]
Je lui ai montré l’écho de L’Intransigeant, m’annonçant pour 1907(32). Il ne le connaissait pas. Surpris plutôt désagréablement, tout en m’assurant que rien de nuisible pour moi n’en résulterait. Assuré aussi que je ne savais d’où ce potin venait. Quant au membre de l’Académie qui aurait raconté cela, par truc, lui ai-je dit. Il m’a répondu que ce pourrait bien être Nau, et les Rosny, qui sont d’un bavard, paraît-il !
La lettre anonyme à Hennique33 est vraie34. Il y a même mieux, me raconte Descaves. Montfort lui-même s’est transporté chez un des Dix, avec le Cahier de la Quinzaine contenant Dingley, pour bien lui montrer que c’était un livre déjà paru, et ne pouvant par conséquent avoir le prix. Il faut croire que je suis encore naïf, car l’idée seulement qu’on puisse avoir tant d’aplomb, et faire de pareilles démarches, me coupe bras et jambes. Il m’en vient aussi, à l’égard de Montfort, un peu de méfiance. Moi qui m’apprêtais, à propos de La Turque, pour le remercier et le complimenter, à lui écrire si cordialement, si franchement, lui parlant de moi, littérairement, sans retenue. Un monsieur qui utilise de plus dans des articles de journaux ce qu’on lui a dit ! Je veux bien le faire moi-même, mais non qu’on me le fasse. Je ferai ma lettre.
Antée

Premier numéro, (juin 1905)
Antée est le nom d’un géant mythologique peu sympathique, ça commence mal. En 1905, deux jeunes Belges Henri Vandeputte (1877-1952) et Christian Beck (1879-1916) fondent la revue Antée. Christian Beck et un habitué du Mercure, il y a publié quatre textes en 1896-1897 et fréquente assidument les Mardis de Rachilde. La première série durera un an exactement, douze numéros. Une deuxième série ouvrira en juin 1906 reprenant au numéro 1

Premier numéro de la deuxième série, juin 1906) »
1907-1908
À l’été 1907, Christian Beck tombe malade. Le dernier numéro de l’année paraît en septembre. Il est question de relancer la revue. À l’automne elle est reprise par André Ruyters (1876-1952), qui lance une nouvelle série, reprenant au numéro 1.

“À nos lecteurs”, en ouverture du numéro de janvier 1908
Cette nouvelle série ne connaîtra qu’un seul numéro, 29e et dernier. Ce dernier numéro se terminera par un éditorial, signé Antée, d’une profonde amertume concernant les prix littéraires et cite Charles-Louis-Philippe :
l’Académie Goncourt étend ses vingt bras en travers du chemin et ne laisse passer que le romancier qui lui plaît […] Il ne s’agit pas d’avoir d’une façon générale du talent, il s’agit de se mettre à la portée d’esprits de grande envergure comme M. Lucien Descaves ou M. Léon Hennique.
Le ton est acerbe, l’ironie affirmée, le désespoir absolu.
Donc ce numéro de janvier 1908 est le dernier. Pourtant, le douze février :
Gide, qui est venu ce matin au Mercure au sujet des épreuves du volume de Signoret dont il s’occupe35, est venu ensuite me demander de faire partie du comité de rédaction d’Antée, qui va reparaître aux frais de Vielé-Griffin36. J’ai répondu que si cela ne m’engage pas à autre chose que mon nom sur la couverture, je n’y vois pas d’inconvénient, tout en lui disant qu’à mon avis, toutes ces histoires de petites revues ne riment pas à grand’chose. Gide m’a expliqué qu’il y a dans la revue Vielé-Griffin, Mockel37 et lui, et que, pour contrebalancer l’influence Mockel et Vielé-Griffin, il a eu l’idée de faire entrer dans le Comité des écrivains d’un autre bord38. C’est ainsi qu’il y aura Philippe, Montfort et moi. De cette façon, on verra que la revue n’est pas uniquement un cénacle. J’ai assez aimé ce On verra. Comme si personne verrait Antée, s’en occuperait, etc… Tous ces messieurs, Mockel, Griffin et Gide, qui ont tous les trois quarante ans, sinon plus, ont l’esprit d’écrivains de dix-huit ans, avec leur manie de fonder des revues, de jouer aux directeurs, aux juges littéraires, de protéger des jeunes, etc… C’est un moyen pour eux d’avoir une petite cour d’admirateurs, de solliciteurs, etc…
La première NRF
On comprend déjà que nous assistons aux prémices de La NRF. Mais nous n’en entendrons plus parler avant l’automne suivant, le 18 septembre :
Trouvé en rentrant une lettre de Montfort, qui me demande d’aller le voir au sujet du projet de revue dont Gide m’a parlé au commencement de l’année et qui serait près d’aboutir.
Paul répond une semaine plus tard, le 24 septembre mais il n’est pas impossible qu’un échange de correspondance ait pu avoir lieu entretemps.
Cher Monsieur,
J’ai en effet quitté la vieille rue Rousselet, ce que je ne cesse de regretter, pour tout le calme et l’isolement que j’y avais. Mais votre première lettre m’est tout de même parvenue, et si je ne vous ai pas répondu tout de suite, ce dont je m’excuse, c’est que j’avais un petit travail à faire et qu’ayant attendu l’extrême limite il fallait m’en débarrasser. Je suis d’ailleurs toujours en retard avec vous. Je dis cela pour votre Montmartre et les Boulevards, dont je ne vous ai pas encore remercié, ni dit tout le bien que j’en pense, dans mon amour des choses rapides et nettes, tout ce qui a l’intérêt d’un document vrai. Mais peut-être Philippe que j’ai rencontré un soir il y a quelque temps et avec qui j’en ai parlé vous a-t-il renseigné là-dessus. Je suis à votre disposition, chez vous, si vous voulez, et le soir que vous voudrez, demain samedi, par exemple, car mes journées ne m’appartiennent pas. J’aurai aussi plaisir à vous voir.
Avec mes meilleurs sentiments.
P. Léautaud
Puis le 28 septembre, en rentrant d’une soirée (il ne semble pas qu’il y ait eu de dîner) chez Eugène Montfort, un très long compte rendu :
Été ce soir chez Montfort, 5, rue Chaptal, pour répondre à son rendez-vous. Accueil charmant. Monsieur Léautaud long comme le bras. Mon aspect l’a surpris. « J’avais vu un autre Léautaud », m’a-t-il dit, comme si on lui avait désigné pour être moi un autre individu. Causé de neuf heures et demie à minuit un quart. Il ne faut certes pas juger les gens sur une première entrevue. Montfort ne m’a pas paru avoir un esprit très remarquable. Pas un mot curieux, pénétrant, une vue un peu profonde, rien de l’homme des Marges. Peut-être est-il de ces gens qui se retiennent, qui se méfient, ou qui se réservent pour leurs livres. […]
Montfort est bien installé. Au sixième, maison très bourgeoise39. L’installation classique de l’homme de lettres qui habite un atelier de peintre. Le seul moyen d’avoir de la place, de ne pas souffrir de cette affreuse phobie qui me tourmente, coins de meubles, murs, angles des tables, etc… Des bibelots, des choses d’art, toute une décoration que je n’aimerais guère pour moi. Une jolie collection de pantins napolitains, cependant, et un fauteuil et un divan comme j’en rêve si souvent.
Montfort m’a demandé mon âge, dont il a été un peu surpris. De février 1877, lui. Tout de même, cinq ans de différence. « Nous n’en sommes pas moins de la même génération », a-t-il ajouté. Surpris aussi de ce que je lui ai dit que je le connaissais depuis longtemps, depuis le temps des naturistes, quand on les rencontrait toujours ensemble, Bouhélier, Leblond40 et lui, que je l’ai vu souvent, que j’étais même à côté de lui à la représentation de Phyllis, de Souchon41, au Palais-Royal. « Je connais ainsi des tas de gens qui ne s’en doutent pas », lui ai-je dit. Encore plus surpris quand je lui ai parlé de mon ignorance de bien des écrivains d’aujourd’hui, et que, même Philippe, que je connais, avec qui je bavarde quelquefois quand nous nous rencontrons, je n’ai pas lu un seul livre de lui, rien que deux Nouvelles, très bien selon moi, récemment, dans Le Matin42. « Vous avez tort », m’a-t-il dit. Parlé de Philippe. Il paraît qu’on lui avait tout à fait promis le Prix Goncourt43 et qu’il a été, dans le moment, très profondément affecté de ne pas l’avoir, ayant fait des projets, bâti des tas de choses là-dessus. « On s’est très mal conduit avec lui » a dit textuellement Montfort. Peu de choses à mon sujet. Je n’ai pas encouragé la conversation sur ce point.
Beaucoup d’éloges sur mes Chroniques dramatiques, la seule chose qu’il lise dans le Mercure avec les Épilogues de Gourmont et les Romans de Rachilde44. Une grande et sincère estime pour Vallette, une réelle admiration pour Gourmont. Il ne semble pas aimer beaucoup le Mercure, auquel il trouve un esprit qu’il a été bien empêché de me définir et de me motiver, comme tous ceux qui expriment cette opinion. Enfin, dans la partie littéraire, on voit à chaque instant des noms nouveaux, inconnus, rien d’un credo littéraire spécial. Dans la Revue de la Quinzaine, à part quelques artisteries d’un Canudo45, d’un Charles Morice46 ou d’un Polti47, c’est de la critique du ton le plus courant.
Assez de ressemblance dans les opinions littéraires. […]
Parlé enfin de leur prochaine revue. La Nouvelle Revue Française, format du Mercure, caractères genre Antée48, premier numéro le 1er novembre. Il y a déjà comme rédacteurs : Gide, Arnauld49, Copeau50, Philippe, Montfort. Montfort directeur. C’est lui qui s’occupera de l’administration. Je lui ai parlé de mon étonnement à voir ainsi des gens qui ne sont plus des jeunes gens avoir encore le besoin, le goût de fonder une revue. Passe encore une Revue à soi, où on est seul, comme Les Marges. Montfort trouve que c’est nécessaire. « Il faut une revue pour les gens de notre génération », m’a-t-il dit. Je lui ai demandé ce que fera Gide. « Je ne sais pas encore, m’a-t-il répondu. Il m’a parlé d’une rubrique… » Les Lettres à Angèle51, que Gide a tant cherché à faire au Mercure. Ce pauvre Gide. Il va être enfin heureux. Il pourra placer ses Lettres à Angèle, ensuite, il lira des manuscrits, les refusera, les acceptera, recevra des jeunes gens, jouera au Cher maître, esthétisera. Il est pourtant charmant, et simple, et très intelligent. Dommage qu’il ait ces côtés de précieux et d’amateur, dans le mauvais sens du mot, c’est-à-dire un restant de puérilité littéraire. Il lui serait si facile de faire son œuvre, s’il en a une à faire. Il a de la fortune. Il a des loisirs. Il est un peu connu. Non. Il lui faut une revue à diriger.
Ma part dans tout cela, c’était d’abord d’être membre du Comité de rédaction, ensuite, de moitié avec Montfort, c’est-à-dire tous les deux numéros, la critique des romans. Moi qui ne lis jamais de romans, qui ai si peu le temps d’en lire. Je l’ai expliqué à Montfort, en plus de tout le travail que j’ai déjà52, que, certes, l’offre ne me souriait guère. Je me demande d’ailleurs ce que j’irais faire là, alors que le Mercure m’est tout ouvert, que j’y suis si bien, si complètement chez moi. L’idée de faire les Romans sous le nom de Boissard m’a ensuite un peu tenté. Je l’ai dit à Montfort. Il paraît que dans cette revue les pseudonymes, comme les anonymats, ne sont pas possibles. Quel sérieux ! Puis, devant mon peu d’entrain, Montfort s’est à peu près décidé pour les Romans par M. Boissard. Rien n’est encore entendu définitivement. Il doit me tenir au courant de ce qui sera fait d’ici là. Je dois aussi lui dire ce que je décide. C’est tout décidé. Je lui écrirai dans quelques jours que mes travaux ne me permettent pas de m’engager à une collaboration comme celle qu’il m’offre, comportant la lecture d’au moins deux ou trois romans pour chaque Chronique.
Montfort, quand nous parlions de Flaubert, m’a parlé de la Correspondance de Zola. « Une grande différence auprès de celle de Flaubert, si intéressante. Il n’y a rien. C’est vulgaire. Mal écrit au possible. On voit tout de suite le manque de race, malgré tout le talent. »
Ce que j’ai appris de plus intéressant, c’est que Mirbeau est malade. Voici comment. Montfort me dit : « Vous connaissez Mirbeau ? » Je lui réponds : « Non. Je n’ai voulu connaître personne. — Il vous aime beaucoup, vous savez. Il parle souvent de vous. Il aime beaucoup ce que vous faites, reprend Montfort. — On me l’a dit, je sais. Ce qu’on dit… ? — Si, si, c’est vrai, c’est très vrai, reprend Montfort. Je vous dis cela, parce qu’en ce moment il est très malade. Il crache le sang, paraît-il… »
Comme je dis que si Mirbeau venait à disparaître, le groupe des gens un peu libres se trouverait encore diminué à l’Académie Goncourt, Montfort m’a dit : « Oh ! vous savez, Mirbeau n’a pas grande influence. C’est plutôt Descaves. Il est très remuant, très intelligent, très adroit. C’est lui qui fait tout, au fond. Les autres sont des indifférents. »
Comme prévu, Paul écrit à Eugène Montfort le trois octobre (1908). Ils se donnent toujours du cher Monsieur.
Il me paraît décidément bien difficile d’accepter la part de rubrique que vous avez bien voulu m’offrir. Je viens de faire mon emploi du temps. J’ai encore pour un bon mois de travail avec les Poètes d’aujourd’hui. D’autre part, j’immobilise au Mercure, depuis près de trois ans, la composition de tout un volume, et l’on me presse, non sans raison, de terminer aussi de ce côté. Je n’ai que mes soirées, comme vous savez. Ajouter à cela le travail d’une rubrique, même bimensuelle, me paraît m’engager beaucoup, en même temps qu’un peu illogique, puisque j’ai quitté ma chronique dramatique pour avoir la paix. Je ne pourrais tenir qu’avec Mauvaise humeur, grande inexactitude, sans compter que lire des romans, cela ne m’amuse pas du tout. Décidément, mieux vaut non. Non pour cela seulement, toutefois. Si vous n’êtes pas trop fâché après moi, je verrai à vous donner quelque chose, quand je me serai mis un peu à jour. Si vous avez un soir rendez-vous avec Philippe et que je ne vous gêne pas, faites-moi signe. J’aurai plaisir à le voir et à vous revoir.
Je vous serre cordialement la main.
Prudemment, Paul se réserve pour l’avenir. Il publiera dans La NRF une série de chroniques dramatiques à partir du premier octobre 1921. Dans son Journal, à la même date du trois octobre 1909, il note :
Écrit aujourd’hui à Montfort pour me libérer tout à fait de ma part de rubrique à sa future Revue. Lire des romans ne me dit rien. Je n’ai pas quitté ma Chronique dramatique pour me charger d’une besogne encore plus embêtante.
Le premier numéro de La NRF (90 pages) paraîtra, daté du quinze novembre.
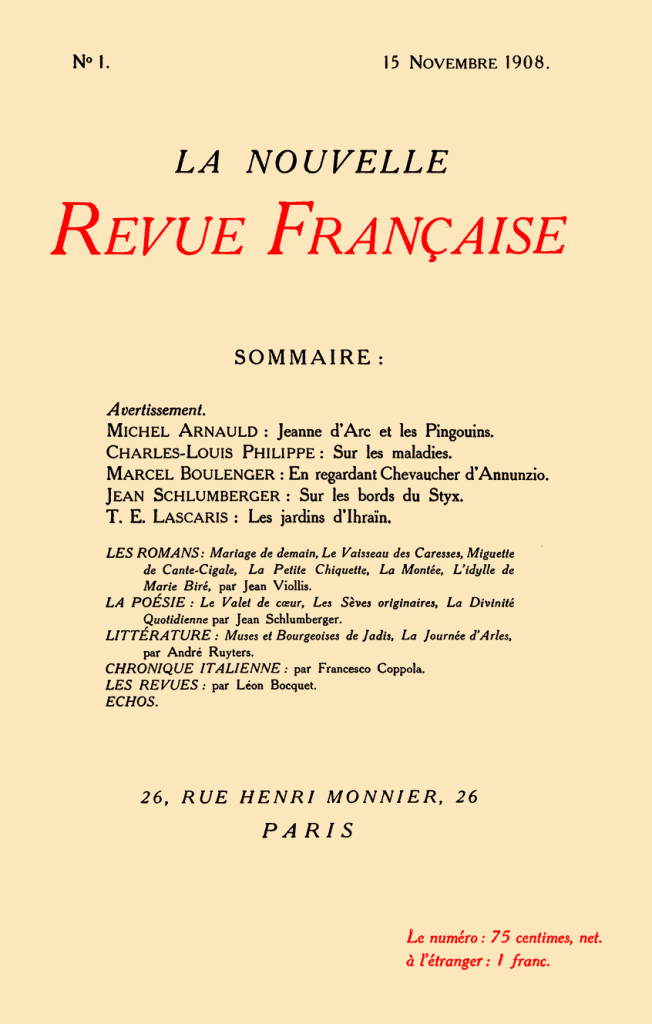
On y trouve sans surprise des noms déjà rencontrés : Michel Arnauld, Charles-Louis Philippe, André Ruyters, Léon Bocquet. On y remarque aussi le nom de Jean Schlumberger.
Paul Léautaud reçoit un exemplaire le 17 novembre, amicalement envoyé :
Reçu ce soir le premier numéro de la revue de Montfort : La Nouvelle Revue Française53. Pas très brillante. Un peu l’ancienne Antée. Je ne figure plus parmi les collaborateurs. Tant mieux. Il y a tout de même un article pas mal de Michel Arnauld sur Anatole France et une bonne critique de romans par Viollis54.
Le premier décembre, un mardi, Paul Léautaud reçoit une lettre d’Eugène Montfort l’invitant pour le samedi cinq.
Le vendredi quatre, Paul, invité par Octave Mirbeau, assiste à la générale du Foyer, enfin créée à la Comédie-Française malgré la vive opposition de Jules Claretie.
Au premier entr’acte, dit bonjour à Mirbeau et remercié d’avoir pensé à moi. Poignée de main très aimable de Descaves. Rencontre de Philippe et de Montfort. Montfort me demande de mettre notre rendez-vous à ce soir.
[…]
Après dîner, reparti chez Montfort. Ce qu’il voulait me dire, en dehors de Philippe, comme il m’en avait prévenu, c’est ceci. La Nouvelle Revue Française est déjà finie pour lui. À ces mots, je l’ai tout de suite arrêté, pour lui dire que j’ai prévu cela dès le soir qu’il m’en a parlé, et les raisons. « Gide ? » lui ai-je dit. C’est bien Gide. Voici comment. Le premier numéro de La Nouvelle Revue Française contenait un article élogieux sur Annunzio par Marcel Boulanger55, et à la revue des Revues, un extrait d’un article de Jean-Marc Bernard56 sur Mallarmé57, relatif à l’impuissance littéraire de Mallarmé, article dont Vallette m’a dit, après avoir lu cet extrait, qu’il doit être très intéressant, que c’est la première fois qu’on voit discuter Mallarmé avec des arguments. Gide, selon Montfort, s’est montré très mécontent et de l’article et de l’extrait, disant qu’il ne peut accepter qu’on louange Annunzio et qu’on critique Mallarmé dans une revue dont il est un des fondateurs et un des membres du Comité de rédaction. De là, le départ de Montfort, qui emmène avec lui les deux bons tiers des autres collaborateurs.
Montfort m’a ajouté que Gide s’est également opposé que mon nom figurât dans le Comité de rédaction, parce que je suis du Mercure. Bien étonnant, après ce que m’a dit Gide au commencement de l’année, à propos de l’installation d’Antée à Paris.
Toute l’histoire m’a bien amusé, comme la déconvenue de Montfort. « Ça vous apprendra à fonder des revues », lui ai-je dit. La vérité, c’est que ça ne lui apprendra rien. Il m’a fait part d’un autre projet déjà réalisé. Les Marges vont reparaître en janvier, sous forme de revue, avec plusieurs rédacteurs. Il voulait me donner une sorte de rubrique de réflexions sur les faits du jour. J’ai dit non carrément, cette fois-ci, voulant absolument avoir la paix avec toutes sortes de collaboration.
Montfort est certainement destiné à mourir d’apoplexie. Il était ce soir vêtu seulement d’un pantalon et d’une chemise, le col déboutonné. Trapu, solide, un cou énorme, le menton presque de niveau avec la gorge. Aucune distinction d’aspect ni de manières. Il a, en parlant, des mouvements de la bouche fort vulgaires.
Paul Léautaud n’évoquera pas la suite, le deuxième « premier numéro » de La NRF qui paraîtra avec une nouvelle équipe le premier février prochain (1909) : Comité de direction : Jacques Copeau, André Ruyters et Jean Schlumberger. Dans l’urgence la revue est domiciliée chez ce dernier, 78 rue d’Assas. André Gide y publiera le début de La Porte étroite et, page 96 est appliqué un pansement ouaté sur la poésie de Stéphane Mallarmé. Quant à Gabriele d’Annunzio, il n’en sera plus jamais question, même pendant l’occupation.
À partir de cette date, Eugène Montfort s’éloigne de La NRF pour n’y revenir (hormis quelques rares comptes rendus de ses romans) que deux fois, la première comme chroniqueur, dans le numéro d’avril 1922, la seconde fois comme sujet de son article nécrologique en février 1937, par Jacques Rivière, le directeur d’alors.
Notes
1 « Les Marges : gazette littéraire par Eugène Montfort », parue de novembre 1903 jusqu’en 1937. Eugène Montfort en fut l’unique rédacteur jusqu’en 1908 (douze numéros), la parution étant alors trimestrielle. Cette année 1908 vit aussi la parution du premier numéro de La Nouvelle revue française. Voir l’article de Fernand Chaffiol-Debillemont (note 205, à paraître le premier mars 2026) dans la Revue des deux mondes du quinze janvier 1967 pages 201-213 : « Eugène Montfort et Les Marges »
2 Le Censeur — politique — financier — littéraire, revue créée par Jean Ernest-Charles (Paul Renaison, 1875-1925).

Le premier numéro du Censeur, daté du 31 décembre 1881
3 Eugène Montfort, Les Cœurs malades, offert à Octave Mirbeau, Charpentier 1904, 261 pages. « J’ai essayé dans ce roman de peindre les ravages de l’amour sur des sensibilités outrées. / Est-ce là une histoire pour gens raisonnables ? Hélas ! je crois bien que non ! » Il semble que ce roman soit à l’origine de la non-obtention de la Légion d’honneur pour Eugène Montfort (voir ici au sept juillet 1911, à paraître le premier décembre 2025).
4 Eugène Montfort, La Maîtresse américaine, Arthur Herbert, porte Sainte-Catherine à Bruges, été 1906, 197 pages.
5 Eugène Montfort, Le Chalet dans la montagne, texte d’une centaine de pages un peu mince, a été inclus dans un ensemble sous le titre général de « Voyages vrais et imaginaires » et complété de Voyage à Florence, Chausey, Sensations anglaises et Nuits d’Espagne afin d’atteindre 297 pages. Charpentier-Fasquelle 1905.
6 Eugène Montfort, Montmartre et les Boulevards, « Phonographies psychologiques et morales », Les marges, 1908. Distribution par Edward Sansot.
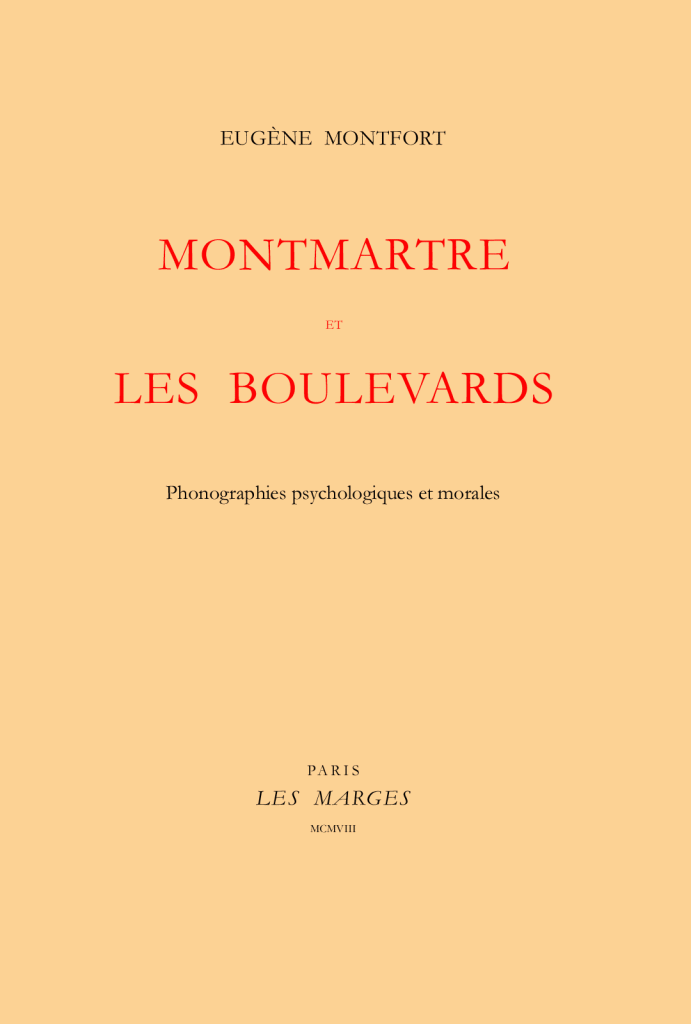
7 Paul Claudel (1868-1955), élève du lycée Louis-le-Grand puis de Sciences-po, licencié en droit en 1888, rejoint le corps diplomatique en 1893. D’abord vice-consul à New York puis à Boston, il est nommé consul à Shanghai en 1895. Après une interruption de cinq années (1900-1905) pour raisons religieuses, Paul Claudel reprendra sa carrière diplomatique et finira ambassadeur à Tokyo, à Washington puis enfin à Bruxelles, son dernier poste, qu’il quittera en 1936 pour se consacrer pleinement à la littérature.
8 « Un grand poète, Paul Claudel », Les Marges de février 1905, page 107 (pagination depuis le premier numéro).

On se souvient, en lisant le texte ci-dessus, qu’en 1905, Paul Claudel pourtant âgé de 37 ans, n’avait encore presque rien publié et qu’Eugène Montfort apparaît bien ici comme visionnaire.
9

Fragment de la couverture d’un des premiers numéros des Marges.
Le liseré se trouvera ensuite sur toutes les couvertures des volumes publiés par la revue. Le café-glacier Napolitain était situé au un boulevard des Capucines. Ce boulevard fait suite au boulevard des Italiens et commence au niveau de la rue Louis-Le-Grand. Comme le Vachette, il était fréquenté par des journalistes et des hommes de lettres.
11 Jean Moréas (Ioánnis À. Papadiamantópoulos, 1856-1910), poète symboliste grec d’expression française. En 1886, Jean Moréas, Paul Adam et Gustave Kahn ont fondé la revue Le Symboliste. Jean Moréas a fait partie des Poètes d’aujourd’hui dès la première édition de 1900 où sa notice a été rédigée par Adolphe van Bever. Lire l’article de René Gillouin en ouverture de La NRF de mai 1912. Voir aussi Alexandre Embiricos « Les débuts de Jean Moréas » dans le Mercure du premier janvier 1948, page 85. Pour le banquet offert à Jean Moréas le deux ou trois février 1891 voir l’article de Francis Vielé-Griffin dans les Entretiens politiques et littéraires de février 1891, pages 58-62. Voir aussi André Fontainas, Mes souvenirs du symbolisme, éditions de la Nouvelle revue critique 1928, à partir de la page 120.
12 Le dernier texte (morceau, quel mot affreux) concernant Jean Moréas a été publié en ouverture du dixième numéro des Marges (novembre 1906), pages 189-194.
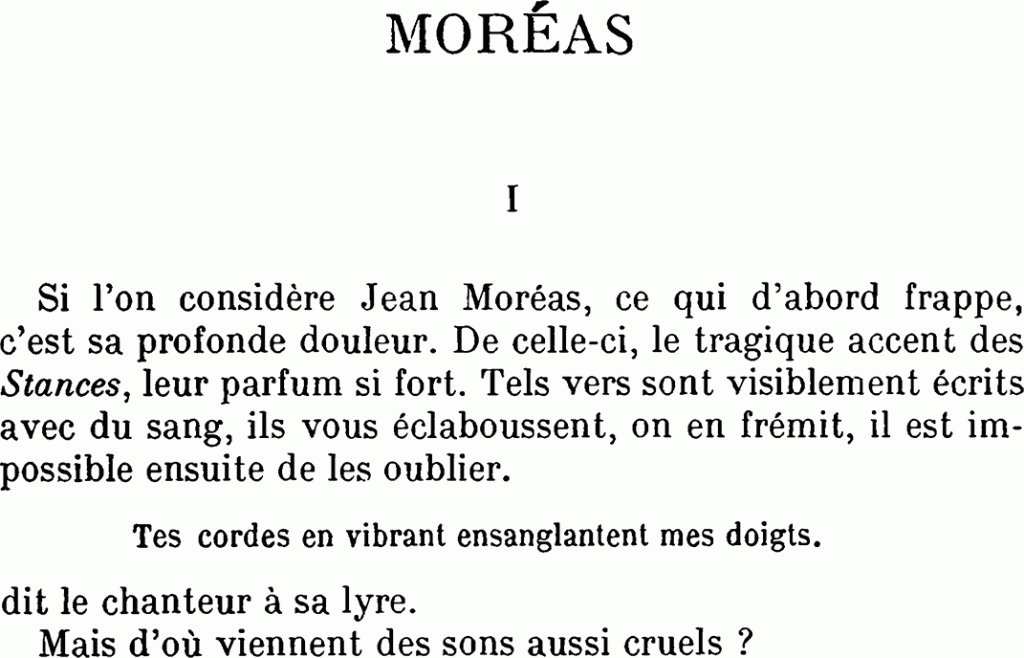
Précédemment était paru, dans le numéro deux des Marges (mars 1904, page 45), un compte rend d’Iphigénie, tragédie en cinq actes de Jean Moréas représentée sur le Théâtre antique d’Orange en août 1903 puis à l’Odéon en décembre et dont le texte est paru au Mercure en 1904.
13 Bien que mort à Saint-Mandé en 1910, Jean Moréas était né à Athènes (en 1856). Il ne s’est installé définitivement à Paris qu’en 1880.
14 Henry Fouquier (1838-1901), journaliste, écrivain, dramaturge et homme politique a épousé en 1876, la veuve d’Ernest Feydeau et devient, de ce fait, le beau-père de Georges Feydeau.

Les Marges numéro dix (novembre 1906), page 204
Le lecteur du Journal littéraire (18 mars 1906) se souvient que « Monsieur Coffe » est un personnage imaginaire, inventé par Paul Léautaud et Remy de Gourmont.
15 À propos de cette lettre, qui n’a peut-être pas été envoyée en l’état, voir au 23 décembre, la conversation avec Lucien Descaves.
16 Eugène Montfort, La Turque — roman parisien offert au romancier (et député) Louis Codet mort à la guerre à 38 ans. Charpentier-Fasquelle 1906, 270 pages.
17 On peut le regretter mais le testament d’Edmond de Goncourt de 1897 est clair et indique « Ce prix sera donné au meilleur roman, au meilleur recueil de nouvelles, au meilleur volume d’impressions, au meilleur volume d’imagination en prose, et exclusivement en prose, publié dans l’année. » Aucune condition d’âge n’est indiquée.
18 Pour mémoire et mieux comprendre ce texte, le premier prix Goncourt a été attribué (en 1903) à John-Antoine Nau pour Force ennemie, le deuxième à Léon Frapié pour La Maternelle, le troisième à Claude Farrère pour Les Civilisés. Tous ces auteurs ayant la quarantaine au moment de leur prix.
19 Claude Farrère (Frédéric-Charles Bargone, 1876-1957), écrivain voyageur et officier de marine, prix Goncourt 1905 avec Les Civilisés. Le six mai 1932, le Président Doumer qui inaugure le salon annuel des écrivains anciens combattants et s’entretient avec Claude Farrère, président de l’association, tombe sous les balles de Paul Gorgulov. Claude Farrère s’interposant, est blessé au bras, ce qui lui vaudra son élection à l’Académie française en mars 1935, devant Paul Claudel. Un court portrait de Claude Farrère sera dressé par Paul Léautaud à cette date du six mai 1932.
20 Les frères Tharaud, Jérôme (1874-1953) et Jean (1877-1952), auteurs féconds, l’un rédigeant, l’autre corrigeant, sont de cette droite coloniale, raciste et antisémite, courante à l’époque. Ils seront d’ailleurs tous deux élus à l’Académie française, l’un en 1938, l’autre en 1946. Dingley l’illustre écrivain (Éditions d’Art Édouard Pelletan, 155 pages).
21 John-Antoine Nau (Eugène Léon Édouard Torquet, 1860-1918), romancier et poète symboliste américain d’ascendance et d’expression françaises. Perpétuel voyageur hanté par la mer est, avec son roman Force ennemie le premier lauréat du Prix Goncourt, en 1903. J.-A. Nau n’avait publié jusque-là que quelques nouvelles dans La Revue blanche et une plaquette de vers à compte d’auteur. C’est donc le livre d’un parfait inconnu qui a remporté le prix. Le roman n’eut par la suite qu’un succès médiocre, ce qui n’empêcha pas le président de l’académie Goncourt, J.-K. Huysmans, de dire bien plus tard, selon Lucien Descaves : « C’est encore le meilleur que nous ayons couronné. »
22 Léon Frapié (1863-1949), a reçu le prix Goncourt le sept décembre 1904, à l’occasion d’une réunion au Café de Paris, pour La Maternelle, à six voix contre quatre. Ce roman basé sur les souvenirs de Madame Frapié s’inscrit dans la veine naturaliste, prolongeant Zola, mort deux ans auparavant. Inséré entre L’Institutrice de province en 1897 et L’Écolière en 1905 ou La Boîte aux gosses en 1907, La Maternelle est le seul roman de Léon Frapié ayant eu un réel succès, bien que l’auteur ait tenté d’épuiser le sujet autant que possible. Trois films en seront adaptés.
23 Normalien, agrégé de lettres et romancier, Louis Bertrand (1866-1941), fut biographe de Gustave Flaubert, dont il connaissait la nièce, Caroline Commanville. Grâce à elle, Louis Bertrand hérita en 1931 de la bibliothèque et des archives de Gustave Flaubert. Avant cela, en 1925, Louis Bertrand a été élu à l’Académie française au fauteuil de Maurice Barrès, dont il prononça un éloge réservé, ce qui lui fut reproché. Son évolution idéologique le conduisit vers la fin de sa vie à écrire, en 1936, un essai hagiographique sur Hitler. Dans Le Pont des Saints-Pères, André Billy écrira : « Louis Bertrand était un gaillard d’une suffisance et d’une méchanceté singulières, avec qui les échanges d’idées étaient difficiles, la plupart des siennes se rapportant à lui-même… »
24 Voir la notice de Francis Jammes dans les Poètes d’aujourd’hui.
25 Deux cousins signent ensemble du nom de Marius-Ary Leblond et sont tous deux critiques d’art réunionnais. Marius Leblond (Georges Athénas (1880-1953) et Aimé Merlo (1877-1958). En France, leur douzième livre et septième roman paru chez Charpentier (470 pages) obtiendra le prix Goncourt en 1909.
26 Centralien et ingénieur, c’est par la petite porte que Maurice Donnay (1859-1945) est entré en littérature, comme chansonnier au côté d’Alphonse Allais, avant de poursuivre une carrière d’auteur dramatique à succès, particulièrement apprécié de Jules Renard. Dans le Mercure du seize avril 1908 à propos de Petite Hollande, comédie de Sacha Guitry, Maurice Boissard écrira : « M. Sacha Guitry, lui, est un élève de M. Maurice Donnay. Il mêle, comme l’auteur d’Amants [Donnay], le pathétique avec la blague boulevardière, et adoucit de plaisanterie la passion de ses personnages. » De Maurice Donnay, Maurice Boissard chroniquera Le Ménage de Molière (Mercure du seize juillet 1912) et Les Éclaireuses (premier avril 1913). Maurice Donnay siègera trente-huit ans à l’Académie française, où il sera élu dans deux mois, le quatorze février 1907.
27 Joris-Karl Huysmans (1848-1907) a d’abord été un romancier naturaliste, proche d’Émile Zola. Vers la quarantaine, J.-K. Huysmans changera d’écriture en se tournant vers ce que l’on appellera l’esthétique « fin de siècle », qui apparaît de nos jours décadente, illustrée par son roman À rebours. Suite à cela, et après la rencontre de Jules Barbey d’Aurevilly, J.-K. Huysmans accomplira la fin du long et douloureux chemin vers la conversion avec En route, puis La Cathédrale, pour finir retiré dans une abbaye bénédictine. Voir l’enterrement de J.-K. Huysmans par Paul Léautaud le 15 mai 1907.
28 J.-H. Rosny est le pseudonyme commun des frères Joseph Henri Honoré Boex (1856-1940) et Séraphin Justin François Boex (1859-1948), tous deux nés à Bruxelles et donc Belges. Dans son testament, Edmond de Goncourt a désigné les frères Rosny comme membres de la future académie Goncourt où ils occuperont les quatrième et cinquième couverts. Entre 1887 et 1908 ils écrivent en collaboration de nombreux contes et romans à dominantes scientifique ou fantastique, mêlant souvent les deux. En juillet 1908 les frères arrêtent leur collaboration et Joseph continue d’écrire sous le nom J.-H. Rosny aîné, pendant que Séraphin signe J.-H. Rosny jeune. J.-H. Rosny aîné aura droit à son portrait-charge dans Mots, propos et anecdotes.
29 Lucien Descaves habite au 46 rue de la Santé. La prison est au 42. Lucien Descaves (1861-1949), journaliste, romancier et auteur dramatique naturaliste et libertaire. Lucien Descaves s’est rendu célèbre par Les Sous-offs, roman antimilitariste pour lequel il a été traduit en cour d’assises pour injures à l’armée et outrages aux bonnes mœurs. Acquitté en 1890, il a donné d’autres œuvres dans le même ton. Rédacteur au journal L’Aurore au moment de l’affaire Dreyfus, il lui apporte son soutien. Lucien Descaves est secrétaire de l’académie Goncourt.
30 Il s’agit de la dernière phrase de l’article, qui sonne comme un remord. Voir aussi le Gil Blas du 18 décembre, page deux, colonne trois : « Renfermé dans sa tour d’ivoire, M. Octave Mirbeau n’a pas entendu venir jusqu’à lui les rumeurs de mécontentement des candidats évincés. » Voir aussi L’Intransigeant du vingt décembre page quatre, « Nos échos ».
31 Peut-être un certain Estienne.
32 Dans la même colonne de L’Intransigeant du vingt décembre évoquée note 30, nous pouvons lire : « Si nous en croyons les confidences d’un membre, et non des moindres, de l’Académie des Dix, on connaîtrait déjà le lauréat du prix Goncourt pour 1907. Ce sera M. Paul Léautaud, auteur du Petit Ami, le collaborateur de Ad. van Bever pour les Poètes d’aujourd’hui, le rédacteur au Mercure de France, le biographe de M. Henri de Régnier. Il obtiendrait les 5.000 francs pour son livre : Amours, tout plein de confidences peu respectueuses à l’égard de sa famille. Quoi qu’il en soit, voilà une façon curieuse de disposer des fonds du vieux Goncourt. »
33 Léon Hennique (1850-1935), romancier naturaliste et auteur dramatique. Exécuteur testamentaire et colégataire avec Alphonse Daudet, d’Edmond de Goncourt, il s’occupa activement de la fondation de l’académie Goncourt, dont il assuma la présidence de 1907 à 1912.
34 Journal littéraire au 21 décembre : « [Henri Albert] me parle aussi du Prix Tharaud : le matin même du jour du dîner, une lettre anonyme envoyée à Hennique, chez Stock, disant que les Tharaud ont de la fortune. » Cette affirmation est peu vraisemblable : le père est mort lorsqu’ils avaient respectivement trois et six ans. Le grand-père maternel était proviseur du lycée d’Angoulême.
35 Emmanuel Signoret, Poésies complètes (Vers dorés, Daphné, La souffrance des eaux, Douze poèmes, Tombeau dressé à Stéphane Mallarmé, Le premier livre des élégies). Préface par André Gide, Mercure 1908, 313 pages et deux pages de fac-similé. Voir la quatrième « Lettre à Angèle » dans L’Ermitage de novembre 1898 (page 352). Journal d’André Gide, ce douze février 1908 : « L’esprit plein de gaieté je vais rapporter les épreuves de Signoret au Mercure. »
36 Francis Vielé-Griffin (1864-1937), poète symboliste, directeur de la revue Les Entretiens politiques et littéraires, intime de Stéphane Mallarmé. Dans son Enquête sur l’évolution littéraire parue chez Fasquelle en 1894, Jules Huret a écrit : « [Francis] Viellé-Griffin qui est une des intelligences les plus complètes de ce temps […]. » On lira aussi la notice de Francis Viellé-Griffin dans les Poètes d’aujourd’hui (à partir de la première édition) rédigée par Adolphe van Bever. On pourra aussi consulter sa notice par Henri Clouard dans sa très respectée Histoire de la littérature française du symbolisme à nos jours (volume I, page 118 de l’édition Albin Michel de 1947).
37 Albert Mockel (1866-1945), écrivain et critique belge. Collaborateur du Mercure. PL en dresse un portrait assez vif à la date du 11 avril, page 82. Lire la notice d’Albert Mockel dans les Poètes d’aujourd’hui.
38 Opposé au symbolisme, qui était encore la pensée dominante de l’époque mais déclinante. Historiquement le Naturisme a été établi en 1895 par Saint-Georges de Bouhélier et Maurice Le Blond (note 40 ci-dessous) mais voit son premier acte public revendiqué dans un (très long) « manifeste » publié par Saint-Georges de Bouhélier dans Le Figaro du dix janvier 1897 (pages quatre et cinq) ce même numéro du Figaro recèle, page deux, un autre texte important sur les « conventions théâtrales », par Henry Becque. À défaut de la reproduction intégrale de cet important manifeste, laissons Le Figaro présenter, de façon très éclairante le texte de Saint-Georges de Bouhélier :

39 La rue Chaptal, dans un lieu populaire de Paris, est une petite voie agréable et calme, bordée d’immeubles cossus. Elle relie la rue Pigalle à la rue Blanche, dans le quartier de jeunesse de Paul. Maurice Barrès et Catulle Mendès ont habité rue Chaptal.
40 Maurice Le Blond (1877-1944), journaliste et écrivain. Saint-Georges de Bouhélier et Maurice Le Blond ont été en 1885 à l’origine du mouvement littéraire Naturisme. Maurice Le Blond a été le secrétaire de Georges Clemenceau. En 1908 il a épousé Denise, la fille d’Émile Zola.
41 Paul Souchon (1874-1951), poète, dramaturge et romancier, spécialiste de Victor Hugo et Juliette Drouet. Il fut conservateur de la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Phyllis, tragédie en cinq actes de Paul Souchon créée le seize avril 1905 aux Bouffes-Parisiens et publiée par le Mercure de France la même année. Paul Léautaud a écrit à Paul Souchon le 27 février 1904 à propos de l’affaire Leonsberry à laquelle on n’a pas compris grand-chose. On peut lire la notice de Paul Souchon dans les Poètes d’aujourd’hui.
42 Dont Après le crime, en page quatre, deux premières colonnes du Matin du 21 septembre.
43 Octave Mirbeau s’était engagé pour Marie Donnadieu (Charpentier 1904, 316 pages).
44 La chronique des « romans ».
45 Ricciotto Canudo (1877-1923) est italien. Installé à Paris en 1902 il a tenu la rubrique des « lettres italiennes » au Mercure entre décembre 1904 et juin 1913. Romancier, poète, philosophe, critique d’art, Ricciotto Canudo a inventé en 1919 le terme de « 7e art ».
46 On ne confondra pas Charles Morice avec Paul Morisse, qui sera le collègue de Paul Léautaud à partir d’octobre 1908. Charles Morice (1860-1919), écrivain, poète et essayiste. Fils de militaire, élevé dans une famille très chrétienne, Charles Morice, âgé de 22 ans, a quitté la maison paternelle pour fréquenter les milieux anticléricaux de gauche. En 1890 il a fait partie des membres fondateurs du Mercure mais PL en parlera peu dans son journal. Pour l’anecdote, le supplément du Nouveau Larousse illustré paru au début du XXe siècle indique la mort de Charles Morice en 1905. On peut lire un article sur Charles Morice dans Les Nouvelles littéraires du 26 janvier 1929, page 9 (deux colonnes).
47 Georges Polti (1867-1946) est chargé, au Mercure, de la littérature dramatique, c’est-à-dire des pièces de théâtre parues en volume ou en feuilleton dans les revues. Nous trouvons sa signature dans une soixantaine de numéros du Mercure entre 1894 et 1910.
48 Du Garamond (ci-dessous, celui de Word) :
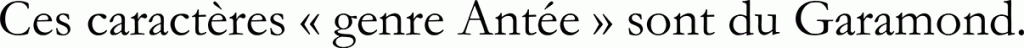
49 Il s’agit de Marcel Drouin (1871-1943), rencontré par André Gide chez Pierre Louÿs. En septembre 1897, Marcel Drouin a épousé Jeanne Rondeaux, sœur cadette de Madeleine Rondeaux, cousine germaine et épouse d’André Gide. Marcel Drouin est normalien, agrégé de philosophie et enseignant au lycée Janson de Sailly. Il est le père de Dominique Drouin, né en juillet 1898.
50 Jacques Copeau (1879-1949), homme de théâtre parmi les plus importants de son temps et ami d’André Gide. Lire, dans Le Monde du deux mars 1989 : « André Gide et Jacques Copeau, une si difficile amitié » à propos la parution de leur Correspondance 1913-1949, Cahiers André Gide numéro treize, Gallimard, 1988, 638 pages.
51 Ces Lettres à Angèle, critiques littéraires, sont parues dans L’Ermitage (d’Henri Mazel) de juillet 1898 à novembre 1900. Voir aussi la note huit de la page « André Gide I »
52 Paul est devenu salarié du Mercure début janvier.
53 Sur le site Internet de Gallimard en 2017 on pouvait lire « Après un “faux départ” en novembre 1908 sous la direction d’Eugène Montfort, le premier “vrai” numéro de La Nouvelle revue française paraît en février 1909. »
54 Jean Viollis (Jean-Henri d’Ardenne de Tizac, 1877-1932), romancier naturaliste époux de la journaliste Andrée Jacquet (1870-1950) qui a utilisé le pseudonyme de son mari pour écrire sous le nom, remarqué, d’Andrée Viollis. Jean Viollis vient de publier, chez Calmann-Lévy un roman, Monsieur le Principal, qui, en décembre prochain perdra le Goncourt face à Écrit sur de l’eau de Francis de Miomandre.
55 Marcel Boulenger (avec un e bien présent sur la couverture, 1873-1932), romancier, journaliste et escrimeur. On se souvient de lui pour ses biographies de personnages imaginaires, auxquelles beaucoup ont cru. L’article évoqué ici est paru page 21 : « En regardant chevaucher d’Annunzio ».
56 Jean-Marc Bernard (Jean Bernard, 1881-1915, mort au combat), a collaboré a plusieurs revues, dont Les Guêpes (tendance monarchiste). Proche de l’Action française, disciple de Charles Maurras, il collabora aussi à la Revue critique des idées et des livres et au Divan d’Henri Martineau (dont le premier numéro paraîtra dans deux semaines, début janvier).
57 Page 77, dans la rubrique des « Revues », Léon Bocquet donne un « Contre Mallarmé » dans lequel il rend compte d’un article de Jean-Marc Bernard « Stéphane Mallarmé et l’idée d’impuissance » paru dans le mensuel belge (de Mons) très à gauche (communiste ?) La Société nouvelle d’août 1909 (pages 177-195).