Page publiée le premier octobre 2025. Temps de lecture : une heure 40.
Genèse de l’édition — La revue Commerce — La revue Variétés — Le portrait par Marie Laurencin — Déjeuner chez Mornay — Le premier exemplaire — Liste des lettres — 1902-1903 — 1904-1906 — 1907-1908 — 1909-1911 — 1912 et 1914 — 1915-1916 — Notes

Genèse de l’édition (1929-1930)
Le onze mars 1929, René Maran (1887-1960), prix Goncourt 1921 pour Batouala chez Albin-Michel vient voir Paul Léautaud :
Tantôt visite de René Maran, venant me demander, de la part de l’éditeur Mornay, si je n’aurais pas un volume à lui donner pour une édition de luxe, Le Petit Ami, par exemple. J’ai répondu la vérité : rien, rien, rien.
Spécialisé dans une mode nouvelle, le « semi-luxe », Georges Mornay est bien connu des gens du Mercure. Son catalogue est fort beau, on y trouve Georges Duhamel (premier auteur publié), Pierre Louÿs, Octave Mirbeau, Eugène Montfort… et les Portraits d’hommes de Rachilde, réunis pour la première fois en volume en avril 1929 (achevé d’imprimer le trente mars), un an avant l’édition courante du Mercure en mai 1930 (achevé d’imprimé du 28 avril).

Justifications des tirages de Portraits d’hommes chez Mornay et au Mercure
Georges Mornay (1876-1935), est peintre. Il a débuté dans l’édition d’art en 1919 par l’édition La Vie des Martyrs de Georges Duhamel, (Mercure 1917) illustrée par Jean Lébédeff. Les éditions Mornay étaient la propriété de Georges et Antoinette Mornay (1867-1962), considérés comme des pionniers de l’illustration dans les ouvrages de « demi-luxe ». La marque a été abandonnée en 1934.
Après René Maran, c’est Georges Mornay qui se déplace, vingt jours plus tard, le 29 mars. Veut-il absolument un texte de Paul ou cherche-t-il simplement des textes à publier ? Il est vraisemblable que sans les Portraits d’hommes de Rachilde il n’aurait pas pensé à Paul Léautaud.
Ce matin, visite de l’éditeur Mornay, pour me demander un texte pour un volume de luxe. Répondu naturellement que je n’ai absolument rien. C’est Mornay qui va publier en volume les Portraits d’hommes que Rachilde publie dans les Nouvelles littéraires1. C’est Vallette lui-même qui m’a dit cela quand ces Portraits ont commencé, — par le sien. Mornay m’a parlé ce matin de ce volume et appris que j’y figure. Il devait venir de voir Rachilde. Elle avait sans doute oublié de lui remettre un papier, car elle est arrivée à son tour dans mon bureau. Mornay lui dit alors l’indiscrétion qu’il venait de commettre en me disant que je figure dans le volume de Portraits.
Une douzaine de jours plus tard, le dix avril :
Commerce
Tantôt visite de Jean Paulhan. Il vient me demander si je peux lui donner quelque chose pour le no de Commerce du mois prochain2. Je dis que je n’ai absolument rien. Il me donne à lire la lettre que lui a écrite Claudel à propos de mon Dialogue3. Dans cette lettre, Claudel écrit qu’après ce qu’il vient de lire du sieur Léautaud il rompt toutes relations avec la N.R.F. Il regrette qu’un contrat le lie à cette maison pour ses ouvrages. Il prie qu’on ne lui envoie plus la revue.
Paulhan : « C’est pour cela. J’aurais bien voulu que vous me donniez quelque chose pour le prochain numéro de Commerce, pour l’embêter4. »
Onze jours plus tard, l’idée a germé, dans le pavillon de Fontenay. Le dimanche 21 avril, nous entendons reparler de Marcel Lebarbier, directeur des éditions de la Belle page, qui a publié Villégiature en 1925.
Marcel Lebarbier m’a écrit il y a quelques jours pour me demander, comme un service, de lui donner quelque chose pour un petit volume de luxe. Je ne lui ai pas encore répondu, n’ayant rien à lui donner. Il m’est venu hier au soir l’idée que je pourrais lui donner une demi-douzaine de lettres prises dans ma correspondance (j’ai pris pendant longtemps le double des lettres que j’écrivais). J’ai travaillé à cette recherche toute cette journée. J’ai trouvé un lot de 37 lettres à Valéry, Rachilde, Schwob, Paupe, Hirsch, Gourmont, Marie Laurencin, Billy, Morisse, Apollinaire, Rouveyre, qui peuvent très bien être publiées. Elles vont de 1902 à 1918. J’ai même envie de les proposer à l’éditeur Mornay, qui est venu il y a quelque temps me demander quelque chose pour un volume de luxe. Publier de son vivant des lettres qu’on a écrites ? Ce serait assez drôle. J’en ai profité pour classer en ordre par année, dans une chemise pour chaque année tous mes doubles de lettres. J’en ai d’autres dans d’autres papiers. Il faudra que je les rassemble.
Mais le lendemain, lundi 22 avril, le projet prend une toute autre direction :
J’ai changé d’avis ce matin dans le train. L’idée m’est venue d’aller offrir ces lettres à Jean Paulhan, pour Commerce. Voilà plus d’un an qu’il me demande de lui donner quelque chose, — il y a quelques jours encore, à propos de l’histoire Claudel. 100 francs la page, m’a-t-il dit. Cela me fera une petite somme.
Je l’ai vu ce soir à 6 heures. La chose est à peu près faite. Il voulait même que je porte mes papiers tout de suite à l’imprimeur de la revue, l’imprimeur Levée, rue Cassette, mais je lui avais demandé au début de la conversation si c’est lui qui décide pour accepter ou refuser les articles. Il m’a dit non. C’est une dame ? une Américaine qui fait les frais de Commerce5. C’est du reste elle-même, m’a-t-il dit, qui l’a chargé, lui, Paulhan, de me demander quelque chose. Je lui ai dit alors de soumettre la chose à cette dame. Je lui avais préparé une note : nombre de lettres, noms des destinataires, époque sur laquelle s’étendent ces lettres. Je la lui ai laissée, à titre de documents. Il est si bien d’avis que la chose est faite qu’il est revenu à sa première idée : m’accompagner sur-le-champ chez l’imprimeur pour lui remettre tout le dossier à composer. J’en suis resté à mon idée d’en parler d’abord à cette dame. Si cela ne réussit pas, j’aurais toujours pour me rattraper la revue belge Variétés6 qui vient encore de m’écrire pour me demander des fragments de mon Journal. Paulhan pense que mes 37 lettres pourraient faire 30 pages de Commerce. À cent francs la page, 3 000 francs. Je vais bien.
Il est entendu avec Paulhan : ou que je ne donnerai mes doubles de lettres que le jour qu’on pourra les composer aussitôt, ne voulant pas risquer la perte de ces papiers, — ou dès maintenant, pour les composer et me les rendre avec les épreuves, quitte à les faire passer dans la revue quand on voudra.
Paulhan m’a promis une réponse prompte. Il riait beaucoup de cette idée de publier des lettres. Il a commencé par me dire, quand je lui ai demandé si c’est lui qui décidait et qu’il m’eût parlé de cette dame : « Naturellement, vous n’acceptez pas qu’on lise d’abord ?… » Et tout de suite après : « Du reste, du moment qu’on vous a demandé… » Je lui ai répondu : « Vous comprenez bien que si je publie ces lettres, c’est qu’elles peuvent être publiées. Je suis le premier intéressé à ne pas publier des choses qui ne vaudraient vraiment rien. Ces lettres vont de 1902 à 1918. Je les ai relues çà et là. Après si longtemps c’est tout de même une expérience. Eh ! bien, mon avis, c’est qu’elles peuvent très bien être publiées. Vous le comprenez bien : je serais le premier intéressé à ne pas le faire si elles ne valaient rien. »
Le lendemain mardi 23 avril :
L’affaire de mes lettres dans Commerce est entendue. J’ai reçu tantôt un pneumatique de Jean Paulhan m’informant qu’elles passeront soit dans le numéro de printemps, ce qui est le plus probable, soit dans le numéro d’été. J’aurai mes épreuves dans les dix ou douze jours.
C’est vraiment charmant à lui d’avoir mis tant de promptitude dans cette petite affaire.
Je suis allé à cinq heures à la Nouvelle Revue française pour le voir, au sujet de la remise de mes papiers pour la composition. Je voulais aussi lui dire que puisque Commerce est fait dans les conditions qu’il m’a dites, par cette Princesse Bassiano, américaine, je crois, il n’y avait pas à s’occuper de ne pas prendre trop de pages, ce qui serait de l’argent de moins pour moi, alors que quelques centaines de francs de plus ou de moins ne sont certainement rien pour cette dame. Il n’est pas venu aujourd’hui. Je n’ai vu que Mme Pascal7. Je l’ai chargée de remercier très vivement Paulhan pour sa célérité, qui me touche beaucoup. Elle m’a dit qu’il a téléphoné dès hier soir, après mon départ, à cette dame. Je lui ai parlé des questions ci-dessus. Elle a été de mon avis. Elle m’a expliqué que Paulhan ne s’occupe que de loin de Commerce. C’est cette dame qui fait tout avec l’imprimeur. C’est à elle que mon dossier de lettres sera remis et c’est elle qui examinera la question de composition avec l’imprimeur. J’ai rappelé à Mme Pascal le prix que m’a fixé Paulhan, depuis longtemps, et encore récemment, en me demandant quelque chose pour Commerce : Cent francs la page. Comme elle lui répétera certainement, rentrée chez eux, notre conversation, ce rappel n’est pas inutile. J’irai voir Paulhan demain à cinq heures et demie. J’ai travaillé ce soir à mettre en tête de chaque lettre le nom du destinataire. Tout cela fera un ensemble assez curieux.
Le numéro de Commerce de printemps est le numéro de mai8, — qui paraît probablement en juin, ou tout au moins fin mai.
Immédiatement après, dans le Journal, vient le récit de la visite de Georges Mornay venant voir Rachilde pour ses Portraits d’hommes.
Je me suis trouvé à midi, dans le bureau de Vallette, lui absent, avec Rachilde et l’éditeur Mornay. Mornay s’est mis à me reparler de son désir que je lui donne quelque chose pour un volume de luxe. Parle ensuite du Petit Ami, quand il reparaîtra. Rachilde se met alors à me dire : « Vous avez tort, Léautaud. Vous devriez publier. C’est le moment. Que diable !… » Je lui réponds : « C’est très joli, Madame, ce que vous dites. Mais je suis ici depuis 9 heures du matin à 6 heures du soir… »
S’ensuit une pénible conversation sur les horaires de travail qui empêchent Paul d’écrire… une situation qui durera jusqu’en 1941.
Le lendemain, mercredi 24 avril :
J’ai vu Paulhan ce soir. Je lui ai remis mon dossier de lettres. Une petite déconvenue. Me voilà maintenant incertain d’avoir 100 francs la page. Paulhan m’a raconté cela, quand je lui ai demandé ce qu’il avait à dire sur ma conversation d’hier soir avec Mme Pascal. La dame en question américaine. Mariée à un américain « roi de chemin de fer »9. Habite Versailles. Vient à Paris tous les deux jours. Elle désire lire mes lettres. Elle viendra les chercher. J’aurai mes épreuves dans une douzaine de jours. Paulhan sait qu’elle a un peu diminué ses prix. Son mari a trouvé un peu exagérées les dépenses pour Commerce, une fantaisie qu’elle se paie. Il sait que Fargue n’a pas été content la dernière fois de ce qu’il a touché. 100 francs la page, c’est pour trois ou quatre pages. Pour les choses longues, Paulhan ne sait pas au juste, mais il ne croit pas qu’on puisse compter sur 100 frs la page. Je ne lui ai pas caché ma déconvenue. Il m’a proposé de dire que je pose comme une condition ce prix de 100 frs la page. Je n’ai pas accepté d’user de ce procédé. Je lui ai seulement dit : « Si vous y consentez, dites que vous m’avez dit 100 francs la page et qu’il y a un peu là comme un engagement. Usez aussi de l’argument du moment, de la coïncidence avec la publication de Passe-Temps. Enfin, faites pour le mieux. » Paulhan est bien de mon avis qu’une femme riche à ce point peut bien payer et qu’il n’y a rien de déshonnête à tâcher qu’elle paie le mieux possible. Convenu de plus de ne rien dire d’une composition en caractère plus petit que le caractère habituel de la revue. Ce serait encore ajouter à la diminution de prix.
J’ai réfléchi après : Paulhan a jugé avant hier que les lettres feront 30 pages de Commerce. Je compte plutôt, moi, 35, au moins. Supposons que cette dame les mette à 70 francs la page. Cela fera environ 2 500 francs. Ce ne sera tout de même pas mal.
Et Paul enchaîne le paragraphe suivant :
Hier, en quittant Mornay, encore en conversation avec Rachilde, je l’avais attendu un moment dans la rue. Je voulais lui demander s’il prendrait ces lettres, pour le volume qu’il voudrait faire de moi. Il tardait tant à descendre que je suis parti. Tantôt René Maran est venu me voir. Il m’a reparlé du désir de Mornay. C’est lui qui m’en a parlé tout d’abord pour la première fois. Je lui ai dit que j’ai vu Mornay hier et la proposition que je voulais lui faire. Il va lui en parler. Il y a quelque chance que Mornay accepte. Ce serait une seconde affaire excellente. Les lettres parues dans Commerce, je les lui donnerai pour un volume.
Le lendemain encore, 25 avril, nous voilà jeudi, Paul écrit à Jean Paulhan et reproduit sa lettre dans son Journal :
Mon cher Paulhan,
J’ai réfléchi sur notre conversation d’hier au soir. 1o Il est tout naturel qu’on n’ait pas 100 frs la page quand on atteint un certain, nombre de pages, comme ce sera le cas. 2o Pas de débat d’argent, surtout quand c’est un tiers, obligeant comme vous, qui doit avoir la corvée. Excusez-moi sur ce point.
Remettez donc tout simplement les lettres, en recommandant la rapidité pour les épreuves. Ce sera parfait ainsi. Nous verrons bien la suite.
Je vous remercie encore de tous vos excellents soins et vous serre la main très cordialement.
P. Léautaud
J’ai en effet un peu exagéré hier au soir avec Paulhan. Je ne pouvais supporter cela ce matin. J’ai été plus tranquille après l’envoi de ce mot.
Le lendemain, vendredi 26 avril :
Tantôt visite de l’éditeur Mornay, accompagné d’un ami. M. Loyal, avocat (j’avais envie de lui, dire : « C’est bien plutôt le nom d’un huissier et à verges10, encore ! ») qui connaît tout ce que j’ai écrit. Il a prêté Le Petit Ami à lire à Mornay. Mornay venait me demander à en faire un volume de luxe dans le texte tel qu’il vient de le lire. Je lui ai dit : pas moyen, naturellement. Je lui parle des lettres que je dois publier dans Commerce, (je lui ai dit une revue, sans lui dire laquelle). Je lui ai dit que si ces lettres lui vont pour un volume de luxe, je les lui donnerai. Je lui ai donné à lire la liste des destinataires. C’est chose entendue, bien que je lui aie laissé toute latitude de ne se décider que sur les textes. Dès que j’aurai les épreuves, je lui enverrai un jeu. J’ai d’ailleurs l’intention, avant de rien conclure, de lui demander ce qu’il me donne comme droits. Je me rappelle l’appréciation de Vallette « 12 % pour des volumes qui sont en réalité des éditions de luxe, ce n’est pas assez. Vous devriez avoir au moins 15 »
La conversation est venue sur mon Journal. Mornay m’a dit qu’il se chargerait très bien de l’édition.
Variétés
Et une semaine après, le vendredi trois mai, rien ne va plus pour Commerce :
Ce matin lettre de Paulhan, ci-jointe. « Commerce n’accepte pas mes lettres ». Commerce ? Je pense que c’est cette dame. Paulhan me marque dans sa lettre son mécontentement du procédé. Il y a de quoi. Je ne suis pas un débutant. Ce n’est pas moi qui ai offert. On m’a demandé, et à plusieurs reprises. Il n’est guère d’usage qu’on refuse quand on a demandé.
J’ai écrit au directeur de la revue belge Variétés, qui m’a demandé, lui aussi, quelque chose, que je pouvais lui donner des lettres (les mêmes) et je lui ai joint la liste des destinataires. Nous verrons bien ce que va dire celui-là.
Paulhan écrit que la raison qu’on donne est qu’on avait cru à des lettres imaginées, malgré les précisions qu’il avait données, dit-il.
À trois heures, visite de Paulhan me rapportant mes lettres. Je lui ai dit « Alors, c’est cette dame, qui a refusé ? » Il me dit qu’il a l’impression qu’il doit y avoir là l’influence de Claudel et de Saint-Léger11, cet autre diplomate littérateur dont on a un peu parlé pour de petits vers précieux, je crois. Mais Claudel est en Amérique. Comment aurait-on eu le temps de le consulter. Et le Saint-Léger pèse-t-il donc si lourd auprès de cette dame comme conseiller littéraire, en admettant qu’elle soit vraiment allée lui demander son avis ?
Le procédé un peu inhabituel n’en demeure pas moins.
J’avoue que ce matin, à la lecture de la lettre de Paulhan, j’ai été très sensible pendant tout un moment à cet échec. Je ne suis pas habitué à en avoir. Cela va mieux ce soir.
Paulhan m’a reparlé de la chicane Claudel avec la N.R.F. Claudel persiste à vouloir rompre avec Gallimard, enragé sur ce point — et Gallimard n’est pas moins enragé, paraît-il, à vouloir le garder. Paulhan m’a confirmé que Claudel est lié à la N.R.F. pour tous ses ouvrages.
Le lundi suivant, six mai :
Cette après-midi12, visite de Mornay, venant me voir au sujet de mes lettres dont nous avons parlé pour un volume. La chose est décidément entendue. Je l’ai mis au courant de la publication possible dans la revue belge Variétés, moyen de me faire un argent supplémentaire. Comme je n’ai pas encore de réponse de cette revue, je lui apporterai mes lettres demain. Promesse de me les rendre dans 8 jours, soit avec épreuves, soit les ayant fait copier à la machine. Droits d’auteur : 10 %. J’ai trouvé que c’est peu. Répondu que c’est ce qu’il donne, même à des auteurs plus connus. Rachilde par exemple. Ce qui est vrai, je l’ai su un moment après de Vallette. Mornay tirera à 500 exemplaires. Il me dit que j’aurai au moins 3 000 francs. Ce qui mettrait l’exemplaire à 60 francs. La collection dans laquelle sera ce volume de lettres, comme le volume de Portraits d’hommes de Rachilde, est une collection d’inédits.
Le lendemain, mardi sept mai :
Ce matin, visite de Mornay. Je lui ai remis les lettres. Il me dit « Je vais les lire. Je reviendrai vous voir après-demain. — Pourquoi avez-vous besoin de les lire ? Alors, ce n’est pas décidé ? — Mais si. Seulement, il est bon de lire un texte pour voir la façon dont on doit le présenter. » Nullement dupe de cette réponse. Je m’attends fort bien maintenant à ce que l’affaire ne se fasse pas. Dans ce cas, Mornay entendra un petit discours de ma part. Je ne lui ai rien demandé. C’est lui, à plusieurs reprises, qui est venu me solliciter. Dans ces conditions il n’avait aucun droit d’examen du texte. Il peut compter que je lui servirai cela.
C’est comme ce directeur de Variétés, qui m’assomme de lettres pour me demander quelque chose pour sa revue et qui ne répond pas à la lettre que je lui ai écrite et qu’il a dû avoir dimanche matin.
Cette après-midi, visite de Jean Jacob, ce jeune belge bibliophile à qui j’ai promis depuis pas mal de temps un fragment de mon Journal pour sa collection de volumes de luxe à petit tirage. J’ai dû lui promettre d’y penser enfin. Il m’a fait part des droits : 12 % payables à la remise du manuscrit.
Je lui ai dit : « Si vous étiez venu hier, je vous aurais donné quelque chose : des lettres. » Je crois qu’il les aurait prises tout de suite, au désappointement qu’il m’a marqué.
Le surlendemain, jeudi neuf mai :
Reçu ce matin la réponse du Directeur des Variétés, la revue belge. Il accepte mes lettres. Publication dans le numéro du 15 août — ou même, si cela m’arrange mieux, étant donné la publication en volume — dans les numéros du 15 juin et 15 juillet. Paiement : 500 francs.
Il faut voir maintenant ce que va me dire Mornay. Je compte le voir demain matin.
Le surlendemain samedi onze mai, Paul écrit à Variétés. Puis :
Ce matin, à mon arrivée à Paris, téléphoné à Mornay. Pas encore arrivé. Quelqu’un me répond, qui est au courant de mon affaire de lettres. Je dis que je comptais voir Mornay hier matin et que j’ai besoin de mes lettres pour la revue qui doit les publier. Mon idée, c’est que je tiens à ravoir mes papiers, que Mornay dise oui ou qu’il dise non.
À dix heures et demie, arrivée de Mornay dans mon bureau. Affaire du volume entendue13. Pour paraître en septembre. Droits : 2 500 francs. (Il m’a laissé par mégarde une enveloppe sur laquelle un décompte du tirage, du prix de vente et des droits, donne pour ces derniers 2 700 francs). Je lui dis : « Comment, vous savez donc dès maintenant le prix que vous vendrez. Du reste c’est bien simple. Vous annoncerez votre tirage et vos prix, n’est-ce pas ? Dix pour cent sur la totalité. Nous verrons bien ce que cela fera. » Il s’est mis en tête de mettre un portrait. Il voulait mettre celui par Rouveyre. Mais il a trop circulé. Il a pensé à demander à Marie Laurencin. Je lui ai dit que ce ne sera pas fameux comme ressemblance14. Il en a convenu, mais, à son avis, un attrait de plus pour le volume et pour la vente. Je n’ai pas tort quand je dis que ces volumes de luxe sont des choses ridicules.

Le portrait de Paul Léautaud par Marie Laurencin dans l’édition Mornay
Il m’a demandé aussi de lui rendre mes « doubles » de lettres, avec cette idée de rehausser les quelques exemplaires de luxe d’un autographe de l’auteur. Refusé carrément.
Je voulais comme titre seulement ceci : Lettres, 1902-1918. Il tient à mettre au-dessus l’énoncé des noms des destinataires. J’ai dit : « Comme vous voudrez. »
Je l’ai prévenu que je ne laisserai, dans le volume, que les initiales pour certains noms : Rachilde, Carco, par exemple. Je me propose même de modifier ces initiales.
J’avais prévenu Mornay l’autre jour qu’il y a dans ces lettres, celles écrites pendant la guerre, quelques passages sur des gens, comme Georges Lecomte15, quelques autres et que je pensais bien que cela lui était égal. Il m’avait répondu oui. Je le soupçonne fort néanmoins d’avoir donné mes lettres à lire à ce M. Loyal, avocat, qui l’accompagnait l’autre jour, pour se rassurer sur ses risques d’éditeur. Ce qu’il m’a dit ce matin, du passage qui se trouve dans ces lettres sur Mlle Z16. et qui a amusé ce M. Loyal, est bien la preuve que je ne me trompe pas.
Envoyé tantôt le dossier des lettres au directeur de Variétés, en demandant composition et envoi des épreuves et des textes le plus tôt possible comme convenu. Envoi fait recommandé. Coût 10 francs 20. Ce n’est pas bon marché.
Enfin, voilà toujours l’affaire de ces lettres, revue et volumes, terminée. À moins que le directeur de Variétés ne se mette à tiquer sur certains passages.
Trois jours plus tard, le quatorze mai :
Ce matin, lettre du directeur de Variétés. Il a reçu les lettres. Il me remercie. J’aurai des épreuves et le retour des textes dans les premiers jours de juin. Il me soumet l’idée de mettre des portraits des destinataires à l’époque des lettres. Je lui ai envoyé un mot pour lui montrer la difficulté, la corvée, et l’engager à renoncer.
Ce matin visite de Mornay. Il venait me dire que Marie Laurencin accepte de faire un portrait de moi pour le volume, et uniquement par amitié pour moi, sans rien toucher, donnant son dessin, dont l’original devra être pour moi. Elle viendra au Mercure. J’ai écrit tantôt à Marie Laurencin pour la prier d’accepter que ce soit moi qui me dérange en allant chez elle, s’il n’y a pas à cela d’indiscrétion. Cette idée de portrait est absolument ridicule.
Mornay m’a dit le tirage du volume : 400 exemplaires ordinaires, 35 de luxe. C’est bien ce qu’il y a de marqué sur l’enveloppe qu’il m’a laissée samedi matin. Il a donné hier l’annonce à la Bibliographie. Elle paraîtra donc cette semaine. Je verrai les prix des exemplaires. Je pourrai déjà fixer mes droits d’auteur.
À Georges Mornay
Paris le 17 mai 1929
Monsieur,
Je n’ai pas vu votre annonce ce matin dans la Bibliographie.
Puisque pas d’annonce encore je me risque à vous dire ceci : Si vous renonciez à ce portrait. À mon âge, c’est un peu ridicule. Pour des lettres, ce n’est pas absolument indiqué. Passe encore si j’étais mort. Le portrait ne vous coûtant rien, je ne pense pas qu’il influe sur le prix des exemplaires. Marie Laurencin, le faisant par amitié pour moi, y renoncera facilement.
Je ne vous force pas. Je propose.
P. Léautaud
Ce même 17 mai :
Mon tour est arrivé. Ce matin, dans les Nouvelles, le Portrait d’homme de Rachilde me concernant. C’est bien ce que j’appréhendais : complètement ridicule.
Le 24 mai :
Dans la Bibliographie, ce matin, l’annonce Mornay. Le tirage de mon volume de lettres […].
Dans le même numéro de la Bibliographie : une page de la revue Variétés annonçant la publication de mes lettres dans un prochain numéro.
Bernard, qui voit l’annonce de mes lettres dans l’annonce Mornay, me demande en plaisantant si j’ai demandé l’autorisation « aux destinataires », me disant qu’ils pourraient bien me faire un procès. Vallette prend l’annonce pour voir les destinataires. Il se voit lui-même. Il me dit : « Hé ! je pourrais bien vous faire un procès ! » Je pense bien que tout cela est en plaisantant, bien qu’il soit établi que la propriété d’une lettre appartient moitié à celui qui l’a écrite, moitié à celui à qui elle est adressée. Je dis même plus, pour ma part une lettre appartient complètement, moralement et matériellement, à celui à qui elle est adressée. À celui qui l’écrit de réfléchir avant de l’écrire17.
Le sept juin :
Pas de Nouvelles littéraires ce matin, ni mon numéro ni celui de Vallette. Il y a grève de facteurs d’imprimés. Beaucoup de journaux manquent au Mercure. J’avais pris le parti d’attendre à demain. À cinq heures, Auriant arrive. Il a acheté son numéro comme d’habitude. Il me montre que mon volume de Lettres chez Mornay figure déjà dans le feuilleton bibliographique18.

Les Nouvelles littéraires, avant-dernière page dernière colonne, dans la catégorie « Ouvrages de luxe et tirages limités »
Vingt jours plus tard, le 27 Juin :
J’ai reçu ce matin les épreuves de mes Lettres, publication dans la revue belge Variétés et ensuite en volume de luxe chez Mornay. […] Je suis tout à la correction de ces épreuves, et à la lecture de ces lettres, que j’avais à peine relues en les retrouvant et en les réunissant pour cette publication. Je n’ai pas changé : la littérature avant tout, par-dessus tout, — heureusement !
Et le trente juin :
Travaillé toute la journée et toute la soirée à la correction de deux épreuves de mes Lettres, celle pour la revue Variétés, et celle pour Mornay. […].
Je ne suis pas mécontent de ces Lettres, que je viens de relire en entier, en corrigeant les épreuves. Des choses très bien. Je n’ai été ni un imbécile ni un braillard pendant la guerre. Je le savais, et quelques-uns avec moi. En voir la preuve écrite, cela fait plaisir.
Je n’ai rien changé, naturellement. Les destinataires possesseurs des originaux pourront confronter. Seulement supprimé des du reste, d’ailleurs, inutiles, et des où, faussement employés, à mon sens, en des que, comme il convient.
Je ne sais si toutes les corrections seront bien faites dans la revue Variétés. Je m’en moque. Ce qui compte pour moi c’est le volume Mornay. Je collationnerai encore soigneusement les épreuves avec mes textes.
Le trois juillet :
Dans les lettres que je vais publier, il est question dans plusieurs, celles à Morisse, à Rouveyre, à Billy, écrites à cette époque, des 50 francs par mois que nous a donnés le Mercure, à Morisse et à moi, en nous mettant dehors à la déclaration de guerre, et il y a même, dans une de ces lettres, mon appréciation un peu franche du procédé. Je l’ai laissée. Tant pis s’il19 n’est pas content.
Le huit août :
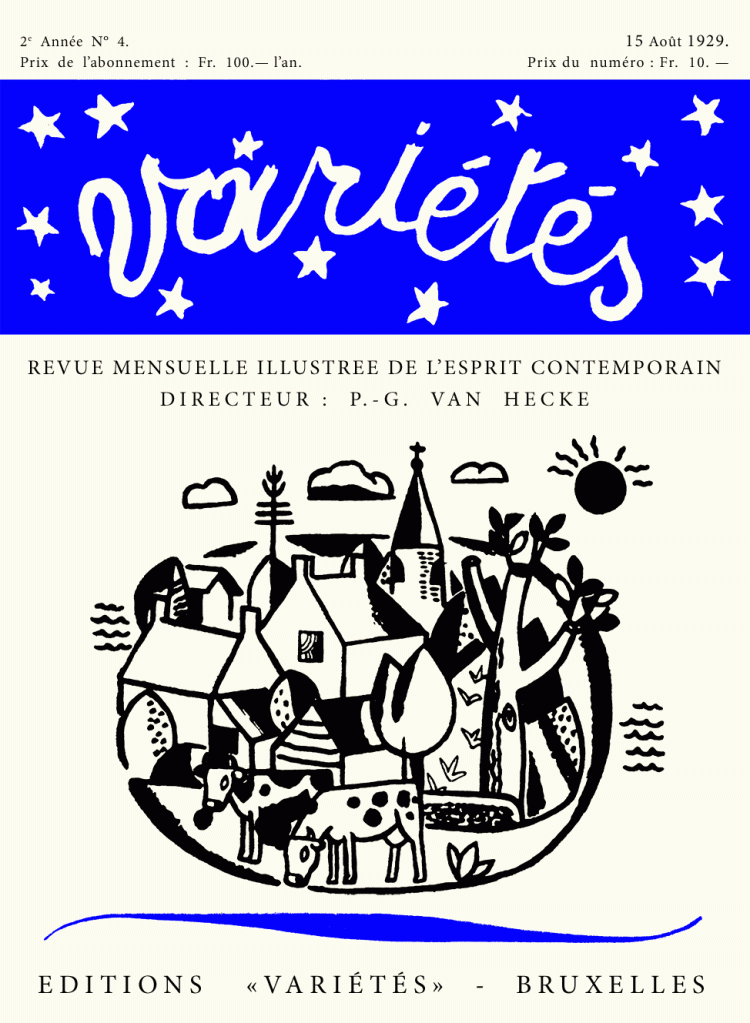
Trouvé ce matin au Mercure le numéro de Variétés contenant la première moitié de mes Lettres. Je suis en tête du numéro, et j’ai même la vedette, avec la bande du numéro, qui porte : dans ce numéro, lettres inédites de Paul Léautaud. J’ai lu ce soir cette première moitié. Bonne impression. Ces lettres souffrent fort bien la publication. Il paraît que l’Intransigeant d’avant-hier, je crois, a reproduit la lettre à Vallette sur la mort de mon père.
[…]
Trouvé également un exemplaire des Portraits d’hommes de Rachilde (édition Mornay) imprimé spécialement à mon nom, avec un envoi particulièrement amical. C’est fort aimable, mais la bêtise du portrait me concernant n’en demeure pas moins.
Puis le 18 Septembre :
Reçu ce matin le numéro de Variétés contenant la seconde moitié de mes lettres. De nombreuses fautes. Même des fautes qui n’étaient pas sur les épreuves. Heureusement qu’il y aura le volume.
[…]
L’Intransigeant, rubrique des Treize, donne ce soir quelques citations.
Il s’agit du numéro daté du 19, page deux, cinquième colonne.
Et le 25 :
J’ai porté tantôt à Mornay le texte complet de mes Lettres, avec les notes, et la table toute prête. Il m’a emmené avec lui, dans sa voiture, le porter à l’imprimerie Coulouma à Argenteuil20.
Fait connaissance avec Mme Mornay, grande amie des bêtes et à qui, pour cela, j’étais depuis longtemps très sympathique. Son fils, Valère (le beau-fils de Mornay), également dans les mêmes sentiments. C’est Mme Mornay qui remplit l’office de lecteur dans la maison d’édition.
J’ai ajouté à mes lettres parues dans Variétés une lettre à Paupe, une lettre à André Gide, et la lettre à Rouveyre dans laquelle je lui parle d’une visite à Gourmont, lettre dont je n’avais pas pris de double, que je me suis rappelée et que Rouveyre m’a apportée ce matin pour que j’en prenne copie.
Cela fait au total 40 lettres, qu’on peut lire, à mon avis, avec des destinataires intéressants.
24 octobre :
Reçu ce matin les épreuves de mes Lettres, volume Mornay. Je ne me suis pas trompé : cette composition en italique sera bien laide.
Samedi neuf novembre :
Mornay venu me relancer ce matin pour les épreuves de mon volume de Lettres. Promis pour mardi. Il a mis la main sur Marie Laurencin, qui va venir me voir au Mercure pour mon portrait.
Douze novembre :
Je suis allé après déjeuner remettre à Mornay mes épreuves corrigées. Il paraît que nous aurons le volume d’ici un mois, mais je n’y compte guère.
Le portrait par Marie Laurencin
Jeudi quatorze novembre21 :
À cinq heures, arrivée de Marie Laurencin, pour le portrait demandé par Mornay, et qu’elle s’est mise à faire dans mon bureau, en une demi-heure ou trois quarts d’heure, en bavardant. Tout ce qu’on voudra, mais pas moi le moins du monde, comme je le prévoyais. C’est même un petit peu ridicule de m’exhiber ainsi.
Elle n’a pas fait mes lunettes, parce que, sous l’éclairage du gaz de mon bureau, elle ne les voyait pas.
Elle a engraissé. Elle a pris une vraie figure de femme. Elle est devenue presque jolie. Un visage si spirituel, si gavroche. On n’est jamais laide avec cela.
Elle m’a dit en riant : « Mon pauvre Léautaud ! Je suis une vieille femme. J’ai 46 ans ! »
Vraiment, c’est à peine si elle en paraît quarante.
Elle n’a fait que rire et bavarder, tout en dessinant, moi assis devant elle et bavardant de mon côté.
[…]
Elle m’a rappelé des choses dont je n’ai aucun souvenir. Par exemple, un jour, Valery Larbaud22 me rencontrant dans un autobus et me saluant comme un vrai personnage et moi faisant ma figure bourrue23.
Elle n’aime pas Mornay. « Il vous a montré la lettre que je lui ai écrite ? » Une lettre fort désagréable. Elle m’a répété qu’elle n’a accepté de faire le portrait qu’à cause de moi. Elle trouve Mornay mal élevé.
Je lui ai dit en riant : « Eh ! un homme mal élevé, cela a son agrément, quelquefois pour une femme ! — Eh ! bien, pas moi, mon cher Léautaud. C’est vrai ce que je vous dis. S’il y a un homme que je peux supporter d’avoir en face de moi à ma table, par exemple, c’est encore mon ex-mari. Oui, vraiment, les autres !… J’aime bien trop être seule. »
Elle m’a dit qu’elle adore la solitude et que c’est la plus grande partie de sa vie, avec sa bonne24 et son chien. Un autre chien qu’elle a est à sa maison de campagne, à Champrosay. Elle m’a invité à y aller, un samedi soir, et passer le dimanche. Elle arrangera cela.
Elle m’a raconté une petite histoire de Billy. Un jour Billy lui dit : « Tu devrais bien donner une aquarelle à X… Il est directeur de musée en province. Cela lui ferait plaisir. Je lui ai dit : Pourquoi ne lui donnes-tu pas, toi, une de celles que tu as ? Pourquoi veux-tu que ce soit moi qui donne quelque chose pour rien à ce bonhomme ?… N’est-ce pas, que j’avais raison ? Les musées !… Je me fiche des musées. J’y allais autrefois avec ma mère, je vous l’ai raconté… (avec un petit air de satisfaction) : on ne regardait que les Vinci ! »
Il y a peut-être là une indication sur la formation de son talent de peintre ?
Je lui ai dit que je pense souvent à elle, en voyant de ses œuvres rue Bonaparte. « Ah oui, des reproductions. » Je lui ai parlé aussi des très jolies choses que je vois également rue des Saints-Pères… « Des anges ! Ce sont mes anges. Je peins des anges pour Rosenberg25. Cela m’amuse. C’est des femmes que j’appelle ainsi. Je les fais un peu sensuelles, légères… » Je lui ai dit le mot que je trouve : aérien, et d’une grâce.
Elle lit beaucoup. Pour me donner une idée de la façon dont elle passe ses soirées, elle m’a raconté celle d’hier : devant elle une gravure représentant un labyrinthe. Elle s’est amusée, en suivant avec son doigt, à y entrer et à en sortir.
Je lui ai donné le Mercure contenant la Gazette que j’ai écrite sur Apollinaire et qu’elle ne connaissait pas26.
N’empêche, grâce à Mornay, que je vais me couvrir de ridicule avec ce portrait. On l’a demandé. Il faut le mettre maintenant.
Elle m’a demandé, en me le montrant, quand il a été à peu près terminé : « Vous le trouvez ressemblant ? » Je ne pouvais que dire oui27. Quelle idée a-t-elle de la ressemblance ?
Le surlendemain samedi seize novembre :
Porté tantôt le portrait Marie Laurencin à Mornay. Trouvé aucune ressemblance, naturellement. Je lui ai dit que je l’en avais prévenu, qu’il n’a à s’en prendre qu’à lui, et, le portrait demandé, qu’il faut le mettre.
Il s’est mis sur-le-champ à crayonner mon portrait — il faisait de la peinture avant d’être éditeur et en fait encore de temps en temps — mais a dû le laisser en plan, le temps me manquant pour rester. Au peu qu’il a fait, pas ressemblance parfaite non plus. D’après tout ce qu’il m’a dit de sa peinture et du manque de satisfaction qu’il en a toujours, trouvant toujours qu’il lui manque il ne sait pas au juste quoi, je crois que ce qui lui manque c’est à la fois et l’art et le ton qui font la personnalité.
Conversation sur la littérature. Comme je lui parlais de mon manque de loisir pour mettre au point tout ce que j’ai à publier, il m’a proposé de me faire des mensualités pendant six mois, par exemple, le temps d’achever un volume. Je lui ai montré l’objection : je ne peux quitter ma place du Mercure — ou si je la quitte je ne la retrouverai pas.
Mais la proposition est bonne à retenir.
Un déjeuner chez Mornay
28 novembre :
Déjeuné chez Mornay. Fatigué de supporter pendant trois heures deux personnes qui n’arrêtent pas de parler. Je suis parti avec un ouf ! énorme de soulagement.
[…]
Mme Mornay, excellente personne, sans apprêts ni détours mais d’une distinction relative. Ils aiment beaucoup tous les deux faire un parallèle entre leur jeunesse fort pauvre et leur réussite d’aujourd’hui. Tout leur intérieur est meublé, tapissé, orné, avec le mauvais goût le plus accompli.

Mornay m’a montré le bon à tirer de mon petit volume de lettres, la page de titre et la couverture, celle-ci avec un très joli dessin représentant un groupe de chats et de chiens. J’ai oublié le nom de l’artiste. Mornay dit que le volume paraîtra pour Noël. Il m’a offert de me verser mes droits. J’ai refusé, disant que je ne reçois jamais rien d’avance, que je ne touche l’argent que lorsque tout est terminé et le volume paru.
Il y a dans une de mes lettres, celles écrites pendant la guerre, un passage dans lequel Georges Lecomte est nommé en toutes lettres, pour les bêtises patriotiques qu’il a écrites à ce moment-là. Mornay, qui est en relations avec lui, m’a demandé s’il ne serait pas possible de remplacer le nom, par exemple, par M. Lebaron. Je lui ai dit que cela n’est pas possible, que le nom figure dans la lettre que possède celui à qui je l’écrivais, qu’en le supprimant ou le déguisant j’aurais l’air d’obéir à un calcul ou de ne pas oser dire ouvertement ce que j’ai dit dans une lettre. Mornay a tout de suite compris et n’a pas insisté.
J’ai ajouté que je n’ai aucune sorte de considération pour Georges Lecomte. Raconté la petite histoire de l’inauguration du Monument Vallès, au Père-Lachaise, quand je l’ai vu, au moment de rejoindre les autres assistants, au nombre desquels Descaves et Séverine, ôter sa Légion d’honneur pour la mettre dans la poche de son gilet28. Il ne me connaissait pas et ne se doutait pas que je le connaissais.
Mornay m’a offert un exemplaire h.c. de La leçon d’amour dans un parc, de Boylesve29, illustré par Carlègle, édité par lui. Il m’a dit en me le remettant : « Si Madame Mornay veut bien vous écrire quelques mots… » En effet, je lui ai remis le volume et elle y a écrit un envoi.
Mornay m’a demandé si je ne connaissais pas un livre amusant, galant, spirituel, prêtant à l’illustration, à lui indiquer. Je lui ai indiqué les Mémoires de Goldoni30. Il a écorché le nom en le répétant.
Le mardi suivant, trois décembre :
Ce matin aussi, lettre de Mornay, me demandant de lui prêter mes Mémoires de Boldini. Et ces gens-là sont éditeurs !
Le premier exemplaire
Samedi 28 décembre.
Trouvé ce matin sur mon bureau en arrivant au Mercure un exemplaire de mon petit volume de Lettres, celui marqué à mon nom, apporté hier soir par Mornay, me dit la concierge. Il n’est pas mal. Le portrait par Marie Laurencin est toujours ridicule mais le petit groupe de chiens et de chats, sur la couverture, est délicieux. Mais voilà bien ma chance. Je feuillette et je tombe, dans une lettre à Paul Morisse, un passage concernant Apollinaire, sur une phrase dans laquelle il manque deux mots : Il a passé à Nice au lieu de Il dit qu’il a passé à Nice31. Tout l’agrément fichu le camp aussitôt. Mornay arrive à ce moment, pour savoir mes impressions. Je lui parle de ma découverte, en lui disant qu’il est bien probable que la faute vient de moi et que je suis impatient de pouvoir vérifier chez moi. Je viens de regarder ce soir. Ma faute, en effet. La phrase a paru ainsi dans Variétés. Elle a été reproduite telle quelle dans les épreuves du petit volume. J’ai bien lu ces épreuves au moins quatre fois. Et je n’ai rien vu. Toujours le même phénomène : je lis avec la mémoire : je vois ce qui manque comme s’il ne manquait pas et je ne vois pas ce qu’il y a en trop. Les deux mots en question manquent, d’ailleurs dans le double de la lettre en question, sur lequel a été faite la composition de Variétés (oubliés comme dans la rapidité de la copie). En tout cas, la phrase est boiteuse et le correcteur de Mornay aurait pu s’en apercevoir.
1930
Le neuf janvier 1930 :
Ce matin lettre de Mornay. Les exemplaires de mon volume de Lettres me revenant sont à ma disposition. Il est déjà parti 360 exemplaires sur les 400 représentant le tirage (exemplaires ordinaires à 50 francs).
Je suis allé chez Mornay après déjeuner. Conversation avec Mme Mornay, mécontente que je n’aie pas répondu à l’invitation à déjeuner que contenait la lettre de Mornay. […]
Un dessinateur, un M. Forgeot, était là qui soumettait des dessins à Mornay. Quand il eut fini de les voir, il dit à l’artiste : « Si vous voulez bien les montrer à Madame Mornay. » Ensuite conversation sur le caractère uniquement artiste de Mme Mornay, heureusement tempéré par le sens pratique de Mornay. J’étais venu en courant pour une demi-heure. Je suis resté une heure un quart.
D’autres exemplaires partis depuis la lettre de Mornay. Tantôt, 2 heures, il n’en restait plus que onze, sur les 400 à 50 francs. Mornay est enchanté, cela se conçoit. Moi aussi, car je n’aimerais guère qu’un éditeur fasse un four, si petit soit-il, avec moi. Mme Mornay trouve un peu excessif d’avoir fixé à 200 francs le prix des 35 exemplaires sur Japon. Mornay assure qu’ils partiront très bien, quand il n’y aura plus du tout d’exemplaires ordinaires.
Je n’ai pas été gâté comme exemplaires pour moi. 7 ordinaires plus 1 japon à mon nom et 1 japon de passe32. Je vais être obligé de réduire de moitié les dons que je voulais faire.
J’ai mis un mot sur les exemplaires Billy, Paupe33, Rouveyre, Laurencin, Morisse, Gide, imprimés à leur nom. Mornay les expédiera.
Touché mes droits : 2 700 francs. 2 700 francs sur un total du prix fort de 27 000 francs. Supposons que la fabrication ait coûté la moitié, ce qui me paraît excessif. Reste 13 500 francs. Presque nets, car Mornay a vendu le volume par souscription, donc très peu de remises à des libraires. Sur 13 500 francs, il me donne, à moi l’auteur, 2 700 francs. Vallette dit après cela que les éditeurs gagnent tout à fait très peu d’argent.
Le quatorze janvier :
Petit séjour de Paul Morisse34 à Paris. Il est venu hier matin. Invitation à déjeuner avec lui. J’ai prétexté mes troubles de santé pour dire non. Revenu ce matin, pour le plaisir de se voir. Conversation. Parlé de Mornay, à propos de mon petit volume de Lettres. Il m’apprend que Mornay ne s’appelle pas du tout Mornay, mais Lévy. C’est Mme Mornay qui s’appelle de ce nom, elle seule. Le fils de Mme Mornay, Valère35, qu’on voit dans la maison, s’appelle Bachmann, probablement le nom du premier mari de Mme Mornay. D’après Morisse, Mornay et sa femme ne sont pas mariés. Morisse a très bien connu Mme Mornay pendant la guerre, dans les cafés de Montparnasse, pendant que Mornay était au front. Elle était alors la maîtresse du peintre Modigliani36. On apprend tous les jours quelque chose.
Le sept février :
Après déjeuner, visite de Mornay. Il me dit que mon petit volume de lettres est presque épuisé, même les exemplaires à 200 francs. Il reste au plus cinq exemplaires et trois ordinaires. Il me lâche dans la conversation ce que lui a coûté la typographie comme il dit à elle seule : 6 000 francs. Mettons qu’il ait eu 1 000 francs de papier, 1 000 francs de brochage, ajoutons 20 % pour les frais généraux. Mes droits d’auteur 2 700 francs. Cela lui fait une dépense totale de 12 300 francs. Si je compte une certaine somme pour remise au libraire (10 %) qu’il n’a certainement pas faite pour tous les exemplaires, il a gagné au bas mot 12 000 francs. Je continue à trouver que c’est un peu excessif.
Le texte des lettres donné ci-dessous est rigoureusement identique à l’original. Indépendamment des dates des lettres, les chiffres des années ont été ajoutés (comme ci-après « 1902-1903) afin de rendre plus commode la navigation dans la page web.
Liste des lettres
La quatrième colonne, notée « CG » indique la disponibilité (ou non) de la lettre dans la Correspondance générale. Quelques lettres absentes de la Correspondance générale sont parues ultérieurement dans le Choix de pages de Paul Léautaud, par André Rouveyre.
Les liens renvoient aux lettres.
| No | Destinataire | Date de rédaction | CG |
| 01 | Paul Valéry | jeudi 15 mai 1902 | oui |
| 02 | Paul Valéry | mardi 07 octobre 1902 | oui |
| 03 | Madame Rachilde | samedi 21 février 1903 | non |
| 04 | Alfred Vallette | lundi 23 février 1903 | non |
| 05 | La Weekly review | lundi 09 novembre 1903 | non |
| 06 | Marcel Schwob | lundi 15 février 1904 | oui |
| 07 | Paul-Arthur Chéramy | jeudi 01 décembre 1904 | non |
| 08 | Paul Blondeau | mardi 03 avril 1906 | non |
| 09 | Paul Valéry | mardi 22 mai 1906 | oui |
| 10 | Adolphe Paupe | mercredi 05 décembre 1906 | non |
| 11 | Adolphe Paupe | dimanche 06 janvier 1907 | non |
| 12 | Adolphe Paupe | vendredi 03 mai 1907 | non |
| 13 | Le Charivari | mardi 01 décembre 1908 | non |
| 14 | Adolphe Paupe | mercredi 05 février 1908 | oui |
| 15 | Charles-Henry Hirsch | vendredi 16 octobre 1908 | non |
| 16 | Émile Henriot | mardi 27 avril 1909 | oui |
| 17 | Adolphe Paupe | mercredi 23 juin 1909 | non |
| 18 | Adolphe Paupe | dimanche 11 juillet 1909 | oui |
| 19 | Remy de Gourmont | mercredi 22 septembre 1909 | non |
| 20 | Charles-Henry Hirsch | samedi 17 août 1912 | non |
| 21 | Adolphe Paupe | jeudi 12 mars 1914 | non |
| 22 | Marie Laurencin | vendredi 20 mars 1914 | oui |
| 23 | Marie Laurencin | mercredi 01 avril 1914 | oui |
| 24 | André Gide | mercredi 15 avril 1914 | oui |
| 25 | André Billy | mardi 18 août 1914 | non |
| 26 | Paul Morisse | mardi 08 septembre 1914 | non |
| 27 | André Rouveyre | vendredi 30 octobre 1914 | non |
| 28 | André Rouveyre | jeudi 05 novembre 1914 | non |
| 29 | Paul Morisse | vendredi 06 novembre 1914 | non |
| 30 | André Rouveyre | dimanche 15 novembre 1914 | oui |
| 31 | André Billy | lundi 23 novembre 1914 | oui |
| 32 | Paul Morisse | mardi 29 décembre 1914 | non |
| 33 | Guillaume Apollinaire | vendredi 01 janvier 1915 | oui |
| 34 | Guillaume Apollinaire | mardi 12 janvier 1915 | oui |
| 35 | Adolphe Paupe | vendredi 08 octobre 1915 | non |
| 36 | Madame Rachilde | lundi 22 novembre 1915 | oui |
| 37 | Robert Foulon | mercredi 24 novembre 1915 | non |
| 38 | Madame Stuart Merrill | mercredi 15 décembre 1915 | non |
| 39 | Guillaume Apollinaire | mardi 15 février 1916 | oui |
| 40 | André Rouveyre | lundi 11 novembre 1918 | non |
Le texte des lettres
1902-1903
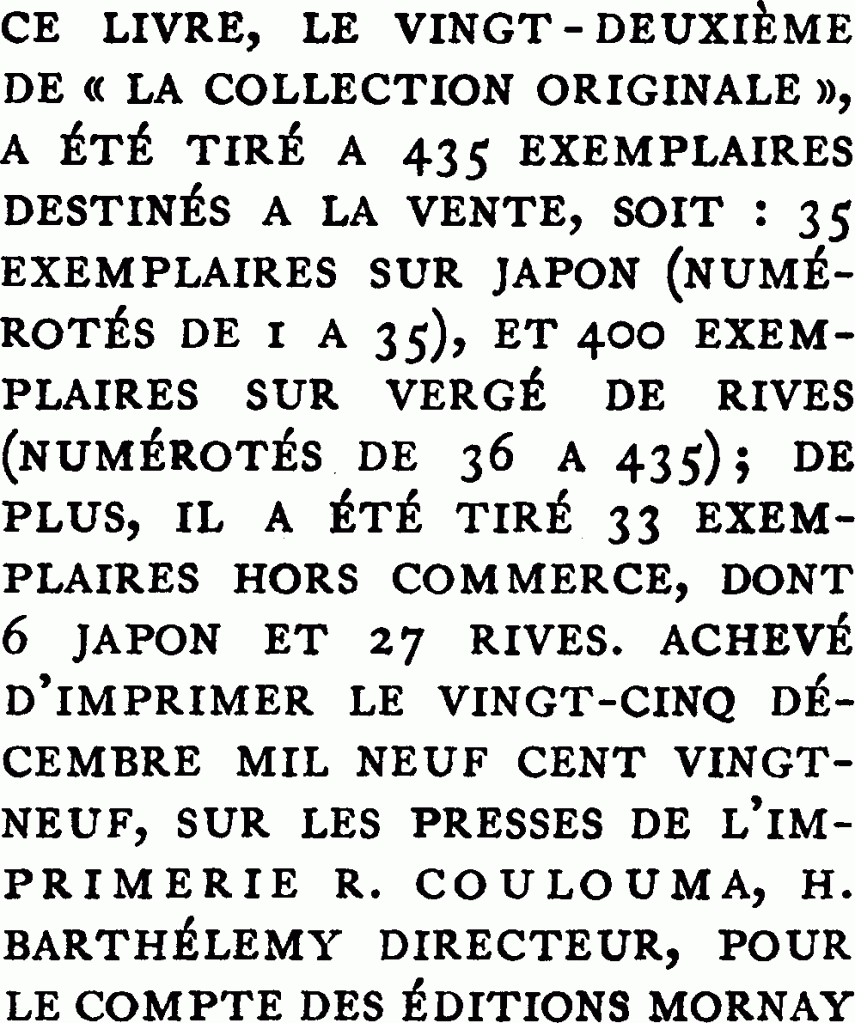
À Paul Valéry
Paris le 15 mai 1902
Mon cher ami,
Toujours vos gentillesses. Mais je n’ai pas la chance de pouvoir vous remplacer pendant vos vingt-huit jours37. Je le regrette pour bien des raisons, celle-ci d’abord, que cela m’aurait mis en relation avec M. L…38, ce qui, peut-être, n’aurait pas manqué d’intérêt pour moi. Mais qui sait si mes scrupules sur ma capacité à tenir l’emploi ne m’auraient pas arrêté. En tout cas, pas moyen. J’ai quitté l’étude Barberon à la fin du mois dernier39. Il le fallait absolument, avant des désagréments. De cette façon, c’est moi qui suis parti. Je suis maintenant chez M. Lemarquis, administrateur judiciaire, en qualité de secrétaire. Ce n’est pas fameux, non, comme appointements ni comme avenir. On y est tenu avec une vraie rigueur et il y a un travail du diable. Mais ce travail n’est pas embêtant. Je suis au moins débarrassé des besognes du Palais40. Si je n’avais pas en ce moment quelques petits ennuis relativement à mon aspect, ce à quoi il m’est fort difficile de remédier, à cause de ma gêne, cela irait assez bien.
Si j’avais encore été chez Barberon, je n’aurais pas hésité à le lâcher pour faire votre remplacement. Mais maintenant, et surtout pris de si court, et surtout pour quoi ? après, je ne le puis. Non, je n’ai pas de chance, car je rate peut-être quelque chose, à cause d’une autre qui ne présente aucune durée ni aucune progression appréciable.
Naturellement, je ne connais personne. C’est bien plutôt vous qui êtes à même de trouver.
Le bouquin41 ? J’attends toujours la réponse du Mercure. Le chat42 ? Charmant et vif de plus en plus.
N’y a-t-il pas moyen de vous voir avant votre départ ? Mais un soir, car toute ma journée est prise, avec seulement une heure et demie pour déjeuner. Avec cela nous avons l’affaire Humbert43… Enfin, s’il y a un moyen, un mot, n’est-ce pas, ou un coup de téléphone, dans l’après-midi, no 23269, pour me donner un rendez-vous.
Que Madame Valéry ne m’en veuille pas de vouloir troubler ces derniers jours avant une séparation. Demandez-lui pardon pour moi.
Il me faut vous quitter. Excusez le ton rapide et la sécheresse de cette lettre. Je l’écris à la diable, au milieu de mes dossiers, et du bruit de la machine à écrire, du téléphone, et des lamentations des imbéciles de la Rente Viagère44.
Mes amitiés, mon cher Valéry, et mes hommages les plus empressés pour ces dames.
À Paul Valéry45
Paris le 7 octobre 1902
Mon cher Valéry,
Il me faudrait des pages pour répondre à votre admirable lettre46. Certainement, votre amitié pour moi vous l’a seule dictée, car je ne peux pas croire et il est impossible qu’il y ait autant de choses dans ce fichu bouquin47, écrit à la diable, un petit morceau de soir en soir, et avec le moins possible de souci littéraire. Je dirai comme vous : le diable, c’est que je vous connais. Je pense à votre sincérité, — de vous à moi, le contraire serait enfantin, — je me dis que rien ne vous obligeait à m’écrire cette lettre, la fin du livre vous étant ignorée, puis je relis votre lettre, et de nouveau je n’en reviens pas. Moi qui croyais avoir un de ces sens critique ! j’en suis pris à la fois d’un vaste sérieux et d’un grand rire. Comme je voudrais savoir où, dans toutes ces pages dont pas vingt ne me contentent, vous pouvez trouver ce que vous appelez une étoffe, un timbre… Nous devrions bien en parler un soir, s’il vous est possible, en flânant sur un boulevard, à moins que vous ne préfériez attendre la fin, et même le volume. Je viens d’arranger un peu, pour le volume, les deux premiers chapitres, pour enlever un peu le côté marlou, tout à fait faux, et pour mettre des choses plus exactes. En réalité, je suis revenu à ce que j’avais d’abord écrit. Je ne sais quelle fantaisie un peu crispée m’avait ensuite entraîné… Tout le reste, à part dix ou quinze lignes, et une femme en moins, sera le même que dans le Mercure.
Dites-moi : à la page 152, — et bien examiné tout le ton du livre, faut-il enlever ou laisser : J’ai même acquis tant d’habileté, etc., etc48.
Ce qui m’a amené à écrire ce livre, — les amis de revue étaient Rachilde, Vallette, Herold, Jarry, et un ou deux autres, — tout le chapitre de l’enfance, sauf l’histoire, quelques lignes, de la remplaçante de Loulou49 — les femmes en tant que connues — la maladie de la Perruche50 — le chapitre de l’entrevue avec ma mère, et le chapitre de la correspondance, qui va venir (et ces deux-là, mot à mot) — tout cela est vrai. Le côté : façon de sentir, n’a pas été cherché une seule minute, à aucun endroit. À Calais, durant ces trois jours passés auprès de ma tante et avec ma mère, j’ai senti de la façon dont j’ai écrit.
La mort de la Perruche — sa déclaration d’amour — et la remise au net du livre, chez une amie, dans le dernier chapitre, — sont de l’amusement.
Le titre me navre, mais il n’y a rien à faire51.
Mon dernier chapitre répondra quelque peu à certains points de votre lettre. Je n’ai jamais arrangé une phrase. Quand une ne me plaisait pas, j’en mettais une autre, voilà tout. Cette page 183(52), qui n’a rien d’extraordinaire, voyons ! je l’ai écrite simplement en recomposant en moi ce qui s’y passait, telle journée, à telle heure, là-bas, à Calais, auprès de ma chère maman. Comme je le dis, je prenais des notes, que je mettais en ordre le soir. Cela m’a fait un cahier d’une dizaine de pages. Je n’ai eu qu’à lier pour obtenir mon chapitre. Je ne croyais pas à une telle impression sentimentale.
À cette même page 183, j’avais d’abord écrit : Jusqu’à quels détails intimes de sa personne mes pensées allaient… Que pensait-elle, là, en me regardant… etc., etc.53
Faut-il remettre comme cela ? — ou laisser comme c’est, c’est-à-dire avec : … Oui, tout son corps, etc., etc.
Ce que j’aurais dû faire, c’est cinquante pages, avec des phrases de catalogue, sèches, exactes, rapides. Mais personne n’aurait voulu les publier, parce que 50 pages.
Je réponds bien mal à votre lettre, mon cher Valéry. Que votre amitié me pardonne, cette amitié que j’ai cru parfois sentir si vive, et à laquelle je tiens tant, sans que vous l’ayez jamais su beaucoup. C’est si difficile à dire ! je suis si plein de besognes, que je n’ai pas encore pu donner un instant à la petite vanité bien humaine d’avoir usé tant de papier.
Vous avez vraiment négligé de me donner de vos nouvelles et des vôtres, si je ne suis pas indiscret. Votre mère54, Madame Valéry55 et sa sœur, comment vont-elles ? Vous voyez bien que je suis un vrai sauvage puisque j’ai continué de manquer à tous mes devoirs vis-à-vis d’elles.
À vous de tout cœur.
Je craignais un peu votre mécontentement de votre nom dans ce livre56 qui parfois m’arrête moi-même, surprise, chagrin, et indifférence tout ensemble.
À Madame Rachilde57
Paris le 21 février 1903
Chère Madame,
Je voudrais bien prendre à la lettre la lettre extraordinaire et amicale que vous avez pris la gracieuse peine de m’écrire, mais il n’y a pas moyen. En admettant que cela fût vrai que ce mince livre soit assez bien, du moment que je n’en retire pas moi-même un tel sentiment, alors ce qu’on peut dire, ce qu’on peut écrire rencontre mon incertitude et n’y change rien. Je sais bien que lorsque je parcours quelques-uns des livres qui composent les étalages des libraires, je me demande par quel tour de force tels ou tels auteurs ont eu le courage de raconter ainsi en 300 pages, par exemple, ce qui aurait pu tenir, et si moins mal, en 150. Hier encore, lisant en flânant deux romans de Maupassant, je n’en revenais pas de tant de remplissage à propos de rien. Mais cela n’empêche pas que ce Petit ami ne me réjouit en rien. Si j’ajoute que je me demande maintenant — à la vérité, j’y suis fait, et ne me le demande plus du tout — si je n’ai pas exagéré en racontant telles ou telles choses et en parlant de telle personne à la fois si près et si loin, vous voyez comme je m’emballe. Il n’y aurait eu qu’un moyen de faire un livre à peu près, qu’un moyen de me contenter : c’eût été d’écrire tout cela sans aucun ton littéraire, sans aucune intention58 littéraire. Cela eût fait peut-être un livre très « épatant », et je me le disais en m’amusant au fur et à mesure que j’écrivais. Mais on n’est pas seul : je ne sais quelle fantaisie m’a entraîné, quelque chose que je ne me connaissais pas, surtout à mon retour de Calais, et je me suis laissé aller, pour voir ce que cela donnerait. J’avais tant résolu de marcher en me fichant des autres livres, tout en me les rappelant très bien. Mon Dieu ! il se peut que je ne voie pas bien clair, tant j’ai encore toutes ces phrases dans la tête, mais tout de même, ce n’est pas immortel, non, et c’est encore moi qui suis à même de mieux voir. J’aurais cru aussi que c’était autre chose, un livre terminé. Ce que cela donne peu envie de recommencer, et comme on était plus heureux avant, quand on imitait en cachette tel ou tel notoire contemporain. Maintenant, moi, je ris de moi-même, dont je ne reviens pas. J’ai l’effroi d’écrire, même une simple lettre. Je n’aurais de goût, et encore, ce n’est pas très sûr, qu’à recommencer ce qui est fait.
Ce que je garde de plus clair de ce livre, savez-vous, c’est bien le petit plaisir d’avoir parlé de mon enfance et de ma chère maman (dire que je ne la reverrai peut-être jamais, après l’avoir si peu vue, et qu’est-ce qu’elle pensera si elle connaît jamais ce livre ?) — mais c’est aussi une amitié plus grande pour ce Mercure, qui m’a été si accueillant, si bienveillant, pour votre mari, pour Régnier59, qui de lui-même a demandé à lire mon manuscrit, c’est enfin des remerciements pour vous, chère madame, qui non contente de lire ce livre avec la conscience qui vous est propre et d’en rendre compte60, j’en suis sûr, avec autant de justesse que de franchise, avez encore voulu m’écrire cette lettre qui me touche, me fait sourire et m’étonne à la fois.
Je vous prie, chère Madame, d’accepter mes plus fidèles hommages.
À Monsieur Alfred Vallette
Paris le 23 février 1903
Mon cher Directeur,
Je ne pourrai pas venir aujourd’hui au Mercure comme c’était convenu. Mon père décidément très mal. Il me faut retourner à Courbevoie. Vous ne me verrez sans doute pas avant quelques jours. Quelle singulière idée, pour un mardi gras, de s’habiller en mort61 !
Cordialement à vous.
À Monsieur le directeur de La Weekly review62
Paris 15 rue de l’Odéon
le 9 novembre 1903
Ce n’est même pas un amateur qui vous répond, Monsieur, ce n’est qu’un liseur. Si vous voulez ajouter : distingué, cela me fera plaisir. Il y a beau jour que je ne lis plus des romans que les titres, sauf pour ceux qui me sont adressés, et dont il faut bien que je puisse faire des compliments aux auteurs. Je n’en suis pas moins très au courant de tout ce qui s’écrit et voici mon avis. Ne m’en voulez pas s’il fait tache dans les éloges dont vont être couverts deux ou trois romanciers contemporains dans les réponses de vos correspondants. Par exemple, le nom de grand écrivain prodigué à M. Anatole France, qui est bien le plus bel exemple du manque de personnalité littéraire.
Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par l’influence sociale et intellectuelle du roman contemporain. Vous voulez parler sans doute de cette manie à la mode de mêler une idée sociale, humanitaire, etc., ou une question de morale à l’art d’écrire. Jolie littérature, que celle vers laquelle nous allons, si cela continue. On en peut juger par le commencement que nous en avons. On veut instruire, éduquer, on écrit pour le plus grand nombre. Comment, dès lors, parler d’une influence intellectuelle ? Il faudrait d’abord que les romans qu’on publie continssent de l’intelligence, ce qui n’est pas possible avec un tel but. Quant à la prétendue liberté avec laquelle les mœurs y sont décrites, vous savez bien qu’aucun dessein philosophique n’y est en jeu, mais bien un tout autre. Je peux bien vous le dire, en attendant que je change : tout ce qui est roman ne m’intéresse guère. J’aime avant tout les livres qui racontent un individu, ou qui peignent une époque, le plus directement possible, presque en style d’affaires, et tous les romanciers du monde, à l’exception de Balzac, ne valent pas pour moi les mémorialistes, les anecdotiers, un Retz, un Chamfort, un Prince de Ligne, un Stendhal… je songe à la fantaisie, au laisser-aller, à la négligence, même… Cinquante Flauberts pour un Stendhal ! C’est presque une devise que je vous offre. On écrivait autrefois par plaisir, on écrit aujourd’hui par métier. C’est tout dire.
Ce qui manque à nos romanciers actuels, c’est d’être des individus intéressants en eux-mêmes, par l’intelligence ou par la sensibilité, et de ne pas savoir qu’écrire, et de n’être pas seulement de bons faiseurs de livres. Que c’est peu, de ne trouver dans un livre qu’un livre bien fait ! Sans compter qu’aucun ne raconte rien, ou à peu près, que ne puisse raconter son confrère. Et ce style ! ces phrases commençant par : Et ! Cependant, il faut bien faire un choix, puisque vous le voulez, et alors, fixant l’objet du roman, qui est selon moi de distraire en intéressant, je nommerai M. Henri de Régnier, dont les livres ont pour me plaire surtout le ton de mémoires, l’anecdote, — et M. René Boylesve. Il y avait aussi M. Hugues Rebell. Il y aurait peut-être eu Jean de Tinan. Un grand écrivain ? Qui sait ? Il y aura peut-être un jour M. Maurice Barrès64, M. Marcel Schwob, M. Remy de Gourmont. Quant au reste, à part deux ou trois livres singuliers et moqueurs…
Laissez-moi vous dire aussi, en passant, combien il est regrettable, pour l’intérêt de votre Revue, que certains collaborateurs notoires que vous mentionnez ne soient pas dans le cas de M. Larroumet65.
Je vous prie de m’excuser si j’ai dépassé les trente lignes prescrites, et d’agréer mes remerciements pour la publicité que vous m’offrez si gracieusement.
Dupont Alexandre66
1904-1906
À Marcel Schwob
Paris 15 rue de l’ Odéon
le 15 février 1904
Cher Monsieur,
Je vous donne ci-contre les termes de la lettre que j’ai écrite à Miss Leonsberry67, il y a aujourd’hui huit jours. Je n’ai encore reçu aucune réponse. Qu’en pensez-vous ? Aurait-elle changé d’avis au sujet de ce travail pour lequel vous avez si amicalement pensé à moi ?
J’ai écrit le même jour à Madame de Pratz68. Non plus aucune réponse. Je vais aller voir si elle est à Paris.
Je commence à être vexé, au sujet du Prix Goncourt, vous savez. J’avais trouvé la lettre de Mirbeau très bien, mais, enfin, elle m’avait laissé calme. Après la communication d’Hennique à Théry, cela change un peu. Avoir raté cinq mille francs à cause de trois ou quatre timorés, bien pensants, et moraux à l’excès ! Je ne suis pas fou de mon livre, mille fois non. Si je l’avais gardé six mois de plus, je l’aurais refait pour en enlever toute la « littérature » qui s’y trouve et qui m’embête. Mais « la peur du sujet » est un motif qui me fait rire. J’en parlais samedi à Vallette. Ce n’est pas seulement cinq mille francs que j’ai perdus, selon lui, mais aussi les trois ou quatre mille de la vente. Sans compter le ressort que cela m’aurait donné, l’espèce de stimulant, toute la petite chaleur qui vous met en train tout à fait ! On travaille tant à vide, ou presque, la plupart du temps. Enfin, malgré mon four, je crois que Vallette, en tant qu’éditeur, ne me garde pas rancune, et qu’il m’accueillera encore, quand je recommencerai69.
Mon meilleur bonjour à Madame Moréno, je vous prie, et croyez-moi votre vraiment dévoué.
À Monsieur P.-A. Chéramy70
1er décembre 1904
Monsieur,
Je lis dans le Mercure71 l’annonce d’un comité, sous votre présidence, pour l’érection à Paris d’un monument à Stendhal. Mon étonnement est grand, et mon déplaisir. Je me demande si vous avez vraiment songé à Beyle en cette circonstance — si toutefois c’est vous qui avez eu l’idée. Lui, statufié, en pleine rue, tout comme un écrivain de pacotille ou un ministre d’avant-hier ! Décidément, c’est vrai : l’élégance, la discrétion, le ton, s’en vont de plus en plus. Il y avait deux choses que j’aimais : un certain quartier de Paris, et un certain écrivain. On m’a abîmé le premier avec une horreur à Gavarni72-73, et on va porter atteinte au caractère du second, avec quelque chose du même genre. Le petit coin du cimetière Montmartre ne suffit-il pas, et n’est-il pas mieux que tout ce qu’on pourra faire ? Il n’est pas un vrai stendhalien qui réponde non.
Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.
À Monsieur Paul Blondeau74
6, rue de Hanovre75
Paris 17 rue Rousselet
le 3 avril 1906
Monsieur,
Vous ne m’avez pas fait perdre mon temps. C’est toujours un plaisir pour un écrivain, surtout à ses débuts, de correspondre avec un lecteur. Sait-on jamais si on en a, des lecteurs ? Cela en fait toujours un. Tout de même, j’en ai quelques-uns ainsi.
Que de choses, que d’autres souvenirs, que d’autres figures j’aurais pu dire et rappeler dans le Petit ami. Votre lettre m’y a fait songer de nouveau tout un moment. Vous vous en doutez : on n’a pas vécu dans un quartier, et de l’enfance que j’ai eue, sans avoir beaucoup vu et retenu. Mais quoi ! On me disait : méfiez-vous. Vous allez ennuyer les gens. Vos souvenirs d’enfance vous amusent, vous donnent même de l’émotion, c’est entendu. Mais les autres, mettez-vous à leur place. Alors je me suis borné, laissant de côté une foule de choses. Il faudra que je répare tout cela un jour, d’une façon ou d’une autre.
Avez-vous bien raison de me féliciter d’être resté si sentimental ? Il me semble quelquefois que je l’ai été trop, ou du moins que je ne me suis pas assez caché et qu’on a dû en rire pas mal. Il est vrai que j’en avais ri tout le premier et que de ce fait c’est encore moi qui gagnais la partie. Mais qu’importe. Quand j’ai la plume à la main, un monde de choses me vient à dire et je vous écrirais pendant des heures si je m’écoutais. Mieux vaut pas. Il en est pour les auteurs qui écrivent trop comme pour ceux qui parlent trop, peut-être c’est autant de moins pour leurs manuscrits. Vous avez dû vivre aussi dans ce quartier de la rue des Martyrs pour en avoir ainsi des souvenirs ? J’ai bien connu le petit café dont vous me parlez. J’y ai même été quelquefois, dans ses dernières années, et j’y ai vu souvent ce gros Chincholle76 du Figaro, « un saint auvergnat qui porte mon nom » comme disait Scholl77. Hélas ! on a abîmé la fontaine de la place Saint-Georges avec une maçonnerie à Gavarni, on a changé le nom de la rue Bréda en celui d’Henry Monnier78. Ces pauvres commerçants de la rue Bréda ! Ce nom les offusquait79, et ils ne disent rien de celui d’Henry Monnier, le peintre des philistins et des épiciers. Je vous le dis : l’ironie est partout.
Je vous renouvelle l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Vous habitez une rue que j’aime beaucoup80.
À Paul Valéry
Paris 17 rue Rousselet
le 22 mai 1906
Voulez-vous demain, mercredi, mon cher ami, entre deux heures et deux heures et demie, Palais-Royal, dans la galerie où il y a l’Office colonial81. Si non, ou si vous changez l’heure, un petit bleu. Sans rien de vous, je partirai. Nous causerons du remplacement82.
Mangeurs de viande froide, vous avez bien raison, tous ces St83. de brocante. Il y a longtemps que j’ai voulu parler d’eux, sur du papier. Mais le Mercure pas moyen. J’ai de si beaux détails, sans connaître personne, car je ne connais ni le professeur d’anglais, ni l’avoué, ni le mardiste. Il est vrai que je connais Gourmont, ce qui n’est pas peu.
Bonnes amitiés.
Galerie Orléans, il me semble.
À Adolphe Paupe
Bibliothécaire du Stendhal-Club
Paris 17 rue Rousselet
le 5 décembre 1906
Cher Monsieur Paupe,
Voilà des temps que je veux vous écrire. J’ai appris à son heure la solution intervenue pour la Correspondance84 : édition chez Gougy85, et un dédommagement approximatif de tous vos soins stendhaliens86. Je fais des vœux pour une réussite complète. Quelles recommandations je vous ferais, très amicalement, si je m’écoutais. Veillez aux coquilles, aux fautes d’orthographe, même (il y en a dans l’édition Lévy87). Ne cherchez pas trop à éclairer le texte. Les noms des destinataires, leur profession, leur situation, quel intérêt ? Vous ne feriez qu’alourdir, embrouiller. Surtout, aucune préface, de personne. Les profanes n’y trouveraient pas une jouissance de plus. Quant à nous, tous ces éclaircissements nous feraient l’effet — triste — d’une vulgarisation. Si je vous disais que je ne suis pas très gai à l’idée que la Correspondance ne sera plus introuvable et que tant d’autres pourront la lire.
Rappelez-moi au bon souvenir de Madame Paupe, en lui présentant mes hommages, et croyez bien, je vous prie, à mes meilleures cordialités.
Et si un portrait, pas d’autre que le Sodermark88. C’est le plus beau. C’est Stendhal après la Chartreuse, après le Brulard89, le vrai Stendhal. Lui-même disait que c’était un chef-d’œuvre.
Je n’ai pas oublié, je n’oublie pas le plaisir que vous m’avez donné en me procurant la vue d’autographes de Beyle.
1907-1908
À Adolphe Paupe
Paris 17 rue Rousselet
le 6 janvier 1907
Cher Monsieur Paupe,
Très aimable, de m’avoir écrit. Seulement, je voudrais vous le dire, et que vous ne vous fâchiez point : je n’aime pas les compliments. Ils me gênent, de vive voix, et écrits ils me font rire. La raison ? C’est que je n’en pense pas un mot moi-même. Le jour que j’aurai changé, ce jour-là seulement je pourrai les prendre au sérieux, ou si vous voulez, avec plaisir.
Vous lisez donc le Mercure, que vous êtes si bien au courant ? Je n’ai pas vu votre « ennemi intime90 » — le mot, presque le jeu de mots, m’a bien fait rire ! — depuis plusieurs jours. Je pense à votre lettre et je me demande si je dois la lui montrer.
Ce qui m’embarrasse, ce sont les éloges que vous faites de son roman du Mercure91. Ah ! s’il n’y avait que la première partie, c’est-à-dire les éreintements, combien ce serait plus simple ! Je n’hésiterais pas à courir les lui faire lire.
Vous pouvez vous moquer tant que vous voudrez de vos lettres, de votre style, etc. Des lettres de gens qui écrivent des livres ne valent pas les vôtres. Vous avez un de ces sans-façons, une de ces rondeurs… Vous aurez été, et vous serez, homme et correspondance, un bel appendice stendhalien.
Aller vous voir, et avec ce bon M. Coffe92 ? Avec plaisir. Mais que dites-vous d’attendre un peu un meilleur temps. Je ne vais pas vous voir davantage non parce que je vous oublie, mais parce que je n’aime pas cramponner les gens. Le travail aussi, la vie, la gloire, les cent petites occupations de chaque jour.
Saluez de ma part Madame Paupe, je vous prie, et croyez bien à mes meilleures cordialités.
À Adolphe Paupe
Paris 17 rue Rousselet
le 3 mai 1907
Cher Monsieur Paupe,
J’ai bien reçu votre lettre et j’en prends bonne note, comme on dit dans vos administrations93. Relativement à M. de Gourmont, comme vous jugez vite, et mal. Au contraire de ce que disait Talleyrand, le premier mouvement, chez vous, n’est pas généreux. Je m’explique. M. de Gourmont ne fait jamais ses services que plusieurs jours après la mise en vente. Hier, au Mercure, il a signé, devant moi, et en me le disant, un exemplaire du Cœur virginal pour vous. D’autre part, le service de la librairie est assez chargé, il n’y a pas qu’un seul service d’auteur à expédier, et les volumes, quelquefois, ne parviennent aux destinataires que quatre ou cinq jours après que l’auteur a fait son service. Ergo : faites-en vous-même des excuses à M. de Gourmont, qui s’est fait un plaisir le premier de vous envoyer son livre.
Quant à moi, très flatté des soins que vous prenez des premiers éléments de mes œuvres complètes, mais combien perdu ce beau zèle. Le Petit Ami dans le Mercure ne ressemble guère à celui en volume. In Memorian et Amours seront un jour réunis en volume, augmentés et complétés (un volume dont je vous accablerai94). Quant à m’avoir au complet avec cela, jolie illusion, vous savez. Avez-vous quatre petits ouvrages de moi, mes premiers, et fort oubliés : Eaux et Forêts, poèmes — La première nuit d’un innocent, roman — Les Doubles déflorées, réponse à M. Marcel Prévost — La Marche funèbre des Chopins, souvenirs d’un vieux beau95 — sans compter bien des articles dans le Mercure, dont quelques titres seulement me reviennent : Sur l’utilité des incendies — Les Bienfaits des épidémies — Le Vice et la Débauche comme règles de morale — Un nouveau moyen de reproduire l’espèce humaine — Les Cérémonies religieuses et guerrières dans la planète Mars — Les Beautés de la Nature d’après le système Gall — Un épisode de la Révolution française : la fausse exécution de Louis XVI, etc., etc. Non, vous n’avez pas tout cela, n’est-ce pas ? Alors, vous voyez ? Il faut bien que ce soit vous pour que je manque ainsi à l’habitude que j’ai de ne jamais parler de ce que j’ai fait.
Je vous envoie mes meilleures cordialités avec mes hommages pour Madame Paupe.
Au rédacteur du Charivari
Paris le 1er janvier 1908(96)
Monsieur et Honoré Confrère,
J’ai lu votre article, dans le Charivari97, sur la rencontre de Stendhal avec cette Anglaise à laquelle il fit prendre Saint-Sulpice pour Notre-Dame et l’Institut pour les Invalides, — cette dernière indication déjà pas si fantaisiste. Vous sollicitez des éclaircissements de MM. Paupe, Stryienski et Léautaud pour savoir si cette Anglaise ne fait pas qu’une avec cette lady Morgan98 dont il est parlé dans le Brulard. Que ne vous adressez-vous à M. Coffe que l’année 1906 et la Chronique stendhalienne nous ont révélé à l’instar de Lucien Leuwen ? Pour être si récent, ce beyliste n’est pas moins à la hauteur que ceux que vous nommez, et il vous donnera aussi bien qu’eux un renseignement qui compliquera encore la question.
Tous mes souhaits pour la nouvelle année, Monsieur et Honoré Confrère, et croyez bien à mes sentiments les plus charivaresques99.
Dupont Alexandre
À Adolphe Paupe
Bibliothécaire du Stendhal-Club
Paris le 5 février 1908
Cher Monsieur Paupe,
Je vous remercie de vos deux coupures de catalogue. Je n’en profiterai pas, pour deux raisons. D’abord, j’ai depuis longtemps le Cordier100 (un grand volume carré, à couverture de parchemin blanc, si c’est bien le même ? — j’ai la paresse de chercher dans mon placard —) et le volume Ancelot101, du moins la petite édition, sans illustrations. Ensuite, je n’achète jamais de livres. Cette acquisition — car l’Ancelot m’a été donné par mon ami van Bever — date d’un temps que j’avais quelque argent momentané. Depuis, ma vie est redevenue très étroite, mes ressources très restreintes, malgré un emploi de bureau de neuf heures du matin à six heures du soir. Quand j’y songe, étant donné l’âge que j’ai déjà, je ne ris pas très fort.
Avez-vous lu dans le Figaro, ou le Temps, je ne sais plus très bien, il y a quelque temps, l’histoire d’un Saint-Simon existant à Rome, tout entier annoté de la main de Stendhal102 ? On en a offert deux mille francs à son propriétaire, qui n’a pas trouvé l’offre suffisante.
Je vous remercie de votre autorisation103 et de vos renseignements pour vos lettres. J’y penserai quand je reverrai Henriot104.
Si Coffe et Gourmont peut être la même chose, Bury, tout en étant aussi Gourmont, n’est du moins pas le même. Bury est exactement le pseudonyme d’un frère aîné de Gourmont — Honoré de Gourmont — qui a un peu écrit dans sa jeunesse, et qui, repris, sur le tard, du besoin d’écrire, a obtenu la rubrique des Journaux. Mais motus, et ne dites pas surtout que c’est moi qui vous ai renseigné105.
Votre date de 1954 m’a fait rêver. Qu’il y aura beau temps que nous aurons tous déménagé106.
Cordialement vôtre.
À Monsieur Charles-Henry Hirsch107
Paris le 16 octobre 1908
Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre, qui m’a plus touché encore qu’elle m’a fait plaisir. Occupé comme vous l’êtes, vous avez bien autre chose à faire que d’écrire des lettres de complaisance. J’ai vu dans la peine que vous avez prise un témoignage de sympathie d’autant plus sincère108.
J’ai attendu pour vous remercier. Je voulais vous rendre la pareille, vous écrire une jolie lettre. Mais cela ne vient pas. Je suis embêté. Je n’ai pas du tout l’esprit amusant. Ne m’en veuillez pas.
C’est vrai qu’on m’a rapporté l’appréciation en question109. Mais si vous croyez que j’en ai été fâché ! Amusé, au contraire, et plein de réflexions, et je ne l’ai rapportée110 que pour communiquer cet amusement, sinon ces réflexions. Maintenant, il se peut très bien que j’aie raté, que mon ton n’ait pas du tout été en rapport. Je suis si maladroit, si ignorant des subtilités du style111. Je regrette bien d’avoir attendu si tard pour écrire. Des amis m’assurent que j’aurais pu avoir du talent. Mais des amis ? Je les soupçonne de se moquer de moi, entre eux.
Peut-être, pourtant, ont-ils raison ? Savez-vous, Monsieur, que j’ai été honoré récemment d’une bien belle offre ? Celle de faire la critique dramatique dans une nouvelle revue, — et accompagnée de compliments ! Le directeur est M. Adelsward de Fersen112. Peut-être connaissez-vous ? Dans ma bourgeoise ignorance des noms littéraires, je me suis renseigné. On m’a parlé d’une certaine réputation… Et puis, je n’avais pas donné ma démission au Mercure pour m’enchaîner ailleurs ! Bref, j’ai refusé. Je me prends quelquefois à le regretter. On disait notre « oncle » Sarcey. On aurait peut-être dit notre « tante » Boissard113.
Je ne veux pas vous quitter sans vous remercier des vœux que vous m’adressez pour « un bel hiver ». Vous n’avez pas cru si bien dire, certainement, toucher si juste. C’est comme M. Fontainas. Je lisais tout à l’heure sa première chronique. Je vous le dis entre nous : j’en ai été surpris. Je ne dis pas cela parce que je la trouve très bien. Mais comment ce monsieur, que je connais à peine, a-t-il fait pour si bien me connaître ? Sans doute, il me raille un peu, en disant que je ne parais pas mon âge. C’est un compliment qu’on fait aux vieillards pour les consoler d’être vieux. En soi-même, on se réjouit d’être plus jeune. Ainsi a fait M. Fontainas. Mais comment a-t-il su la société tranquille au milieu de laquelle je vis ? Je n’en rougis pas, j’aime les bêtes, et je sens même souvent que je n’aime plus qu’elles. À un âge auquel on est revenu de bien des choses, elles restent seules à m’enchanter, mystérieusement, et tendrement.
Croyez-moi, Monsieur, votre dévoué et reconnaissant
Maurice Boissard
1909-1911
À Émile Henriot
Paris le 27 avril 1909
Mon Cher Ami,
La petite note du Charivari sur mon adopté114 et que tout le monde a lue au Mercure, m’a ravi. J’aime tant les bêtes… à quatre pattes ! Un petit détail, cependant. Ami n’est pas un caniche. C’est là le nom vulgaire, celui qu’on donne en gros à trois ou quatre espèces de chiens. De son vrai nom générique, c’est un barbet. Lisez tout le bien qu’en disent les naturalistes, — (dans le Larousse).
Un autre détail, autrement grave. Il concerne mon chat, Boule, que vous connaissez aussi. Je lui ai lu la biographie charivaresque, c’est-à-dire pleine d’esprit, qu’Ami doit à votre bienveillance. Si vous aviez vu son air faussement dédaigneux, cachant une intense jalousie ! Sous ses manières discrètes, ce chat est comme Mme de Noailles : il aime beaucoup la réclame.
Quant à ce que vous dites de l’appétit d’Ami pour les œuvres littéraires, c’est malheureusement exact. J’ai même eu dernièrement une alerte assez chaude. Le Mercure imprime en ce moment un livre de M. Émile Magne. Ami a failli, l’autre jour, en dévorer le manuscrit115. M. Magne était présent. Il a fallu toute la bonne humeur qui ne le quitte jamais pour conjurer une perte irréparable. J’ai toutefois une consolation dont l’importance ne vous échappera pas. M. Paul Adam116 n’est pas des auteurs du Mercure. Ainsi, Ami ne verra jamais un de ses ouvrages. Sans cela, je ne serais pas tranquille. À huit mois, le sens critique, même chez un chien, n’est pas très développé. S’il voyait un manuscrit de ce grand auteur, Ami serait capable de n’écouter que son appétit, et cette littérature est si indigeste qu’elle pourrait lui être fatale.
Nous vous serrons tous les trois la patte très cordialement.
À Adolphe Paupe
Bibliothécaire du Stendhal-Club
Paris le 23 juin 1909
Cher Monsieur Paupe,
J’avais oublié de vous le dire. C’est Stryienski qui m’a envoyé le niais en question117. Ainsi, vous voyez, le lui adresser, cela ne prendrait pas.
Quant à la Vie amoureuse de Stendhal118, n’est-ce pas que c’est beau ? On copie des phrases d’un auteur. On les met bout à bout, en reliant par d’autres phrases qui n’en sont que la répétition. Exemple :
« À cette époque, Stendhal était très gêné. Il écrivait à son père de lui envoyer de l’argent. « Mon cher papa, je suis excessivement gêné. Envoie-moi un peu d’argent. »
Trois cents pages de morceaux de ce genre et on a un volume et on est un auteur. Avouez que c’est pour rien.
Je vous remercie pour Stendhal et l’Angleterre119, mais je n’ai aucun endroit. J’ai lu votre préface dans l’exemplaire de Gourmont. Elle m’a plu pour sa bonhomie et son esprit, et Gourmont m’a dit que tout l’ouvrage est bien fait et fort intéressant.
Vous ne douterez plus de la niaiserie de l’attaché quand vous l’aurez entendu débiter ses phrases, vanter ses relations, mêler la politique et la littérature, et parler de Stendhal comme d’un frère. Il a dû le découvrir il y a huit jours. Il m’avait demandé un rendez-vous par lettre. Poliment, je ne lui avais pas répondu. Un matin, il m’est tombé dessus au Mercure. Un bluffeur, de plus.
Ce jeune politicien, — comme Mélia, qui se prépare à être député, ce qui sera un bien pour les lettres, — est venu un jour demander à Vallette de lui accorder la firme du Mercure120 pour deux volumes qu’il faisait imprimer. Accordé. Et il fait suivre sa signature, dans la lettre qu’il m’a écrite, de ceci, pour se donner de l’importance : trois volumes au Mercure. Il ne se doutait pas de mon emploi dans la maison et que j’ai dans mes besognes la confection du Catalogue.
Bonne poignée de main.
24 juin 1909
J’avais cette lettre dans ma poche pour la mettre à la poste quand j’ai trouvé votre lettre en arrivant au Mercure. Beaucoup de vrai dans ce que vous me dites de mon caractère d’après mon écriture, mais rien à beaucoup envier. Comment n’être pas modeste, quand, à près de quarante ans, on n’a rien fait ? Le contraire serait comique. Nonchalance, hésitation, manie de la rêverie, manque d’ambition, manie de la réflexion, tout cela m’a déjà fait manquer quelques bonnes occasions. Un amour extrême pour les animaux est venu par-dessus le marché manger encore une bonne partie du peu de temps que j’ai à moi. Ma vie est un tableau que je m’amuse à regarder tous les soirs, de neuf heures à minuit, enfoncé dans un fauteuil, et sur lequel il n’y aura peut-être un jour rien d’écrit, ou si peu ! Mais je ne suis jaloux de personne. Je ne changerais pas ce que je suis pour être un autre. J’ai le bonheur de n’avoir pas grand regret de grand’chose et je sais rire de moi encore plus que des autres.
Quant à Gourmont, vous ne vous trompez pas. C’est quelqu’un de tout à fait remarquable, et au nombre des premiers. Il faut de plus l’estimer autant qu’on l’admire, pour sa vie isolée, fière, libre : l’homme qui n’a jamais rien demandé. Pour moi, l’amitié qu’il a pour moi, sans que j’aie jamais rien fait pour la mériter, et dans laquelle il n’entre de sa part pas la moindre supériorité, la moindre morgue — la camaraderie la plus simple, la plus franche, me laissant toute ma liberté, ce qui est encore à son éloge — aura été un des grands plaisirs de ma vie (ils sont rares).
Bonnes vacances, heureux homme.
À Adolphe Paupe
Paris le 11 juillet 1909
Cher Monsieur Paupe,
Je suis un peu en retard pour vous répondre. Excusez-moi.
J’accepterai avec plaisir l’invitation que veut bien me faire Madame Paupe. Elle ne s’est pas trompée sur mon compte. C’est toutes les bêtes que j’aime. Même, je les aime trop. Ma vie en est un peu gâtée. Un chat sans gîte, un chien perdu, un cheval maltraité ou blessé, et voilà une journée fichue. Je porte chaque jour la pâtée à trois chats qui vivent abandonnés dans un coin de mon quartier. Il y a deux mois, j’en avais trois autres dans un autre endroit, mais disparus. On a dû me les tuer. Il m’arrive de temps en temps de reconduire, et souvent au diable, un chien égaré avec son adresse sur son collier. Je fais hospitaliser, sans plaisir, certes, tel autre que je trouve perdu sans collier, ainsi que des chats quand ils sont trop exposés. Au mois de mars dernier, j’ai même recueilli pour mon compte personnel un jeune fou de barbet trouvé dans la rue, crotté… comme un barbet, c’est bien le cas de le dire. Ce qui me fait avec mon chat deux bêtes chez moi. Et cela est loin de me contenter. Si je m’écoutais, et si je le pouvais, je ramènerais une nouvelle bête chaque semaine. Être un peu à mon aise, et pouvoir avoir un petit pavillon, avec un bout de jardin, pour y avoir des animaux et de toutes sortes ! J’y pense souvent. Rue Rousselet121, j’avais mon évier envahi de fourmis : je leur mettais du sucre chaque soir, et je vous garantis que dans chaque maison où j’habite, les oiseaux du voisinage ne sont pas longs à me connaître, et à arriver à la volée dès que j’ouvre ma fenêtre le matin. Je m’arrête. J’aurais l’air de vouloir me faire de la réclame. Vous voyez que j’ai de quoi m’entendre avec Madame Paupe. Cela me changera des grossièretés de certains concierges de ma rue, aussi bêtes que brutes, qui ont l’air de me considérer comme un phénomène parce que je m’intéresse, non pas seulement en théorie, mais en action, aux animaux. Il y a quelques mois, un dimanche, sous une pluie battante, j’aperçois un chat sur le toit d’un pavillon à un étage presque en face de chez moi. Je m’informe. On a effrayé ce chat. Il a grimpé là par peur. Aucun moyen de redescendre. Je mobilise des échelles, deux gamins, un panier. Nous montons retirer ce chat. Je donne cinquante sous aux gamins pour leur aide. Si vous aviez entendu les concierges amassés à nous regarder ! Cinquante sous, pour un chat ! Il m’aurait fallu faire la quête, je n’aurais pas trouvé un sou, un seul. J’aurai tout dit avec ceci : On dit : « Une maison sans enfants n’est pas une maison. » Je dis, moi : « Une maison sans bêtes… »
Vous m’avez encore fait un grand plaisir avec Stendhal et l’Angleterre. Vous êtes un charmant homme et je ne sais comment vous remercier.
Présentez mes hommages à Madame Paupe. Vingtras122, quand on lui parlait d’un nouvel individu à connaître, demandait : « Sa redingote m’ira-t-elle ? » Moi je demande : « Aime-t-il les bêtes ? » C’est mon point de départ pour ma sympathie. Avouez que vous ne vous doutiez pas que j’étais à ce point. C’est ainsi, pourtant. On blague, on fait de l’ironie, on égratigne de son mieux, et il suffit des beaux yeux tendres d’une bête pour faire de vous l’individu le plus sensible, le plus affectueux, le plus charitable. Je demande le Prix Montyon123.
Je vous serre la main.
À Remy de Gourmont
Paris le 22 septembre 1909
Cher Monsieur de Gourmont,
Je serai tout de même un peu avec vous à Rouen124, le temps que vous lirez ces lignes. Votre carte m’a rappelé les trois jours que j’ai passés là avec vous. J’ai une grande mémoire, une grande capacité à retrouver les sensations éprouvées. J’ai revécu ces trois jours dans tout le plaisir qu’ils m’ont donné grâce à vous. Le paysage doit être beau, en effet, en ce moment, dans la brume légère de la saison. Je me suis tenu à quatre pour ne pas aller avec Dumur le revoir et vous y retrouver. Je voyais déjà votre surprise, à sept heures, au Café du Commerce, à votre table du coin, quand nous vous aurions abordé tous les deux, Dumur d’un côté, moi de l’autre. Dumur, encore, vous l’attendiez, lui ! Mais moi ! Nous aurions bien ri tous les trois. Ce sera pour une autre année. Le diable est de savoir laquelle. Mais je vois que Rouen est devenu pour vous un quartier général de vacances. J’ai du temps devant moi.
Vous savez que Paupe m’avait écrit pour me demander mon avis, et surtout le vôtre, sur ses travaux dans l’Intermédiaire125-126. Il m’a écrit de nouveau et j’ai dû lui répondre. Ma foi, j’ai dit le vrai, et que vous n’aviez pas été transporté d’admiration. Ce pauvre Paupe vient de m’écrire à ce sujet. Il est navré. Il regrette de n’avoir pas suivi son premier mouvement, qui avait été de me soumettre sa fantaisie ». « Mon intention était excellente, dit-il, — et il ajoute : comme celle de l’ours du fabuliste, sans doute127. » Enfin, il veut que je vous ramène à l’indulgence, comme il dit, car il vous estime et vous aime, et reconnaît que vous n’avez eu que d’excellents procédés envers lui. Les deux extrêmes, quoi ! Je dois le voir prochainement. Je lui donnerai l’absolution.
Votre dernier Épilogue128 m’a ravi, et aussi le mot final de vos prochains Journaux129… : « Nous autres qui ne sommes pas académiques130. » Je peux bien vous faire des compliments, pendant que vous êtes en province. Ici, quand je vous vois, il n’y a jamais moyen. C’est trop difficile. Et puis, vous êtes si simple, si cordial, et vous savez laisser vos amis si libres ! Je sens fort bien tout cela, et son très grand prix, si je n’en dis rien. Les grandes admirations sont sans doute comme les grandes douleurs : elles sont muettes.
Bonjour à Rouen pour moi, et à Dumur, s’il est encore votre compagnon, et une bonne poignée de main.
1912 et 1914
À Charles-Henry Hirsch
Paris le 17 août 1912
Mon Cher Hirsch,
Vous n’avez pas de chance. Le patron est absent. C’est moi qui ouvre le courrier. J’ai lu votre lettre accompagnant votre prochaine chronique, et dans celle-ci les commentaires dont vous accompagnez les citations de l’article de Billy131.
Merci. Je vois que je suis pour vous comme les enfants auxquels il ne faut faire nulle peine, même légère. Et rassurez-vous. Il n’y a rien dans votre commentaire qui puisse me mécontenter. Je voudrais bien voir que je me fâche de l’appréciation de quelqu’un sur mon compte. Libre moi, mais libres les autres aussi.
L’article de Billy ? Mon Dieu ! j’avoue que le premier jour… Vous me croirez si vous voulez : je n’étais pas gai. Je peux vous le dire. Je l’ai dit à Billy lui-même. Je retirais de cela la même impression que je retirais autrefois des interviews de Huysmans, qui me faisaient dire : Mon Dieu ! que cet homme doit être peu intelligent ! — Je regrettais quelques nuances… Après cela, on m’a dit que je me trompais, que c’est au contraire très bien. Très bien ? On peut dire beaucoup de choses, par là.
Quant au croquis qui vous inquiète pour mon goût, mais non ! Je le trouve même plutôt juste. « Vieil acteur de province » ? Cela rentre assez dans ma rubrique. Je puis même dire dans ma famille. J’aime mieux cela que le « curé défroqué ». Il y a, je sais bien, la « petite cravate de paysan qui va au marché » ? Mais quoi ! Billy ne pouvait tout de même pas me montrer sous les aspects d’un jeune premier mondain. Je sais bien que j’ai un côté un peu caricature. Billy l’a pigé, comme on dit. Il a bien fait. Il aurait même eu tort de l’éviter. Je ne me serais pas reconnu. Je me demande seulement, étant données l’immense publicité des Soirées de Paris, et celle non moins immense du Mercure, si j’oserai encore me montrer dans les salles de spectacle l’hiver prochain.
Quant aux bêtes, je pourrais vous dire là-dessus bien des choses. Je ne les aime pas par dépit. Je n’ai de dépit de rien. Je n’en ai que de moi-même. J’ai la même charité pour les gens que pour elles. Il est bien vrai pourtant que je n’aime rien tant que la solitude et le silence, au milieu de ces animaux qui me mangent ma vie, je le sais bien, je me le dis moi-même. Mais qu’y faire ? C’est devenu une passion que je sens bien incurable.
Tenez. Je viens de recevoir le dernier Bulletin de la S.A.P. relatant la distribution des récompenses. J’y lis ceci :
« BATAILLON, chien de régiment, 22e colonial, Toulon. Chien braque, âgé de 12 ans. À fait les campagnes de Chine et de Madagascar, a assisté aux différents combats auxquels a pris part au Maroc le 22e colonial. Nommé sergent par le régiment. »
Ah ! bigre, je ne suis pas chauvin, ni même très patriote. Mais cette brave bête… je la verrais, je crois bien que je crierais, pas : Vive l’armée, non, ce serait trop, mais, mon Dieu ?… : Vive le Bataillon !
Surtout ne perdez pas votre temps à m’écrire sur tout cela même deux mots. Je sais que vous travaillez beaucoup. C’est même une raison pour laquelle je vous rends bien la sympathie que vous m’avez toujours montrée. Sympathie d’un homme qui avait rêvé de travailler, lui aussi, de vivre seul, de n’avoir aucun lien, d’être un écrivain un peu connu, d’habiter rue de Richelieu, d’être répandu, de voir des gens, de les regarder, de les écouter, et de faire avec tout cela des choses… Ah ! c’est d’une riche ironie.
Présentez, je vous prie, mes hommages à Madame Hirsch, et croyez bien à ma vive cordialité.
Une chose encore que je ne puis me retenir de vous dire : ce n’est pas moi qui ai coché sur les Soirées de Paris le titre de l’article de Billy. Je ne m’en suis aperçu qu’en préparant l’envoi de votre paquet.
À Adolphe Paupe
Bibliothécaire du Stendhal-Club
Paris le 12 mars 1914
Cher Monsieur Paupe,
Est-ce à vous que je dois l’exemplaire que je viens de recevoir de La Vie littéraire de Stendhal132 ? Oui, probablement, puisque votre carte s’y trouve insérée. Je vous en fais mes remerciements. Je vous en fais surtout mes compliments. Le volume est amusant. Il y a des choses dedans qui aideront un jour un stendhalien à dresser votre physionomie, à crayonner votre portrait, à dire l’homme curieux, patient, maniaque, fervent, et très sympathique que vous aurez été, que vous êtes encore, Dieu merci ! Si je faisais de la critique littéraire, il y a longtemps que cela serait fait. Je vous soupçonne, d’ailleurs, de cacher votre jeu et de n’être pas indemne, au fond, d’une certaine vanité. Parions que vous vous êtes un peu rengorgé devant votre glace, quand vous avez reçu et tenu en main le premier exemplaire de ce livre ? Je vous l’ai dit souvent : vous passerez à la postérité. Vous en voilà assuré, maintenant que vous figurez dans cette merveilleuse édition des œuvres complètes de Beyle. Vous l’avez bien gagné par vos travaux, vos soins, et votre admiration d’un caractère presque unique.
Je ne vous remercie pas des mots aimables pour moi que vous avez mis dans votre ouvrage133. Vous avez satisfait là une manie que je ne partage pas. Je ne veux pas avoir l’air de m’y associer.
Je monterai134 peut-être vous voir un de ces dimanches, dans quelque temps. En attendant, rappelez-moi au bon souvenir de Madame Paupe et de vos enfants, et croyez à toute ma cordialité.
À Mademoiselle Marie Laurencin
Paris le 20 mars 1914
Chère Mademoiselle,
J’ai pour vous, prêt à prendre tout de suite, un beau caniche tout noir. Le chien que je vous destinais n’est décidément pas bien portant. Mieux vaut pour vous ne pas vous charger du souci de l’avoir.
Voulez-vous me dire quel jour et à quelle heure on peut aller vous montrer le caniche en question ? Il est tout frais tondu, mais son poil repoussera et il recouvrera bientôt cet aspect ébouriffé amusant qu’ont les chiens de cette sorte que, pour mon goût, je préfère à l’état naturel, c’est-à-dire non tondu.
Si vous m’en croyez, vous procéderez de cette façon :
On vous amènera le chien. Vous direz s’il vous plaît. Si oui, vous lui prendrez mesure de son tour de cou. Vous lui achèterez un collier (plus grand naturellement que le tour de cou) et ferez graver la plaque à votre nom et votre adresse. (Si vous le préférez, je me chargerai de cela.) Quand vous aurez ce collier tout prêt, on vous amènera le chien pour de bon. À moins que vous ne soyez bien sûre de ne pas le laisser égarer tant qu’il n’aura pas son collier. Dans ce cas, vous pourriez le garder tout de suite. Mais soyez sérieuse : la question du collier avec nom et adresse est très importante. Ce matin encore, Billy a vu ramasser, rue de Richelieu, un malheureux chien que nous aurions pu sauver s’il avait eu un collier en règle.
Du reste, pour le caniche en question, pendant un bon mois, il faudra ne le sortir qu’à l’attache et le combler de gentillesses. Ce pauvre chien ne fait que pleurer depuis qu’il a perdu ses maîtres. À ce point que, si on ne peut le placer, on va l’abattre, tant il est malheureux.
J’attends votre réponse.
Mes sentiments les plus amicaux.
À André Gide
Paris le 15 avril 1914
Mon cher Gide,
J’ai été bien surpris de votre lettre. Très flatté aussi. Je ne me serais pas attendu à un pareil honneur. Ce dernier mot est peut-être de trop, d’ailleurs. Je ne dois peut-être votre invitation qu’à votre cordialité. Je vais en tout cas bien mal répondre à votre amicale ambassade. J’en suis, pour mes travaux, au même point qu’il y a deux ans, je puis même dire qu’il y a huit ans. Depuis 1906, je dois donner un livre au Mercure, et je n’ai pas encore pu trouver la centaine ou la cent cinquantaine de soirées de suite dont j’ai besoin pour écrire les deux cents pages de volume que j’ai à écrire. Je laisse de côté les raisons matérielles. Mais j’ai besoin, pour travailler, d’illusion, de bonheur d’esprit. Je ne les ai pas tous les jours, il s’en faut.
Excusez-moi donc. Votre lettre m’a fait plaisir pendant quelques minutes. Je vous en remercie.
Je ne vous ai dit que mon sentiment très sincère à propos de vos Souvenirs de la Cour d’Assises135. Cela m’a fait plaisir qu’un homme comme vous s’intéresse à ces choses, et surtout ne craigne pas de montrer qu’il s’y intéresse.
À vous très cordialement.
À Mademoiselle Marie Laurencin
Paris le 1er avril 1914
Chère Mademoiselle,
Je suis bien ennuyé. Billy m’a dit tantôt que le chien est bien laid, qu’il est vieux, que vous n’en êtes pas plus enchantée. Tout cela est-il bien vrai ? Il dit même que ce n’est point un caniche. Moi, je ne l’ai jamais vu. On est venu me parler pour lui. J’ai tout fait ensuite par correspondance. M’a-t-on trompé ?
Est-on venu vous apporter le collier ? Si non, quand on viendra, parlez à cette dame. Il vaut mieux ne pas laisser ce chien goûter au bonheur si vous ne devez pas le garder. Il vaudrait mieux le rendre dès maintenant. Je vous dis cela très amicalement. Je ne serai nullement fâché. Je comprendrai très bien. Je vous en aurai un autre, et cette fois-là je ferai les choses moi-même. Les candidats ne manquent pas.
Pauvres bêtes, chez elles aussi, il y a ceux qui plaisent et ceux qui ne plaisent pas. Il faut tout de même reconnaître qu’un chien qui doit vivre en appartement doit réunir certaines conditions.
Ne venez pas me voir avec lui, si vous devez le rendre. J’aime mieux, dans ce cas, ne pas le connaître136.
À vous.
Je suis à votre disposition pour écrire moi-même à la dame en question.
La question de propreté est secondaire. Un chien se forme très rapidement sur ce chapitre. Il faut lui apprendre.
À André Billy
Paris le 18 août 1914
Toute mon amitié vous accompagne, mon cher Billy. Le proverbe qui dit : loin des yeux, loin du cœur — reçoit en ce moment un joli démenti137.
Courage et patience.
À Paul Morisse
Pornic le 8 septembre 1914
Mon cher Morisse,
Je suis en effet ici138 depuis le 3, ou 4 ou 5 du mois, je ne sais plus au juste. Je n’en ai aucun contentement. Ce départ a été une folie. Sans doute, avec ma ménagerie, en voyant le gouvernement filer, les portes de Paris se fermer, les Allemands à Creil, on pouvait avoir des craintes motivées. Mais, quand même, j’eusse mieux fait d’écouter ma négligence, mon indécision, ma résignation, et de ne pas bouger. Je serais aujourd’hui tranquille chez moi, n’ayant pas subi cet odieux voyage, ayant évité ce dépaysement, cette vie incommode, et n’ayant pas à envisager un autre odieux voyage, sans doute, celui du retour. Trente-six heures de train pour venir ici, dans un fourgon, debout, au milieu de quelles gens ! J’aurais été seul, jamais je ne serais monté là-dedans. J’aurais écouté ma répugnance, mon déplaisir, je me serais fait rembourser mes billets et je serais rentré chez moi. Jamais je ne me consolerai d’avoir, pour la première fois de ma vie, fait une action qui me déplaît. Ajoutez que cela m’a tiré d’affaire moins qu’à moitié. Je n’ai pu emmener toutes mes bêtes : neuf chiens et une trentaine de chats. Il n’y fallait pas songer. J’ai amené quatre chiens et neuf chats. Le reste a été confié à une dame amie de Paris. Une plainte n’a pas tardé à être faite contre elle et il lui a fallu, sans regret, certes, réintégrer Fontenay. Résultat : les frais de ces déménagement et réemménagement, l’entretien de la maison de Fontenay, bêtes et gens, mes frais de voyage et de séjour ici, mes frais de retour, les dettes inévitables. Ah ! vraiment oui, cela a été une belle opération. J’en suis d’autant moins fier qu’à dire franc je me reconnais peu de l’avoir effectuée.
Je pense que vous n’avez pas écrit sans ironie, tel que vous me connaissez, ce que vous me dites de mon goût à vivre ici et à rêver au bord de la mer. J’ai le courage de mes ridicules comme de mes manques de goût, et je vous dirai tout net que la mer ne me dit rien. Elle est là, à cent mètres de ma fenêtre, et je regarde cela comme une grande étendue d’eau sale. Je me suis fait ramasser par Madame C…, un soir qu’elle me montrait cette mer éclairée par la lune, parce que je lui ai dit que je trouvais cela assez chromo, et pour le vrai, c’est mon impression sincère. Je ne suis pas fait pour les mers, décidément, pas plus celle de Genève139 que celle d’ici. Le pays lui-même m’est fort indifférent. Fontenay offre des coins à mon avis cent fois plus agréables pour la rêverie. Que je regrette Paris ! Je vous jure que c’est vrai : à Tours, dans le train, regardant sur la carte le trajet parcouru et constatant à quelle distance énorme déjà je me trouvais de Paris, du cadre de ma vie, de l’atmosphère familière, j’ai eu au cœur un serrement d’angoisse. Que dire ici, à cette pointe de côte, à quatre cent cinquante kilomètres de Paris ! Est-ce donc possible ! Je suis ici, moi ? je me sens si loin, si désorbité, que je doute, par moments, de la possibilité du retour. Je ne suis pas fait pour l’exportation, j’aurais tort de n’en pas convenir.
Vous m’avez fait grand plaisir en me renseignant sur Billy. Je m’inquiétais déjà du manque de réponse de Madame F…-F…140 à ma lettre. Elle doit être très contente et heureuse de l’envoi de Billy à Rodez. Faites-lui, je vous prie, mes amitiés et faites part de mon bonjour à Mademoiselle Chérie141. Quand je vais aller en ville, j’achèterai des cartes postales et j’écrirai à Billy. Mais — et Pergaud142 ?…
J’ai écrit à Vallette pour lui demander s’il a des nouvelles de Billy (ne recevant rien de Madame F…-F…), de Bernard, de Cros143, d’Apollinaire, de son gendre144, et ce qu’il y a de nouveau au Mercure. Je n’ai pas encore sa réponse. Les lettres de Paris mettent en ce moment cinq jours pour venir ici.
Je vais aussi rentrer probablement bientôt à Paris. Il me faut compter avec les difficultés du voyage, l’affluence de voyageurs à la fin des villégiatures. Je serai seul à repartir, seul avec quatre chiens et six paniers à chats. Je vais encore m’amuser. Non, quand je pense que je suis venu ici, dans ce décor d’opéra-comique, alors que j’étais si bien chez moi, seul ! Je me couvre d’ironies, dans ces moments-là.
Comment allons-nous vivre, si la guerre dure, avec nos admirables cinquante francs par mois ? Vous, encore, vous êtes seul. C’est beaucoup, d’être seul, et je n’oublie pas, certes, qu’à notre âge cinquante francs par mois ne sont rien. Mais moi, avec tous mes compagnons !
Je vais probablement avoir à passer la nouvelle visite des réformés et des exemptés (j’offre cette singularité d’être à la fois un réformé et un exempté). J’ai déjà accompli la première obligation prescrite par l’arrêté du Ministre : l’envoi au maire de ma commune de ma situation militaire. J’attends maintenant une convocation — s’il doit m’en venir une. Je rirais bien de me voir transformé en héros.
M. et Madame C… vous remercient de votre bon souvenir et me chargent de vous adresser le leur, très cordial. Je crois qu’ils ont pris une piètre idée de moi, depuis que je suis ici, à cause de mon peu d’admiration pour le pays. Mais que voulez-vous ? Toutes ces petites maisons sur lesquelles on lit KER ceci, KER cela, KER autre chose, chiqué breton que tous les gens de Paris tiennent à arborer, ces gens qui s’en vont comme de grands enfants, les mollets et les bras nus, armés de filets, de gaffes, de pelles, de nasses, pour faire les pêcheurs le long de cent mètres d’eau, je trouve tout cela assez comique. Quant au paysage : un chromo, je ne m’en dédis pas. C’est la fadeur, l’insignifiance mêmes. Une autre observation que j’ai faite, c’est qu’ici, toutes les femmes (les natives, j’entends) ont le nez pointu. À Paris, au moins, elles n’ont que le caractère. Pour les regarder, c’est moins déplaisant.
J’ai eu de temps en temps des nouvelles de mon frère145. Les dernières datées du 15. Depuis plus d’une semaine, à cette époque, à se battre, presque sans nourriture ni sommeil. En bonne santé, néanmoins.
À vous cordialement.
À André Rouveyre
Fontenay-aux-Roses
le 30 octobre 1914
Mon cher ami,
J’ai été content d’avoir de vos nouvelles. J’ai pensé plusieurs fois à vous pendant ces derniers mois. Je me demandais où vous pouviez bien être, et ce que vous pouviez bien faire. Je vois que l’héroïsme vous a visité — en vain, heureusement ! — et que vous avez toujours votre bonne humeur. Tant mieux. S’il y a en ce moment beaucoup de choses qui portent à pleurer, il y en a encore plus, je crois bien, qui font éclater de rire. La guerre montre, poussées à leur perfection, la monstruosité et la stupidité humaines. Je suis rentré à Fontenay samedi dernier146. Votre lettre m’y a rejoint, renvoyée de Pornic. J’ai passé là-bas à peu près deux mois ni bons ni mauvais. Je ne suis pas voyageur. L’habitude me manque. Je n’avais rien de mes affaires. J’étais tout dépaysé. J’aspirais au retour. J’y aspirais en me disant, tel que je me connais : Quand tu seras parti, tu regretteras ce petit coin tranquille, cette maison accueillante, ces hôtes bons camarades, et même ce paysage dont la vue ne te dit rien. Je ne me trompais pas, mon cher ami. Rentré dans ma maison vide, regardant mon jardin tout rempli de feuilles mortes pourrissant sous la pluie, je regrette la côte de Pornic, où il faisait encore, quand je l’ai quittée, une tiédeur presque printanière. Il est vrai, les soucis qui m’attendaient ici sont pour beaucoup dans ce regret. De grands soucis, certes. Je m’imaginais que la guerre durerait trois mois et grâce à quelques petites économies j’étais paré pour ce temps. Le trimestre est écoulé et on dit n’en être encore qu’à des débuts. Je commence à ne plus rire et même à voir les choses assez en noir. Je ne sais pas si vous savez ce que le Mercure nous alloue, à moi et à Morisse, pendant toute la durée de cette histoire. Ce n’est pas lourd. C’est même un peu honteux. Cinquante francs par mois ! Un homme, à quarante-trois ans, avec les modestes habitudes qu’il a prises, vivre avec cinquante francs par mois147, en l’an de grâce 1914, toutes les denrées renchéries sous l’effet de cette guerre ! Il va pourtant falloir y réussir, moi, et mes neuf chiens et mes vingt-sept chats. Y réussir ? À la vérité, je n’y crois pas beaucoup. J’ai eu avant-hier avec Vallette une entrevue à ce sujet. Je comptais assez sur des actions, ou sur une avance de ma gratification de fin d’année148, qui doit rester intacte, il me semble, puisque venant de l’exercice à fin juin dernier. Je suis sorti de cet entretien comme devant. Si encore je pouvais m’engager… au Mont-de Piété !
Mon frère, qui se bat depuis le 1er septembre devant Verdun, est toujours vivant, et sans blessure — tel il était du moins au 17 octobre, date de sa dernière lettre — après s’être trouvé dans plusieurs occasions dangereuses. Pas déchaussé ni dévêtu depuis le 2 août, jour de son départ. Voyez ce que cela représente pour un homme habitué à quelque propreté. Il lui serait d’ailleurs impossible de se déchausser, dit-il. Il faudrait couper le cuir des souliers. On nous montre les prisonniers allemands ayant mangé des betteraves pour toute nourriture. Mon frère, lui, plusieurs fois, n’a eu à manger que des carottes prises dans les champs. Toujours à se battre, mal nourri, dormant rarement, allongé sur la terre trempée, transformé en un vrai paquet de boue, les mains glacées pouvant à peine tenir le fusil, les jambes malades, tel il me dit être. Je lui écris souvent. De temps en temps il reçoit une de mes lettres. Je lui envoie du chocolat, du tabac (dont ils sont fort privés). Reçoit-il ? On n’en sait trop rien. Je viens de lui envoyer tricot, gants, chaussettes. Cela lui parviendra-t-il ? Il faut l’espérer, sans trop le croire. S’il ne revient pas, il y a un enfant, un petit garçon de huit ans, dont j’ai promis de me charger. Cela me fera un enfant, à moi qui n’ai jamais pu en faire149. La guerre m’aura ainsi fait perdre beaucoup d’argent (pour ma bourse) — environ deux cent cinquante francs par mois — et procuré un héritier. Ce sera d’une belle ironie.
Je vous écris campé chez moi comme un réfugié. Sous le coup de l’alerte, quand les Allemands étaient à Compiègne (et même plus près, on l’a caché) et qu’on parlait à Fontenay de nous faire évacuer, ma bonne a pris sur elle, en mon absence, de déménager mes meubles, mes livres, mes papiers. Tout cela est au Mercure, empilé, en vrai bric-à-brac. Il reste à Fontenay le strict nécessaire, un matelas par terre, une table, une chaise, une lampe. Je me promène au milieu de tout cela, chapeau sur la tête, enfermé dans mon pardessus, gelé, soucieux, regardant tomber la pluie, entouré de mes bêtes, ne pouvant même plus aller facilement à Paris à cause de la rareté des trains, me demandant quand on va enfin se décider à nous ficher la paix. Il paraît que ce n’est pas proche, que nous en avons encore pour des mois. Nous serons jolis, alors, en particulier comme en général.
Voilà toutes les nouvelles, mon cher Rouveyre, du moins toutes mes nouvelles. Remerciez Madame Rouveyre de son bon souvenir et présentez-lui mes hommages. Je dirais bien aussi un bonjour à ces deux jolies petites filles que j’ai vues chez vous un jour si j’étais sûr qu’elles se rappellent de moi. Dites en tout cas bonjour de ma part à Robert, excellent serviteur du vieux répertoire, et à son Boulot150, et quant à vous, homme aux profonds dessins, ma meilleure poignée de main, avec le regret des jours que nous disions des riens dans ces bureaux de la rue de Condé.
À André Rouveyre
Fontenay-aux-Roses
le 5 novembre 1914
Mon cher Rouveyre,
Votre offre, dans laquelle je sens bien que Madame Rouveyre a sa grande part, est tout à fait gentille, mais je n’en profiterai pas, je vous le dis tout de suite151. 1o J’ai toute la place nécessaire chez moi, mes bêtes y ont leurs aises, la sécurité d’un bon voisinage, et peuvent y faire, sans mécomptes pour moi, les petits dégâts que des animaux font toujours dans une propriété. 2o Il me faut compter, en ce moment plus que jamais, avec la question des approvisionnements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c’est que d’avoir à nourrir neuf chiens et vingt-sept chats. Les chiens, encore, on s’en tirerait, avec des croûtes et de la graisse. Mais les chats ? Il leur faut absolument de la viande. J’ai essayé pendant quelque temps de les mettre au riz : tous malades. Il faut donc, pour nourrir tout ce personnel, des croûtes et de la viande. En temps ordinaire, déjà impossible de trouver le nécessaire à Fontenay (vous savez bien la manutention de croûtes que je fais dans mon bureau du Mercure). À plus forte raison en ce moment. Il me faut tous les deux jours aller à Paris chercher des croûtes. Deux fois par semaine, de grand matin, on va s’approvisionner de mou, de foie, de têtes de mouton aux Halles. (Songez qu’il en faut chaque jour une moyenne de trois kilos, qui reviennent entre 1 fr. 25 et 1 fr. 50.) Grâce à tout ce travail, et en payant des prix déjà fort haussés (on m’a augmenté les croûtes) j’arrive à maintenir à peu près en état tout mon monde à quatre pattes. De pareilles difficultés déjà alors que je suis tout près de Paris ! Vous devinez ce qu’elles pourraient être plus loin. Surtout qu’il ne faut pas trop parler ni montrer de bêtes en ce moment. Il y a de telles gens… Je vous encombrerais donc, mes animaux vous causeraient (inévitablement) quelques petits dégâts, sans que ni eux, pour la nourriture, ni moi, pour mes soucis, nous nous en trouvions mieux. Je vous écris tout cela très simplement, sans phrases, tout comme vous avez fait vous-même. Je suis sûr que ma rapidité de style ne vous fâchera pas et que vous comprendrez ma situation.
Quant à moi, personnellement, si, en ce moment, je vis un peu campé, je n’en souffre en rien. Le seul malheur est que cette maison est humide en diable (un véritable aquarium) et qu’il faut prendre ses précautions. On ne les prend d’ailleurs pas, naturellement.
Grand merci pour le contenu de votre lettre. Je ne ferai pas de genre avec vous sur ce sujet : ces petits papiers152 me seront d’une aide réelle. Je serais seul, je vous le dis comme je le pense et le ferais, je m’en tirerais fort bien, ou à peu près fort bien, avec quelques privations, avec la fameuse allocation du Mercure. Mais c’est ma folle ménagerie qui me coûte et qui m’inquiète. Un seul détail : moi je pourrais fort bien manger froid tout le temps, n’importe quoi. Mais ces messieurs, il faut leur faire cuire leur viande, leur confectionner du bouillon pour tremper leur pain. Rien à regretter, d’ailleurs, devant leurs mille témoignages d’affection et de gentillesse.
Je vous souhaite, de votre côté, de la patience, mon cher Rouveyre, si vous trouvez, comme moi, que la vie, en ce moment, a des côtés parfois insupportables. Remerciez, comme je voudrais le faire moi-même, Madame Rouveyre, et présentez-lui mes hommages et croyez comme toujours à ma fidèle amitié.
Je lis, de temps en temps, pour me distraire, un Voyage en Allemagne, écrit récemment par une femme. Le talent ne manque pas (un peu trop joli, peut-être), ni l’émotion, une sorte de grâce, la « sensibilité » comme on disait au XVIIIe siècle. On y promène le lecteur dans Cologne, Cassel, Weimar, Potsdam et Dresde, Nuremberg et Munich. On y visite les « Maisons sacrées », celle de Goethe, celle de Schiller, celle de Liszt, celle de Herder… On y voit les amours de ces hommes, amours ardentes, violentes, amères, sans cesse déchirées et sans cesse reprises, toutes pleines à la fois de désirs et de reproches. Bien des notations exactes, en plus, et qui font rêver. C’est là, évoquée, l’âme de l’Allemagne chantante et fleurie, comme dit l’auteur. C’est d’un joli contraste avec toutes les horreurs que nous lui devons actuellement. Mais l’Allemagne, tout de même, allez, est une grande nation.
À Paul Morisse
Fontenay-aux-Roses
le 6 novembre 1914
Mon Cher Morisse,
Il y aura demain samedi deux semaines que je suis rentré à Fontenay. Le retour a été parfait. Quelques heures de plus qu’en temps habituel. Mais elles ont passé vite. De gros soucis m’attendaient chez moi. Vous savez que l’opinion assez répandue était que la guerre durerait environ un trimestre. En serrant fort, et y compris l’allocation du Mercure, j’avais à peu près de quoi aller. Voilà le trimestre écoulé et on dit n’être qu’aux débuts de cette histoire. Je commence à ne pas savoir à quel saint me vouer ni comment je me tirerai d’affaire avec mes neuf chiens et mes vingt-sept chats. Je serais seul, à l’extrême rigueur, en mangeant, comme au temps de ma jeunesse, du pain et du fromage, je pourrais sans doute m’en tirer. Mais il faut à toutes ces bêtes, non seulement du pain (et les croûtes ont fort augmenté), mais également de la viande (l’essai que j’ai fait du riz m’a rendu toutes les bêtes malades). Cette viande, qu’on va chercher deux fois par semaine de grand matin aux Halles, représente, sans être prodiguée, une dépense quotidienne qui va de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 selon les cours. Ajoutez-y le prix des croûtes. J’atteins facilement trois francs par jour, rien que pour mes bêtes. Vous voyez si j’ai souci de m’inquiéter, ma réserve épuisée et n’ayant plus comme budget que les cinquante francs du Mercure. Emprunter ? Vendre ? Emprunter à qui ? Vendre quoi ? Je me fais la réponse moi-même. À la veille de mon départ de Pornic, j’avais écrit à Vallette à ce sujet. Arrivé à Fontenay, j’ai trouvé une lettre de lui me donnant un rendez-vous au Mercure. J’y suis allé. Il m’a parlé longtemps, mais quant au résultat : rien, ni maintenant ni plus tard. Il voit tout en noir. Le Mercure perdra cent mille francs153. Notre allocation annuelle (sur les bénéfices de l’année) concernant l’exercice à fin juin dernier, les fonds qui devaient la fournir le Mercure ne les a pas touchés. La première année de la reprise des affaires sera, selon lui, à peu près équivalente à zéro. Beaucoup de créances, belges, allemandes, ne pourront être recouvrées154. Enfin, rien, rien, rien. Débrouillez-vous comme vous pourrez.
Vous avez bien raison, et je suis absolument de votre avis, quant à ce que vous dites de Paris, en ce moment, et des conversations qu’on y entend. Je ne dirais encore trop rien de Paris. À s’y promener seul, sans rien dire à personne, cela va encore, bien que certains petits tableaux d’un patriotisme niais donnent vite envie de s’en aller. Mais les conversations ! Ah ! oui, il vaut mieux être chez soi, et seul, et plutôt ne rien savoir que de savoir ce que dit celui-ci, ce que dit celui-là, ce que dit un troisième encore. Je doute fort que quelqu’un excelle mieux que Vallette à vous flanquer par terre, et je le lui ai dit l’autre jour : « Il n’est pas drôle de venir vous voir. Vous avez une façon d’envisager et de présager les choses ! » Et les journaux, mon cher ami, que dites-vous des journaux, si vous en lisez ? J’en ai pris quelques-uns au Mercure. Ils ne se sont jamais montrés bien malins, mais en ce moment, quelle bêtise basse, servile, poltronne, menteuse ! Quels gaillards, tous ces gens qui écrivent des phrases à flafla, qui mentent, dénaturent et calomnient à qui mieux mieux. Vraiment, je crois que la guerre montre, poussées à leur perfection, la bêtise et la monstruosité humaines. L’Allemagne, parce qu’elle a déchaîné la guerre155, et sans doute cette guerre est odieuse, est devenue le dernier pays du monde et le plus bas. Tous ses soldats sont des sauvages, comme si nous n’avions pas aussi des brutes chez nous et comme si le bas peuple, ici ou ailleurs, ne se valait pas à peu près. Je lisais, l’autre jour, dans la Dépêche de Toulouse, un article sur je ne sais quel article de Maximilien Harden156. Il paraît que Harden a écrit : L’Allemagne doit vaincre parce qu’elle est la plus forte. « Le raisonnement est odieux », écrivait le journaliste de la Dépêche. Imbécile ! Mais non le raisonnement n’est pas odieux. C’est le résultat qui le serait, si l’Allemagne vainquait. Avec cela que si nous l’emportons ce ne sera pas parce que nous aurons été les plus forts ? Et ce qu’écrit Maurice Barrès, et ce qu’écrit Georges Lecomte, et ce malheureux Franc Nohain157, et ce très malheureux Hugues Le Roux158, et tous les autres. Ah ! certes, je veux bien être patriote, mais pas si être patriote veut dire être bête à ce point.
Que vous avez de la chance d’être seul, matériellement et moralement ! Je serais comme vous, je n’aurais pas bougé de Pornic, où j’aurais pu vivre à peu près avec nos fameux cinquante francs mensuels. Je me faisais peu à peu à cette vie isolée, silencieuse, sans rien autour de moi qui évoquât cette terrible et pitoyable affaire159. Mais il a fallu revenir.
Savez-vous quelque chose de Bernard ? Le patron s’étonne de ne pas avoir de ses nouvelles, alors qu’il serait tout bonnement à Vaugirard, au ravitaillement. Que peut bien cacher ce silence ?
Vous savez la blessure du gendre de Vallette, qui le prévoit devant rester infirme ?
J’ai lu qu’Alain-Fournier160 est prisonnier en Allemagne, et sans doute aussi André du Fresnois161. Pas de nouvelles d’Apollinaire ni de Billy. J’ai écrit à Billy il y a quelques jours, ainsi qu’à Pergaud, le sergent Pergaud, s’il vous plaît, qui montre dans sa correspondance au Mercure un entrain du diable, disant qu’il ne donnerait pas sa place pour tout au monde. Brave Pergaud ! En voilà un à qui la guerre fournira des sujets pour écrire. Nul dépaysement. Par contre, que de livres, publiés seulement un mois avant la déclaration, vont se trouver périmés, absolument ! Il y aura tout de même un changement (pas trop grand, espérons-le). Voyez-vous un livre de Madame Aurel après ces tueries, ces brutalités ? J’ai lu de bien mauvais vers — de circonstance — d’Émile Henriot, dans une dernière Revue Hebdomadaire162. Hirsch aussi, lui, s’est mis à la mesure des événements, et même le tout petit Machard163.
Mon frère est toujours debout, après s’être trouvé, à bien des reprises, dans des occasions dangereuses. À se battre sans arrêt depuis le 1er septembre. La santé moins bonne, cependant, les yeux, le ventre et les jambes un peu malades. Il m’écrit souvent. J’ai encore reçu de lui, hier, une lettre, datée du 30 octobre. Je le soigne de mon mieux : chocolat, tabac, vêtements. Mais que ces envois sont longs à parvenir ! Je crains fort les détournements en cours de route.
Je vis ici campé comme un réfugié, la maison presque vide, sans, feu, enfermé dans mon pardessus et le chapeau sur la tête, me promenant, lisant, soupirant, maugréant, ricanant, envoyant au diable toutes ces choses absurdes. Mais vous me connaissez bien.
Je vous souhaite d’avoir de la patience, vous aussi. À quoi passez-vous bien le temps, là-bas ? On a beau avoir plein la tête de choses pour se tenir compagnie, il y a des moments que cette vie agace un peu. Curieux aussi : quelle envie de vivre (sous tous les rapports) vous donnent tous ces événements ! Ne pensez-vous pas à ce : ah ! qu’on aura, quand ce sera fini et qu’on sera encore là, — si on y est ?
À vous cordialement.
À André Rouveyre
Fontenay-aux-Roses
dimanche 15 novembre 1914
Mon cher Rouveyre,
J’ai fait tous ces jours-ci des courses — sans résultat — pour tâcher de trouver une occupation quelconque. J’ai aussi en ce moment quelques animaux malades, d’où certains soucis supplémentaires. Tout cela m’a empêché de vous répondre plus tôt. Rien de bien neuf à vous dire, d’ailleurs. J’attends toujours, avec la même impatience, que cette odieuse guerre prenne fin. Le livre dont je vous ai parlé est Un Voyage, par Jacques Vontade164-165, (Madame Bulteau, je crois ?) édité chez Grasset, 61, rue des Saints-Pères. Qu’est-ce que vous pouvez bien faire de votre temps là-bas ? Quand j’aurai un moment, je tâcherai de vous écrire plus longuement. Je suis allé voir Gourmont. Rien d’intéressant. Je l’ai trouvé un peu vieilli166, en diable enrhumé du cerveau, engoncé dans sa robe de chambre, se mouchant à chaque instant dans un vrai mouchoir de paysan, déjà tout trempé.
Mes hommages à Madame Rouveyre et une vraie poignée de main pour vous.
À André Billy
Fontenay-aux-Roses
le 23 novembre 1914
Mon cher Billy,
J’ai su, comme vous, la mort d’Alain-Fournier, en même temps que celle de bien d’autres, dont le nom m’était connu, sinon la personne. J’ai fort bien connu Fournier. Je le voyais souvent au Mercure, du temps qu’il rédigeait une sorte de gazette littéraire à Paris-Journal. On ne le voyait plus depuis qu’il était secrétaire chez Claude-Casimir Perier. C’est l’horreur — une des horreurs — de la guerre, qu’on y voit tomber l’homme délicat, instruit, élevé, aussi bien que la brute. Du moins, Fournier, lui, y était parti, si j’en juge par une lettre qu’il écrivit alors à Péguy167, dans des sentiments guerriers. Je ne sais pas, mais cela me dispose à m’attendrir un peu moins sur lui. Quiconque a le goût de tuer, s’il est tué je ne vois pas bien de quoi il peut se plaindre168.
Vous voyez, mon bien cher ami, je n’ai pas acquis des sentiments nouveaux, appropriés aux circonstances. Ces histoires me font horreur, et la grandeur, je me le reproche quelquefois, m’en échappe. Là non plus, je ne crois pas, et mon manque de foi me fait me détourner169. Je ne pose pas, croyez-le bien, puisque, ce que je suis, je me reproche quelquefois de l’être, me disant que si tous étaient comme moi, le péril serait grand pour bien des choses. Mais qu’y faire ? En bien des choses j’ai poussé de singulière façon, et qui m’a joué bien des tours fâcheux pour moi. Croyez-moi, je ne m’aime pas toujours, tel que je suis. Certains déboires que j’ai derrière moi me font souvent regretter de n’être pas tout autre.
Je m’étonne de la vie que vous menez. C’était bien la peine de vous emmener là-bas. Cela dure pour vous depuis trois mois, bientôt. Vous devez bien vous amuser. Heureux encore que vous ayez le moyen et la possibilité de vivre à part, presque chez vous. Ce que je regarde comme le plus affreux dans ces histoires, c’est une certaine société. Vous m’objecterez qu’on est vite camarades, même qu’une fraternité s’établit. Merci. Cette camaraderie, cette fraternité obligées ne me font pas envie. Et pourtant, c’est peut-être un sort analogue au vôtre — moins la facilité de vivre un peu à part et d’avoir un chez moi — qui m’attend un de ces jours. Je dois en effet passer la visite des réformés et des exemptés (je suis l’un et l’autre). Mais quand ? Personne n’a trop l’air de le savoir. Je suis de la classe 1892. On paraît n’être encore allé que jusqu’à la classe 1910. Si, comme je crois pouvoir en juger, on procède par cinq classes, avec un temps d’arrêt entre chaque groupement, la classe 1892 peut être encore loin. Mais je dis cela sans certitude, tout, et cela aussi, étant probablement soumis aux événements. Il paraît qu’on prend beaucoup dans la révision des gens de l’armée auxiliaire. Pas loin de cinquante pour cent, presque. On prend, paraît-il, beaucoup moins dans les réformés et les exemptés. Il semble qu’on veuille, avec ceux d’entre eux qu’on prend, reformer l’armée auxiliaire. On ne sait que penser. On cite des cas de nouvelles réformes pour des motifs anodins, des cas de déclarations de bons malgré des infirmités réelles. Il en est de ces choses comme de toutes les autres : tout dépend de l’homme auquel on a affaire. Nous verrons.
J’ai toujours mes soucis. Je les ai même plus grands, ma réserve d’argent épuisée et tous mes moyens se trouvant réduits à l’allocation du Mercure. Je dure comme je peux. Je vis chez moi en pardessus, le chapeau sur la tête, gelant, grognant, ricanant, plein d’impatience et de sarcasmes. Quand nous fichera-t-on la paix, grands Dieux ! Cette guerre m’agace. Que de choses elle m’a déjà coûtées, que de mauvaises choses elle m’a déjà occasionnées, que de mécomptes, que de soucis, que de chagrins ! Je devais passer de si belles vacances ! Allez, moi aussi je suis bien atteint.
Au sujet de la littérature, je l’ai écrit dernièrement à Morisse : que de livres, publiés seulement un mois avant la guerre, vont se trouver périmés, vides, sans intérêt. Ce ne sera peut-être pas un mal ? Voyez-vous un livre de Madame Aurel, un livre de Cocteau170, etc., après ces tueries ? On aura sans doute un peu retrouvé le sens et le goût de la réalité. Il y aura quelque littérature patriotique, certes. Mais je crois qu’on s’en lassera vite. Ne vous semble-t-il pas que nous sachions déjà tout ce qu’on nous racontera là ? 1870 n’est pas si loin qu’on garde encore quelque fatigue de toutes les balivernes qu’il nous a values. Celles qui nous attendent n’auront pas grande durée. J’espère bien, par-dessus le marché, que la liberté d’écrire demeurera pleine et entière. La contrepartie sera possible. Je connais quelqu’un qui s’amusera quelquefois. Madame F… m’a dit que, dans cet ordre de choses, vous avez quelque souci pour votre livre171. Je le lui ai dit comme je le pense, comme je vous le dis aujourd’hui à vous-même : vous vous exagérez les choses. Ce sont les faiseurs de choses alambiquées, irréelles, maniérées jusqu’à l’artificiel et inventées de toutes pièces, ce sont ces gens-là qui seront atteints. Mais la vie restera toujours la vie, et les hommes toujours des hommes, et les sentiments vrais toujours des sentiments vrais, et ceux qui les peindront ne seront touchés, diminués en rien, surtout lorsque, comme vous, ils ont encore ce mérite de ne pas se perdre jamais dans de vains ornements puérils et encombrants. Peut-être même êtes-vous trop sec ? Nous en parlions un jour avec Morisse. Mais la sécheresse ? Il me semble qu’on pourrait dire qu’il en est d’elle pour la littérature comme pour le corps : elle conserve.
Je suis allé deux fois voir Madame F…-F…, un dimanche, et un mercredi. Mais à vous dire franc, je n’aime guère sortir. La société de trop de gens m’ennuie. Les conversations sur la guerre me lassent. Les journaux aussi me lassent par leur bêtise. J’aime autant être seul, ici, quitte à geler. J’ai plein de choses dans la tête pour me tenir compagnie. Quand j’écris, comme aujourd’hui, à un ami comme vous, ma journée est parfaite.
Allons, au revoir, mon cher Billy, au plus tôt que les événements le permettront. Prenez soin, un peu, des bons et pauvres chiens faméliques, aussi des chats si vous en voyez, prenez soin de vous-même, et croyez à mon amitié.
Merci de votre pensée pour mon frère. Il est toujours debout, intact, quoique en pleine action jour et nuit.
À Paul Morisse
Fontenay-aux-Roses
le 29 décembre 1914
Mon Cher Morisse,
En effet, Le Cardonnel172 m’a écrit, au sujet des vacances de L’Havas. J’ai fait ma demande, suivant les indications qu’il m’a données. La réponse m’est venue, dans la forme banale : pas de place en ce moment, nous prenons bonne note, etc., etc. Je souhaite que vous ayez meilleure chance, ce qui ne m’étonnerait pas étant données : Io votre connaissance de l’allemand, 2 votre complète libération militaire.
Mon amitié est enchantée de savoir Billy libéré et rentré. C’est vous qui m’en avez donné la première nouvelle.
Mon existence est toujours la même et je pense bien que Madame D… — la dame en question — me continuera son aide jusqu’au bout. Dans quel pétrin je serais sans elle ! Songez que c’est elle qui assume la corvée d’aller chaque semaine aux Halles pour les achats de viande pour les bêtes. Je me sens gêné, quelquefois, quand je songe à toute la peine qu’elle prend et au peu de moyens que j’aurai pour lui en savoir gré.
J’ai reçu hier une lettre bien curieuse d’Apollinaire. Je dis : curieuse, par un certain ton qui se dégage des mots. Que de choses il a l’air d’évoquer sans les dire : les misères, les pauvretés d’autrefois. Lui aussi n’a pas toujours dû être heureux. Est-ce assez curieux comme on donne sa sympathie aux gens, souvent bien avant qu’ils vous aient témoigné la leur : Billy, Apollinaire, Gros173. Je ne sais pas ce que vous pensez au juste d’Apollinaire. Mais, moi, je l’aime vraiment beaucoup.
Apollinaire est à Nîmes, 2e canonnier conducteur au 38e régiment d’artillerie de campagne, 70e batterie. Il est là-bas M. Guillaume de Kostrowitzky. Il dit qu’il n’est pas malheureux, que l’argent seul est rare. Exercice, pansage, astiquage, étude du 75, équitation, manœuvre, etc., il travaille sans arrêt, et le temps passe, sans qu’on pense, dit-il, beaucoup à la guerre. Il dit n’être pas mal dans son costume d’artilleur. Mais que diable a-t-il été faire là ? Il dit que des amis lui offraient l’hospitalité et l’entretien complet en Suisse pendant toute la durée de la guerre, mais qu’il aurait payé cette tranquillité momentanée par des remords. Il dit qu’il a passé à Nice174 quatre mois qui furent les délices de Capoue (en tout cela je vous reproduis ses propres mots), mais qu’il a bien fallu s’arracher à ce bonheur pour faire son devoir. Tout cela sonne curieusement pour moi. Je regrette bien d’être si pauvre. J’aurais avec plaisir envoyé quelque chose à Apollinaire.
Je comprends votre chagrin, mon cher Morisse, au sujet de votre femme. Vous vous reprochez certaines choses. Mon cher ami, qui n’a pas à s’en reprocher, de cette sorte ou d’autres ? On a de temps en temps une illusion qu’on suit, dont on retombe après. Elle a été du bonheur, quand même, si elle n’a pas toujours été le devoir. Mais sacrifier toujours le bonheur au devoir, ce doit être bien dur. Je ne vous ai jamais cru dénué de vie intérieure, bien au contraire. Je vous sais trop intelligent. C’est ce que je voulais vous dire quand, dans des lettres précédentes, vous m’avez d’une part rappelé quelques petites disputes que nous avons pu avoir, et, d’autre part, dit votre impatience de certaines conversations qu’on entend en société à Paris : quoi que nous ayons pu avoir et que vous ayez pu me dire, du moins êtes-vous de ces gens qui ne disent pas de bêtises (si vous dites quelquefois des choses qui me révoltent). C’est beaucoup.
J’avoue que je commence à croire que ce n’est pas très prochainement que nous nous retrouverons dans ce bureau que vous évoquez. D’après tout ce que j’entends dire, l’hiver va se passer sans événement, ou presque. On attendrait la fin de février pour des actions résolues. Comme ces actions résolues se heurteront probablement à des actions non moins résolues et que la besogne qu’on se propose — si tant est qu’on s’y tienne n’est pas mince, cela nous prépare encore un assez beau loisir. Je commence à craindre pour le Mercure et je me demande quelle y sera notre rentrée.
J’ai, comme toujours, assez fréquemment des nouvelles de mon frère. Le pauvre garçon n’a toujours pas écopé, mais il me dit être dans une bien mauvaise santé, au point de tomber plusieurs fois de suite quand il lui faut marcher. Quand on ne combat pas, il faut faire le terrassier, ou le bûcheron. Avec cela, comme nourriture principale, de l’alcool. Le curieux, c’est que son major lui a offert de le faire évacuer et qu’il a refusé. Je veux croire qu’il a de meilleures raisons que l’amour-propre.
Avez-vous lu, ces jours-ci, un nouveau récit de Barrès sur la mort de Péguy175 ? Je ne sais votre avis, mais je trouve cela nullement émouvant. Cela tient pour moi plutôt d’une sorte de délire, d’illumination, d’orgueil mystique — et bien inutile. C’est l’envie de mourir pour mourir. (Vous savez que je sens peu l’héroïsme.)
J’ai vu hier, sur le bureau de…, une lettre de… à …, qui est un bien joli petit tour de flatterie et d’intimité… par la signature : Votre petit…
Charles, le concierge, est parti. Il garde une voie à Gonesse. Quant à B…, la guerre n’a pas entamé son intelligence.
Vivez ces jours avec patience et croyez à mes meilleures cordialités.
1915-1916
À Guillaume Apollinaire
Fontenay-aux-Roses
le 1er janvier 1915
Mon cher Apollinaire,
J’ai bien reçu votre lettre, curieuse, surprenante, touchante. J’ai des soucis aujourd’hui. Je vous répondrai dans quelques jours.
Je vous adresse mes vœux, mon cher ami. Vous savez mon amitié pour vous, en effet. Plus d’une fois, tous ces derniers mois, je me suis demandé où vous pouviez bien être, et à quoi faire ?
Je vous serre bien affectueusement la main.
À Guillaume Apollinaire
Fontenay-aux-Roses
le 12 janvier 1915
Mon cher Apollinaire,
Si vous avez écrit à d’autres amis en même temps qu’à moi, vous devez savoir maintenant les petites nouvelles du Mercure. La maison est fermée — pour la rédaction — depuis le 31 août dernier, et Vallette a la décision formelle de ne reprendre le Mercure qu’à la fin complète de la guerre176. Morisse et moi nous avons donc été mis à pied, avec une allocation mensuelle de cinquante francs. De plus, pas moyen de trouver quoi que ce soit à faire d’autre. Vous voyez que la vie s’est compliquée pour nous aussi, pour moi surtout, avec toute la ménagerie dont je suis entouré. On vit, cependant, il le faut bien, on dure comme on peut. J’ai trouvé, pour moi, le mot qui résume mon existence actuelle : j’attends.
Votre lettre, comme je vous l’ai dit, a été une vraie surprise pour moi. Je ne vous aurais pas cru ces dispositions, ces sentiments. Il y avait encore des côtés de vous que je ne connaissais pas. Ou alors, quoi vous a changé ?… Moi, — je ne m’en félicite ni ne me le reproche, — rien de tout ce qui se passe depuis cinq mois passés ne m’a changé sur aucun point et si j’éprouve un sentiment, ce n’est que d’horreur et de dégoût.
Je suis néanmoins heureux de votre bon état d’esprit. Tant mieux, tant mieux ! Du moment qu’on y est, mieux vaut y être avec bonne humeur et acceptation que dans des dispositions d’esprit opposées. Je suis seulement chagrin de vous savoir privé sans doute de bien des choses. Je vous mets dans ma lettre un petit, tout petit, bien petit billet. Ne me remerciez pas. Je suis honteux de faire si peu, avec la vraie et grande amitié que j’ai pour vous. Dites-moi seulement, par un mot, si vous avez reçu, cela uniquement comme renseignement.
Je ne vous souhaite pas bon courage puisque vous l’avez. Je vous souhaite seulement bonne endurance, bonne chance, bonne attention et bonne prudence. Gardez-vous, si l’occasion le veut, en restant humain. Ces choses sont horribles, je n’ai que ce mot pour elles.
À vous bien affectueusement.
Qu’avez-vous fait de votre chatte177 ?
À Adolphe Paupe
Bibliothécaire du Stendhal-Club.
Paris le 8 octobre 1915
Cher Monsieur et ami,
Il n’y a nullement à me remercier de mon assistance au cortège de Gourmont178. C’est vous, au contraire, qui m’avez tenu compagnie. Nous ne nous voyons pas souvent. Cela nous a fait un moment à passer ensemble.
C’est moi qui vous remercie pour m’avoir envoyé une copie de votre dernière lettre de Gourmont. Elle a son intérêt. La maladie l’avait beaucoup changé physiquement. Elle l’avait aussi atteint un peu intellectuellement. La guerre lui a donné à son tour une secousse un peu forte, passagère, il est vrai, car depuis quelque temps il s’était repris. Mais, enfin, il y a eu une secousse, et ce sceptique, ce grand indifférent, ce contempteur, a eu une faiblesse. Elle est regrettable, grandement regrettable. Il a raté une belle occasion de mépriser179.
Avez-vous remarqué dans l’article de Pierre Louÿs, dans la France, le passage : « Le respect de la langue française, la haine de Dieu, le goût de la liberté, le regret de la femme, l’amour des livres, le mépris du monde180 » ! C’était bien là toute la personne morale de Gourmont. Il y a longtemps que j’ai pensé que la maladie qui l’a défiguré, étant encore jeune, a eu une grande influence sur son œuvre. Nos idées, nos goûts, nos façons d’être, nous viennent souvent du genre de vie que nous sommes plus ou moins obligés de subir.
Il y aura prochainement sur lui un article dans le Mercure181, un feuilleton dans le Temps182, et une étude dans la Revue des Deux Mondes183.
Mes hommages à Madame Paupe, et pour vous mes meilleures cordialités.
À Madame Rachilde
Paris le 22 novembre 1915
Chère Madame,
J’ai bien reçu votre lettre184, dans laquelle on vous reconnaît tout de suite, comme dans les moindres choses que vous écrivez. Excusez mon long retard à vous répondre. J’ai eu tous ces derniers temps beaucoup de travail au Mercure, et chez moi, depuis plusieurs semaines, je ne suis guère porté à écrire185.
Je vois que vous avez aussi votre ménagerie. C’est fort bien et je me doute si toutes ces bêtes doivent être heureuses avec vous. Moi, j’ai toujours les miennes, un peu augmentées, même. Un restaurateur de Robinson vient un jour me demander un chien. Je m’occupe de lui en trouver un. Je le trouve. Je vais chez lui pour lui en parler, le lui décrire, conclure, enfin. Je trouve dans sa cour un chien. Je m’informe. Celui-là devait être mené le lendemain à la Fourrière, parce que courant après les poules. Résultat : je n’ai pas fourni de chien et j’ai ramené chez moi l’amateur de poules. Trois ou quatre chats se sont aussi trouvés avoir besoin d’une maison. Ils l’ont eue. Ce qui porte actuellement mon personnel à dix chiens et vingt-huit chats, plus l’immuable chèvre. C’est tout un monde à aimer.
Mademoiselle Ch…186 n’est pas morte de la petite affaire de la rubrique rentrée. Il paraît qu’elle a des quantités de « filleuls187 » auxquels elle écrit, écrit ! … Elle a donc de quoi employer son talent. Elle aime infiniment la littérature et elle en met partout, et je pense même qu’elle devait en mettre jusque dans la seconde sérieuse de ses plus intimes plaisirs avec un de nos amis, quand il avait encore le bonheur de la cultiver. Ce n’est pas sans dessein que j’emploie ce mot : cultiver. On m’a rapporté — ce n’est pas l’intéressé — que lors de la rupture, elle lui écrivit pour le consoler et lui remontrer qu’après tout il n’était pas à plaindre, ayant joui du « joli jardin de sa chair ». Joli, si on veut, mais : jardin, quand on la connaît ?… Une plate-bande, tout au plus.
Je pense souvent au premier mardi188 après la guerre. Ce sera drôle à voir.
Avec mes hommages bien cordiaux.
À Monsieur Robert Foulon
Paris le 24 novembre 1915
Monsieur,
Je veux au moins vous remercier pour la peine que vous avez prise de m’écrire. Cela fait toujours plaisir de recevoir l’appréciation d’un lecteur, même si elle est défavorable, et encore plus quand elle est favorable. Cela montre qu’on a au moins un lecteur, ce dont on n’est jamais très sûr. Je ne mérite pas très complètement les compliments que vous voulez bien me faire, Monsieur, car le peu que j’écris j’ai grand plaisir à l’écrire, et je ne conçois pas d’ailleurs qu’on écrive autrement, et ce plaisir me paie déjà de mes modestes travaux. Il y a toutefois dans votre lettre une appréciation fort exacte et c’est à cause d’elle que j’ai voulu vous répondre. C’est quand vous écrivez que je parais ronger mon frein. Je le ronge, en effet, et non, à certains moments, sans une certaine impatience. La raison, comme le sentiment de la justice et de l’humanité, vont en ce moment-ci un train pitoyable, et si la guerre met en valeur beaucoup de cruauté, elle monte aussi à un degré vraiment excessif une certaine bêtise. Vous parlez de l’intelligence. Hélas ! à écrire ce mot on risque en ce moment de paraître parler en fat. N’importe, parlons-en comme vous le faites. Plus on vieillit, plus on se rend compte qu’elle seule compte et vaut la peine qu’on vive. Espérons qu’elle sera notre salut et qu’elle redeviendra notre sauvegarde. On m’assure que l’état d’esprit des gens qui sont aux armées n’est pas du tout l’état d’esprit des héros de nos journaux. Si cela est vrai, rien n’est perdu et nous aurons de quoi rire, ne rongeant plus notre frein, quand cette affreuse histoire sera terminée.
Je vous souhaite, de mon côté, si vous le permettez, de la patience dans votre exil provincial, de la bonne chance s’il y a lieu, et je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments de sympathie.
Maurice Boissard
À Madame Stuart Merrill189
Paris le 15 décembre 1915
Madame,
Cela a été pour moi une bien grande surprise et un vrai chagrin de recevoir samedi dernier le faire-part de la mort de votre mari. J’étais absent de Paris quand elle est survenue, et on ne m’en avait rien dit au Mercure quand je suis rentré le vendredi 10. Je n’ai pas beaucoup connu Stuart Merrill. Depuis une vingtaine d’années je le voyais seulement de temps en temps au Mercure. Mais il y a longtemps que je savais, pour l’entendre dire de tous côtés, quel homme charmant, quel ami parfait, quel caractère généreux il était. J’ai du reste été à même de l’apprécier. Peut-être avez-vous été au courant de l’obligeance qu’il eut à mon égard, voilà un an, à propos de toute ma ménagerie. Je dis : peut-être, car il était bien capable de rendre un service sans en rien dire même à vous-même, tant il était discret sur ce point. Plus que cette obligeance, la façon, les termes dans lesquels il l’eut m’ont touché beaucoup. J’ai pensé à cela, Madame, en lisant l’autre matin le faire-part de sa mort, et c’est dans ce sentiment de profond regret que je vous prie d’agréer mes plus sincères condoléances et mes hommages très respectueux.
1916 et 1918
À Guillaume Apollinaire
Paris le 15 février 1916
Mon cher Apollinaire,
J’ai passé votre lettre au patron pour qu’il vous réponde sur la question des souscriptions en vue de l’édition d’un volume de vers. J’attendais qu’il me la rende pour vous répondre en ce qui me concerne. Comme il tarde, je n’attends plus.
Vous avouerez, mon cher Apollinaire, que le détail que vous avez tenu à éclaircir n’avait aucune importance. Au moins pour moi. Vous dites que votre embarras sur cette question, devant mon air caustique, a dû vous donner à mes yeux l’air d’un embusqué. Qu’êtes-vous allé chercher là ? Le diable si j’ai pensé à cela. Et quand vous seriez un embusqué, croyez-vous que vous perdriez à mes yeux ? Pas du tout. Au contraire, j’en serais très heureux, car je trouverais là une plus grande certitude de vous revoir. Cela seul a du prix pour moi : vous revoir. Savez-vous que je pense déjà à ce dîner que j’espère bien que nous ferons ensemble, vous, Billy, Montfort et moi, quand cette affreuse histoire sera finie. Je reverrai Cros aussi. Il manquera, hélas ! j’en ai bien peur, le pauvre du Fresnois, tombé quelque part obscurément, « disparu » comme on dit, lui qui me plaisait tant aussi…
Quittez donc vos grands airs mécontents, mon cher Apollinaire. N’oubliez pas l’amitié que je vous porte. C’est un objet de peu de prix et qui ne peut guère être utile. Elle est en tout cas sincère et grande et fidèle.
Toujours bon courage, et patience, et prudence, et meilleure humeur possible.
À André Rouveyre
Paris le 11 novembre 1918
Mon cher Rouveyre,
Le pauvre Apollinaire est mort, avant-hier samedi, à six heures du soir. Je l’aimais tendrement, comme homme et comme écrivain. Je suis plein de chagrin. Vous aussi vous allez avoir une grande peine.
Amitiés.
Notes
1 Les quinze portraits, dans l’ordre de publication dans Les Nouvelles littéraires (décembre 1927 à mai 1928) sont ceux d’Alfred Vallette, Maurice Barrès, Willy, Jules Renard, Jean Lorrain, Albert Samain, Paul Verlaine, Jean de Tinan, Laurent Tailhade, Léon Bloy, Remy de Gourmont, Paul Léautaud. À cette liste, les éditions en volume ajouteront Jean Moréas, Louis Dumur et Léon Delafosse.
2 Commerce, cahiers littéraires trimestriels, revue fondée en 1924 par Marguerite Caetani. Paul Valéry, Léon-Paul Fargue et Valery Larbaud sont directeurs de la publication. Cette revue paraîtra sur vingt-neuf numéros entre 1924 et 1932. Voir Ève Rabaté : La Revue Commerce. L’esprit « classique moderne » (1924-1932), classiques Garnier 2012.
3 La NRF de décembre 1928, pages 760-768 :

4 Paul Claudel publie aussi dans Commerce, comme dans le numéro de ce printemps, « Conversation dans le Loir-et-Cher » et à l’automne « Le Livre de Christophe Colomb ».
5 L’américaine Marguerite Chapin (1880-1963), a épousé en France en 1911 l’Italien Roffredo Caetani, prince de Bassiano (1871-1961), compositeur, collectionneur d’art et mécène. Marguerite Caetani est éditrice, journaliste, critique littéraire, collectionneuse d’art. Elle a fondé la revue Commerce en 1924 mais en 1932 la revue cessera de paraître et le couple retournera s’installer en Italie.
6 Cette « Revue mensuelle illustrée de l’esprit contemporain », fondée par Paul-Gustave Van Hecke, a été aussi brillante qu’éphémère et n’a duré que vingt-cinq numéros répartis sur deux années, de mai 1928 à avril 1930. À ces vingt-cinq numéros a été ajouté, en juin, un numéro hors-série et hors-commerce.
7 Germaine Dauptain (1885-1976) a épousé Paul Pascal dont elle divorcera pour épouser Jean Paulhan en décembre 1933.
8 Les numéros de Commerce étaient datés des saisons.
9 Absolument pas. Peut-être son père.
10 Le s est ici fautif, les huissiers n’ayant qu’une verge, signe de leur charge. La verge en question est une « baguette, ornée d’ivoire ou d’argent à chaque extrémité, portée autrefois par les huissiers, les sergents. » (TLFi). Les huissiers devaient toucher la personne à qui était signifié l’« exploit ». Le site Web des huissiers de justice indique « On pouvait les reconnaître à leurs manteaux rayés et à leur “verge” […] Une ordonnance datée de 1425 précisait qu’ils devaient être mariés, tonsurés et porter continuellement leur costume rayé. L’huissier était un des symboles de l’autorité royale mais c’était la verge qui était la principale caractéristique de l’autorité de l’huissier. Il s’agissait d’une sorte de petite baguette ronde, en ébène, longue d’une trentaine de centimètres garnie de cuivre ou d’ivoire. » L’expression venue spontanément à l’esprit de PL lui vient évidemment (le nom de Loyal) du Tartufe (acte V, scène IV) : « Je m’appelle Loyal, natif de Normandie, / Et suis huissier à verge, en dépit de l’envie ». La distribution des personnages de la pièce indique « Monsieur Loyal, sergent. »
11 Saint-John Perse (Alexis Leger, 1887-1975), poète, écrivain et diplomate, lauréat du prix Nobel de littérature. La confusion de PL vient du fait que Saint-John Perse a utilisé d’autres pseudonymes, tels que Saint Leger Leger, ou Saintleger Leger. Son nom de Saint-John Perse est devenu définitif à partir de 1924. Leger, qui ne porte pas d’accent, se prononce Leuger.
12 Par le mot midi, après midi devrait être naturellement masculin, comme matin, jour ou soir. Les dictionnaires sont néanmoins tolérants au féminin, le plus souvent employé par Paul Léautaud.
13 Cet ouvrage sera achevé d’imprimer le 25 décembre 1929. Paul Léautaud en trouvera un exemplaire sur son bureau le 28 décembre.
14 En effet. Dans le Journal des débats du 28 juin 1944, évoquant ce portrait, Gaëtan Sanvoisin parlera d’un portrait de femme.
15 Romancier et dramaturge, dreyfusard farouche, l’avocat Georges Lecomte (1867-1958) a été directeur de l’école Estienne (imprimerie) et journaliste, président de la société des Gens de lettres en 1908 puis réélu en 1913. En 1924, Georges Lecomte a été élu (difficilement) à l’Académie française puis secrétaire perpétuel en 1946, malgré son soutien au Gouvernement de Vichy.
16 Henriette Charasson (1884-1972), poète et auteur dramatique d’inspiration catholique, a secondé Rachilde dans la chronique des « Romans » à partir de 1914 et sera en charge des questions religieuses de 1936 à mai 1940.
17 Ce n’est pas du tout ça de nos jours. Une lettre, comme toute œuvre originale est régie par le droit d’auteur et appartient donc à son auteur en pleine propriété. Le destinataire est propriétaire de la feuille de papier et de l’encre qui la recouvre, mais pas du texte. La loi de l’époque était celle de juillet 1881 sur la presse.
18 Les Nouvelles littéraires, avant-dernière page, dernière colonne, dans la catégorie « Ouvrages de luxe et tirages limités »
19 Alfred Vallette.
20 Cette imprimerie a été en activité de 1911 à 1957, d’abord au 18, rue de Diane à Argenteuil puis, en 1945 aux 203-205 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, sous la direction de Robert Coulouma (1887-1976).
21 Ce texte est aussi reproduit dans la page sur Marie Laurencin.
22 Valery Larbaud (1881-1957), poète et romancier. Fils du propriétaire d’une source d’eau de Vichy, fils unique né sur le tard, Valery Larbaud a pu se consacrer à son art sans connaître les soucis habituels des jeunes hommes de lettres. Valery Larbaud est surtout connu pour son roman Fermina Márquez (Fasquelle 1911), présenté sans succès au prix Goncourt.
23 Cette rencontre n’a pas été notée dans le Journal littéraire.
24 Suzanne Moreau (1905-1976), qui sera adoptée en 1954 par Marie Laurencin, qui en fera son héritière.
25 Corrigé de « Roserberg » dans l’édition papier. Vraisemblablement Paul Rosenberg (1881-1959), galeriste au 21, rue La Boétie depuis 1911.
26 Mercure du premier juillet 1927.
27 Ce portrait est un peu éthéré comme ceux que réalise Marie Laurencin. Il y a quelque chose de Cocteau, à la même époque.
28 Fait noté le 15 février 1914.
29 L’œuvre de René Boylesve (René Tardiveau, 1867-1926) est souvent inspirée par ses souvenirs d’enfance ou de voyage ou, parfois, de l’histoire de la Touraine. Il sera académicien français en 1918. Son nom a été le premier cité par Paul Valéry lors de son discours de remerciement à l’Académie française, le 23 juin 1927, six mois après sa mort. Voir Les Nouvelles littéraires du 26 janvier 1926. Éditions de la revue blanche, 23 boulevard des Italiens, 1902, 303 pages. La Leçon d’amour dans un parc, éditions de la Revue blanche, 23 boulevard des Italiens, 1902, 303 pages sera suivi des Nouvelles leçons d’amour dans un Parc, éditions du Livre, 1924, 204 pages.
30 Mémoires de Goldoni « pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son théâtre », Baudouin 1822 (et Mercure 2003). Paul Léautaud a rencontré Benjamin Crémieux au Vieux Colombier à l’occasion de la représentation de deux pièces de Goldoni, qui n’ont pourtant pas été chroniquées dans Les Nouvelles littéraires.
31 Il s’agit de la lettre datée du 29 décembre 1914, page 104.
32 Ces exemplaires « de passe » servent au réglage des machines. Ils ne sont évidemment pas déclarés dans le nombre du tirage, ne comptent pas pour la rémunération de l’auteur… mais sont souvent vendus.
33 C’est impossible, le stendhalien Adolphe Paupe étant mort en 1917. Journal particulier au 22 février 1917 : « Appris tantôt, par un faire-part reçu par Vallette, la mort de Paupe, qu’on enterre demain. »
34 Paul Morisse (1866-1946) a partagé le bureau de Paul, de janvier 1908 à 1911.
35 Valère Bachmann (1892-1940, mort au combat), fils de Jacques Bachmann et d’Antoinette Mornay (1867-1962).
36 Amedeo Modigliani (1884-1920) est arrivé à Paris en 1906 où il s’est rapidement lié à Maurice Utrillo et à Max Jacob. Un mode de vie particulièrement désastreux l’a conduit à la mort à l’âge de trente-cinq ans.
37 Il s’agit d’une période militaire.
38 Il s’agit ici, non pas d’André Lebey (1877-1938), auteur de L’Âge où l’on s’ennuie mais d’Édouard Lebey, son oncle. De 1900 à 1922 Paul Valéry fut secrétaire particulier d’Édouard Lebey (1849-1922), directeur de l’Agence Havas entre 1879 et 1900 et atteint d’une maladie neurodégénérative. Pendant ses absences, voulues ou forcées, Paul Valéry se faisait remplacer par Paul Léautaud auprès d’Édouard Lebey. Ainsi qu’en témoigne la correspondance de Paul Valéry, Édouard Lebey et lui se tutoyaient.
39 Depuis mars 1895, Paul Léautaud travaillait pour l’étude d’avoué Barberon, 17 quai Voltaire. Léon Barberon, né en 1843, est mort le seize janvier dernier.
40 Du Palais de justice.
41 Le Petit Ami.
42 Boule.
43 D’origine paysanne pauvre, Thérèse Daurignac, née en 1855, parvient, en 1878, à épouser Frédéric Humbert, fils du maire de Toulouse. En 1879, elle prétend avoir reçu une partie de l’héritage de Robert Henry Crawford, millionnaire américain. Dès lors, les Humbert obtiennent d’énormes prêts en utilisant le supposé héritage comme garantie. Cette escroquerie dure une vingtaine d’années jusqu’à ce qu’un juge fasse ouvrir le coffre-fort où sont censés se trouver les documents prouvant l’héritage. Le coffre ne contient qu’une brique et une pièce d’un penny. Les Humbert fuient en Espagne où ils sont arrêtés en décembre 1902. Les deux époux sont condamnés à cinq ans de travaux forcés.
44 Cette affaire de la rente viagère est en lien avec l’affaire Humbert.
45 « Au même » dans l’édition originale. Le choix a été de redonner ici le nom des destinataires.
46 La plupart du temps les lettres reçues par Paul n’ont pas été conservées.
47 Le Petit ami, encore, paru en feuilleton dans les numéros du Mercure de septembre, octobre et novembre. Ce sept octobre Paul Valéry n’a donc pas connaissance de la troisième partie.
48 Fin du premier paragraphe, qui fait presque toute la page : « J’ai même acquis tant d’habileté que j’ai l’air d’un miché qui ne veut pas marcher. » Cette phrase sera conservée. Le lecteur du XXIe siècle la trouvera aussi page 112 de l’édition imprimée le 10 décembre 1997 pour le Mercure de France mais aussi vendue sous la couverture de l’Imaginaire Gallimard.

49 Madame Leroux était surnommée Loulou. On ne la confondra pas avec Hélène Leroux.
50 Jeanne Allery, amie de Blanche Blanc, est dépeinte, dans Le Petit Ami sous le nom de La Perruche. Elle n’est pas si morte que ça puisque Paul lui écrira le seize février 1903.
51 Paul Léautaud avait choisi Souvenirs légers. Alfred Vallette imposa le sien.
52 Cette page 183 du Mercure commence par « Elle riait, d’un rire gamin et délicieux » et se termine par « Y avait-il en elle ce même dédoublement de tendresse qu’en moi, ce ». Elle correspond à la page 157 de l’édition citée note 48. Selon une note d’André Rouveyre qui reproduit également cette lettre (Choix de pages de Paul Léautaud, éditions du Bélier 1946, page 260).
53 Ce passage est terriblement dérangeant : « Et puis, elle m’avait vu si peu enfant. Je ne devais guère être pour elle qu’un homme, et un jeune homme encore ! Et comme, tout de même, j’étais son fils, je pouvais peut-être ne pas lui déplaire ?… Jusqu’à quels détails intimes de sa personne mes pensées allaient… Oui, tout son corps… Et elle que pensait-elle, là, en me regardant ?… Y avait-il en elle ce même dédoublement de tendresse qu’en moi, ce même trouble voluptueux de choses familiales et d’idées amoureuses ? »
54 Née Fanny Grassi à Trieste (1834-1927). Son père était diplomate, consul d’Italie à Sète. En 1861, Fanny avait épousé Barthélémy Valéry, son aîné de neuf ans, né à Bastia (1825-1887), vérificateur des douanes à Bastia puis à Sète.
55 Née Jeannie Gobillard (1877-1970), épousée le 31 mai 1900, qui donnera trois enfants à son mari. Jeannie est l’aînée de Paule (1867-1946), peintre, nièce de Berthe Morisot dont elle sera un des modèles. Paule loge chez elle, rue de Villejust, avec sa sœur et son beau-frère.
56 À la toute fin du chapitre six, correspondant à la fin du texte paru dans le Mercure d’octobre 1902 (page 193) : « Je passai sur le pont de bois où, avant qu’il fût marié, j’allais, presque chaque dimanche, m’asseoir et bavarder avec Valéry. » Le vieux pont de bois en question peut être la passerelle de l’Estacade, détruite en 1932.

L’estacade, par Charles Huard pour Paris vieux et neuf, sur un texte d’André Billy, Chez Eugène Rey, 1909
57 Cette lettre est absente de la Correspondance générale. Paul répond à une lettre de Rachilde, elle aussi absente de la Correspondance., que voici : « 16 février 1903 / Je vous écris ce que j’aurais dû vous dire si je vous avais revu après lecture de votre livre. Y a pas ! C’est épatant ! Et je suis bien certaine que dans cinquante ans votre livre aura pris la place de Manon Lescaut… avec quoi on nous remet en mémoire souvent, trop souvent, que l’émotion et la simple vie sont encore les seuls moyens de véhiculer de la littérature après plusieurs siècles de pente… Si quelques grands critiques voulaient se donner la peine de lire… vous auriez un beau concert ! Seulement, il n’y a plus que votre serviteur qui lise ! »
58 « intention » rajouté arbitrairement à la place d’un blanc dans l’édition papier. Note de Paul Léautaud dans l’édition Mornay : « Mot sauté dans le double de cette lettre. » Comprendre ici que Paul ne s’est pas souvenu, en 1929, date de l’édition Mornay, du mot manquant à sa lettre de 1903.
59 Henri de Régnier est le dédicataire du Petit Ami. Lire les « Lettres à Henri de Régnier 1901-1904 »
60 Rachilde a rendu compte du Petit ami en ouverture de sa rubrique dans le Mercure de mars 1903, pages 731-734.
61 Cette phrase est restée célèbre. Firmin Léautaud mourra dans trois jours, le 26 février 1903.
62 En 1903, l’hebdomadaire d’Arthur Bles The Weekly critical review, 336 rue Saint-Honoré où écrivait parfois Jules Claretie, Remy de Gourmont, Louis Dumur et d’autres, avait entrepris une enquête sur le roman contemporain. Bien entendu les auteurs des Poètes d’aujourd’hui avaient été sollicités. Cette revue paraissait à Paris en anglais et en français.
63 Note supprimée.
64 Maurice Barrès (1862-1923), écrivain et homme politique, figure de proue du nationalisme français. Maître à penser de sa génération et de ce courant d’idées, sa première œuvre est un triptyque paru sous le titre général du Culte du Moi chez Alphonse Lemerre (Sous l’œil des Barbares, 1888, Un homme libre, 1889, et Le Jardin de Bérénice, 1891), tous trois lus et admirés, un temps, par Paul Léautaud.
65 Note de Paul Léautaud : « 1. La Weekly Review le comprenait au nombre de ses collaborateurs alors qu’il était mort. »
66 Ce pseudonyme a été créé par Paul Léautaud alors qu’il travaillait à l’étude Lemarquis de la rue Louis Le Grand. Voir Souvenirs de basoche : « Prenant un nom d’emprunt, un bien joli nom, qui pas une fois ne mit aucun d’eux en défiance : M. Pierre Dupont Alexandre (j’avais donné les instructions nécessaires à ma concierge), j’écrivis à un certain nombre de créanciers »…
67 Corrigé de Lounsberry, graphie la plus souvent rencontrée dans la correspondance de Paul Léautaud. Le nom de cette demoiselle n’apparaît jamais dans le Journal mais quatre fois dans les lettres de Paul Léautaud à Marcel Schwob disponibles : ce 15 février 1904 et le 25 février. Le trois mars, c’est Paul qui écrira à cette personne et elle sera encore citée dans une lettre le 17 mars. La lecture de ces lettres fait apparaître une affaire importante autant que secrète.
68 Clara Cadiot (1886-1934), bien oubliée de nos jours, est née en Angleterre de parents français s’étant rencontrés à Londres. Claire traduit Pierre Loti en anglais et se lance dans le journalisme, publiant autant dans des journaux français qu’anglais. Peut-être a-t-elle épousé un de Pratz mais peut-être s’agit-il d’un pseudonyme. Claire devient ensuite professeur d’anglais dans des lycées parisiens, avant de devenir romancière, produisant les ouvrages féministes à la mode de ce temps. On retiendra, après un retour à Londres, The education of Jacqueline, Mills and Boon, Londres 1910. Claire de Pratz n’apparaît pas dans le Journal de Paul Léautaud ni dans aucune autre lettre disponible.
69 Note de Paul Léautaud : « Je n’ai recommencé que vingt-cinq ans plus tard. » Avec Passe-Temps.
70 Paul-Arthur Chéramy (1840-1912), homme de lettres et bibliophile, avoué près le tribunal civil de la Seine. A été président de la Chambre des avoués de la Seine. Ses initiales « P. A. », le plus souvent rencontrées proviennent de Paul Arthur.
71 « Échos » du Mercure du premier décembre 1904, page 855.
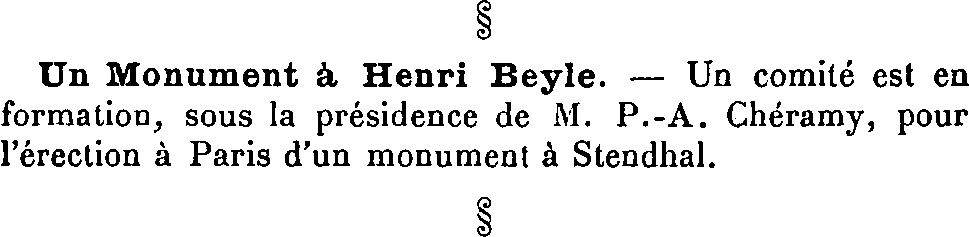
72 Dans ses entretiens avec Robert Mallet, Paul Léautaud dira, à propos de son enfance : « Et puis, j’allais jouer aussi place Saint-Georges. Il n’y avait pas encore la statue de Gavarni, mais un bassin où je m’amusais avec un petit bateau. » Cette fontaine et son bassin servaient, depuis 1824, à abreuver les chevaux.
73 Gavarni (Sulpice-Guillaume Chevallier, 1804-1866), caricaturiste. Avec son contemporains Honoré Daumier (1808-1879) il a été l’un des plus importants dessinateurs de presse de son temps.
74 Paul Blondeau est un lecteur de L’Ermitage, et de Paul Léautaud. Journal littéraire au 27 mars 1906 : « Été à l’Ermitage. Trouvé une lettre d’un M. P. Blondeau, 6, rue de Hanovre […].
75 Corrigé de Hanôvre.
76 Charles Chincholle (1843-1902), journaliste et écrivain, fut le secrétaire des dernières années d’Alexandre Dumas avant d’entrer au Figaro en 1872, signant parfois ses articles Henri Hamoise.
77 Aurélien Scholl (1833-1902), journaliste, directeur du Voltaire à sa création en juillet 1878. Il a passé quatre années au Figaro mais avant C. Chincholle. Aurélien Scholl est aussi auteur dramatique et romancier. Dans le Journal au 22 août 1936, Paul Léautaud s’amusera, avec un certain dédain à citer ces vers de Paul-Jean Toulet (1867-1920) : « Cependant, au café, les jeunes chroniqueurs, / Soucieux de toucher à la caisse, et nos cœurs, / Composent Scholl avec Chincholle[…] »
78 Henry Monnier (1799-1877), caricaturiste et illustrateur, puis auteur dramatique. La rue Henry-Monnier a pris son nom en juin 1905.
79 On peut se demander pourquoi : Bréda était un propriétaire qui avait reçu de la ville de Paris à la fin des années 1820 l’autorisation de transformer à ses frais un chemin en deux rues et une place, l’une des rues et la place pouvant porter son nom, l’autre rue devenant la rue Clauzel.
80 Contrairement à ce que l’on pourrait penser la rue de Hanovre ne se trouve pas dans le quartier de l’Europe mais, proche de l’Opéra et parallèlement à la rue du Quatre-Septembre, cette petite rue calme relie la rue de Choiseul à la rue de la Michodière. Journal littéraire au 25 octobre 1907 : « J’ai quelquefois par-dessus la tête de la rive gauche. J’y pensais hier soir en allant au Vaudeville. Habiter rue Richelieu, ou une de ces rues : du Helder, de Hanovre, de Grammont, de Choiseul, etc… […] Ce serait très agréable. »
81 Cette galerie, délimitée par deux doubles lignes de colonnes, se trouvait entre la cour d’honneur et le jardin. Elle était recouverte d’une verrière. L’endroit ressemblait assez à ces galeries couvertes qui subsistent encore aujourd’hui à Paris. On y trouvait également la libraire de l’éditeur Édouard Dentu.
82 Peut-être auprès d’Édouard Lebey, déjà évoqué note 38.
83 Stendhal.
84 Adolphe Paupe et Paul-Arthur Chéramy, Correspondance de Stendhal (1800-1842), trois volumes agrémentés d’une préface de Maurice Barrès, chez Charles Bose, 1908.
85 Lucien Gougy (1863-1931), libraire, 5 quai Conti. Journal au quinze avril 1930 : « Je découpe aujourd’hui dans un journal, pour la garder ici, une photographie de la vieille maison où se trouve la librairie de Gougy, sur le quai, presque face au Pont-Neuf, qu’on est en train de mettre à bas. Elle aura fait partie du cadre d’une grande partie de ma vie. »
86 Note de Paul Léautaud : « Ce projet d’édition chez le libraire Gougy ne se réalisa pas. C’est chez l’éditeur Bosse que la Correspondance parut. »
87 Romain Colomb (non nommé), Correspondance inédite, « précédée d’une introduction par Prosper Mérimée, ornée d’un beau portrait de Stendhal » 272 lettres, Michel Lévy 1855, deux volumes. Cette Correspondance a été éditée dans le cadre des Œuvres posthumes.
88 Olof Johan Södermark (1790-1848), peintre suédois, a réalisé ce portrait de Stendhal en 1840, qui ne sera détrôné dans le goût de Paul que le 18 février 1938 par celui d’Henri Lehmann. Ce portrait est aussi celui donné dans l’édition de Michel Lévy.
89 Stendhal, Vie de Henri Brulard « publiée par Casimir Stryienski », Charpentier 1890, 327 pages.
90 Note de Paul Léautaud : « Il s’agit de Remy de Gourmont et de son roman Un Cœur virginal, qui paraissait dans le Mercure. » Numéros du quinze décembre 1906 au premier février 1907. Le roman paraîtra en volume au Mercure, au printemps 1907 (voir la lettre suivante).
91 Vraisemblablement dans la lettre d’Adolphe Paupe dont nous n’avons pas connaissance. Adolphe Paupe a écrit cinq textes dans le Mercure, évidemment tous sur Stendhal, entre 1906 et 1910.
92 Dans L’Ermitage du quinze mai 1906 est paru, page 129, une « Chronique Stendhalienne » « par M. Coffe », en réalité rédigée par Remy de Gourmont. Adolphe Paupe n’ayant pas été informé de la supercherie, a vivement critiqué ce texte.

93 Adolphe Paupe travaillait dans une compagnie d’assurances.
94 Non, In Memoriam et Amours réunis dans le même volume ne sont parus qu’accompagnés du Petit ami qu’en décembre 1956, après la mort de Paul Léautaud.
95 Tous ces titres, parfaitement fantaisistes, sont des inventions, comme ceux-ci-après.
96 À partir de ce premier janvier 1908, Paul Léautaud est officiellement salarié du Mercure de France.
97 Du Charivari, J.-P. Béchu et M. Mélot pourront écrire qu’il a été « le premier quotidien illustré satirique du monde » (La Belle Époque et son envers : quand la caricature écrit l’histoire, A. Sauret, 1980). Le Charivari parut de fin 1832 à 1937. On doit à Charles Philippon, son créateur, la caricature de Louis-Philippe en forme de poire, ce qui lui vaudra un procès mais aussi la notoriété.
98 Lady Morgan n’apparaît qu’une seule fois dans la Vie de Henry Brulard (ici note 89) :
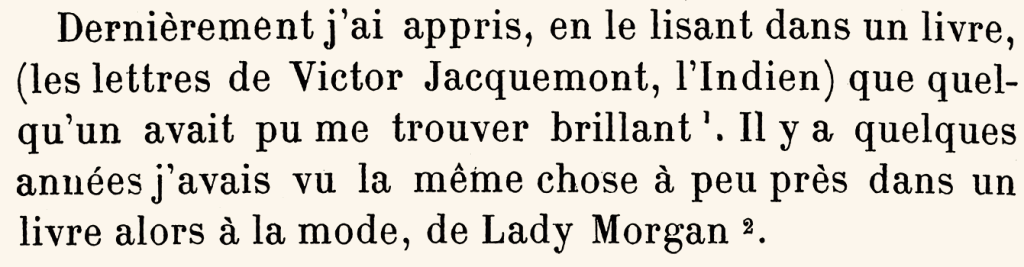
Fragment de la page seize de Vie de Henry Brulard dans l’édition Charpentier de 1890
La note 1 renvoie à la page 34 du premier volume de la Correspondance de Victor Jacquemont. Cette Correspondance cite trois fois le nom de Stendal sans jamais le trouver « brillant » mais au contraire lui attribue « une infirmité pour les arts » (page 41). Référence : Correspondance de Victor Jacquemont « avec sa famille et ses amis pendant son voyage dans l’Inde » (1828-1832) éditée chez Fournier en 1833, page 33 »
Pour approfondir : Victor Jacquemont (1801-1832), naturaliste et explorateur, est mort à 31 ans à Bombay, d’où le surnom de « l’Indien » donné par Stendhal. Une rue porte son nom à Paris. Lady Morgan, née Sydney Owenson (1776-1859), romancière irlandaise. Le « livre à la mode » de Sydney Morgan est peut-être The Wild Irish Girl, paru à Londres en 1806 et à Paris sous le titre La Sauvageonne Irlandaise.
99 Une lettre identique a été adressée à Henriot (père ou fils ?), auteur de l’article du Charivari.
100 Le problème est qu’il y a deux Cordier (sans lien de parenté) spécialistes de Stendhal (lire le récit de l’explication de ce point par Adolphe Paupe le 18 mars 1906). Le premier Cordier, si l’on peut dire, est Henri (1849-1925), qui a connu Stendhal et est l’auteur notamment de Stendhal et ses amis : notes d’un curieux (1890) et de Molière jugé par Stendhal (1898). Le « second » est Auguste Cordier (1834 ?- ?), auteur de Stendhal raconté par ses amis et ses amies, Laisney 1893 et Comment a vécu Stendhal, avec une préface de Casimir Stryiensky, chez Villerelle 1900.
101 Virginie Chardon (1792-1875), femme de lettres et peintre, a épousé en 1818 le vaudevilliste Jacques-François Ancelot (1794-1854). On lui doit entre autres, Un salon de Paris de 1824 à 1864, paru chez Édouard Dentu en 1866 (393 pages). Voir d’Henri Matineau, « Stendhal et le salon de Madame Ancelot », Le Divan, Études Stendhaliennes, 1932.
102 Long article (plus de deux colonnes) de Jean Carrère « Saint-Simon annoté par Stendhal », dans Le Temps du douze février 1908.
103 Face au détriment de ce pauvre Adolphe Paupe, dont Paul Léautaud adorait se moquer : « Autorisation de publier en feuilleton dans Le Charivari toutes les lettres que j’ai de lui et que je ferais précéder d’une petite étude biographique… » voir le Journal à cette même date du cinq février.
104 Bien que Marie Dormoy, dans la Correspondance générale indique « Émile Henriot » comme destinataire des lettres de cette époque, il s’agit plus vraisemblablement de son père, Henri Maigrot (1867-1933), alors directeur du Charivari et qui avait choisi Henriot pour pseudonyme, pseudonyme qui sera repris par son fils.
105 Il s’agit, là encore d’un canular. « R. de Bury » est bien Remy de Gourmont, qui a écrit 337 textes sous ce nom d’avril 1897 à août 1915. Le pseudonyme a ensuite (prémonition de Paul Léautaud) été repris par son jeune frère, Jean de Gourmont à la mort de son aîné en septembre 1915 pour 172 textes, jusqu’à sa mort en février 1928.
106 Eh bien non… en 1954, Paul Léautaud sera encore vivant.
107 Charles-Henry Hirsch (1870-1948), poète, romancier et dramaturge, responsable, au Mercure, de la rubrique des « Revues » depuis 1898, en même temps qu’il a été employé de banque jusqu’en 1907. C.-H. Hirsch est aussi un auteur de romans populaires ou naturalistes, comme son célèbre (à l’époque) Le Tigre et Coquelicot de 1905 chez Albin Michel, ou licencieux comme Poupée fragile, chez Flammarion en 1907. En 1910, il sera un des défenseurs des Fleurs du mal. Charles-Henry Hirsch est l’un des auteurs Mercure les plus prolifiques avec 792 textes, d’août 1892 à décembre 1939. Il est aujourd’hui essentiellement connu comme l’auteur du scénario du film Cœur de lilas (Anatole Litvak 1931) avec Jean Gabin.
108 Il n’est pas impossible que la lettre de Charles-Henry Hisrch ait été motivée par l’arrêt (provisoire mais personne ne le sait encore) de la parution des chroniques dramatiques de Maurice Boissard dans le Mercure, remplacé par André Fontainas dans le numéro de ce seize octobre.
109 Note de Paul Léautaud : « M. Charles-Henry Hirsch avait trouvé “un peu vachard” le ton des premières chroniques dramatiques de Maurice Boissard. »
110 À la fin de sa dernière chronique, datée du premier octobre, Maurice Boissard prend congé : « J’ajouterai ceci. Une personne pleine de complaisance m’a rapporté quelques opinions sur mes chroniques dramatiques. […] M. Charles-Henry Hirsch a dit qu’il trouvait mon ton « un peu vachard »…
111 Paul se moque ici de C.-H. H, comme il se moquait d’Adolphe Paupe.
112 Jacques d’Adelswärd-Fersen (1879-Capri 1923), poète et romancier. Aristocrate et dandy, il est connu pour avoir créé en 1908 Akademos, la première revue homosexuelle française. L’écrivain Roger Peyrefitte lui a consacré en 1959 un roman, L’Exilé de Capri, en partie inspiré de sa vie. Adelswärd-Fersen devient extrêmement riche lorsqu’il hérite de la fortune familiale en 1898, à la mort de son grand-père qu’il semble avoir peu connu. Son parti devient très recherché dans les plus hauts cercles, certaines familles souhaitant qu’il épouse une de leurs filles. Mais dans sa garçonnière de l’avenue de Friedland étaient organisés des « tableaux vivants » qui mettaient en scène des élèves du lycée Carnot plus ou moins dénudés, ce qui donna lieu à un procès dont on aurait parlé davantage si n’était arrivé au même moment celui de la rouverture de l’Affaire Dreyfus.
113 Dans un peu plus d’un an, le premier décembre 1909, Maurice Boissard aura à remplacer André Fontainas le temps d’un numéro du Mercure. Il conclura cet intérim par ce paragraphe : « Voilà mon intérim terminé et je vais maintenant rentrer dans ma retraite. Avant de vous quitter, laissez-moi vous dire une bien belle offre qui m’a été faite comme je terminais ma première année de critique dramatique. Celle de rendre compte des théâtres dans la revue Akademos, dont on préparait le premier numéro. Comme j’avais besoin de repos, il me fallut refuser, en remerciant comme il convenait. J’en ai eu un peu de regret, pendant quelque temps. On disait « notre oncle Sarcey ». On aurait peut-être dit « notre tante Boissard ». La lettre de refus de Paul est datée du 28 août 1908.
114 Lire le Bestiaire au vendredi 23 avril.
115 Ce qui implique qu’Ami se trouvait dans les bureaux du Mercure. Émile Magne, Le Plaisant Abbé de Boisrobert, fondateur de l’Académie française, 1592-1662, Mercure 1909, 497 pages. Dans le Mercure du premier juin 1909, page 428, Émile Magne a écrit « La Jeunesse de Boisrobert ». Émile Magne (1877-1953), critique, historien de la littérature et de l’art, a publié en 1898 une première étude portant sur les erreurs de documentation dans Cyrano de Bergerac. Spécialiste du XVIIe siècle, Émile Magne sera un collaborateur régulier du Mercure dans lequel il a écrit 258 articles entre mai 1901 et juin 1940. Voir trois portraits de lui par Paul Léautaud au 13 avril 1923, au 24 septembre 1928 et au 25 juin 1937.
116 Paul Adam (1862-1920), écrivain et critique d’art. Son premier roman, Chair molle (1885), accusé d’immoralité, provoque le scandale. On lira avec intérêt le portrait de Paul Adam dressé par André Billy dans La Terrasse du Luxembourg, Fayard 1945, page 139 et suivantes.
117 Voir, dans la Correspondance générale, la lettre du vingt juin : « Il m’est tombé dessus l’autre jour pour solliciter son admission au Stendhal-Club. Je lui ai dit que l’entrée y était fort difficile, que vous étiez le secrétaire-archiviste du club, qu’il s’adresse à vous. Mon cher Monsieur Paupe, je vous en prie, menez-le de votre mieux, et le plus sérieusement du monde, et le plus longtemps possible, je ne dirai pas en bateau, ce ne serait pas suffisant, mais en CROISEUR. Dites-lui par exemple que le Stendhal-Club est très fermé, qu’on y est admis qu’après avoir écrit un ouvrage quelconque mais remarquable sur Stendhal, et qu’il faut de plus l’avis favorable de tous les clubistes, lesquels trouvent qu’ils sont en nombre suffisant. Enfin, distinguez-vous. Cela fera travailler un peu cet attaché (insuffisamment) de ministère et nous débarrassera de lui. » Henri-Martin Barzun (Henri Louis Martin, 1881-1973), homme de lettres avant-gardiste ayant pris une grande part dans le théâtre expérimental.
118 Jean Mélia, La Vie amoureuse de Stendhal, Mercure 1909, 418 pages.
119 Doris Gunnel, Stendhal et l’Angleterre, préface d’Adolphe Paupe (deux pages datées d’octobre 1908), chez Charles Bosse, 46 rue Lafayette, 322 pages.
120 En clair, à compte d’auteur.
121 On a pu observer que la dernière lettre adressée depuis la rue Rousselet est du trois mai 1907. La suivante, de janvier 1908 ne porte pas d’adresse. Mais ce n’est pourtant que le 27 mars 1908 que Paul s’est installé rue Dugay-Trouin.
122 Jacques Vingtras est le personnage éponyme de la série romanesque de Jules Vallès, composée de L’Enfant (1879), Le Bachelier (1881), et L’Insurgé (1886, posthume).
123 Site web de l’Académie française : « En 1782 le baron de Montyon a apporté […] une donation à l’Académie qui a “pour objet un acte de vertu dont l’éloge ou le récit sera fait dans une assemblée publique par le Directeur” […] La vertu était désignée au sens vieilli du mot : honnêteté, pudeur, sagesse ».
124 Souvenir de ce voyage à Rouen où Remy de Gourmont, Louis Dumur et Paul Léautaud se sont rendus l’an dernier.
125 Note de PL : « L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux. Adolphe Paupe y avait publié une petite fantaisie sur les réunions des rédacteurs de la « Chronique Stendhalienne » fondée à L’Ermitage par Remy de Gourmont sous le pseudonyme de Monsieur Coffe. Adolphe Paupe était la candeur même. On lui faisait croire tout ce qu’on voulait. Il fut pendant longtemps à croire à l’existence réelle de Monsieur Coffe. » La « petite fantaisie » indiquée par Paul Léautaud est parue dans L’Intermédiaire du vingt août, colonnes 268-270.
126 L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux « questions et réponses, communications diverses à l’usage de tous, littérateurs et gens du monde, artistes, bibliophiles, archéologues, généalogistes, etc. » est paru du dix juillet 1864 au trente avril 1940 (numéro 1936). Au début de ce siècle il paraissait le dix et le vingt de chaque mois, sur deux colonnes. Ce n’étaient pas les pages qui étaient numérotées mais les colonnes. Chaque numéro commençait par une série de questions des abonnés, suivies des réponses. Dans le numéro du dix juillet nous trouvons, colonne dix, un court texte de J. Brivois à propos du Stendhal-Club et colonne 84 un article d’Adolphe Paupe : « Taine et Stendhal » à propos d’une « théorie de la race », qu’on peut ne pas souhaiter lire.
127 Allusion à la fable de Jean de La Fontaine, L’Ours et l’amateur des jardins qui a entraîné l’expression » pavé de l’ours ».
128 Remy de Gourmont a écrit 319 « Épilogues » dans le Mercure, de décembre 1895 à sa mort.
129 Note de Paul Léautaud : « Les Épilogues, les Journaux, les deux rubriques de Remy de Gourmont dans le Mercure. »
130 Mercure du premier octobre 1909, bas de la page 528 à propos d’un article d’Octave Uzanne sur la fermeture du bal Bullier paru en une de La Dépêche (de Toulouse) du 17 septembre. Remy de Gourmont, qui signe « R. de Bury » termine son compte rendu par ces mots : « Voilà une page d’histoire littéraire qui ne sera point recueillie dans les manuels académiques. C’est pourquoi nous la conserverons, nous qui ne sommes point académiques. »
131 Note de Paul Léautaud : « Soirées de Paris, no juillet 1912. » Dans la chronique des « Revues » du numéro du premier septembre. Dans cette rubrique, page 157, un chapitre porte le chapeau suivant : « Dans Les Soirées de Paris (juillet), M. André Billy donne, plutôt qu’un portrait de M. Paul Léautaud, une suite de croquis d’après ce très original écrivain. D’ailleurs, M. Billy imprime en sous-titre : « Gestes et paroles. » Voir le Journal littéraire au 21 août 1912. Les Soirées de Paris est un « recueil mensuel » de littérature fondé en février 1912 par Guillaume Apollinaire et quatre amis : André Billy, René Dalize, André Salmon et André Tudesq. L’analogie du titre avec le recueil de nouvelles Les Soirées de Médan d’Émile Zola, vient tout de suite à l’esprit, même après plus de trente ans. Ce recueil mensuel a été interrompu par la guerre.
132 Adolphe Paupe, La Vie littéraire de Stendhal, Champion 1914, 227 pages, offert à Remy de Gourmont « En témoignage de grande estime et d’affectueuse sympathie » (30 mai 1912). La préface est de novembre 1913. Autant dire que ce livre a traîné.
133 Paul Léautaud est cité dans la préface et deux fois dans l’ouvrage, pages 184-185.
134 Adolphe Paupe habitait 50 rue des Abbesses, dans le nord de Paris… et peut-être un étage élevé. Il était père de cinq enfants, dont un seul garçon, qui mourra en mars 1915, à l’âge de 26 ans.
135 Du 13 au 25 mai 1912, André Gide a été juré volontaire lors d’une session aux assises de Rouen. Ses notes prises au cours des audiences fourniront la matière du texte Souvenirs de la cour d’assises qui paraîtra dans deux numéros de La NRF (novembre et décembre 1913) avant la publication en volume en 1914.
136 Note de Paul Léautaud : « C’est pour me consoler de cette mésaventure que Marie Laurencin m’offrit son portrait par elle-même, qui orne depuis mon bureau du Mercure. »
137 La déclaration de guerre est intervenue le premier août mais André Billy, né en décembre 1882 ayant plus de trente ans sera envoyé à Rodez, ainsi que nous l’apprendrons dans la lettre suivante (huit septembre), adressée à Paul Morice.
138 Paul avait été « mobilisé » par Anne Cayssac, qui avait fort insisté pour qu’il la rejoigne à Pornic, ce qu’il a rapidement regretté, avant de revenir à Fontenay… ce qui lui évitera la même erreur en 1940.
139 Allusion évidente, chaque fois qu’il s’agit de Genève, à sa mère, Jeanne Forestier, qui a épousé un genevois et qui mourra le quinze mars 1916, poignardée par sa bonne.
140 Louise Faure-Favier (1870-1961), écrivaine, journaliste et aviatrice amie de Guillaume Apollinaire (rencontré en septembre 1912) et de Marie Laurencin. En août 1907, Louise Faure-Favier a épousé Jean Ernest-Charles mais est ces temps-ci maîtresse d’André Billy.
141 Anne-Chérie Charles (1898-1990), peintre connue sous le nom de Chériane, fille de Louise Faure-Favier et d’Ernest Charles. En 1946, Anne-Chérie Charles épousera Léon-Paul Fargue (1876-1947).
142 Louis Pergaud (1882-mort pour la France en avril 1915), ce qui lui a juste laissé le temps d’écrire quatre livres publiés de son vivant, tous au Mercure : trois recueils de nouvelles animalières, De Goupil à Margot (1910), prix Goncourt, La Revanche du corbeau (1911), Le Roman de Miraut, chien de chasse (1913) et enfin La Guerre des boutons (1913).
143 Guy-Charles Cros (1879-1956), professeur de collège et traducteur, a été le secrétaire d’Adolphe van Bever au début de 1914. Son père, Charles Cros (1842-1888), était poète et inventeur du phonographe, qu’il n’a pu réaliser faute de moyens. Lire sa nécrologie dans le Mercure de février 1957.
144 Robert Fort (1890-1950) a épousé Gabrielle Vallette en 1911. Il a 24 ans.
145 Maurice Léautaud, fils de Firmin et de Louise Viale.
146 Ce trente octobre 1914 est un vendredi. Le samedi précédent était le 24.
147 Le Mercure rouvrira le premier mars 1915 mais avec un demi-appointement de 125 francs par mois.
148 En 1905 Paul avait acheté des actions du Mercure.
149 Note de Paul Léautaud : « Il n’y a pas là un regret, bien au contraire. »
150 Note de Paul Léautaud : « Un bouledogue dont Rouveyre faisait alors sa société. »
151 Il s’agit peut-être d’une invitation à Barbizon, où André Rouveyre avait une maison.
152 De l’argent, vraisemblablement, dont André Rouveyre ne manquait pas.
153 Note de Paul Léautaud : « La guerre a, au contraire, enrichi considérablement les éditeurs. »
154 Note de Paul Léautaud : « Au lendemain du traité de paix, les libraires allemands se déclaraient prêts à régler leur compte, intégralement. »
155 Note de Paul Léautaud : « J’ai changé d’opinion depuis. »
156 Maximilian Harden (Felix Ernst Witkowski, 1861-1927), journaliste et polémiste allemand talentueux, s’est réfugié en Suisse en 1922. Première colonne de une de La Dépêche du 18 octobre (article non signé).
157 Franc-Nohain (Maurice Legrand, 1872-1934), avocat, écrivain, librettiste et sous-préfet, a reçu le grand prix de littérature de l’Académie française en 1932.
158 Hugues Le Roux (Robert Le Roux, 1860-1925), journaliste et écrivain, Hugues Le Roux a été sénateur de Seine-et-Oise de 1920 à sa mort.
159 Note de Paul Léautaud : « Deux mois sans lire un journal et sans la moindre curiosité pour ce qui se passait. C’était la tranquillité parfaite. »
160 Alain-Fournier (Henri-Alban Fournier, 1886-mort au combat le 22 septembre 1914, à 27 ans), romancier et journaliste, surtout connu pour Le Grand Meaulnes, son unique roman achevé. Fils d’instituteurs, Alain-Fournier a rencontré Jacques Rivière, futur directeur de La NRF, qui a épousé sa sœur, Isabelle Fournier en 1909. En 1910, Alain-Fournier publie quelques œuvres personnelles dans le quotidien Paris-Journal. Et devient le secrétaire de Claude Casimir-Perier (1880-1915) puis l’amant de sa femme, la comédienne Simone Le Bargy (1877-1985). L’Intransigeant du 26 octobre nous apprend, page deux, qu’« Alain-Fournier et Jacques Rivière sont blessés et prisonniers » alors qu’Alain-Fournier est mort depuis plus d’un mois. Voir, ci-dessous, la lettre à André Billy du 23 novembre 1914.

161 André du Fresnois (André Casinelli, 1887-disparu le 22 août 1914), personnalité royaliste, critique dramatique talentueux à la Revue critique des idées et critique littéraire à la revue de L’Action française.
162 La Revue hebdomadaire « Romans, histoire, voyages », abondamment illustrée, éditée par Plon, paraît depuis mai 1892 et se poursuivra jusqu’en février 1939.
163 Alfred Machard (1887-1962), auteur dramatique, poète et romancier, moins connu de nos jours que son épouse, Raymonde Machard (1889-1971), romancière. Le seize mai 1914, Maurice Boissard a chroniqué Pigeon va chez la voisine, saynète en un acte d’Alfred Machard. Journal littéraire au 19 octobre 1935 : « Arrivé ce matin au Mercure un nouveau roman d’Alfred Machard : La Marmaille. Ce garçon, dont on faisait un foin du diable à ses débuts, qu’est-ce qu’il est devenu ? Zéro. »
164 Jacque Vontade (sans s au prénom) (Augustine Bulteau, 1860-1922), divorcée en 1896 (et non veuve) du romancier et auteur dramatique Jules Ricard (1848-1903). Augustine Bulteau s’est d’abord intéressée à la peinture et à la photographie avant de se tourner vers l’écriture et de produire une dizaine de romans populaires. C’est pourtant moins l’écriture, selon Florence Callu, que son salon du 149 avenue Wagram qui lui valut la célébrité. Louis Duchesne, Correspondance avec Madame Bulteau (1902-1922), édition établie et annotée par Florence Callu, École Française de Rome, 2009, 675 pages.
165 Jacque Vontade, Un voyage Belgique Hollande Allemagne Italie, Grasset, 506 pages.
166 Remy de Gourmont mourra dans dix mois, en septembre 1915.
167 Charles Péguy est lui aussi mort au combat, d’une balle au front, lors d’une mission de sacrifice sur un terrain à découvert, le cinq septembre 1914.
168 Dans l’édition de la Correspondance générale, Marie Dormoy ajoutera la note suivante : « Léautaud a pensé de même lors de l’exécution de Brasillach. »
169 André Billy avait été élevé dans un milieu très religieux.
170 Jean Cocteau (1889-1963) a déjà publié deux volumes de poésie en 1910 et 1912, les deux seuls ouvrages de lui parus au Mercure.
171 Peut-être La Malabée, orné de cinq dessins de Jean-Émile Laboureur, paru à la Société littéraire de France, rue Christine, en 1917 (107 pages).
172 Il y a deux Le Cardonnel, Georges et Louis, frères, s’occupant de littérature. Georges Le Cardonnel (1872-1951) est surtout connu des Léautaldiens pour son ouvrage en collaboration avec Charles Vellay : La Littérature contemporaine : opinions des écrivains de ce temps, dans lequel Paul Léautaud bénéficie d’une notice, rédigée par ses soins, Mercure de France 1905. Son frère est l’abbé Louis Le Cardonnel (1862-1936), poète discret ayant lui aussi sa notice dans l’édition de 1908 des Poètes d’aujourd’hui.
173 Jean-Marie Gros, fondateur du théâtre de L’Œuvre, au côté de Lugné-Poe. « Gros était dévoué à “l’Œuvre” et d’une telle affabilité qu’il désarmait, par sa bonne grâce, les violences et les rancunes que je pouvais déchaîner. Qui, mieux que Gros, pouvait être, auprès de moi, le contrepoids, la rançon de mes fugues, et de mes foucades ?… En outre, il possédait une juste science de la correction bourgeoise, qui flattait les abonnés lorsqu’il allait les visiter. Il fut précieux, réservé… » Lugné Poe, La Parade, « Souvenirs et impressions de théâtre » tome II, Acrobaties, page 35, Gallimard 1931.
174 Texte corrigé en fonction des indications du Journal littéraire (23 décembre 1929).
175 Il s’agit peut-être des deux premières colonnes de L’Écho de Paris du 26 décembre : « Un témoin raconte la mort héroïque de Péguy ».
176 En fait bien avant, le premier avril 1915, mensuellement puis sur le rythme bimensuel dès le premier janvier 1916.
177 Guillaume Apollinaire répondra à Paul dans une lettre datée de Nîmes le quatorze janvier et que l’on peut lire dans le Choix de pages de Paul Léautaud par André Rouveyre.
178 Remy de Gourmont est mort le 27 septembre 1915. Lire le Journal littéraire à la date du lendemain et des jours suivants. Le premier octobre, jour de l’inhumation : « J’ai rejoint le cortège boulevard Saint-Germain, à 11 heures et demie, à la hauteur de la rue Saint-Guillaume. Peu de monde. Beaucoup plus à l’église, paraît-il. J’ai fait route avec Paupe à mon bras. »
179 Sa vie durant, Paul Léautaud reprochera cette « faiblesse » à Remy de Gourmont.
180 Long article dans La France du trente septembre (parution tous les deux jours sur une seule feuille recto-verso). L’article commence par un texte d’Henri de Régnier, puis celui de Pierre Louÿs, le plus long. Il est suivi de « Comment est mort Remy de Gourmont » par Bernard Lecache, puis « L’Homme et l’œuvre » par Léon Guillot de Saix. Plus de deux colonnes en tout. Le texte cité par Paul Léautaud se trouve au bas de la première colonne. Le numéro suivant, du deux octobre présente un long article non signé, près de deux colonnes, rendant compte des obsèques de Remy de Gourmont et reproduisant les discours.
181 En ouverture du Mercure du premier novembre, quinze pages de Louis Dumur suivies des discours d’Henri de Régnier, de Georges Lecomte (Société des Gens de lettres), de Maurice Ajam (journal La France), Fernand Mazade (La Dépêche de Toulouse), Xavier Carvalho (presse portugaise et brésilienne), M. Juliot Piquet (La Nacion de Buenos-Aires). Les « Échos » de ce même numéro donnent une biographie de trois pages, non signées, peut-être de Louis Dumur.
182 Le Temps offre une courte nécrologie au bas de la dernière page de son numéro du 29 septembre, six lignes annonçant les obsèques dans la rubrique nécrologique du numéro du premier octobre. Le numéro du trois octobre donne un compte-rendu de ces mêmes obsèques : « Les obsèques de Remy de Gourmont ont eu lieu hier à Saint-Thomas-d’Acquin à dix heures et demie. […] / Le deuil était conduit par le vicomte de Gourmont, M. Jean de Gourmont et M. de Gourmont, frères du défunt, et Mlle [Marie] de Gourmont, sa sœur. » Le Temps donne ensuite une liste des assistants à la cérémonie : Alfred Vallette, Henri de Régner, Georges Lecomte (président de la société des gens de Lettres), Gustave Kahn, Rosny aîné, Albert Métin, Paul Adam, Tristan Bernard, Jean Marnold, Henri de Groux, Henri Albert, prince Cantacuzène, Paul fort, etc. Les aléas des délais d’impression du Mercure et ceux de la mort se contredisent parfois et dans Le Temps du sept octobre, en haut de la page trois, Roland de Marès, à la fin de son feuilleton des « Revues », rend compte des derniers « Épilogues » posthumes, parus dans le Mercure d’octobre. Le feuilleton évoqué par Paul Léautaud est celui des « Livres » de Paul Souday, dans Le Temps du cinq novembre.
183 Article d’André Beaunier, premier novembre 1915, pages 206-217.
184 Peut-être à l’occasion de la parution — devenue assez rare — d’une Chronique de Maurice Boissard dans le Mercure du premier novembre. On peut observer, pur hasard, que cette chronique rend compte de la publication du Théâtre de demain, une enquête de Léon Guillot de Saix et Bernard Lecache (cités note 180), parue dans La France, et éditée en volume (175 pages) par ce même journal.
185 De fait, Paul Léautaud est moins assidu à son Journal, qui ne donne que deux journées pour ce mois de novembre.
186 Pour Henriette Charasson, note seize. Il s’agit peut-être de la suppression d’une rubrique ?
187 Filleuls de guerre.
188 Allusion aux mardis de Rachilde, organisés, d’octobre à avril, dans le bureau d’Alfred Vallette.
189 Stuart Merrill (1863-premier décembre 1915), poète symboliste américain d’expression française a été codirecteur littéraire de L’Ermitage à partir de 1892. Sa veuve est née Claire Rion en 1882.