Par Marie Dormoy
Page publiée le premier juin 2025. Temps de lecture : 23 minutes.
Ce texte de Marie Dormoy est paru dans le Mercure de France de mai 1957 pages 31-42. Le texte en est intégralement reproduit ici.
J’ai appris à lire dans le Mercure de France. Dès que j’eus atteint l’âge de comprendre ce que je lisais, je fus attirée, avant tout autres textes, par les articles de chronique théâtrale1. Il y était question de pièces que je ne connaissais pas, que je ne connaîtrais jamais, mais celui qui les racontait et les commentait y mettait tant de verve, tant de fantaisie, tant de personnalité, que cette lecture m’enchantait. Qui était ce Maurice Boissard, dont on ne voyait le nom nulle part ailleurs que dans le Mercure ? Je me renseignai auprès d’un ami de Rachilde et de Vallette, qui se renseigna lui-même auprès de Dumur. Celui-ci, avec sa placidité helvétique, répondit tout bonnement : « Boissard ? C’est un de nos employés. »
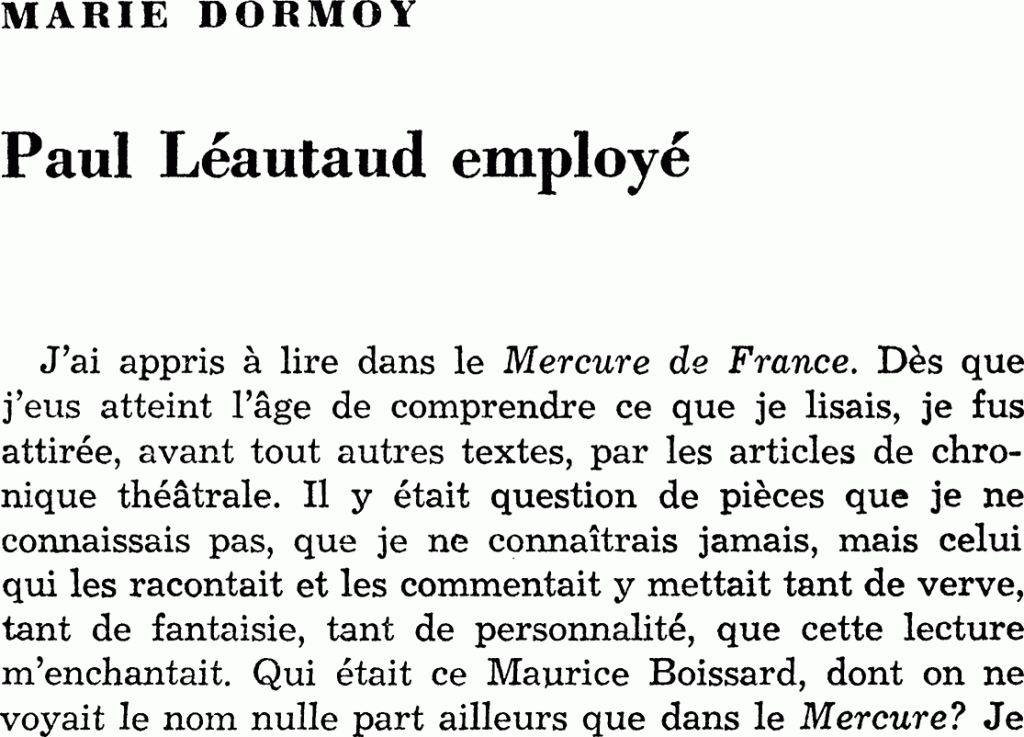
Comme je n’avais pas grande connaissance des us et des coutumes de la vie littéraire, je m’imaginai, sachant que la vertu dominante du Mercure était une stricte économie, que, pour réduire les frais, on chargeait chacun des employés de la maison d’une des rubriques de la revue : au comptable, la philosophie, au commis des ventes, la poésie, au concierge, la musique. Ce fut seulement bien plus tard que j’appris le vrai nom de Maurice Boissard : Paul Léautaud, auteur d’un roman scandaleux, ami des bêtes jusqu’à la folie, qui allait au théâtre de temps à autre et passait le plus clair de son temps à sauver des chiens et des chats en péril.
Quelques années après, je fis enfin sa connaissance2. Le plus curieux est que je ne me souviens pas d’avoir éprouvé, à notre première entrevue, le choc que ressentaient ceux qui le voyaient pour la première fois. L’auteur des Chroniques était si semblable à ce qu’il écrivait qu’il ne pouvait y avoir de surprise. En lui plus qu’en tout autre, le style, c’était l’homme. Il était aussi tellement appareillé au Mercure d’alors, qu’on ne pouvait l’imaginer vivant en un autre endroit, pas plus qu’un autre que lui à la place qu’il occupait. Il était vêtu pauvrement ? Le Mercure était une très vieille maison, aux peintures écaillées, aux parquets mal cirés, aux plafonds noircis par les becs de gaz, seul éclairage admis, aux fenêtres voilées d’une brume légère. Il ressemblait à un notaire de province ? Cela convenait parfaitement à une administration qui réprouvait le téléphone, l’électricité, la machine à écrire. Il était libre dans ses propos, ne se pliait à aucune règle ? C’était le ton habituel de la maison et ce n’était pas impunément que Vallette avait installé sa maison dans l’ancien hôtel de Beaumarchais.
Le Mercure des premières années était une chose dont, maintenant, nous n’avons plus idée. La liberté qui y régnait était telle que Vallette s’interdisait de lire, avant de les envoyer à l’imprimerie, les articles des collaborateurs attitrés. Ceux-ci, entre eux, pouvaient s’accabler de louanges, se dénigrer à plaisir, personne n’y trouvait à redire. C’est probablement parce qu’en cette maison une telle liberté régnait dans tous les domaines, qu’en 1907, Léautaud, à la demande de Vallette et de Gourmont, y accepta un emploi de secrétaire.
Depuis qu’il était sorti de l’école communale, Léautaud avait dû gagner sa vie, et durement. Dès qu’il fut en possession de son certificat d’études, sans même lui accorder un jour de vacances, son père le fit entrer comme apprenti à la Compagnie des Indes, rue de Richelieu, installée maintenant rue d’Antin. Heureux d’être délivré de l’école, de commencer sa vie d’homme, il y arriva un beau matin, tout guilleret. On lui mit un balai entre les mains, on lui fit balayer le magasin. Quand ce fut fini — il avait l’habitude ! — on lui montra des ballots de dentelles et de lingeries, rangés dans des casiers disposés le long des murs, on lui ordonna de les descendre, de les épousseter, de remonter nettoyer les casiers vides et ensuite d’y replacer les ballots. La journée fut longue !
Rentré chez son père après dix heures d’un si rude travail, fourbu, l’enfant se révolta. Il déclara que ce n’était pas la peine d’avoir été premier depuis trois ou quatre ans et de façon continue à l’école, pour maintenant faire un métier de coltineur. Pour une fois, Firmin Léautaud se laissa convaincre et, dès le lendemain, s’enquit d’une autre place3.
Par suite de hasards inconnus, il fut employé à la Lessive Phénix, à la Compagnie des Eaux de Pougues, au journal La République — pour faire des bandes4 à raison de plusieurs centaines par jour — et autres places aussi peu glorieuses. Il s’y trouvait toujours mieux que chez lui, en butte aux sévérités d’un père injuste, aux avances équivoques d’une trop jeune belle-mère.
Le nombre de places qu’il fit entre sa quinzième et sa dix-neuvième année semble prouver que l’apprenti, doué de qualités certaines, se montrait aussi fantaisiste et étourdi que l’avait été l’écolier. On avait pour lui des indulgences, mais qui ne pouvaient être illimitées. Dans l’une de ces places, il fut chargé par le chef de bureau de rechercher une adresse dans le Bottin. Il ne la trouva pas. « Cherchez bien, je suis sûr qu’elle y est. » Il ne trouva pas davantage. « Cherchez encore », insista le chef. Il ne trouva encore pas. « Je vais chercher moi-même, dit le chef sans impatience, et, si je la trouve, vous quitterez la maison ce soir. » Le chef ouvrit le gros livre, chercha, trouva, et le pauvre Paul fut mis dehors.
Il est pourtant une maison qui lui laissa de délicieux souvenirs, ce fut La Nation, compagnie d’assurances située rue d’Amboise, au coin de la rue de Richelieu. Le sous-directeur était si libéral qu’il conseillait lui-même aux employés, les jours de beau temps, d’aller prendre l’air au soleil. C’est à ce moment que Léautaud prit l’habitude de ces longues promenades dans Paris qui étaient et furent toujours un de ses plus grands plaisirs. Partant de la rue d’Amboise, il déambulait sans fin dans ce quartier du Palais-Royal qu’il connaissait déjà puisqu’il venait souvent, avec son père, au Théâtre-Français. Quartier, pour lui, déjà plein de souvenirs, qui lui fut cher entre tous, qu’il rêva toujours d’habiter.
Léautaud ne commença sa vie sérieuse et stable d’employé qu’après sa libération du service militaire, quand il entra, en qualité de tribun, chez un gantier, oncle de Georges Beer, l’acteur du Théâtre-Français. Juché sur sa haute tribune — d’où son nom de tribun — comme Diafoirus sur sa chaise, il établissait à toute allure les débits qu’on lui criait de tous les coins à la fois. Il fallait une grande dextérité, une non moins grande promptitude d’esprit. Emploi médiocre, malgré tout, puisque le patron, qui savait déjà que son « tribun » publiait des poèmes et des articles, lui disait de temps à autre : « Vous savez, Monsieur Léautaud, je suis gêné de vous employer à la maison de gants. »
Est-ce parce qu’il était lassé d’un tel emploi que Léautaud quitta la « tribune », ou parce que le patron, bien qu’indulgent, préféra se séparer d’un comptable-poète chez qui le poète l’emportait un peu trop souvent sur le comptable ? Nous ne pouvons le dire, puisque Léautaud lui-même ne s’en souvenait pas. Quittant sans regrets la ganterie, il se présenta, comme étudiant en droit, — ce qui était pure invention, — à l’étude Barberon, quai Voltaire, où il fut tout de suite admis comme troisième clerc.
Ce fut la vie sérieuse, ce fut la vie sévère. Ses appointements étaient de cinquante francs par mois, auxquels s’ajoutaient les trente de la tante Fanny. Les semaines étaient de cinquante-quatre heures5. Heureusement qu’entre l’expédition des actes on pouvait rêver… ou rimer. Heureusement aussi qu’il y avait les courses en ville, grâce à quoi, en trichant un peu, Léautaud pouvait faire un détour, entrer à la Bibliothèque Nationale, bavarder avec Jean de Tinan, Henri Albert ou quelque autre ami du Mercure.
Léautaud resta huit ans pleins à l’étude Barberon, de 1894 à 1902. Il n’en partit que parce qu’il n’y avait pas là, pour lui, de possibilité d’avenir. Il avait accédé, par son travail consciencieux, au grade de premier clerc, avec des appointements de cent francs par mois, mais, n’ayant aucun titre, il ne pouvait espérer plus.
Le manque de liberté ne l’empêcha quand même pas de faire sa carrière littéraire puisque c’est pendant ce temps qu’il publia, en plus de quelques poèmes, les Essais de Sentimentalisme, l’Essai, l’Ami d’Aimienne et enfin Le Petit Ami. Arrivé inconnu, il quitta l’étude auréolé du prestige de l’homme de lettres, sinon célèbre, du moins en passe de l’être. Ses collègues lui témoignaient de l’estime, avaient pour lui quelque considération, le chargeaient des besognes délicates, comme, pour le départ du Principal, de composer le discours d’adieu. Ce qu’il fit simplement et avec émotion, car il avait pour ce M. Bertin, avec qui il correspondit quelques années encore, une réelle sympathie.
Reconnu, après la publication du Petit Ami, comme un écrivain de valeur, sollicité par divers directeurs de revues pour des collaborations régulières, il aurait pu vivre de sa plume. Il ne l’osa pas et entra, on ne sait à quel titre, chez M. Lemarquis, administrateur judiciaire, avec qui il s’entendait le mieux du monde. Il y resta trois ans.
Là, il fut heureux, car il était dans la vie. Il lui fallait débrouiller des divorces, des faillites, des saisies, toutes choses qui provoquaient chez lui une grande excitation cérébrale. Parmi ces affaires, quelques-unes étaient d’importance : divorce du peintre La Gandara6, affaire Humbert7, liquidation Dehaynin. Léautaud devait aller souvent au Palais où il rencontrait toutes sortes de gens avec qui il lui fallait discuter, qu’il fallait convaincre, sur qui il fallait l’emporter. C’est pendant cette période qu’il écrivit In Memoriam, Amours, qu’il commença sa grande aventure stendhalienne. Malheureusement, cette belle vie ne dura que trois ans et se termina de façon bien inattendue.
Un des collègues de Léautaud avait, grâce à de fausses écritures, détourné une somme de quarante-deux mille francs. Le comptable s’en aperçut, prévint le fondé de pouvoir. On fit une enquête. On interrogea Léautaud qui déclara ne rien savoir, ce qui était vrai, mais qui, ne pouvant jamais retenir sa langue, crut bon d’ajouter : « Du reste, si je savais quelque chose, je ne le dirais pas. » Cette déclaration fit un beau vacarme. Le fondé de pouvoir accusa Léautaud de favoriser les voleurs, Léautaud répondit qu’il ne faisait pas partie de la police, de part et d’autre les répliques se succédèrent, et, de la part de Léautaud, plutôt corrosives. Outré d’une telle insolence, le fondé de pouvoir déclara qu’à la suite d’un tel scandale il n’accorderait pas, comme il était d’usage, la gratification de fin d’année à un homme qui prenait si peu les intérêts de la maison. Outré à son tour d’une telle injustice, Léautaud donna sa démission.
L’affaire fut portée à la connaissance de M. Lemarquis. Pris entre deux feux, ne pouvant désavouer son fondé de pouvoir, il accepta la démission de Léautaud, mais lui offrit de travailler pour lui personnellement, quand il aurait besoin d’un « extra », ce qui arrangea tout à fait Léautaud. Il avait, de la sorte, une certaine tranquillité matérielle, en même temps que des loisirs pour continuer sa tâche d’écrivain. Il y avait aussi, l’été, les remplacements de Valéry auprès de M. Lebey8. Travail qui n’en était pas un et dont Léautaud a toujours gardé un heureux souvenir.
Dans ses tractations au cabinet Lemarquis, Léautaud avait réussi, par des manœuvres un peu libres, entreprises plus par l’amour du jeu que par cupidité, à mettre de côté une somme d’environ deux mille cinq cents francs. Avec l’aide matérielle de Blanche, qu’il acceptait sans y voir rien d’immoral, [il avait] de quoi vivre deux ans. Ce qu’il fit.
Cette liberté, que lui a-t-elle rapporté ? bien peu de chose. Il a travaillé à son grand livre, à celui qu’il nommera plus tard le Passé indéfini, mais il ne l’a pas achevé — il ne l’achèvera jamais9-10. Il voit l’un, voit l’autre, bavarde avec Vallette, baguenaude avec Gourmont. Le temps passe, le pactole s’épuise, et, en été 1907, Léautaud, ne voyant toujours pas la possibilité d’être prêt pour le Goncourt, se résout à accepter l’offre faite par Gourmont, de la part de Vallette, d’une place de rédacteur, pour ne pas dire employé, au Mercure, à raison de 150 francs par mois.
Léautaud accepta, parce qu’il était apathique, irrésolu, que son « côté épicier » comme il disait, était satisfait par la perspective d’appointements réguliers, l’absence d’aléas, qui amenaient une grande tranquillité d’esprit, mais l’homme de lettres se regimbait, tout en se disant que lui seul était fautif puisque, s’il l’avait réellement voulu, il aurait pu comme tant d’autres, vivre de sa plume. Il ne le voulait pas. Tout est là.
Ce qui le fit accepter fut aussi qu’il s’agissait du Mercure de France, qui était déjà « sa » maison, où il se rendait chaque jour. Curieuse maison ! la seule, peut-être, dans laquelle Léautaud pouvait, sans détonner, tenir un emploi.
L’idée, en apparence saugrenue, que j’avais eue dans mon enfance, des employés-collaborateurs, se trouvait à peu près juste. Léautaud n’était pas une exception. Louis Dumur, Louis Mandin, Ad. Van Bever, Paul Morisse11, écrivains, eux aussi, étaient employés à des besognes modestes et pour des salaires encore plus modestes. À cette époque, la chose était courante, du second métier. L’art y gagnait, et aussi la dignité de l’écrivain. Il régnait aussi une liberté dont, maintenant, nous n’avons plus que de trop rares exemples.
Léautaud devait entrer en fonctions le 1er janvier [1908]. Ce jour étant férié, il resta chez lui. Le 2, il arriva le matin, à l’heure convenue, s’en alla déjeuner et, l’après-midi, resta encore chez lui pour recevoir son demi-frère, Maurice, qui n’avait pu venir la veille lui apporter ses vœux de nouvel an. Vallette ne fit aucune réflexion, mais ne dut pas être très satisfait, lui qui était la régularité même.
Les jours suivants, il vint au Mercure le matin, il y vint l’après-midi, mais à des heures fantaisistes. Dès le 7 janvier, il note dans son Journal : « Je ne suis encore arrivé au Mercure à l’heure qu’une seule fois, le premier matin. Tous les autres jours c’est à neuf heures et demie le matin, l’après-midi à deux heures et demie. Je ne flâne pas, pourtant. Le temps de venir (il habitait alors rue Rousselet12), de faire mes commissions, de faire mon déjeuner et celui de Boule, de garnir les feux et de mettre tout en ordre, je n’ai jamais fini avant deux heures passées. Aujourd’hui, je suis arrivé il était trois heures. » Le 10 janvier, autre son de cloche : « Le travail du Mercure m’assomme de plus en plus. Travaillé aujourd’hui toute l’après-midi à mettre en français simple une chronique d’un écrivain Sud-Américain13. » Il y avait seulement dix jours qu’il était entré en fonctions et il devait y rester trente-quatre ans !
Au début, il travaillait au deuxième14 étage, dans le bureau de Van Bever, qui commande celui du Directeur, bureau dans lequel tout le monde entrait librement puisque, sur la porte, se lisait l’inscription, — elle y est encore Entrez sans frapper. Arrivait l’un, arrivait l’autre, on bavardait.
Si nous nous reportons au Journal de ces années et considérons toutes les pages consacrées au compte rendu des conversations tenues chaque jour, nous pouvons nous demander quand, dans cette maison d’une activité exceptionnelle, on pouvait bien travailler. Vallette encourageait quelque peu cette façon d’être. Chaque matin, dès cinq heures, il était à son bureau et commençait son travail. Travail attentif, sans relâche. Il répondait lui-même — à la main ! — à toutes les lettres reçues. Il faisait les comptes, il administrait, avec une conscience rare. À neuf heures sa journée était faite. Il allait alors voir les uns et les autres, se renseignait sur le travail fait et à faire, racontait une anecdote, en écoutait une autre, sur laquelle celui-ci ou celui-là renchérissait. À la tombée de la nuit arrivait Remy de Gourmont15, emmitouflé d’une écharpe qui ne cachait qu’à demi son pauvre visage tuméfié16. On bavardait encore beaucoup, encore longtemps. Des visiteurs arrivaient, à qui Gourmont, suivant l’humeur du moment, tournait le dos17 ou accordait un cordial bonjour. Il avait la dent dure. À peu près autant que Léautaud. Aussi tous les confrères, tous les amis, étaient-ils consciencieusement déchiquetés. Quand Léautaud quittait le Mercure, tardivement, il se disait qu’il avait bien travaillé, et beaucoup plus longtemps qu’il ne le devait. Ce qui l’incitait à l’indulgence pour ses inexactitudes d’horaires.
Quand il voyait des confrères vivre librement, lorsqu’il songeait à sa fierté ressentie jadis quand Descaves venait le prier d’envoyer son livre aux Goncourt18, il ne regrettait pas d’avoir agi selon sa conscience d’écrivain, mais en éprouvait une grande tristesse, et se disait : « J’ai dû faire une gaffe énorme, en acceptant ma place au Mercure19. »
Quelquefois, il lui arrivait un « petit bonheur », comme le jour où Gide, très surpris par la qualité de la petite annonce publicitaire de la Porte étroite, s’était enquis de son auteur20. Ayant appris d’Alfred Vallette que c’était Léautaud, il avait poussé un : « Ah ! alors ! » qui consola celui-ci de bien des misères, dont il se souvenait encore, au déclin de sa vie, avec émotion.
Quand Van Bever quitta le Mercure, vers 1910 ou 1912(21), Léautaud, faisant équipe désormais avec Paul Morisse, s’installa avec celui-ci dans le petit bureau du premier étage, qu’il dénommait son « placard ». Là se trouvait, se trouve encore, le casier dans lequel Léautaud distribuait chaque matin le courrier des collaborateurs. Ce placard était envahi, à longueur de jours, par les uns et les autres. Les bavardages y étaient encore plus longs et plus fréquents qu’à l’étage supérieur, parce que le placard n’était pas sous l’œil du patron. Chaque soir, en montant chez celui-ci, Remy de Gourmont s’y arrêtait, autant pour reprendre son souffle que pour s’entretenir, un moment, avec Léautaud. C’est aussi dans ce placard que Léautaud, à partir de mars 1914, recevait, à la tombée du jour, le Fléau22. Heureusement que les murs n’ont pas plus d’yeux que d’oreilles !
Les rapports entre Léautaud et Alfred Vallette furent quelque peu cahotants. Vallette était la patience même et avait Léautaud en grande estime, mais quand celui-ci avait passé un peu trop de temps à courir après les chiens errants ou à nourrir les chats abandonnés, qu’il était arrivé à son travail à onze heures trois quarts pour en repartir à midi moins cinq, Vallette, quand il le voyait réapparaître vers trois heures de l’après-midi, prenant son courage à deux mains, lui disait, assez sévèrement : « Alors, Léautaud, vous étiez malade ce matin ? — Malade ? moi ? Mais non. Pourquoi voulez-vous que je sois malade. Je ne suis jamais malade. » Ceci avec une certaine hargne, celle qu’on éprouve envers ceux susceptibles de vous jeter le mauvais sort.
Léautaud regimbait souvent contre les exigences, pourtant si légitimes, de Vallette. De même qu’il aurait voulu que le mari de sa maîtresse s’alliât à lui contre elle, de même aurait-il souhaité que son ami Alfred Vallette le défendît auprès du directeur du Mercure de France.
Malgré tout ce qui put se produire entre eux : divergences d’opinions, discussions, voire disputes, le jour où l’on enterra Vallette, on put voir, au cimetière de Bagneux, devant la tombe ouverte, Léautaud, les cheveux au vent, vêtu d’un bleu de travail sur lequel il avait mis un veston de facteur, chaussé d’escarpins vernis, tenant à la main son chapeau de clown, écoutant avec recueillement les paroles émues que prononçait, en adieu au défunt, Georges Duhamel, et laissant couler sans honte, de grosses larmes lentes sur son visage ravagé.
Léautaud aurait fini ses jours comme employé au Mercure si, en 1941, il n’avait été mis à la porte, sur l’heure, — jalousie ? vengeance ? — par le directeur d’alors, Jacques Bernard. Le coup fut rude. Léautaud le reçut sans broncher, sans laisser rien voir de son désarroi, de son chagrin. Grognant continuellement à son habitude contre l’obligation d’un travail qui était loin de le passionner, il ne concevait pas de ne plus participer à l’activité de la maison à laquelle il devait sa renommée d’écrivain. En deux jours, puisqu’il lui fallait partir incontinent, il déménagea son « placard », — vieux papiers entassés là-dedans depuis plus de trente ans, — décrocha le délicieux pastel qu’avait fait exprès pour lui Marie Laurencin, son propre portrait par André Rouveyre, la photographie décolorée de Remy de Gourmont. Il se terra dans sa thébaïde de Fontenay-aux-Roses, — pendant l’occupation, que Fontenay était loin de Paris ! — et, plus que jamais, rêva au passé.
Le dernier acte de sa vie d’employé, Léautaud le joua au Palais de Justice, où il avait été convoqué comme témoin lors du procès intenté à Jacques Bernard pour faits de collaboration. À l’appel de son nom, il se leva, se dirigea d’un pas hésitant vers le tribunal, ceci parce que sa vue était déjà très mauvaise, que la lumière l’éblouissait. Vêtu de vêtements usagés, d’autant plus minable d’aspect qu’il succédait, à la barre, à Georges Duhamel et à Maurice Garçon, il fit piètre mine. « Que savez-vous de cette affaire, lui demanda le Président. Quels rapports aviez-vous avec le prévenu ? » Bouleversé par l’aspect de celui-ci qui, en quelques mois, avait vieilli de vingt ans, Léautaud répondit d’une voix éteinte : « Je ne sais pas… Je le voyais très peu… Nos bureaux n’étaient pas au même étage… Je ne m’occupais pas de ses affaires… » Pris d’impatience, le Président insista « Enfin, vous lisiez bien le Mercure, vous saviez bien quels articles s’y publiaient23 ! — Non, je ne lis jamais le Mercure », répondit du ton le plus humble le timide témoin. Désarmé, le Président lança un coup d’œil circulaire. Haussements d’épaules, hochements de tête voulant dire : Quel pauvre type. Ce doit être un garçon de bureau du plus bas étage. Sait-il seulement lire ? À cette époque, Léautaud n’était pas encore auréolé par la radio. « Je vous remercie », conclut le Président d’une voix coupante.
À la sortie du Palais, très content de lui, Léautaud confiait à qui voulait l’entendre : « Je n’ai rien dit. Je n’avais rien à dire, Bernard était un misérable, mais ce n’est pas à moi à le faire condamner. » C’était pourtant ce même Jacques Bernard qui, un matin d’automne24, quelques années auparavant, avait enjoint de façon grossière au plus vieil employé, au plus vieil auteur vivant, de ne pas remettre les pieds dans une maison qui était et demeurait, plus que toute autre, « sa » maison.
Léautaud est toujours présent au Mercure. Dans chacune des pièces de l’entresol est apposé un portrait : Léautaud en clochard, Léautaud en habit avec son chapeau-claque, Léautaud porteur de pâtées pour les chats, Léautaud écrivain. Dans l’escalier, dans les bureaux, les dégagements, on s’attend toujours à entendre sa voix sonore et son rire strident, à le voir surgir, hirsute et familier d’un étage ou d’un autre, de derrière une porte. Tous l’aimaient. Tous le regrettent. Il était insupportable. Il avait de délicates attentions. Nul ne peut oublier le grand exemple qu’il nous a donné : accepter l’esclavage pour rester un homme libre.
Annexe I :
Marie Dormoy et la publication du Journal de Léautaud
Texte de Georges Piroué paru dans le Mercure de janvier 1960, page 172.
Cela commençait mal. J’avais sonné trois fois en vain25. J’avais rappelé l’ascenseur dans l’intention d’aller me renseigner auprès de la concierge sur cette inexplicable absence. Et cet ascenseur, révisé depuis peu, comme on me l’apprit plus tard, s’était arrêté vingt centimètres au-dessus de l’étage, bloqué.
Je sonne une quatrième fois et j’entends une voix claire qui me crie : « Une seconde, j’arrive. » La même voix que j’avais entendue une semaine auparavant au téléphone. J’avais pensé : « Tiens, elle n’a pas de voix de téléphone. » Je veux dire ce ton neutre dont tout le monde use pour se garder de l’oreille inconnue qui, collée à l’écouteur lointain, vous scrute auditivement. Non, qu’elle soit au bout du fil ou derrière sa porte, Marie Dormoy est déjà tout entière dans la fraîcheur de ses intonations.
Robe sombre à grand col blanc. Yeux clairs dans un visage plein. Elle me fait entrer ; elle me laisse m’installer. Plus tard, lorsque nous serons en pleine conversation, elle s’écriera : « Vous ne fumez pas ? J’ai oublié… » Je lui ferai signe que je n’ai pas le temps, en agitant ma main droite armée du stylo. Car Marie Dormoy parle vite, sans mots superflus, et avec tant de charme quand elle se permet une digression qu’on a envie de suivre son discours à la trace, non par peur d’être distancé, mais par plaisir de Petit Poucet à recueillir tous les cailloux.
— Vous avez écrit un livre sur Léautaud et vous êtes, si je suis bien renseigné, son exécuteur testamentaire. Est-ce indiscret de vous demander quels ont été vos rapports personnels avec l’ermite de…
— De Fontenay. Ah quelle baraque ! J’ai vu Léautaud pour la première fois en 1917. J’avais été conduite auprès de lui par la femme de Boès qu’on appelait « la Chimère ». C’était une des Muses du symbolisme qui tenait un magasin face à la Sorbonne. Liée avec Rachilde. Le salon de Rachilde au Mercure, une vraie basse-cour ! j’avais lu naturellement les chroniques de Maurice Boissard dans la revue. On se demandait : « Qui est-ce ? » Et Dumur répondait : « Un de nos employés ! » Comme vous voyez, c’était le règne de l’artisanat et du désintéressement. Je me souviens que son aspect ne m’a pas étonnée. Il avait quarante-cinq ans et ressemblait déjà à un clochard…
Le clochard que je me rappelle avoir rencontré une seule fois, en 1949, si je ne me trompe26. J’étais avec un ami à l’angle de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain. Il pleuvait. « Tiens, voilà Léautaud », dit l’ami. Je vis un vieillard avec une canne dans la main droite et une filoche27 dans la main gauche. Le visage, où le reflet des lunettes mettait un éclat spirituel et froid, était dissimulé sous un capuchon pointu, en toile de sac, comme en portent les débardeurs. Étrange mélange de XVIIIe siècle, dans le détail de la physionomie et de gothique dans l’accoutrement.
— …Seconde entrevue en 1921. J’avais écrit un article sur l’enseignement de Bourdelle.
— Le sculpteur ?
— Oui, j’avais assisté souvent à ses leçons de la Grande Chaumière28. Il paraît que j’avais mal corrigé les épreuves. On me fait venir. J’étais inquiète. Léautaud a été tout sucre.
En 1925, je crois, des affaires plus importantes nous rapprochent. D’abord, le projet d’Ambroise Vollard de faire illustrer Le Petit Ami par Vuillard29. Une idée épatante. Vollard offrait 25 000 francs. Léautaud refuse. Ensuite, le projet d’achat du Journal Littéraire par la bibliothèque Doucet. À cette occasion, des dames du monde dont j’étais le guide ont fait le voyage de Fontenay. Quelle histoire !
Il y a un condensé de la voix de Marie Dormoy qui est son rire. Rire que je dirais à deux étages, tantôt cristallin et d’une spontanéité communicative, tantôt d’un ton plus bas, que je me risquerais à qualifier de sérieux et qui est moins le signe d’une insouciante gaîté qu’une invitation à deviner et à partager certaines arrière-pensées.
— Ce projet a aussi avorté. Mais je suis retournée quelquefois à « l’arche de Noé ». Il fallait surveiller ce Journal. Vous savez que Léautaud avait des crises de destruction. Il faisait des feux de ses papiers dans son jardin. Un mètre cube, par exemple, pendant la guerre. Et il avait encore ses fameuses crises de colère. Le fréquenter, c’était presque entrer en religion.
En 1934, j’ai publié Amour à 155 exemplaires, sur un papier de Vollard, avec une lithographie de Vuillard30. Bénéfice : 6 072 francs. J’ai remis 6 000 francs à l’auteur et j’ai gardé les 72 francs. Quant au Journal, j’ai proposé à Léautaud de le copier. Sa confiance était limitée. Il aurait voulu que ce fût quelqu’un d’étranger à la littérature qui s’en occupât. Ce souhait n’était pas stupide, mais allez trouver l’oiseau rare. Tout de même pas un vacher du Massif Central !
Il arrive souvent que Marie Dormoy émaille sa conversation d’expressions inattendues qui sont un peu comme une injection de suc campagnard dans la correction citadine du langage. (Il m’a toujours semblé que l’équilibre français était le même que celui d’Athènes : esprit délié sur fond rural.) Je note également, à propos de je ne sais plus quoi, un « ennuyeux comme la pluie et les mouches ». « Comme la pluie » est banal. Mais l’intervention des mouches indique le choix dans la comparaison et partant la lucidité dans la manière de qualifier l’ennui.
La question de l’achat du Journal s’est réglée en 1939. Comme la société Doucet venait d’être dissoute, on m’avait remis clandestinement 35 000 francs avec quoi j’ai conclu le marché. Marché de dupe : Léautaud me vendait quarante-cinq années de Journal, de 1893 à 1938 inclus, contre mille francs par an. Il me manquait donc 10 000 francs. Je les ai demandés à l’Université. Ils m’ont été refusés. Je m’en suis tirée à coups de tours de passe-passe. Après la Libération, pour les années 1939 à 1950 inclus, le prix a été porté à 10 000 francs par an. Ce n’était pas lourd. Mais je tenais à remettre l’argent à Léautaud par petits paquets. Avec les 6 000 francs d’Amour, il avait acheté des fauteuils Louis XVI et un paravent de papier31.
La publication a débuté en 1954. Léautaud désirait que le Journal parût au Mercure de France par fidélité à la maison où il a passé sa vie. Dès 1933, un traité avait été négocié entre Vallette et lui à ce sujet32. Le premier volume a été édité à la suite d’un troc. M. Hartmann avait sollicité le droit de rééditer Le Petit Ami. Léautaud accepta puis fut furieux d’avoir cédé. Hartmann proposa de rendre Le Petit Ami et de prendre le Journal à la place. Il était indiqué d’en publier le premier volume avant la mort de son auteur33.
— Que pensez-vous de la valeur de cette œuvre ?
— Si je me suis attachée au Journal de Léautaud, c’est que j’y voyais une œuvre unique, un document « authentique » au sens gidien du terme, comme on n’en a jamais vu jusqu’ici, comme on n’en verra peut-être plus jamais, car peu d’hommes, je pense, peuvent consentir à se dénuder ainsi. Quant à la forme sous laquelle cette œuvre nous est parvenue, j’ajouterai ceci : il s’agit d’un recueil de notes prises au jour le jour que Léautaud avait toujours eu l’intention de récrire et de compléter. Il l’a effectivement fait jusqu’à l’année 1905. Puis il a négligé de continuer. Notez qu’il est permis de se féliciter de la chose : Léautaud manquait de clairvoyance en ce qui le concernait et son travail de révision n’aurait sans doute pas toujours été sans défaut. Quoi qu’il en soit, il nous reste aujourd’hui à livrer tel qu’il est ce journal au public. À lui de juger, d’y trouver des longueurs, des redites indéniables. À lui aussi d’imaginer, en le lisant, ce qu’il aurait pu être.
Georges Piroué
Notes
1 Marie Dormoy est née en novembre 1886, près de quatorze ans après Paul Léautaud. La première série de chroniques théâtrales de Paul Léautaud a été publiée dans le Mercure d’octobre 1907 à janvier 1921, totalisant 112 numéros.
2 Dans un entretien avec Georges Piroué dans le Mercure de janvier 1960 (annexe I), Marie Dormoy dira : « J’ai vu Léautaud pour la première fois en 1917. J’avais été conduite auprès de lui par la femme de Boès qu’on appelait “la Chimère”. » La « Chimère » en question était Marguerite Boès, épouse de Karl Boès, directeur de La Plume. Les circonstances de cette première rencontre n’ont pas été notées par Paul Léautaud. Il a noté ce que Marie Dormoy indique comme deuxième rencontre, cinq ans plus tard, début avril 1922. Journal littéraire au mardi quatre avril : « Visite d’une dame, auteur d’un article sur Bourdelle, venue me demander à revoir ses épreuves pour un ajouté. Une amie de Mme Boès. Elle a deviné qui j’étais et m’a dit que Mme Boès devait nous faire nous connaître. Tout à fait charmante. Elle est restée deux minutes et je n’ai même pas retenu son nom. » Cet « article sur Bourdelle » est paru dans le Mercure du premier mai 1922, page 684.
3 Note de Marie Dormoy : « Les dates que nous donnons ici et l’enchaînement des faits peuvent paraître fantaisistes. La cause en est que Léautaud, qui se targuait d’une mémoire infaillible, attribua souvent, au même fait, des dates et des causes différentes. Nous avons choisi ceux et celles qui nous ont semblé, grâce à des recoupements et à des comparaisons, les plus véridiques.
4 Des bandes d’adresses d’expédition qui entouraient les journaux. Paul Léautaud retrouvera cette activité au Mercure pendant plusieurs années.
5 Sans doute davantage, soit six journées de dix heures. La « semaine anglaise » libérant le samedi après-midi, n’interviendra qu’en 1917.
6 Antonio de La Gandara (1861-1917) a été admis en 1878 — à dix-sept ans — à l’École des beaux-arts de Paris avant d’exposer au salon de 1882. En 1885 Antonio de La Gandara a la chance de réaliser un portrait pour Robert de Montesquiou. Ce portrait (de nos jours exposé au musée des beaux-arts de Tours) plait au mécène qui présente le peintre à ses amis, entraînant la gloire et la fortune. En 1904, Antonio de La Gandara a réalisé un portrait d’André Rouveyre.
7 D’origine paysanne pauvre, Thérèse Daurignac (1855-1918) parvient, en 1878, à épouser Frédéric Humbert, fils du maire de Toulouse. En 1879, elle prétend avoir reçu une partie de l’héritage de Robert Henry Crawford, millionnaire américain. Dès lors, les Humbert obtiennent d’énormes prêts en utilisant le supposé héritage comme garantie. Cette escroquerie dure une vingtaine d’années jusqu’à ce qu’un juge fasse ouvrir le coffre-fort où sont censés se trouver les documents prouvant l’héritage. Le coffre ne contient qu’une brique et une pièce d’un penny. Les Humbert fuient en Espagne où ils sont arrêtés en décembre 1902. Les deux époux sont condamnés à cinq ans de travaux forcés. À sa libération de prison, Thérèse émigre vers les États-Unis et meurt à Chicago en 1918.
8 Il y a deux Lebey. André Lebey (1877-1938), écrivain aussi méconnu que prolifique (un livre par an dont quelque biographies entre 1895 et 1937). C’est de son oncle, Édouard Lebey (1849-1922), ancien directeur de l’agence Havas, dont il est question ici. Victime, en 1900, d’une maladie neuromusculaire grave, le rendant très dépendant, Édouard Lebey se faisait aider par Paul Valéry, qui s’est parfois fait remplacer par Paul Léautaud.
9 Journal littéraire au douze juin 1907 : « Conversation peu gaie avec Vallette et Gourmont. Je renonce décidément à publier mon Passé Indéfini, malgré la mise en pages toute prête pour le bon à tirer. J’ai tout ce qui compose Amours en horreur. J’ai écrit cela trop vite, comme un travail commandé. Quels moments j’ai passés ! Au point de planter tout là et d’aller flâner dehors pour n’y plus penser. »
10 Des fragments de ce Passé indéfini paraîtront pourtant dans La NRF de juillet 1870, présentés (et sans doute choisis) par Marie Dormoy. Le texte peut en être demandé ici.
11 Paul Morisse (1866-1946) est aujourd’hui connu pour être le traducteur des Hymnes à la nuit de Novalis en 1908 (voir le Journal littéraire au 26 octobre 1908) et aussi de Stefan Zweig pour son Émile Verhaeren, sa vie, son œuvre en 1910. Voir André Billy, Le Pont des Saint-Pères, Fayard 1947, pages 35-37. On ne confondra pas Paul Morisse avec Charles Morice.
12 Paul Léautaud avait emménagé au dernier étage du 17 rue Rousselet le huit avril 1905 pour se réinstaller avec Blanche. La rue Rousselet est desservie par le métro Vaneau. Pour se rendre à pieds au 26 rue de Condé, prévoir 25 minutes.
13 On pourrait penser à Eugenio Díaz Romero (1877-1927), poète et journaliste, correspondant du Mercure à Buenos Aires et fondateur du Mercure d’Amérique. EDR a tenu au Mercure de France treize rubriques des « Lettres hispano-américaines » de mai 1901 au seize janvier 1908. Mais corriger le dix pour une parution le seize est peu vraisemblable. Une erreur de date est possible.
14 Remplacé de « second » dans le texte du Mercure. Il y avait un troisième étage, partiellement occupé par Louis Dumur et même un espace sous les combles, dévolu aux stocks de livres.
15 Remy de Gourmont travaillait alors à la Bibliothèque nationale, sur l’autre rive.
16 Par un lupus tuberculeux. Voir le Journal littéraire au neuf novembre 1905 : « Van Bever m’a raconté lundi soir l’histoire de la maladie de Gourmont »
17 Allusion vraisemblable au récit de Maurice Boissard dans sa chronique dramatique parue dans le numéro de La NRF du premier avril 1922 réservée à deux représentations du Misanthrope, une interprétée par Louis Jouvet et l’autre par Lucien Guitry : « Le Misanthrope, c’était encore Remy de Gourmont, comme je l’ai vu […]. Au Mercure, un soir, dans mon bureau, que nous étions là à bavarder comme nous le faisions chaque jour, quelqu’un entra. C’était M. Victor Barrucand. Il reconnut Gourmont. Sans doute heureux de cette rencontre et de se faire connaître, il s’approcha, face à lui. Il s’inclina, son chapeau à la main : “Monsieur de Gourmont… Je suis M. Victor Barrucand.” Gourmont leva à peine la tête : “Qu’est-ce que vous voulez que cela me fasse ?” puis se souleva et son fauteuil en même temps en le tenant des deux mains, fit un demi-tour et se rassit le dos tourné à l’importun. » Dans le numéro de La NRF de juin 1922, page 763, Victor Barrucand démentira.
18 Lire au deux novembre 1905 à propos d’In Memoriam.
19 Journal littéraire au 17 janvier 1908.
20 Journal littéraire au 18 décembre 1909.
21 Au début de 1912.
22 Anne Cayssac
23 Cette question est surprenante, le Mercure de France ayant cessé de paraître après juin 1940 pour ne reparaître que bien après la Libération, en décembre 1946. Lire ici-même le travail de Julien Doussinault sur le Mercure de France dans cette époque tourmentée
24 Le 26 septembre 1941.
25 Depuis octobre 1934, Marie Dormoy habitait au six avenue Paul Appell, tout au sud de Paris, au dernier étage d’un de ces immeubles de briques que l’on construisait alors sur les emplacements des anciennes fortifications.
26 Le nom de Georges Piroué (1920-2005) n’apparaît pas dans le Journal littéraire.
27 La filoche en question est le terme populaire, peut-être issu d’une marque commerciale, désignant un filet à provision. Ce mot est aussi utilisé par les pêcheurs et les chasseurs de papillons.
28 Cette académie de peinture (et donc de sculpture) se trouvait depuis 1904 au 14 de la petite rue de la Grande chaumière, qui est le nom d’un ancien bal, près du carrefour Vavin. Cette académie est encore en activité de nos jours et sert parfois de décor pour des films.
Ajout de juin 2025 : Concernant la disparition de cette académie de peinture, lire l’article du Monde du quatre juin 2025 : « L’Académie de la Grande-Chaumière, à Paris, au cœur d’une polémique sur la préservation du patrimoine ». Cet article est sous-titré : « Cette école du quartier de Montparnasse, foyer historique de la vie artistique et intellectuelle de la capitale française au XXe siècle, doit quitter les lieux, où le nouveau propriétaire veut lancer son propre projet culturel. »
29 Édouard Vuillard (1868-1940), peintre, dessinateur, graveur et illustrateur. Édouard Vuillard réalisera, le 23 juin 1934 un portrait (lithographie) de Paul Léautaud dans son bureau du Mercure, destiné au frontispice d’Amour, qui paraîtra aux éditions Spirale le vingt décembre 1934.
30 Une autre édition a été produite par le Mercure de France, achevé d’imprimer du quatre février 1939, sans la lithographie d’Édouard Vuillard.
31 Journal littéraire au deux mars 1935 : « Je me suis acheté un paravent XVIIIe assez joli, et deux fauteuils Louis XV, copie, pas laide, d’une jolie simplicité. Achat que je regrette ce soir. Pour 1 000 ou 1 200 francs de plus, j’aurais pu trouver des fauteuils médaillon Louis XVI — ce que je désirais, d’ailleurs — d’époque. Je ne serais pas mort de ce surplus. » Il semble que cet achat comprenait en outre une bergère Directoire (Journal au 24 octobre). Lire aussi la note de Marie Dormoy à la lettre de Paul Léautaud datée du 21 février.
32 Note d’Édith Silve, Journal particulier au six août 1933 : « C’est en juin 1932 que Marie a parlé pour la première fois à Léautaud d’un éventuel achat du Journal littéraire par la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Le Journal littéraire s’en fait longuement l’écho. Marie n’aura de cesse désormais de s’employer à amener Léautaud à effectuer ce dépôt. En 1943, Marie fera acheter par la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet les années 1893-1938 du Journal littéraire. En 1950, la bibliothèque achètera les années 1939-1949. Un mystère épais plane sur les dernières années 1950-1956 de ce journal. » Voir au six juin 1932 et les correspondances avec Paul Valéry s’en suivant.
33 Ce seront deux volumes qui paraîtront avant la mort de Paul Léautaud, les 22 décembre 1954 et premier mars 1955. Le troisième volume est paru le premier avril 1956, trente-neuf jours après sa mort, le 22 février.