Texte publié le premier octobre 2023. Temps de lecture 24 minutes avec les deux interventions ultérieures.
Intervention de Jean-Luc Souloumiac.
Intervention de Dominique Brouttelande.
En mars 1895, après avoir travaillé quelques temps chez le gantier Berr, Paul Léautaud est engagé comme troisième clerc dans l’étude de Léon Barberon, avoué, 17 quai Voltaire. Il y est resté sept ans. Cette expérience a été très formatrice et, sa vie durant, Paul Léautaud en a conservé le bénéfice, qu’il serait intéressant de faire saillir.
Sept ans après, le seize janvier 1902, Léon Barberon meurt avant sa 59e année. L’étude est rachetée et le nouveau propriétaire n’aime pas Paul Léautaud qui doit démissionner.
Lettre à Paul Valéry datée du 28 janvier 1902 :
Le père Barberon est mort, nous l’avons enterré samedi dernier et je suis presque à la veille de me trouver sans place. Déjà, depuis plusieurs mois, ma situation à l’étude était difficile. Mon principal ayant acheté une charge, le patron me faisait sentir davantage sa mauvaise humeur d’avoir un clerc comme moi. Le nouveau principal — un jeune millionnaire qui n’a de considération que pour les gens qui ont de la fortune — avait aussi à mon égard des façons toutes spéciales, comme par exemple de me répéter ce que m’avait dit le patron en réponse à une demande d’augmentation : qu’on n’était pas clerc d’avoué pour gagner sa vie et qu’il ne me gardait que par égard pour ma situation. […] Je suis donc en train de me préoccuper d’une autre place, pour éviter d’être remercié…
Nous avons une lettre de demande d’emploi datée du 18 février adressée à plusieurs éditeurs.
Fin avril 1902, Paul Léautaud a démissionné de l’étude Barberon pour être embauché début mai (le jeudi premier mai ou le lundi cinq) comme secrétaire dans l’étude de Monsieur Lemarquis, administrateur judiciaire, trois rue Louis-Le-Grand, loin du lycée, entre l’avenue de l’Opéra et la rue de la Paix, dans un bel immeuble qui existe encore.
Lettre à Paul Valéry datée du quinze mai 1902 :
Ce n’est pas fameux, ah ! non, comme appointements ni comme avenir. On y est tenu avec une vraie rigueur et il y a un travail du diable.
Cette surcharge de travail lui convient d’autant moins qu’il est absorbé par la rédaction du Petit Ami qui paraîtra à la rentrée dans trois numéros du Mercure.
Lettre à Paul Valéry datée du onze novembre 1902 :
…dans cette étude Lemarquis, je tourne de plus en plus à l’homme-vapeur, et d’autre part, Vallette me réclame mon paquet.
Ce « paquet » est l’édition définitive du Petit Ami qui paraîtra en volume le 18 février 1903. Journal littéraire à cette date :
Le Petit Ami a paru — 1 089 exemplaires — aux étalages des libraires cette après-midi, vers trois heures, environ trois exemplaires à chacun.
Ce même 18 février 1903 paraît chez Charpentier, en deux tomes, Vérité, le troisième et dernier des Quatre Évangiles d’Émile Zola, mort le 29 septembre dernier. Premier tirage : 40 000 exemplaires.
Cette publication, cet impérieux désir d’écrire, donnent à Paul Léautaud le sentiment de s’être engagé dans une impasse avec cet emploi mal payé qui lui prends tout son temps. Il a trente ans passés, il fréquente le monde littéraire où on le voit de plus en plus souvent. En plus de ces quatre Essais, il a partagé les Poètes d’aujourd’hui avec Adolphe van Bever et écrit son Petit Ami. Il fréquente le salon de Rachilde1, y rencontre Henri de Régnier, qui le félicite pour les Poètes d’aujourd’hui2, comme pour Le Petit Ami3, lui envoie ses livres4. Il fréquente Marcel Schwob, écrit à André Gide5, à Auguste Gilbert de Voisins6. Marcel Schwob lui présente Édouard Champion7, il dîne chez les parents de Jean de Tinan8 avec Henri Albert9…
Il est temps de quitter ce travail de secrétariat qui lui prend tout son temps et l’empêche d’écrire.
Donc, le huit avril 1903 :
Donné aujourd’hui ma démission à l’Étude Lemarquis pour la fin du mois. Je ne ris pas. Que va-t-il advenir de ce moi si peu hardi, si peu illusionné sur son propre compte, lancé en pleine littérature ? Mais s’y lancera-t-il vraiment, du reste ?
À l’occasion de la publication de fragments de son Journal dans le Mercure de mai 1940 (pages 265-566), Paul Léautaud inscrira une note sous cette journée du huit avril 1903 :
La vérité est que je donnai ma démission dans les conditions suivantes. On m’avait promis de l’augmentation à la fin de ma première année. Entre-temps, mon collègue comme secrétaire, un nommé R…, avait volé à l’étude, au moyen d’écritures truquées et de signatures imitées, une somme de 42 000 francs. Quand cela se découvrit, alors qu’il était en vacances, je m’empressai de remettre au fondé de pouvoirs quelques papiers que R… m’avait donnés à lui garder, en disant que je les avais pris sans me douter de rien, et que, d’ailleurs, si j’avais su quelque chose, je n’aurais rien dit, mon métier n’étant pas de dénoncer les gens. La fin de ma première année de présence arrivée, je priai ce fondé de pouvoirs de vouloir bien rappeler à M. Lemarquis sa promesse d’augmentation. Il s’y refusa en ces termes : “Je ne m’occupe pas des gens qui approuvent les voleurs”. C’était interpréter tout de travers ce que je lui avais dit. Je le lui répétai et j’ajoutai que, puisqu’il se refusait à transmettre ma demande, je donnais ma démission. En fait, sur la demande de M. Lemarquis, je continuai à venir à l’Étude les après-midi, jusqu’au règlement final d’une affaire dont j’étais chargé10.
Cette affaire importante était l’affaire Dehaynin.
Dans son Journal, Paul Léautaud en donne des détails au jour le jour mais c’est dans les Entretiens avec Robert Mallet qu’il en brosse une description générale (début de la cinquième émission et page 47 de l’édition Gallimard de 1951) :
RM : Vous avez eu d’autres affaires importantes à traiter ?
PL : Oui, j’ai eu la succession Dehaynin de près de deux millions à liquider.
RM : Deux millions, pour l’époque, c’était une somme !
PL : Lemarquis m’a dit : « Voilà le dossier. Tâchez qu’il en reste le plus possible pour l’héritière. » Il y avait quinze ans que les créanciers attendaient, c’étaient des couturiers, des chapeliers, des commerçants de luxe. Cette femme — Mme Dehaynin — était extraordinaire. Alors, j’ai convoqué les créanciers par séries. Certains avaient une créance, par exemple, de 50 000 francs. Alors, je leur disais : « La succession n’est pas brillante, vous savez… Je vous offre 15 000 francs. » « Monsieur, c’est indigne ! Une marchandise que j’ai payée ! Voilà quinze ans que j’attends ! » « Je n’y peux rien. C’est comme ça. » Alors, ils s’en allaient, d’autres revenaient. On payait intégralement ceux qui ne cédaient pas…
RM : Et ceux qui avaient cédé ?
PL : Eh bien, tant pis pour eux.
RM : Alors, vous travailliez à cette sorte de duperie ?
PL : C’était le métier. On est arrivé au mieux, c’est-à-dire à payer le moins possible.
RM : En sorte que les plus exigeants étaient favorisés ?
PL : Vous comprenez, il fallait la mainlevée de tous les créanciers pour retirer les fonds. Alors, on était intéressé à l’avoir. Quand nous voyions des gens solides sur leurs pieds qui disaient : « Moi, je veux être payé intégralement », il fallait bien payer. Il n’y a qu’un très vieux jardinier qui est venu et à qui j’ai dit : « Vous, on vous paie avec les intérêts.»
RM : À quel sentiment obéissiez-vous ?
PL : Parce que cet homme m’était sympathique. Enfin, c’était un malheureux, n’est-ce pas, qui vivait pauvrement, qui avait travaillé et qui n’avait jamais été payé. Vraiment ! Tandis que les couturiers de la rue de la Paix, les chapeliers de luxe ne me faisaient pas pitié. Ces gens qui faisaient des affaires et qui avaient eu souvent de gros bénéfices pouvaient participer à des pertes.
RM : Alors, vous avez voulu que ce pauvre homme ne soit pas perdant.
PL : Après quinze ans, il ne s’attendait pas à ça !
RM : Dans ces affaires importantes, M. Lemarquis vous laissait donc une grosse responsabilité.
PL : Oui. Il avait toute confiance en moi.
Lisons maintenant cette affaire telle qu’elle est relatée dans le Journal.
Nous nous souvenons que c’est le huit avril 1903 que Paul Léautaud a donné sa démission de son emploi de l’étude Lemarquis et pourtant ce n’est que près de deux ans plus tard, le premier février 1905 que le nom de Madame Dehaynin apparaît dans le Journal. Ces affaires de succession prennent un temps fou.
Mercredi premier février 1905
Voyage à Beauvais, chez un M. Hercelin, avec Mme Dehaynin et son petit jeune homme, qui s’appelle, si j’ai bien entendu, Paul Wertheimer. Voyage ayant pour but un emprunt, encore, sur les droits dotaux de Mme Dehaynin11.
Avant le train, je les ai accompagnés au buffet de la gare du Nord et après leur repas, Mme Dehaynin désirant finir sur du chocolat, je lui ai offert un des deux inséparables Grondart12 dont j’avais fait provision. Cela m’a amené à être renseigné sur le petit jeune homme. Dans le wagon elle continuait à pignocher son chocolat : « T’en veux, coco ? » lui a-t-elle dit. Coco en a accepté un petit bout.
Au retour, à Creil, pendant l’arrêt pour le changement de train, confidence de Mme Dehaynin. Ils doivent se marier. « Ce n’est pas une beauté, me dit-elle, mais il est si bon ! » Elle ne m’a pas dit à quoi. La pauvre femme. Il a vingt-trois ans, elle en a au moins trente-cinq. Quelle illusion ! Elle paraît l’adorer, si peu joli qu’il est. Comme elle me recommandait de ne rien lui dire de mes craintes sur la réussite de l’emprunt : « Il est aussi d’une famille riche, paraît-il. À ce point qu’il cherche à emprunter 100 000 francs sur ses droits. » Rien que ça ! Tout cela, comme l’argent de l’emprunt présent, pour faire la fête ensemble. J’aurais bien tort d’avoir des scrupules à accepter une commission.
Rentré à Paris à six heures moins le quart. En fiacre chez Pamaron, rue de Magdebourg13. Pamaron encore à son bureau. En fiacre Chaussée d’Antin. Le petit jeune homme assis sur le strapontin, en face Mme Dehaynin, qui le calait dans ses jambes. Une de ses mains ne se voyait plus, passée sous sa robe à elle, et tous deux se regardant avec des yeux ! Ils ne se gênaient vraiment pas. Je finissais par en avoir assez de regarder par la portière, pour ne pas les déranger.
Vendredi 17 Février 1905
Après bien des démarches, des courses, des accrocs, l’emprunt Dehaynin est chose faite. Mme Dehaynin a touché cette après-midi et m’a versé ma commission : 2 500 francs.
Vendredi 13 Octobre
Vu M. Lemarquis. Langlois, l’homme d’affaires bien connu par l’affaire Humbert, vient de mourir. M. Lemarquis est nommé à l’effet de représenter à l’inventaire la Société dont Langlois était liquidateur. J’aurai à aller sur place faire des notes sur les dossiers.
D’autre part, dans l’affaire Cronier-Say, M. Lemarquis me demande s’il me va d’aller à la Nationale consulter des journaux au sujet d’une polémique qui aurait tendu à représenter les héritiers Say comme au courant des spéculations de M. Cronier, lequel n’aurait plus été, en quelque sorte, que leur mandataire tacite14. C’est entendu. Dès cette après-midi inventaire Langlois, et ensuite chaque matin pour les dossiers… D’ici quelque temps, à la Nationale l’après-midi, pour les recherches Say.
Dimanche 12 Novembre 1905
Dîné avec Bl…15 chez Mme Dehaynin, à l’hôtel meublé où elle se cache, Hôtel de Florence, 26, rue des Mathurins16. Après le dîner, petite conversation dans le salon de l’hôtel. Mlle Marcelle Dehaynin, accompagnée au piano par sa mère, nous danse quelques Cake-Walk, la Matchiche, etc.
Lundi 20 Novembre
Depuis le 9 courant, je vais chaque après-midi travailler avec Lavialle17 à la Nationale à mes recherches dans les journaux pour M. Lemarquis, affaire Cronier-Say. Aujourd’hui, Gourmont18 m’aperçoit en arrivant. Il vient me dire bonjour et me demande si je pars à 4 heures, pour remonter ensemble. Au moment de partir, je m’aperçois que j’ai besoin d’aller à l’étude, et je vais à sa place, le lui dire. « Mais, dites donc, me dit-il, je vais y aller avec vous, chez Lemarquis. » Nous partons ensemble. Arrivés rue Louis-le-Grand : « Je vais entrer avec vous, hein ? Cela m’amusera de voir comment c’est. » Si bien qu’il est entré avec moi et s’est assis sur la banquette du public, pendant que je cherchais des pièces dans le dossier Dehaynin sur mon bureau. Sa mise, son visage, sa tournure, comme on n’en voit pas souvent, attirent les regards. Mahaud, le principal, vient à moi, pendant que je cherche dans mon dossier et tout bas, en le regardant : « C’est encore un usurier de Madame Dehaynin ? » — tant il est habitué à me voir en affaires avec des gens de cette sorte. Je réponds « Mais non, mais non » en éclatant de rire et en regardant Gourmont, qui regarde paisiblement le va-et-vient de l’étude.
Mercredi 29 Novembre
J’étais passé vers cinq heures à l’étude Lemarquis, pour demander à M. Lemarquis si je devais toujours continuer à fouiller les journaux pour l’affaire Cronier-Say. M. Lemarquis pressé ne peut me parler sur place. Il me dit de l’accompagner, qu’il va prendre une voiture19, que nous bavarderons ensemble pendant le trajet. Je l’accompagne. Il me parle de l’affaire. Les recherches sont désormais inutiles. Il a obtenu un quitus de la Société Say. Nous parlons de Cronier. Je lui dis qu’il a dû avoir cinq minutes pas drôles, avant de se tuer… M. Lemarquis me répond : « Quant à moi, je ne me sens guère le courage de le blâmer, étant donné… » À ce moment, nous étions arrivés rue de Lisbonne à l’Hôtel Cronier. Nous descendons de voiture, M. Lemarquis me dit d’entrer avec lui si je veux et nous entrons. L’hôtel plongé dans l’obscurité, sauf un grand salon où les gens de loi travaillent, notaire, commissaires-priseurs, experts, clercs à chacun, et maintenant M. Lemarquis lui-même. Dans le vestibule, des meubles, des candélabres, à moitié emballés, de la paille sur les rampes de marbre, les tapisseries descendues des murs, dans toutes les pièces le désordre, le déménagement. Toute une famille vécut là, riche, puissante, heureuse peut-être, puis un soir, rentrant là, seul, un homme se tua. Jaluzot20 a plus d’estomac. Ce n’est pas lui qui se tuera jamais : il est au-dessus de l’honneur. Il avait une jolie figure intelligente et distinguée, ce Cronier.
Je pense que la fin de la réponse de M. Lemarquis devait être : « … étant donné que cela m’a rapporté une belle affaire. »
Jeudi 30 Novembre 1905
Aujourd’hui je suis allé à Beauvais, chez Herselin, pour la négociation d’un nouvel emprunt de Mme Dehaynin. Je m’assomme décidément en chemin de fer.
Mardi 12 Décembre
Reçu ce matin une lettre de Mme Dehaynin m’avisant que son hôtelier, après lui avoir coupé la nourriture, l’avait, devant le défaut d’argent qu’elle lui montrait, invitée à décamper au plus tôt — et me demandant de venir la voir vers cinq heures, muni autant que possible d’un grand carton pour lui sortir quelques affaires. Cette idée de me faire traîner un carton sous le bras, de la rue Rousselet à la rue des Mathurins !… Je suis allé la voir sans carton. En effet, obligée de déguerpir. Elle a arrêté une chambre un peu plus loin, dans un autre hôtel, rue de l’Arcade21, où, dit-elle, elle va fourrer sa tante et sa belle-sœur, pour se retirer, elle et les deux enfants chez une cousine. J’ai dû tout de même faire comme eux tous le déménageur clandestin. On m’a passé, sous mon pardessus, un manteau de femme. Dans les poches de ma jaquette, plusieurs lots de papiers. Dans les poches de mon pardessus, de l’argenterie. Dans mes bottines, me faisant comme des guêtres d’acier, au moins une douzaine de couteaux à manches d’argent, et sur l’estomac, mon pardessus croisé dessus, deux sortes de larges toques de femmes. Sans oublier une serviette de cuir, sous le bras, et encore pleine de papiers. De là je suis allé dans cet équipage avec Mme Dehaynin à l’hôtel de la rue de l’Arcade, où, pour expliquer tout sans rien dire, Mme Dehaynin, en me parlant devant les gens, me parlait comme au fils de sa tante et au frère de sa belle-sœur, les ayant fait passer elles deux comme la fille et la mère. Après deux voyages, et avoir été forcé de m’arrêter en route pour retirer d’un de mes souliers un couteau à découper dont la pointe m’entrait dans le pied, je suis parti, m’étant laissé enlever la promesse de revenir recommencer demain matin.
Mercredi 13 Décembre 1905
Ce matin, fait encore deux voyages de déménagement furtif avec Mme Dehaynin, ou plutôt Mlle Dehaynin, car c’est en sa compagnie que j’ai fait deux fois le trajet, ce matin.
Samedi 21 Juillet 1906
J’avais reçu ce matin un télégramme de Mme Dehaynin, me demandant d’aller la voir sans faute à sept heures, et dîner avec elle, avec Bl…. Justement Maurice22 venait dîner. J’y suis allé seul, une demi-heure. Un hôtel chic, Splendid-Hôtel, du reste, avenue Carnot23. Mme Dehaynin va encore faire là quelque escroquerie pour un millier de francs. Je suis de mieux en mieux avec elle, libre parler, etc… Je lui ai dit deux mots de la bonne manière pour se tirer d’affaire, quand on est une jolie femme. Elle avait l’air de ne pas comprendre. J’ai appuyé un peu. À quoi elle m’a répondu que pour cela il faudrait avoir des relations, etc… — car la galanterie ordinaire, non. Et comme elle n’a plus guère de toilettes et que les relations se sont faites rares ! Nous irons dîner avec elle, Bl… et moi, demain dimanche soir.
Dimanche 22 Juillet 1906
Dîner avec Mme Dehaynin et sa fille. Nous rions tout en dînant, du bon dîner que nous faisions et qui lui coûterait si peu, en fin de compte. Quel caractère d’aventurière ! Elle me disait qu’elle se faisait fort d’aller vivre deux mois sur la meilleure plage sans bourse délier, tant elle savait entortiller les gens, qui ne pouvaient que la laisser partir, le coup fait. « Quand je serai usée ici, me disait-elle, j’ai envie d’aller à l’Hôtel Ritz. » Après dîner, nous sommes allés au salon de l’hôtel. Nous étions seuls. Mme Dehaynin s’est mise au piano et nous a chanté La femme à papa, La Mascotte, Madame Angot24. Toute une vieille époque de plaisir, de cascades — et quelques bonnes minutes pour moi. Il paraît que les procès Héraus et créanciers sont remis au 6 novembre.
En 1907 nous ne lirons rien sur Madame Dehaynin et en janvier 1908, Paul Léautaud est embauché par Alfred Vallette comme secrétaire au Mercure de France ce qui fait qu’on peut croire cette affaire terminée. Mais non.
Samedi 25 avril 1908
Mme Dehaynin m’a récrit, pour me parler d’une nouvelle combinaison pour se procurer de l’argent. Il y a bien deux ans que je n’avais de ses nouvelles. Je n’ai pas encore eu le temps de lui répondre. J’ai peu de confiance dans une réussite. Quant aux moyens d’y arriver ? J’ai bien oublié l’affaire. Je n’ai plus le dossier ni la facilité de l’avoir à l’Étude Lemarquis, etc., etc…
Elle me donne son adresse, mystérieusement, comme un secret à garder, 16, avenue Carnot25, avec une invitation à déjeuner pour avant-hier, hier ou aujourd’hui, à mon choix. Il faudrait bien au moins que j’aille voir ce dont il retourne.
Dimanche 26 Avril
Été voir ce matin Mme Dehaynin, 16, avenue Carnot, dans un petit appartement meublé au premier, vraie installation d’hôtel, désordonnée et bohème. Elle vit là avec sa fille, et la fameuse tante, en réalité sa mère. Elle m’a dit que c’est Paul Wertheimer26 qui subvient à ses besoins. Elle m’a encore dérangé pour rien. Elle a rencontré il y a quelques jours l’usurier Berr27. Il lui a offert ses services. Elle s’est emballée là-dessus, croyant toujours qu’elle a des fonds à lui revenir. J’ai essayé de lui faire comprendre que Berr, quand il verra les chiffres, se dérobera certainement, sans y réussir beaucoup. Elle va arranger un rendez-vous avec lui.
Elle était très jolie ce matin, pleine de jeunesse.
Elle s’est défendue d’avoir fait de nouvelles dettes. Je n’en crois rien. Non plus que son entretien par le petit Wertheimer. Il est tout l’opposé d’un homme qui donne de l’argent à une femme. Il a bien fallu qu’elle vive tout le temps depuis que je ne l’ai vue. Elle cache soigneusement son adresse actuelle, bien qu’elle soit en meublé et qu’elle ne puisse être saisie. Il faut donc qu’elle craigne de nouvelles oppositions chez Lemarquis. Malgré tout ce qu’elle soutient qu’il ne s’en est pas produit.
Vendredi 9 Octobre 1908
Reçu ce matin une lettre bien intéressante de Mme Dehaynin. Elle me parle de sa liaison avec le petit Wertheimer. Il y a un beau cri : « C’est Biribi, avenue Carnot. » Il faut vraiment qu’elle passe par une vraie crise pour me faire de ces confidences. Je garde cette lettre de côté. Si je parle un jour en détail de Mme Dehaynin, c’est un document.
PL continuera de voir Madame Dehaynin et de lui rendre de menus services, comme le quinze octobre, une course chez un couturier. En 1972, à l’occasion du centième anniversaire de Paul Léautaud, la BNF a présenté une lettre de Madame Dehaynin à Paul Léautaud. Il s’agissait de la pièce numéro 52 dont voici le commentaire : « Léautaud eut la succession Dehaynin à liquider. Depuis quinze ans des créanciers attendaient. Le rôle de Léautaud fut de les convoquer pour régler tout, au mieux pour l’héritière. / L’affaire à peine liquidée, Madame Dehaynin était à nouveau ruinée. Par cette lettre elle fait appel à Léautaud pour l’aider à la tirer d’affaire. »
4 Août 1909
Déplorable journée. Règlement de ma créance Dehaynin. Par ma distraction, oubli que j’étais porté pour 3 000 frs, et un excès de délicatesse ridicule, et aussi une sorte de veulerie momentanée, alors que hier soir je réglais ma conduite sur la connaissance que j’ai du caractère peu résistant de Mouillefarine. Par tout cela, j’ai perdu 300 francs, pour ne pas dire 500.
Nous n’entendrons pratiquement plus parler de Madame Dehaynin et c’est heureux parce qu’on commence à n’y plus comprendre grand’chose. Il faut aller chercher dans le Bestiaire pour avoir des nouvelles, à la date de « Samedi » (peut-être le neuf octobre 1909).
Samedi
J’ai eu à aller cette après-midi voir le secrétaire de M. Lemarquis pour l’affaire Dehaynin, à la Banca espagnole rue Saint-Georges. Défense de monter avec un chien et j’ai dû attacher Ami dans la cour. Quelle fête il m’a faite, quand je suis venu le reprendre, après plus d’une demi-heure.
Nous ne lirons plus rien dans le Journal littéraire, sauf quelques réminiscences, çà et là.
Notes
1 Journal littéraire au deux décembre 1902.
2 Lettre d’Henri de Régnier à Paul Léautaud datée du 29 janvier 1901.
3 Remerciement de Paul Léautaud à Henri de Régnier daté du 14 janvier 1903.
4 Lettres de Paul Léautaud à Henri de Régnier des six octobre 1901, 29 avril et 15 novembre 1902, six avril 1903…
5 Lettre du 23 mars 1903.
6 Sans savoir, semble-t-il que Gilbert de Voisins est le nom de famille d’un homme de lettres (1887-1939) prénommé Auguste.
7 Journal littéraire au cinq avril 1903.
8 Journal littéraire au sept avril 1903.
9 Henri Albert (Henri-Albert Haug, 1869-1921) signait de ses seuls prénoms et beaucoup pensaient ainsi qu’il se nommait Albert. Spécialiste de Nietzsche et auteur Mercure depuis 1891, il y tint une rubrique de « Lettres allemandes » de janvier 1893 à juin 1921. Dans d’autres journaux il utilisait parfois le pseudonyme de Matin Gale. Lire, à l’occasion de sa mort, un court portrait dans le Journal littéraire au trois août 1921.
10 Paul Léautaud évoquera cette affaire dans des termes similaires lors des Entretiens avec Robert Mallet (page 48) mais indique « le matin ». Voici le texte des Entretiens à propos de cette affaire : « J’avais, en face de moi, un collègue qui s’appelait R… Il s’en va en vacances, pendant un mois. Et puis, au bout de quelque temps, je m’aperçois que le fondé de pouvoir et le comptable tenaient des messes basses. Alors, je leur demande : “Qu’est-ce que vous avez à jacasser en cachette ?” Enfin, je les tourneboule tellement que le comptable me dit : “R… a barbotté 42 000 francs au patron à l’aide de fausses signatures et de majorations de prix de grosses de jugement.” Il était toujours en vacances. Alors, je leur dis “Quand R… est parti, il m’a tendu quelques papiers en me disant : « Gardez-moi ça dans le tiroir ». Je ne les ai même pas regardés, je ne sais pas ce que c’est. En tout cas, moi, je ne voudrais pas avoir l’air de garder ce qu’il m’a confié.” De plus, je dis au fondé de pouvoir : “Écoutez, je n’ai jamais pu rien soupçonner de ce que pouvait faire R… Maintenant, je dois vous dire que, même si je l’avais découvert, je n’aurais rien dit. Ce n’était pas mon affaire de le dévoiler. Je lui aurais peut-être dit, à lui-même : mon ami, vous avez tort. Mais, quant à aller le dénoncer ! Non !” Bon. On m’avait promis une augmentation au bout de l’année. Quand l’année a été expirée, je suis allé trouver mon fondé de pouvoir et je lui ai dit : “Monsieur, je viens vous rappeler que l’année est expirée, qu’on m’avait promis une augmentation. Vous seriez bien aimable si vous vouliez en dire un mot à M. Lemarquis.” Il m’a répondu : “Je ne ferai jamais aucune démarche pour les gens qui approuvent les voleurs.” Je lui ai répondu : “Monsieur, je n’approuve pas les voleurs. Je dis simplement que je ne suis pas chargé de faire la police.”
11 Il s’agit d’une affaire Lemarquis. Ce souvenir fera l’objet de plusieurs pages du Souvenir de basoche et a également été évoqué lors des Entretiens avec Robert Mallet, au début de la cinquième émission. Cette Madame Dehaynin habite 22, rue Dufresnoy, dans les très-beaux quartiers de Paris.
12 La chocolaterie Grondard au un rue de l’Odéon, a été fondée en 1853.
13 Près du Trocadéro, la rue de Magdebourg relie l’avenue Kléber à l’avenue du Président Wilson.
14 Il s’agit des sucres Say, fondés par Louis Say (1774-1840). Henry, son petit-fils délègue ses pouvoirs à Ernest Cronier (vers 1850-27 août 1905) et ils achètent des usines ensemble dans les années 1885-1900. Mais Ernest Cronier spécule, perd beaucoup d’argent et se suicide en 1905.
15 Blanche Blanc est la maîtresse que Paul conservera plusieurs années ente fin 1898 et le début de 1914 où Blanche a été remplacée par Anne Cayssac. Par rancœur, Paul ne nomma jamais Blanche dans son Journal autrement que Bl…
16 Cet hôtel existe toujours, assez ordinaire, renommé en « hôtel Georges Sand ».
17 Admirateur de Besançon. Voir le Journal littéraire au 29 mai 1904.
18 Sans prénom il s’agira toujours de Remy de Gourmont (1858-1915), romancier, journaliste et critique d’art, proche des symbolistes et figure majeure du Mercure de France. Paul Léautaud deviendra son intime. Voir le très riche site http ://www.remydegourmont.org/
19 À cette époque, il s’agit vraisemblablement d’une voiture à cheval.
20 Jules Jaluzot (1834-1916) devient chef du rayon au Bon marché où il rencontre Augustine Figeac, cliente, sociétaire de la Comédie-Française. De treize ans son aînée, elle apporte une forte dot. Jules se met à son compte. Le boulevard Haussmann et la rue du Havre viennent d’être percés par Haussmann. La gare Saint-Lazare est en construction. C’est là que Jules, à trente ans, fonde son magasin « Le Printemps ». Il deviendra député conservateur en même temps que directeur de plusieurs journaux. À l’époque où nous sommes, une partie de sa fortune est engloutie pour payer ses créanciers à la suite de compromissions lors du krach du sucre de 1905.
21 Il existe de nos jours un « hôtel de l’Arcade » au 9 rue de l’Arcade, semblant du même niveau que l’hôtel Georges Sand, distant de 450 mètres.
22 Maurice Léautaud, (1884-1961), fils de Firmin et de Louise Viale.
23 Il existe en 2023, un « Hôtel Splendid Étoile » au 1, avenue Carnot, donc à l’angle de la place de l’Étoile. Compter 450 €uros la nuit et sans doute le double avec la vue sur l’Arc de triomphe.
24 La Femme à papa, opérette en trois actes d’Hervé sur un livret d’Alfred Hennequin et Albert Millaud, crée au théâtre des Variétés le trois décembre 1879. La Mascotte, opéra-comique en trois actes d’Edmond Audran, sur un livret d’Henri Chivot et d’Alfred Duru, créé au théâtre des Bouffes-Parisiens en décembre 1880. La Fille de Madame Angot, opéra-comique en trois actes de Charles Lecocq, livret de Clairville, Siraudin et Koning, créé au théâtre des Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles en décembre 1872.
25 L’adresse est belle, à huit maisons en descendant de la place de l’Étoile. L’immeuble est encore visible de nos jours.
26 Le « petit jeune homme » du voyage à Beauvais (voir au 1er février 1905).
27 Il ne s’agit pas, on s’en doute, du comédien Georges Berr (note au 24 août 1894), ni de son oncle gantier qui a embauché Paul Léautaud comme tribun en octobre 1892.
Suite à la publication de cette page, plusieurs lecteurs ont apporté quelques points de détails quant à la biographie de Madame Dehaynin. Retenons-en deux.
Intervention de Jean-Luc Souloumiac
D’abord Jean-Luc Souloumiac, qui a envoyé ce message le premier octobre, jour de la publication :
Suite à votre article, j’ai cherché à en savoir un peu plus sur cette dame Dehaynin.
La revue Le Droit du 4 avril 1901 nous fournit quelques éléments, à extraire bien entendu du fatras juridique…
Charles-Alfred Dehaynin décède le 13 juin 1895 (un des fondateurs du CIC ?). Il logeait au 188 rue du faubourg Saint-Martin. Marié à dame Dehaynin-Schickel puis à Mlle Heraëns, qui divorcera (peut-être la Dehaynin de PL).
À sa mort, actif net de 484 532 francs après le paiement intégral de tous les créanciers.
Le contrat de mariage date du 8 juillet 1887 et stipule que le mari consent à Mlle Heraëns, pour le cas où elle lui survivrait, une donation de 330 000 fr. Par jugement du 13 avril 1893, le divorce est prononcé et condamne Dehaynin à verser à son ex-femme une pension alimentaire mensuelle de 1000 francs qui sera convertie en une rente viagère annuelle de 9000 francs jusqu’à concurrence des 330 000 de la donation initiale. Est-ce la poursuite de cette rente qu’elle demandait ?
Lemarquis est bien cité dans cette affaire qui lui vaudra d’ailleurs un procès qu’il gagnera aux dépens des accusateurs.
Après la lecture du texte de Jean-Luc Souloumiac, Dominique Brouttelande a apporté à son tour ces précisions et ces illustrations :
Intervention de Dominique Brouttelande
Le passage sur Madame Dehaynin dans Souvenirs de basoche m’est resté en mémoire depuis ma première lecture. Aussi est-ce avec plaisir et intérêt […] que j’ai lu la séquence que vous lui consacrez.
Intéressant également est le complément apporté par Jean-Luc Souloumiac visant à nous renseigner sur Monsieur Dehaynin et à tenter d’identifier Madame Dehaynin. Ce qui m’a incité à y aller voir de plus près et permis, je pense, d’identifier « Mme D »…
Rappelons d’entrée que Charles Alfred Dehaynin est :
• né le 9 août 1843 – Paris,
• décédé le 13 juin 1895 – Franconville, Seine-et-Oise, à l’âge de 51 ans.
Rentier, il semble avoir fait fortune, ou bénéficié de l’activité florissante de production de charbon de terre et de bois de ses père et oncle, sise 188 rue du faubourg Saint-Martin, Paris28. En 1893, à l’occasion de son dernier mariage, on parle de Charles Dehaynin comme « le millionnaire bien connu » (L’Écho de Paris du 17 avril 1893).
Sur le plan familial, contrairement à ce qu’avance l’intervenant précédent, Charles Alfred Dehaynin s’est marié en juillet 1887 avec Clotilde Heraeus (1869-1937) dont il divorcera 13 avril 1893 pour se marier ensuite le 11 septembre 1893 à Neuilly avec Louise Schickel (1863- ?). C’est donc dans cet ordre Heraeus puis Schickel qu’il faut retenir les relations matrimoniales de Charles Alfred Dehaynin. La veuve Louise Schickel-Dehaynin se remariera le 4 mars 1897 à Meudon avec Henri Gaston Camille Partin.
Ni Clotilde Heraeus, divorcée depuis 1893, ni Louise Schickel, alors épouse Partin depuis plusieurs années, n’est donc Mme D… quand Paul Léautaud rencontre ladite personne en 1905.
À vrai dire, à relire Souvenirs de basoche, Paul Léautaud nous renseigne suffisamment pour nous permettre aujourd’hui d’identifier Mme D… et nous convaincre qu’aucune de ces deux femmes n’était Mme D…
En substance, dans ses Souvenirs de Basoche, Paul Léautaud nous indique que Madame Dehaynin est âgée de 35 ans environ (soit d’ailleurs sensiblement l’âge de notre auteur), qu’elle est « fille d’une sorte de gitane épousée par amour par un millionnaire » et dont le « frère ou demi-frère », au travers du faire-part de son décès en janvier 1905 inséré dans le texte, avait pour patronyme Hermoso. Mme Dehaynin a encore une fille prénommée Marcelle, âgée d’une douzaine d’années en 1905.
Il ressort des quelques recherches effectuées sur Charles Alfred Dehaynin, que celui-ci, avant d’épouser Clotilde Heraeus puis Louise Schickel, s’était déjà marié le 5 avril 1873 à Biarritz avec Maria Amalia Dolores Antonia Martina Hermoso. Née à Madrid le 10 juillet 1840, elle décède le 25 juillet 1892 au Vésinet. Elle était alors divorcée de Charles Alfred Dehaynin. De cette union semble être née, avant mariage puisque le 23 janvier 1871, à Saint-Sébastien (Espagne), une fille Maria Del Pilar Fernanda Amalia Carlota Dehaynin. Voilà « la » Mme D… de Paul Léautaud. Il ne s’agit donc pas d’une des épouses de Charles Alfred Dehaynin, mais de sa fille.

L’écho de Paris du 17 septembre 1893, page une.
Les images de cet ajout sont fournies par Dominique Brouttelande »
Deux autres points apportent confirmation.
Dans Souvenirs de basoche, Paul Leautaud comme on l’a vu, évoque le rôle « équivoque » du frère de Mme D… (Guillaume) dont le patronyme Hermoso vient ici confirmer le lien familial.
Cela ressort par ailleurs du carnet mondain de L’Écho de Paris du 16 avril 1892 qui relatant la cérémonie de mariage de Mademoiselle Maria Dehaynin avec Francois Joseph Lecœuvre le 12 avril, nous informe que « Mademoiselle (…) Dehaynin, fille de Mme de Hermoso […] donnait le bras à son frère M. de Hermoso, ancien attaché à l’ambassade d’Espagne. »
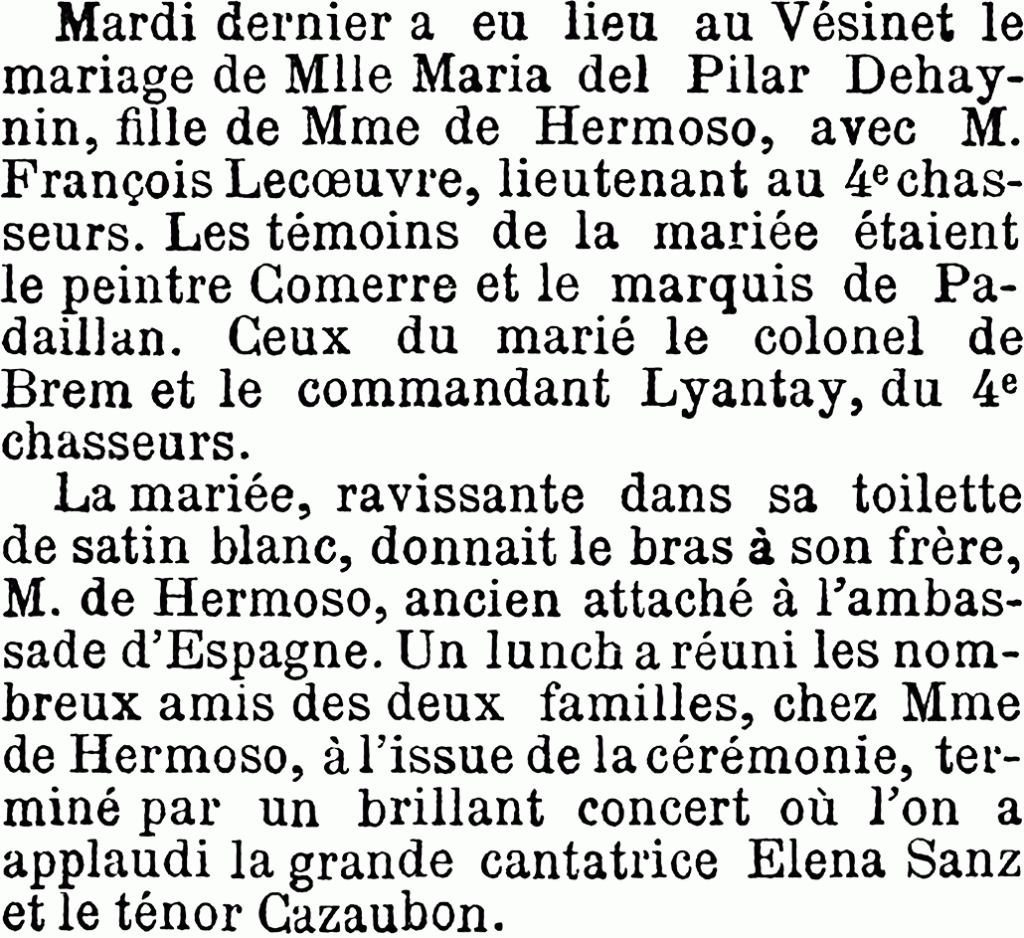
Pour l’anecdote, on retiendra que le jeune époux François Lecœuvre, lieutenant au 4e chasseurs, avait notamment pour témoin le commandant Lyantay (sic). C’est-à-dire en fait le futur Maréchal Lyautey…
Et Marcelle ? Paul Leautaud l’évoque rapidement. Elle est alors âgée de 12 ans environ, en 1905. Elle est donc née vers 1893. Mais elle s’appelle en fait logiquement Marcelle Amalia Lecœuvre. Quelques années plus tard, les journaux Le Petit Journal et La Lanterne dans leur édition des 17 et 19 avril 1909, nous rapportent une bien singulière histoire entre elle (alors âgée de16 ans…) et un jeune homme également prénommé Marcel. Les articles aux titres mélodramatiques « Drame d’amour ou accident d’auto ? » et « IDYLLE TRAGIQUE — Un drame parisien à Saint Germain » racontent le mauvais roman d’amour entre une jeune demoiselle : « Mlle Marcelle Lecœuvre, dont la mère, veuve du capitaine Lecœuvre, du 4e chasseurs à cheval, habite boulevard Malesherbes. » (La Lanterne) et un jeune homme de 21 ans « soldat au 54e de ligne à Compiègne, fils d’un grand commerçant de la rue de la Douane » (ibid.). Escapade amoureuse des jeunes fiancés en automobile, hôtel du Prince de Galles à Saint Germain en Laye, tentative de suicide, coup de feu dans la chambre, les familles arrivent… Ce jeune homme ? Il deviendra dans quelques années célèbre puisqu’il s’agit du cinéaste Marcel L’herbier ! Si celui-ci épousera une autre Marcelle, Marcelle Lecœuvre deviendra une Madame Noël en 1939 avant de décéder en 1941.

Fragments du début des articles du Petit Journal du 17 avril 1909 et de La Lanterne du 19 avril 1909.
Les textes de ces articles sont donnés en entier en annexes I et II »
On retiendra donc que lorsque Paul Léautaud rencontre Madame Dehaynin, vu la relation qu’elle entretient en 1905 avec un « petit jeune homme », est très probablement déjà veuve. En tout état de cause, Madame veuve Lecœuvre semble bien connue d’un certain monde parisien, sujet de chroniques mondaines de l’époque. On ne s’explique pas en revanche pourquoi Paul Léautaud parle de Madame Dehaynin et non Lecœuvre. Enfin, une allusion en fin de séquence reste intrigante. Paul Léautaud indique qu’à l’occasion des dernières fois où il rencontra Mme D… celle-ci vivait « avec sa fille et une vieille tante qu’elle traînait partout et qui était en réalité sa mère. » L’état civil confirme néanmoins que Madame Hermoso mère est décédée le 25 juillet 1892. Sauf à imaginer une autre histoire…
Un dernier point : Paul Wertheimer, le « petit gringalet » de 23 ans (en 1905), « d’une famille riche, paraît-il », qui plait tant à Mme D… serait-il le Paul Wertheimer (1883-1948), futur co-fondateur en 1924 avec son frère Pierre, de la Société des parfums Chanel… ? « Coco », ne lui disait-elle pas Mme D… ?
Et pour terminer, un portrait de la dernière épouse du sieur Dehaynin, quand elle était connue sous le nom de « Mademoiselle Louisa » :

Annexe I
Le Petit Journal du 17 avril 1909.
Drame d’Amour ou accident d’auto ? —
Deux jeunes gens blessés à Saint-Germain-en-Laye
Le bruit se répandait hier, à Saint-Germain-en-Laye, que deux jeunes gens, de familles honorablement connues, venaient de tenter de se suicider dans un hôtel de la ville.
D’autre part, les parents des jeunes gens, aussitôt informés et accourus au chevet de leurs enfants, affirmaient que les deux blessés avaient été victimes d’un accident.
Voici impartialement exposées les deux versions telles que nous les avons recueillies :
Jeudi après-midi, un jeune soldat du 24e d’infanterie, M. Marcel Lerbier, âgé de 22 ans, en congé de convalescence à Paris, chez son père, commissionnaire de la rue de la Douane et juge au tribunal de commerce, était venu chercher en automobile Mlle Marcelle Lecœuvre, fille d’un ancien lieutenant de chasseurs décédé, et de Mme Lecœuvre, née Dehaynin, demeurant boulevard Malesherbes.
Les deux jeunes gens, dont les familles étaient au mieux, se fréquentaient depuis un an et avaient été fiancés.
Ils gagnèrent rapidement Saint-Germain et descendirent à l’hôtel du Prince de Galles, au coin de la rue de la Paroisse et de la rue du Château.
Après avoir copieusement dîné, les deux amis montèrent se coucher en recommandant qu’on les réveillât le lendemain matin, à neuf heures.
À leur réveil on leur porta leur déjeuner qu’ils prirent au lit, et lorsque le garçon se fut retiré, on entendit deux détonations partant de leur chambre.
On se précipita chez eux et on trouva les deux jeunes gens gisant sur leur lit tout ensanglantés.
On constata que la jeune fille venait de se tirer un coup de revolver dans la joue, la balle était ressortie, et après avoir fracassé le maxillaire, était allée briser un carreau d’une fenêtre.
Son compagnon, lui, soit en essayant de la désarmer, soit en tentant à son tour de se suicider, s’était percé la main droite, d’où le sang coulait abondamment.
Le docteur Chasneau, appelé au chevet des deux blessés, leur a prodigué les premiers soins.
Telle est la version qui a cours à Saint-Germain.
Les deux familles sont arrivées hier, dans l’après-midi, à Saint-Germain, et se sont installées au chevet des blessés que l’on soigne à l’hôtel en attendant qu’on puisse les transporter à Paris.
Les parents, interrogés, ont déclaré que leurs enfants avaient été blessés dans un accident d’automobile qui leur était arrivé avant-hier soir, et ont démenti formellement les bruits de suicide.
M. Carré, commissaire de police de St-Germain, a ouvert une enquête.
Les blessures des victimes, quoique graves, ne mettent pas leur vie en danger.
Annexe II
La Lanterne du 19 avril 1909, page trois :
IDYLLE TRAGIQUE — Un drame parisien à Saint-Germain
Marcel L’Herbier, actuellement soldat au 54e de ligne à Compiègne, fils d’un grand commerçant de la rue de la Douane, avait fait la connaissance, dans un bal mondain, d’une ravissante jeune fille, âgée de seize ans à peine, Mlle Marcelle Lecœuvre, dont la mère, veuve du capitaine Lecœuvre, du 4e chasseurs à cheval, habite boulevard Malesherbes.
Un roman d’amour s’était ébauché entre les deux jeunes gens.
Il y a quinze jours Marcel L’Herbier obtenait un congé de convalescence ; il revit Mlle Lecœuvre et ils décidèrent de fuir ensemble.
Jeudi soir une automobile s’arrêtait boulevard Malesherbes. Déjouant la surveillance de sa femme de chambre, Mlle Marcelle Lecœuvre rejoignait Marcel L’Herbier et la voiture partait pour Saint-Germain.
Une panne malencontreuse survint dans fa côte du Pecq et les deux amoureux durent prendre une voiture de louage qui les déposa à l’hôtel du Prince-de-Galles où, après avoir diné joyeusement, ils retinrent une chambre pour la nuit.
Hier matin, comme le garçon de l’hôtel venait de leur apporter le petit déjeuner, deux détonations retentirent. On se précipita dans la chambre : dans le lit, couvert de sang, la jeune fille était étendue, ne donnant plus signe de vie. À côté d’elle était couché Marcel L’Herbier, la main percée d’une balle.
Le docteur Chesneau fut appelé en hâte ainsi que M. Carette, commissaire de police. La jeune fille n’était qu’évanouie ; mais elle portait au côté droit du visage une blessure provenant d’un coup de revolver tiré dans la bouche ; le projectile avait fracassé le maxillaire et percé la joue. Le jeune homme était moins grièvement atteint ; il avait seulement la main droite traversée.
D’après les déclarations recueillies par le commissaire de police, Mlle Lecœuvre avait voulu se tuer ; en cherchant à la désarmer, le jeune homme avait fait partir un coup de revolver qui l’avait blessé, et la jeune fille, introduisant l’arme dans sa bouche, avait pressé la gâchette : heureusement, le coup avait dévié et n’avait produit qu’une blessure à la tête.
Les parents des deux jeunes gens ont été prévenus ; les blessés sont soignés à l’hôtel du Prince-de-Galles.
Et une dernière note :
28 Cette adresse, face aux voies ferrées de la gare de l’Est, dans un lieu assez désolé rappelant le décor d’Alexandre Trauner dans Le Jour se lève, semble avoir été construit exprès pour y vendre du charbon.