Page mise en ligne le quinze décembre 2026 — Temps de lecture : 36 minutes
Mercure de mars 1903
La Renaissance latine du quinze mars 1903
La Revue bleue du 21 mars 1903
Le Voltaire et La Politique coloniale du douze avril
Gil Blas du treize avril
La Grande France
La Plume du quinze juin 1903
La Revue hebdomadaire du 18 juillet 1903
Le Soir du 31 août et Paris du deux septembre 1903
Notes
Indépendamment des critiques du Petit Ami, cette page va présenter quelques éditions du roman, certaines à faible tirage.
Avant la mort de Paul Léautaud en février 1956, Le Petit ami n’est paru qu’une seule fois sous deux formes et versions successives, la première dans les numéros de septembre, octobre et novembre 1902 du Mercure de France et la seconde en volume au Mercure de France en février 1903. Aucune autre édition n’aura lieu en France avant 1956, c’est-à-dire du vivant de Paul Léautaud.

L’achevé d’imprimer de l’édition Mercure du cinq décembre 1956, dix mois après la mort de Paul Léautaud et 53 ans après l’édition précédente
« En France » parce que l’on sait qu’une édition est parue en 1943 aux Pays-Bas, « imprimée en quelques exemplaires pour les admirateurs hollandais de Paul Léautaud » (colophon). Le texte est en français, assortie du dessin de Marie Laurencin pour l’édition des Lettres de Paul Léautaud parues chez Mornay en 1929.
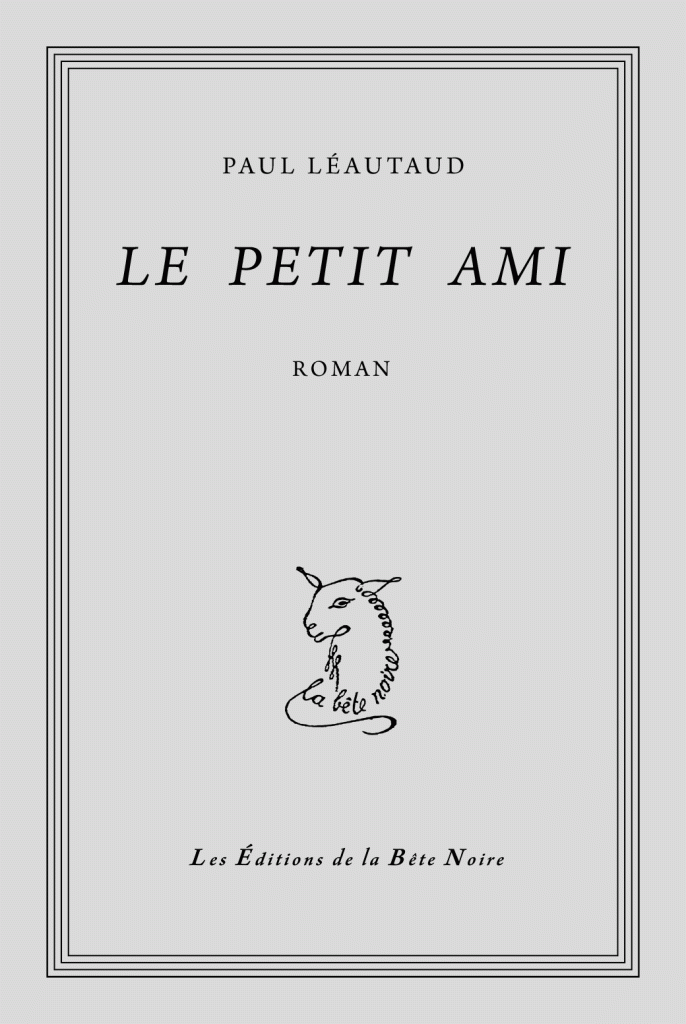
Couverture de l’édition hollandaise de 1943
Mais revenons à l’édition originale. La première mention du Petit Ami sous la plume de Paul Léautaud est dans une lettre à Paul Valéry du seize mars 1902 :
Le bouquin (qu’il sera court) je le recopie.
« Le bouquin ». Quand l’auteur peine à écrire le titre de son livre, ce n’est pas bon signe. En effet ce n’est pas le titre que Paul avait choisi. Il préférait Souvenirs légers. C’est Alfred Vallette qui lui a imposé Le Petit Ami. Alfred Vallette a-t-il aussi imposé le A majuscule ? Toujours est-il que Paul Léautaud n’écrira jamais ce titre autrement. Plusieurs couvertures, après la mort de Paul, ne respecteront pas ce choix.
Le cinq juillet, le texte est accepté par Alfred Vallette pour parution, dans le Mercure, dans un premier temps (automne 1902). Pour la parution en volume, Paul Léautaud assaille Paul Valéry de demandes de conseils. Des broutilles, des quarts de phrases. C’est bien la première fois — et sans doute la seule — qu’il a besoin que quelqu’un lui tienne la plume. On peut penser que seule sa grande proximité avec Paul Valéry lui a commandé de se confier ainsi.
Le 22 décembre, Paul Léautaud écrit à Alfred Vallette :
Je vous retourne les premières.
Ces premières sont le premier jeu d’épreuves corrigées. Il y avait à cette époque deux jeux à la charge de l’éditeur. Les jeux suivants, à la demande de l’auteur, lui étaient facturés. Et le 24, il note dans son Journal :
Vallette, qui m’avait déjà dit cela à peu près, me disait ce soir, devant Gourmont : « Je ne sais pas ce que donnera votre livre. Mais je n’entends que des gens qui en parlent. Il y en a qui trouvent cela très bien, et d’autres qui ne peuvent pas le sentir. »
L’achevé d’imprimer est du quinze janvier 1903.
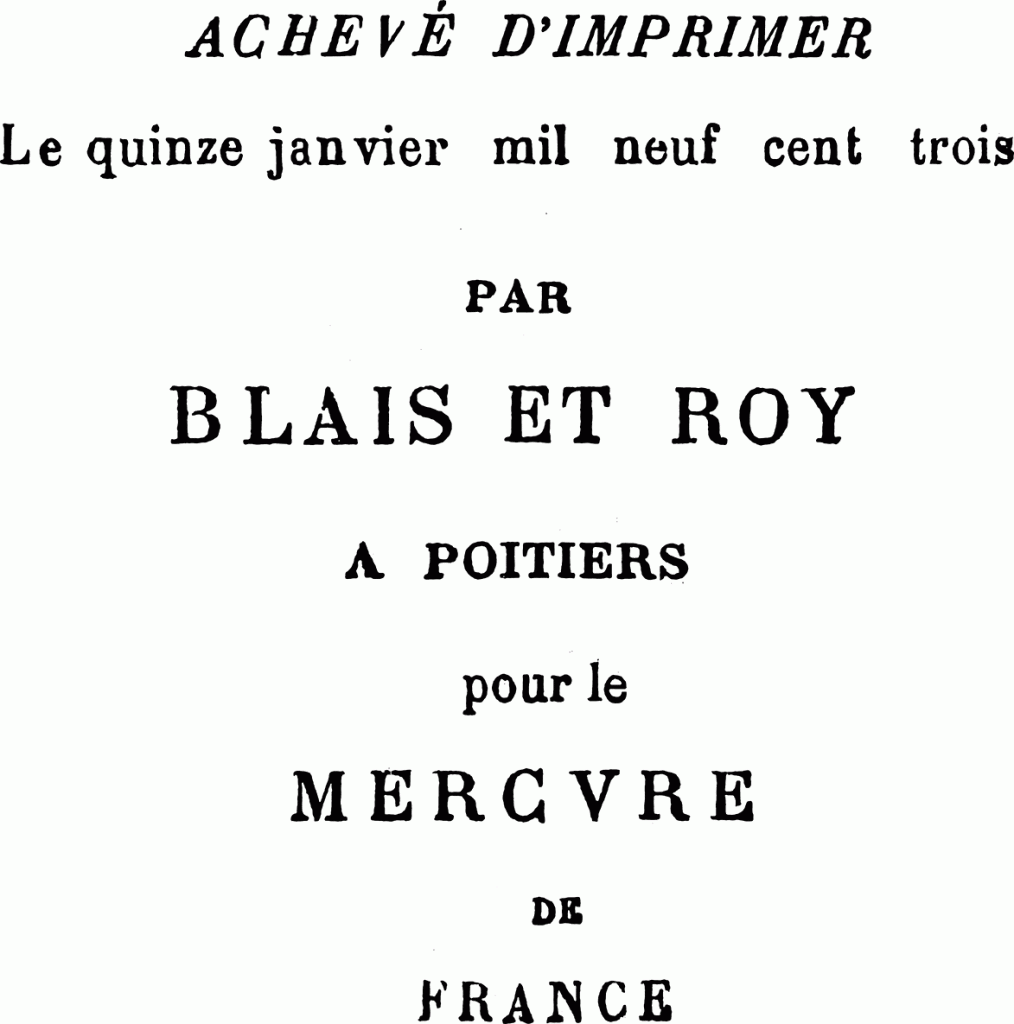
Image : Maxime Hoffman, depuis son original
Cinq jours auparavant, le dix janvier 1903, une journée importante figure dans le Journal, dans lequel Paul a noté :
Vu Georgette pour la dernière fois.
Il s’agit de Georgette Crozier. Certains léautaldiens considèrent qu’il s’agit du « vrai début » du Journal. Pour une édition abrégée, sans doute. Il est vrai que cette rupture entraînera plusieurs longues pages.
Le lendemain onze janvier, l’imprimeur a perdu la cocotte.
D’Alfred Vallette à Paul Léautaud :
11 janvier 1903
Je réclame au clicheur votre justification, et il me répond qu’il n’a rien à moi. Ne lui aurais-je pas remis le dessin ? Mais alors où est-il ? Je ne le retrouve pas. Pour ne rien retarder, voulez-vous avoir l’obligeance de me redonner votre cocotte ?
Paul Léautaud se fera faire un cachet.

Image : Maxime Hoffman, depuis son original
Le quinze février quelques exemplaires fraîchement imprimés sont envoyés en service de presse. Nous avons notamment une lettre à Jules Claretie, l’administrateur général de la Comédie-Française. Il sera le premier à répondre (lettre à Paul Valéry datée du seize).
Ce seize janvier Rachilde écrit à Paul Léautaud :
Je vous écris ce que j’aurais dû vous dire si je vous avais revu après lecture de votre livre. Y a pas ! C’est épatant ! Et je suis bien certaine que dans cinquante ans votre livre aura pris la place de Manon Lescaut1… avec quoi on nous remet en mémoire souvent, trop souvent, que l’émotion et la simple vie sont encore les seuls moyens de véhiculer de la littérature après plusieurs siècles de pente… Si quelques grands critiques voulaient se donner la peine de lire… vous auriez un beau concert ! Seulement, il n’y a plus que votre serviteur qui lise !
Journal littéraire :
18 Février [1903]
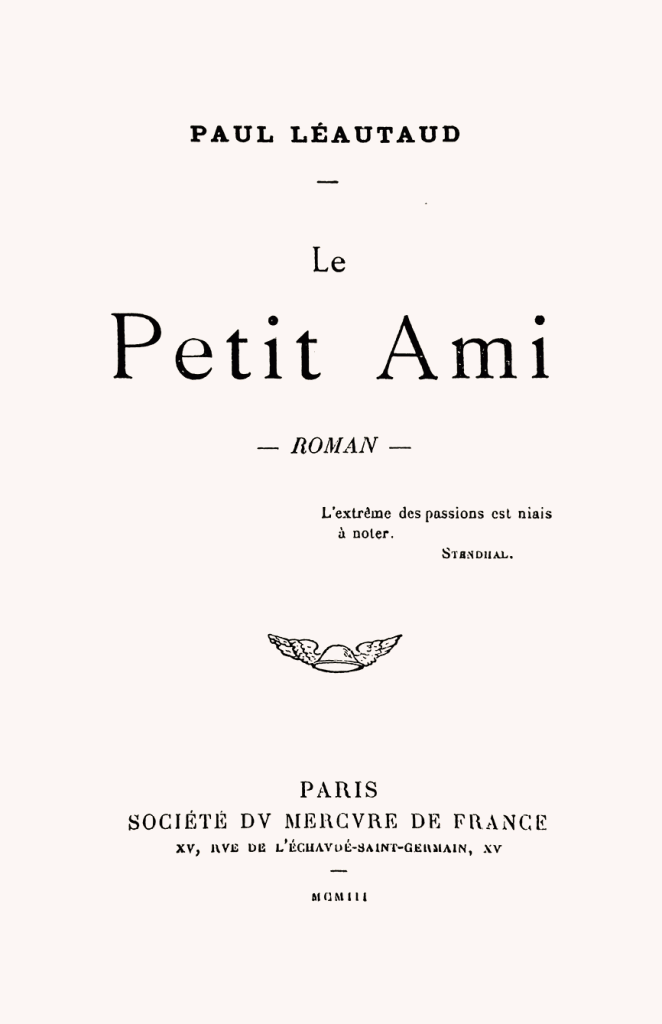
Image de Maxime Hoffman, depuis son original
Le Petit Ami a paru aux étalages des libraires cette après-midi, vers trois heures, environ trois exemplaires à chacun2. La vue de cela n’est pas gaie, de ce livre que personne ne feuillette. Boulevard des Italiens, à la Librairie Flammarion3, un flâneur l’a pris, l’a ouvert, et lu en divers endroits, et l’a reposé.
Ce matin, a paru aussi Vérité, l’épais et lourd roman de Zola. Il en est déjà au quarante-et-unième mille.
Je ne suis jamais bien sûr d’avoir du talent. C’est même bien rare que je me sente quelque chose… Ce soir, en regardant tous ces étalages, je m’en sentais encore moins. Question grave : que pense le passant qui s’arrête, prend le Petit Ami, le feuillette, le lit çà et là, et le repose4 ?
Monceau5 me dit que Schwob est surpris de n’avoir pas reçu le Petit Ami. Je lui en ai pourtant dédicacé un exemplaire. Je lui en envoie un autre. Ce soir, je retrouve le premier, oublié dans un tiroir de ma commode.
Envois. Sur l’exemplaire de Moreno : l’unique exemplaire en témoignage d’admiration (pour son talent à dire les vers).
Sur l’exemplaire de Gourmont : À Monsieur Remy de Gourmont, grand excitateur d’esprit.

Dessin anonyme clôturant la première partie du Petit Ami dans le Mercure de septembre 1902, page 731
Si on ne peut dire que Le Petit Ami a été un grand succès de librairie, il a pourtant reçu plusieurs critiques souvent élogieuses, toutes reproduites dans cette page, accompagnées des lettres de remerciements de l’auteur.
Mercure de mars 1903
La première critique a été celle de Rachilde, qui tenait à l’époque — avec une grande originalité à défaut d’un grand sérieux — la rubrique des romans dans le Mercure de France. Voici son compte rendu paru dans le numéro de mars 1903, pages 731-734 :

« Montage » du bas de la page 731 et du haut de la page 732 du Mercure de mars 1903
« L’extrême des passions » doit toujours se remplacer par une ligne de points, dans les romans qui se respectent. L’auteur de ce livre-ci a, très heureusement, supprimé les lignes de points, mais il a remplacé la « niaiserie » de la passion par la candeur ingénue de l’aveu personnel ; il a compris qu’un roman ne vaut que par ce qu’il recèle de confession et c’est bien pour cela qu’il a fait une œuvre géniale. Je ne crois pas à la conscience absolue pas plus qu’à l’inconscience absolue des gens de génie. Je ne veux pas croire que Paul Léautaud puisse être aussi sincère qu’il désire nous le faire supposer. Ce n’est pas le maçon qui compte, machinalement, les pierres de son mur et c’est encore moins l’architecte mélodramatique vous démontrant, plans et devis à la main, de quelle façon l’édifice social croulera. Je m’imagine que l’auteur de Petit Ami a étudié, avec soin, la vie de tous les jours et qu’il a essayé d’introduire ses observations au cours d’une existence relativement exceptionnelle. En disant Je, moi « telle chose m’advint », il fut, ou très adroit, ou très honnête, selon qu’on se place en face du lecteur ou devant la vie. Cependant je ne voudrais pour rien au monde qu’il fut seulement l’un ou l’autre : rosse ou naïf !
Dernièrement, on découvrait que la mère de Tolstoï, l’ineffable héroïne de l’Enfance du maître écrivain russe, était morte avant la date des notations vivantes données par son fils. Le comte Tolstoï a donc inventé, de toutes les pièces de son artifice littéraire, l’histoire de cette mère qui meurt en douceur et en beauté pour la plus grande gloire future de son enfant. Or, certains lecteurs ont senti leur enthousiasme diminuer en présence de ce mensonge, simple confirmation, pourtant, du génie de Tolstoï. Il est vraiment fort étrange que nous ne puissions concevoir la beauté sans toute la vérité, alors que l’exagération de la vérité nous conduit généralement à la beauté, plus lumineuse que la vie. Non, nous ne pouvons rien faire sans la vie, sans notre vie, propre ou malpropre, mais nous n’avons du génie que le jour où nous en déduirons, logiquement, ce qui n’est pas arrivé. (Auprès des littérateurs, Dieu, qui sait d’avance, est un assez malhonnête homme quand il déjoue nos petites prévisions, car notre amour de la déduction logique nous mène à beaucoup plus de loyauté que la providence n’a l’habitude d’en mettre dans ses quotidiens rapports avec nous). Le Petit Ami de Léautaud est un sincère… littérateur. Revenu de loin, c’est-à-dire de la recherche de la forme rare, trop souvent pauvre masque de l’absence du fond, l’auteur, après un travail acharné sur la mécanique de la phrase, en est arrivé à concevoir le roman vivant et cependant un peu exceptionnel, intéressant, et il lui a appliqué toutes les théories du réalisme, moins la grossièreté voulue. Il a vécu… jusqu’au sacrifice de sa personnalité. Seul, le roman de Manon nous offre une somme d’émotions aussi ingénues et aussi intenses, Manon est un livre mal écrit, selon les goûts du jour, mais il est admirablement fait et celui de Léautaud est aussi bien fait sans avoir l’air de contenir plus d’art, ce qui est un joli tour de force. Elle sort de l’humanité, cette œuvre de Léautaud, elle en sort, tout en en étant formée, comme une statue habilement ébauchée sort de la glaise fraîche et nous évoque le marbre définitif de l’avenir. L’auteur a daigné dire : Je, moi, ma mère, et situer une aventure qu’il fait sienne avec la loyauté de l’inventeur qui essaye sur lui le poison nouveau, mal ou remède, dont il a découvert les principales substances. Je l’admire pour ce courage — lui, un timide, qui murmure : « Pourquoi donc ai-je été chercher tout ça… Non, vraiment, je suis bien incapable de toutes ces actions grotesques » — Ce courage n’est pas la maladive perversité des littérateurs très rosses de notre siècle, mais mieux une générosité d’écrivain, presque une noblesse. Il induit de ce qui a été ce qui aurait pu être, selon le fatal enchaînement des événements qu’entraîne certaine naissance. Oui, j’ai le mépris des souteneurs mondains ou demi-mondains, racontant leurs exploits sous le voile d’une tendre pitié pour leurs victimes… et d’un pseudonyme dissimulant les plus grands noms de France ! (Pour ce que ça coûte). Oui, mille fois oui, j’ai horreur des trinités conjugales, en chemises, avec ou sans le chapeau du premier Paris payé, avec ou sans le génie du scandale (on a quelquefois du génie comme un cochon serait rose !) oui, j’ai le préjugé de la pudeur littéraire, mais je suis touchée par la noble pauvreté d’un homme qui vous donne sa misère passionnelle, toute la misère possible ne pouvant offrir plus à sa seule déité : la littérature. Voici de la laideur pour faire de la beauté ! Cela me console des montreurs d’ours ou de princesses, des dompteurs de chimères ailées de plumes de dindes, des invertis, des convertis et des cocus… lesquels ne sacrifient qu’au veau d’or sans aucune aspiration vers un autel plus pur. Léautaud ne parle pas le langage des cours, basses ou hautes, pour qu’on lui jette deux sous. Il a montré, d’après sa propre imagination, un rare personnage qu’il fallait bien créer par amour de l’art : le souteneur intellectuel. Un homme, l’ami des filles, des petites filles, de celles qu’on n’affiche pas et qui ne vous posent guère ! C’est un métier honorable que d’être le protecteur spirituel, le petit consolateur de ces pauvrettes ! Jésus ne fut-il pas le premier des amants de cœur dans toute l’adorable expression du mot, celui qui a chassé les marchands du temple secret de Madeleine ? Croyez-moi, Léautaud, c’est en songeant bien plus au pâle crucifié qu’à votre Petit Ami que je me dis : « Après tout, n’est pas fils de putain qui veut ! »
Rachilde
Rachilde et Paul Léautaud (qui n’était pas encore salarié du Mercure) se sont sans doute rencontrés plusieurs fois dans les mois qui ont suivi ce compte-rendu et ce n’est que le deux septembre 1903, soit six mois plus tard, que Paul Léautaud écrit enfin une lettre de remerciement à Rachilde, dont voici la fin :
Je voudrais bien profiter de cette lettre pour vous remercier de votre article sur le P.A. Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas. Mettez cela, je vous prie, en croyant à ma sincérité, sur le compte de mon manque de liberté et surtout sur le compte d’une timidité excessive. Savez-vous que les quelques autres articles qu’on a écrits sur le P.A. se sont tous rencontrés avec le vôtre, ce qui pourrait me donner de la vanité, si j’avais plus de ressort et de solidité et moins de réflexion. Mais il y a ce si, qui tiendra de plus en plus une grande place dans ma vie, je le sens bien. Ce qu’il y a de certain, c’est que vous avez été seule à comprendre deux choses à mon égard : de quelle fatigue des livres qui ne sont que des phrases venait le style du P.A. — et ensuite qu’avec les choses que j’avais à raconter on ne pouvait guère faire mieux. Cela est beaucoup et je ne saurais vous en remercier trop bien. Quand je dis pourtant qu’on ne pouvait faire mieux, je m’oublie : j’ai un regret profond de n’avoir pas écrit le P.A. tout à fait sans phrases, en style « d’affaires ».
La Renaissance latine du quinze mars 1903
La Renaissance latine a été une revue mensuelle sérieuse mais brève Elle n’est parue que sur 38 numéros, du quinze mai 1902 au quinze juin 1905 sous les directions de Louis Odéro puis Constantin de Brancovan. Le jeune prince Michel-Constantin Bassaraba de Brancovan (1875-1967) est le frère aîné (un an) d’Anna de Noailles, qui a donc pages ouvertes dans la revue.
On a beau scruter le sommaire de cette Renaissance latine du quinze mars 1903, le nom de Gilbert de Voisins n’y apparaît pas. C’est pourtant le titulaire de la rubrique des livres. Contrairement au Mercure, ce mensuel de 256 pages paraissant le quinze, ne distingue pas les romans dans une rubrique séparée même si les titres sont classés par thème. Après avoir sauté les ouvrages scientifiques (La Politique agraire du parti socialiste) viennent la poésie puis la littérature. Le Léautaldien retrouve des noms connus, Joséphin Péladan, Jean Ernest-Charles, Pierre de Querlon, Jean Viollis…
Auguste Gilbert de Voisins (1877-1939), poète et journaliste. Gilbert de Voisins est son nom de famille, Auguste son prénom. La famille de Voisins est d’une ancienne noblesse française (XIIe siècle), et compte une branche Gilbert de Voisins. Auguste épousera en 1915 Louise, la troisième fille de José Maria de Heredia, divorcée de Pierre Louÿs en 1913. PL développe un peu la famille dans son Journal au 9 janvier 1906.
Voici le texte d’Auguste Gilbert de Voisins. On peut noter qu’il note mal le nom (pseudonyme) de Jean Ernest-Charles (J.-Ernest Charles). Ernest-Charles est le nom de famille, Jean le prénom. Il note aussi fautivement le nom de Paul Léautaud qu’il écrit Leautand, comme on a pu le lire dans l’image ci-dessous.
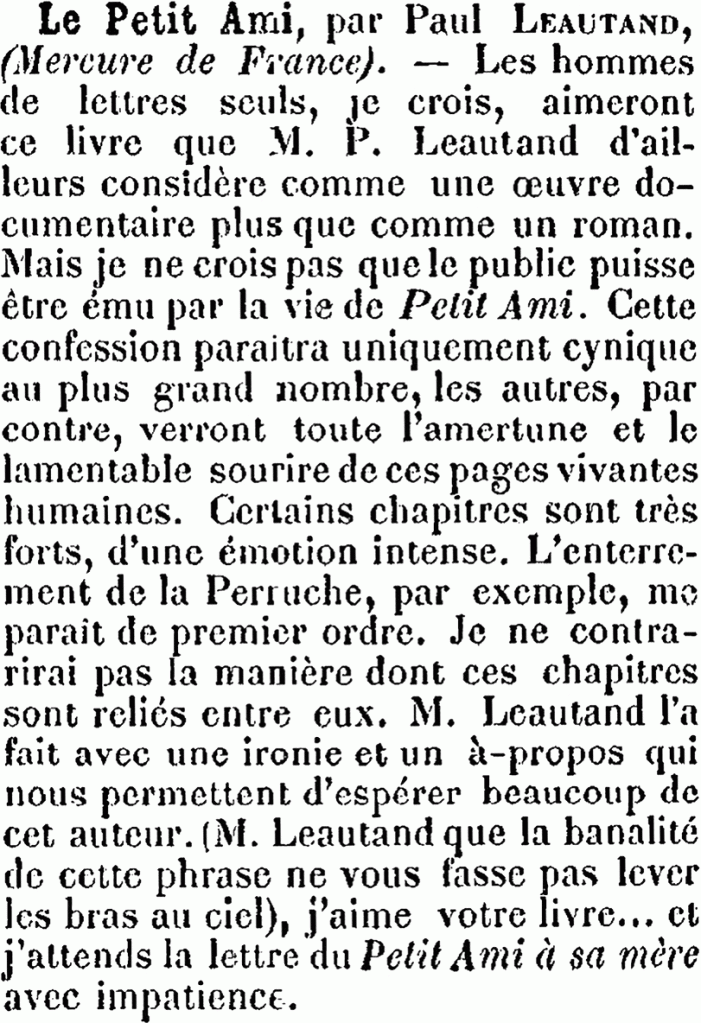
Ces Lettres à ma mère, qui seront rassemblées par Paul Léautaud en 1953 ne seront publiées elles aussi, par Marie Dormoy, qu’après sa mort, en juin 1956.
À la lecture de ce texte il semble bien qu’Auguste Gilbert de Voisins a déjà rencontré Paul Léautaud au moins une fois. Confirmation nous en sera donnée ci-après. La première fois, pourtant que le nom d’Auguste Gilbert de Voisins apparaît dans le Journal littéraire est trois années plus tard, le neuf janvier 1906 à propos d’In Memoriam. Néanmoins Paul n’attendra pas autant qu’avec Rachilde pour une lettre de remerciements :
À Gilbert de Voisins
Paris le 5 avril 1903
Cher Monsieur,
Il y a seulement une dizaine de jours que j’ai appris par Buré6 que c’est à vous que je dois l’excellente note de la Renaissance latine sur le Petit Ami. Je voulais vous en remercier tout de suite, mais l’existence que je mène me laisse tout au plus deux ou trois heures de répit chaque jour et cela m’a mené jusqu’à aujourd’hui. Je vous le dis en confidence : les quelques lignes que vous avez écrites m’ont fait plus de plaisir qu’aucun des trois quatre articles que j’ai eus. Dire que je partageais absolument l’avis dont elles témoignent, non, c’est un avis trop indulgent, trop élogieux même, et de ce livre je ne suis, moi, que très à moitié content. Mais j’y sentais comme un encouragement, quelque chose aussi comme une sympathie inconnue. Maintenant que je sais de qui me vient ce témoignage, il m’est encore plus précieux. Nous nous connaissons plutôt peu, cher Monsieur, et même je ne crois pas que nous nous soyons jamais dit plus de dix mots. Mais dès la première fois que je vous ai vu, au Mercure, dans le salon de Rachilde, il y a déjà quelques années je vous ai trouvé tout pour me plaire. Il se trouve aujourd’hui que quelques pages que j’ai écrites ont arrêté votre attention, que même vous les aimez jusqu’à dire que vous les aimez, et que ces lettres entre un fils et une mère un peu singulière peut-être, vous intéressent à l’avance. Comment voulez-vous que je puisse vous remercier. Ce sont choses trop délicates pour que des mots y suffisent.
Croyez bien, je vous prie, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.
P. Léautaud
La Revue bleue du 21 mars 1903

La Revue bleue du 21 mars 1903
Jean Ernest-Charles a été évoqué supra, le revoilà comme auteur d’un compte rendu du Petit Ami dans la Revue bleue du 21 mars 1903.
La Revue politique et littéraire, fondée en 1863 par Eugène Yung, publiée sous des titres divers jusqu’en 1939. En 1903 la parution était hebdomadaire sur 32 pages. Cette revue était plus connue sous le nom de Revue bleue, de la couleur de sa couverture, par opposition à la Revue scientifique ou Revue Rose.
Jean Ernest-Charles (Paul Renaison, 1875-1925), journaliste et avocat surtout connu pour avoir été le créateur de la revue Le Censeur politique et littéraire avec son épouse Louise Faure-Favier. Il sera en 1918 le premier président du Syndicat national des journalistes. On pourra lire, dans le Journal littéraire à la date du douze mai 1908, le récit d’un incident auquel Jean Ernest-Charles sera mêlé, en tant que journaliste au Gil Blas.
Voici le texte de Jean Ernest-Charles :

Texte de Jean Ernest-Charles paru dans la rubrique « La Vie littéraire » de la Revue bleue du 24 mars 1903, page 378. Suite du texte ci-dessous
Et le livre de Paul Léautaud retient l’attention malgré tous ces enfantillages infiniment littéraires, justement parce qu’on devine en lui la vérité. Toutes les fois que Paul Léautaud consent à ne pas se montrer homme de lettres, l’homme de lettres le plus homme de lettres de Paris et du boulevard, il est en même temps un écrivain pittoresque, un psychologue curieux, et même un bon moraliste. Et enfin son roman n’est point la répétition de tant de romans banaux ! Celui-ci, on peut en être sûr, est réellement inédit.
Paul Léautaud a une conception un peu particulière de la famille, mais les faits l’amènent nécessairement à cette conception inattendue et d’ailleurs amusante… Le Petit Ami est le fils d’un excellent homme de Montmartrois, voué à des occupations vaguement artistiques, et dont la vie est moins régulière que les habitudes. Tous les soirs, vers minuit, il passe à la Brasserie des Martyrs, et y loue d’occasion une femme de rencontre. Le Petit Ami est le fils sceptique d’une de ces femmes, non pas étonné d’être au monde, ni même de la façon un peu spéciale dont il y est venu. Son père l’élève tant bien que mal, s’en remet surtout aux soins d’une vieille bonne. Et l’enfant grandit dans des maisons où vivent des multitudes de filles, et toute son adolescence se passe aussi dans ces maisons, et du vaste monde il ne connaît vraiment que ce quartier. Il devient le petit ami de ses aimables habitantes. Mais il n’abuse pas de la situation, car, — cette fois-ci, c’est heureux pour lui, — il y a toujours beaucoup de littérature dans son cas. Les circonstances, qui pour lui sont prodigues de bizarreries agréables lui permettent de connaître sa mère, qui a enfin bien tourné et bien réussi, s’est fondée vers quelque Genève une belle famille, et il entretient avec elle un commerce assez nettement amoureux, orné d’un grand luxe d’analyses. Quant à son père, il ne s’occupe pas de ces détails.
Voilà, sans doute, un sujet inattendu ; s’il n’était convenable de s’attendre à tout. Quand Paul Léautaud consent à le traiter sincèrement, son livre atteint à une surprenante originalité. Hélas ! il ne consent pas toujours… Mais quels tableaux de la vie et du monde montmartrois ! Ces tableaux paraissent dans tous les romans parisiens. Ici on croit les voir pour la première fois : Paul Léautaud les a presque renouvelés. L’âme du quartier des Martyrs est dans le Petit Ami et dans son auteur.
En dépit de toutes ses inexpériences entretenues par une application que rien ne lasse, c’est un livre. Il n’est point improvisé, jeté en toute hâte aux lecteurs. Celui de Léon Frapié7 est, plus encore, un ouvrage lentement élaboré. De Léon Frapié on ne connaît qu’un roman : L’Institutrice de province, d’une exactitude douloureuse. Marcelin Gayard, moins douloureux, n’est pas moins exact. Léon Frapié suit dans la vie un ouvrier, et comment cet ouvrier devient patron, puis employé, et comment les idées de cet ouvrier sont naturellement déterminées par les milieux qu’il traverse, les difficultés ou les facilités de sa vie… et c’est de l’analyse patiente et sage, un peu narquoise, pas plus qu’il ne faut, une description mesurée, légèrement souriante, un peu grise, le style d’un écrivain qui n’est pas, Dieu merci, l’homme de lettres… Et peut-être est-ce d’une prévoyance plus heureuse d’écrire comme Léon Frapié, de rares romans approfondis dignes d’être lus et dont on se souvient sans bruit, que de façonner, à la manière de tant d’autres, des romans innombrables dont il faudra bien qu’un jour le lecteur se détourne avec fatigue et peut-être avec dégoût.
J. Ernest-Charles
Ce mois de mars 1903, Paul a reçu indirectement, par l’entremise d’Adolphe van Bever une proposition d’Henri Albert8 de rédiger des articles pour la Revue bleue. Dans une lettre à Henri Albert du 28 mars, il écrit :
Je n’ai pas encore remercié Charles pour son article. Je pensais que peut-être je le verrais avec vous et qu’il était préférable d’attendre cette entrevue. Dois-je maintenant lui écrire mes remerciements ? Et puis-je lui parler de la question des articles c’est-à-dire lui dire que je suis au courant, et le remercier là-dessus aussi ? Mais mieux vaut attendre que je vous aie vu, n’est-ce pas ?
C’est le trente mars qu’il écrira à Jean Ernest-Charles :
À Ernest Charles
Paris le 30 mars 1903
Monsieur,
Excusez-moi de vous remercier seulement aujourd’hui des bienveillantes lignes que vous avez écrites dans la Revue bleue sur le Petit Ami. Je pensais vous voir prochainement avec Albert et je préférais attendre cette entrevue. Puisque elle est un peu ajournée, je veux vous dire combien vous m’avez fait plaisir en vous occupant un peu d’un livre sur lequel j’ai bien du mal, moi-même, à avoir une opinion bien arrêtée. Je ne crois pas avoir eu en l’écrivant rien qui approche du désir « d’épater le bourgeois » comme on dit, ni aucune satisfaction exagérée d’avoir et d’exprimer des sentiments soi-disant rares9. Non, je vous assure. Que ce que je sens, que ce que j’ai écrit ne soit pas le fait de tout le monde, mon Dieu ! peut-être. Mais vous l’avez écrit vous-même avec justesse : la façon dont j’ai été élevé, la famille que j’ai eue y sont pour beaucoup — et je me suis dit aussi qu’après tout, il faut se montrer comme on est, ou à peu près. Où je suis tout à fait d’accord avec vous, si vous le permettez, c’est quand vous reprochez à ce livre d’être trop littéraire. Ah ! oui, que je vous donne raison, ici, je ne sais pas si je suis autant homme de lettres que vous le dites, mais il me semble bien que ce petit ami aurait été beaucoup mieux, ou moins mal, si vous préférez, sans telle ou telle plaisanterie inutile, sans tel ou tel mot qui vise à être de l’esprit et n’en est pas du tout. Quand je songe que j’avais rêvé d’écrire un livre de souvenirs, dans un ton rapide et sec, sans avoir l’air de m’y arrêter autrement ! Je ne sais quelle fantaisie m’a entraîné au fur et à mesure que j’écrivais et je me suis laissé faire, pour voir ce que ça donnerait, comme si c’eût été un autre qui écrivît sous mes yeux. Je songe maintenant aux 80 et 100 pages que j’aurais pu écrire, plus serrées encore que le chapitre de Calais. Il est vrai que ça aurait peut-être encore moins plu.
Malgré tout, j’ai un peu le droit de me redresser. S’il est vrai que mon roman n’est point la répétition de tant de romans banaux — et au fond, c’est bien un peu vrai — mais que vous l’ayez dit, vous, cela compte, et s’il est vrai qu’il soit réellement inédit, c’est un grand point, et quand il n’y aurait que cette appréciation dans votre article, je vous devrais pour cela de grands remerciements. Mais vous avez bien voulu aussi louer quelque peu un style que je croyais sans intérêt, une psychologie que je croyais à peine existante ; vous avez été jusqu’à m’accorder un certain don de description. Ici je ne sais plus que dire. Je n’ai jamais eu beaucoup de confiance en moi ; sitôt que j’ai fini d’écrire, je suis plein de doute. Après tant d’éloges inattendus, je suis capable de me prendre au sérieux et de rêver des choses impossibles.
Il ne me reste plus maintenant qu’à vous dire quelques mots au sujet de votre proposition, pour ainsi dire, dont Albert m’a fait part, de collaborer à la Revue bleue : articles sur Paris. J’aurais préféré vous voir pour que vous me donniez dès maintenant quelques indications si vous le vouliez bien. Mais j’ai vu Albert aujourd’hui. Il est convenu que je vais faire une sorte de commencement, que nous irons ensuite vous montrer. Comme vous le pensez bien, je vais faire tous mes efforts pour profiter de la grande aide que vous m’offrez si spontanément, sans me connaître, rien que pour le plaisir de faire plaisir, on dirait. Là-dessus, je voudrais vous remercier comme je le désire, que je ne le pourrais pas10.
Croyez bien je vous prie, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.
P. Léautaud
Dans la Correspondance générale, la lettre suivante est celle adressée à Auguste Gilbert de Voisins que nous avons lue dans le chapitre précédent.
Le Voltaire et La Politique coloniale du douze avril

Le Voltaire est un quotidien dont le premier numéro est paru le cinq juillet 1878 sous la direction d’Aurélien Scholl (1833-1902). Ce quotidien paraîtra jusqu’au début des années 1930.
L’origine de cet article nous est donnée dans le Journal littéraire au trente avril 1903, à l’occasion d’une soirée chez le sculpteur Jose de Charmoy :
[…] Mme de Charmoy m’avait demandé si cela me ferait plaisir qu’elle me fît faire un petit article quelque part. « Moi, Madame, lui avais-je répondu, mais certainement. Je ne demande que la gloire, moi ! » Et le jeudi suivant, j’avais appris que Fleischmann avait écrit des choses dans le Voltaire. Quelle publicité ! Il n’y a guère que les garçons de bureau des ministères qui lisent ce journal. Le dit Fleischmann était là, qui me demanda un exemplaire, que je lui promis, avec l’intention de ne pas tenir. Mais le lendemain, il déposa des journaux chez moi, et ce soir je lui ai remis un exemplaire déjà destiné et pas envoyé, sur lequel j’avais gratté le premier envoi.

La Politique coloniale, journal économique et littéraire, est paru en 1879, d’abord bi-hebdomadaire puis quotidien. Des textes du poète, romancier, journaliste et historien belge Hector Fleischmann (1882-1913 ou 1914, mort à 31 ou 32 ans) — et peut-être d’autres journalistes — paraissaient le même jour dans ses deux titres sous le pseudonyme de « Jeannine » « votre petite amie très littéraire ».
Dans La Politique coloniale comme dans Le Voltaire, « Jeannine » ne tient pas une rubrique littéraire mais donne diverses nouvelles sous le titre « Paris qui passe ». Une pièce de Jean Aicard se joue à Asnières, des poèmes de Léon Deubel et d’Henri Martineau, Le Petit Ami, visite au peintre Maurice Cléret…
Voici le texte d’Hector Fleischmann :
Mais voici tout aussi tendre, moins amoureux pourtant11, un livre qui selon toute justice devrait être célébré en cette heure, Le Petit ami, de Paul Léautaud. Ces souvenirs de vie sentimentale nous sont contés avec une grâce charmante et douloureuse, une ironie atténuée, calme et souriante. Est-ce bien un roman ? J’en doute fort, et qu’importe ? M. Paul Léautaud a écrit là une chose simplement admirable. Je me souvenais de quelques-unes de ses pages lues jadis au hasard des revues et ma sympathie devient aujourd’hui de l’admiration. Qu’est-ce donc que ce petit ami ? Ses aventures ne sont guère compliquées !
C’est le petit ami d’humbles et belles courtisanes, de femmes de vie amoureuse de tendresse assez large. D’avoir vécu dans leur intimité simple et dans le parfum de leurs robes fort belles, il a conservé une douceur atténuée et tendre, une joie calme qui se résigne à l’ennui des jours. Et de cet apaisement sentimental vient Une ironie qui mérite d’être signalée parce qu’elle ne ressemble à aucune autre. Comme on dit : l’ironie de Laforgue, où pourra déformais dire : l’ironie de Paul Léautaud, et cet hommage de personnalité sera le plus noble et le plus beau qu’on pourra rendre à cet écrivain dont les livres sont rares mais merveilleusement dignes d’admiration.
La lettre de remerciement à Hector Fleischmann ne figure pas dans la Correspondance générale. Par contre, dans le Journal littéraire au 17 mars 1906 nous pouvons lire :
Gaubert avait apporté pour moi un numéro du Fin de siècle12, où commence un roman de Fleischmann, intitulé : Tu me plais, avec une épigraphe faite d’une phrase de The small friend13. C’est une des phrases des lettres de ma mère. Je ne trouve pas très drôle de la voir mise ainsi, en épigraphe à un tel roman, d’un tel auteur, et dans un tel journal.
« un tel journal ». Fin de siècle est un bi-hebdomadaire littéraire illustré de tendance populaire créé en 1891. Tu me plais « roman des bars et des tavernes » est paru sur trois numéros, du dimanche onze mars au dimanche 18 mars 1906. Ce n’est pourtant pas un roman spécialement court, disons qu’il a été interrompu brutalement ; la dernière parution indique « (à suivre) » mais dans le numéro suivant le lecteur a droit au roman de Paul Vigné d’Octon14 Les Baisers.
Gil Blas du treize avril
Au début de mars 1903 Paul Léautaud a envoyé Le Petit Ami à un certain nombre de critiques de revues et journaux dont Léon Blum, qui en rendra compte dans sa chronique des livres du Gil Blas du treize avril.
À Léon Blum
Paris le 3 mars 1903
Monsieur,
J’ai des excuses à vous faire pour vous : envoyer si tard ce volume. Mais mon père soudain malade, sa mort la semaine dernière, ses obsèques, les mille occupations en un mot de telles circonstances, m’ont tenu loin de chez moi ces derniers quinze jours et forcé d’ajourner l’achèvement de mon service. Je ne sais pas si l’envoi que je vous fais vous fera plaisir, mais il me fait plaisir, à moi, et c’est peut-être l’essentiel. Il n’est pas trop tôt que je m’acquitte des heures charmantes que j’ai passées autrefois, ah ! il commence déjà à y avoir longtemps, en lisant dans la Revue blanche les pages que vous y publiiez : Dellamatro Suasoria15. L’envie m’est venue bien souvent aussi de demander « M’aimez-vous ? » à tous ceux dont je sentais la vie pénétrer un peu la mienne, je n’ai plus la revue près de moi mais je n’ai pas oublié la phrase — le Livre de mes Amies16 et les pages sur Bourget et sur France, en même temps que bien des critiques de livres. Non, vraiment il n’est pas trop tôt. Et puis, vous le savez, les amis inconnus que font ainsi à quelques-uns certaines pages presque pas connues, ces amis-là sont peut-être la meilleure récompense.
Je vous prie de croire à mes sentiments les plus distingués.
P. Léautaud

Léon Blum, encore journaliste mais déjà auditeur au Conseil d’État, rend compte, sur une colonne et demie du livre d’Adolphe Brisson Les Prophètes, d’Hugues Le Roux : Chasses et gens d’Abyssinie, du Petit Ami et du roman de Pierre de Querlon : Les Joues d’Hélène (pages deux et trois).
Voici le texte de Léon Blum :
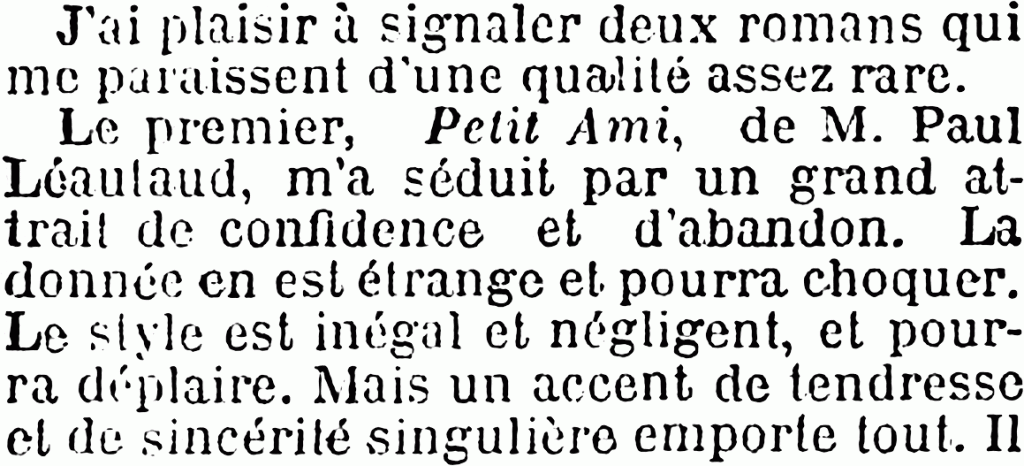
J’ai plaisir à signaler deux romans qui me paraissent d’une qualité assez rare. Le premier, Petit Ami, de M. Paul Léautaud, m’a séduit par un grand attrait de confidence et d’abandon. La donnée en est étrange et pourra choquer. Le style est inégal et négligent, et pourra déplaire. Mais un accent de tendresse et de sincérité singulière emporte tout. Il y a, dans ce roman, cent pages de souvenirs d’enfance qui sont parmi les plus précis, les plus vivants, les plus spéciaux que je connaisse. Et l’on peut y trouver, par surcroît, beaucoup d’histoires charmantes qui ne sont plus tout à fait d’un petit garçon… Livre un peu déconcertant, somme toute, voilé de tristesse et d’enfantillage, écrit au hasard, et tout plein de littérature. Mais son grand charme naît d’une sincérité qui devient parfois gênante par son excès et par une sorte d’impudeur volontaire. Ce sont plus que des confidences, ce sont des confessions. Elles sont si franches, si dévoilées, et en même temps si simples, qu’elles ne plairont peut-être beaucoup qu’à de très jeunes gens, et à des femmes. Mais c’est le public auquel j’aimerais le mieux plaire si j’écrivais des romans. Et j’ai toujours eu un goût particulier pour les livres qu’on sent, comme celui-ci, uniques de leur espèce, et que l’auteur même ne récrira pas.
Paul écrira à Léon Blum une lettre de remerciements, que voici :
Paris le 23 avril 1903
Monsieur,
Je ne sais comment vous remercier de tout le bien que vous avez dit du Petit Ami dans votre critique de Gil Blas. Vous louez ma sincérité, le particulier de mes souvenirs d’enfance, jusqu’à une certaine tendresse que je n’ai pu dissimuler toute, et me prêtant le public le plus délicieux qui soit, vous dites sentir mon livre, presque unique dans son genre. Ce que je vous dois, pour avoir écrit cela, c’est un grand plaisir, très secret, et il semble qu’il suffise presque que je vous le dise pour m’acquitter. Ai-je vraiment mérité de tels éloges ? J’ai bien de la peine à le croire, tant j’ai peu de confiance en moi, et tant surtout, je trouve mon livre encore dix fois trop littéraire. Cela doit être un peu vrai pourtant, car ce que vous dites, et si adroitement, je l’ai retrouvé à peu de choses près, dans chacun des trois quatre articles que j’ai eus. Mais que vous l’ayez dit, vous que je connais, littérairement, depuis longtemps déjà et à qui j’ai souvent pensé comme à un ami intellectuel, cela me ferait presque oublier ma modestie.
Je vous prie de croire à mes sentiments très distingués.
P. Léautaud
La Grande France
Ce journal dont il reste peu de trace n’est paru, semble-t-il, que de janvier 1900 à septembre 1903. Cinq jours après la lettre de remerciements à Léon Blum, Paul Léautaud en écrit une au journaliste colonial Jean Rhodes17, alors correspondant du Matin en Mandchourie, qui sera correspondant du Temps en Chine.
Paris le 23 avril 1903
Monsieur,
Je suis bien en retard pour vous remercier de l’article si plein d’indications exactes que vous avez écrit dans la Grande France sur le Petit Ami. Excusez-moi. Je comptais vous rencontrer un jeudi chez van Bever et vous remercier de vive voix. Je vous le dirai en confidence : je ne sais plus au juste que penser de mon livre. Je croyais avoir fait un livre de hasard, et surtout je croyais — mon Dieu ! je le crois encore un peu par moments — avoir gâché un sujet qui eût pu être presque absolument bien en cinquante pages. Et voilà que trois critiques, qui se trouvent justement être des gens difficiles, d’esprit renseigné et curieux, Léon Blum, Gilbert de Voisins et vous, écrivent sur ce livre presque les mêmes choses, louant ma sincérité, le particulier du sujet, jusqu’à l’intensité même de certaines pages, et jusqu’à cette tendresse que je n’ai pu dissimuler toute. Je ne vous dirai qu’une chose, Monsieur : malgré mon grand manque de confiance en moi, vous m’avez fait un grand plaisir, un de ces plaisirs qu’on goûte en secret, à peu près comme on goûte l’orgueil, et je voudrais vous assurer mieux qu’avec des mots, de mes remerciements.
Croyez bien, je vous prie, à mes sentiments très distingués.
P. Léautaud
La Plume du quinze juin 1903
La Plume est une revue littéraire et artistique bimensuelle fondée en 1889 par Léon Deschamps qui l’a dirigée durant onze années. Karl Boès (1864-1940) lui a succédé. La revue a disparu en 1914. Les bureaux étaient situés au 31 rue Bonaparte.
C’est Robert Scheffer qui tient la rubrique des romans. Robert Scheffer (1864-1913), ancien secrétaire des Commandements de la reine de Roumanie Carmen Sylva (on s’amuse de ce titre mais ce n’est pas rien) est poète et nouvelliste. Il a collaboré au Mercure (trois textes) et à La Revue blanche. Voici son texte, pages 701-702 :
« Plus je vais, et plus je pense qu’on ne devrait peut-être commencer à écrire que vers quarante ans. Avant, rien n’est mûr, on est trop vif, trop sensible, pour ainsi dire, et surtout on aime encore trop la littérature, qui fausse tout. » Ainsi s’exprime à un endroit de son livre M. Paul Léautaud, l’auteur du Petit ami. Je ne sais pas l’âge qu’a M. Léautaud. Quoique Le Petit ami soit le premier livre qu’à ma connaissance il publie, ce n’est certainement pas un jouvenceau. Il y a de la mélancolie rétrospective dans ses pages, une sorte de langueur provoquée par les souvenirs et que le jeune homme ne connaît point.
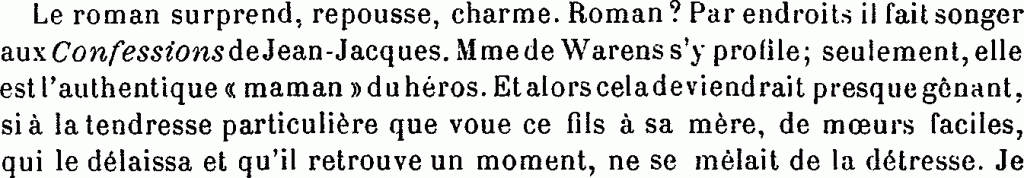
Le roman surprend, repousse, charme. Roman ? Par endroits il fait songer aux Confessions de Jean-Jacques. Mme de Warens s’y profile ; seulement, elle est l’authentique « maman » du héros. Et alors cela deviendrait presque gênant, si à la tendresse particulière que voue ce fils à sa mère, de mœurs faciles, qui le délaissa et qu’il retrouve un moment, ne se mêlait de la détresse. Je sais bien que maint passage effarouchera le lecteur prude (p. 50, p. ex.) ; et que le ton équivoque de la correspondance qu’échangent la mère et le fils est propre à le choquer. Mais le livre ne sera pas lu du lecteur prude. Et puis, qu’on se rassure : le « petit ami » reste le petit ami, et c’est sa mère qui, après s’être prêtée au jeu, se reprend la première, comme il convient. À vrai dire, à cette étrange aventure sentimentale qui donne quelque unité au roman, je préfère tous les autres souvenirs contés par M. Paul Léautaud. Il relate sa vie amoureuse avec une grâce, une sensibilité parfaite où s’insinue si naturellement quelque tristesse. Si aimables sont les femmes faciles qu’il nous présente, blondes ou brunes, toutes aimées, toutes belles… Sa phrase est souple et voluptueuse comme leur démarche. Et s’il sourit parfois, c’est en s’attendrissant. Petit ami eût pu s’intituler Un tendre si le titre n’était déjà en librairie18.
Robert Scheffer
Paul lui écrit le 22 juin :
Paris, 29, rue de Condé
le 22 juin 1903
Monsieur,
J’ai lu dans la Plume les excellentes lignes que vous avez écrites sur le Petit Ami et je ne veux pas manquer de vous en remercier, très sincèrement. Je pense que vous ne gardez aucune mauvaise impression de la façon dont nous nous sommes rencontrés au Mercure, van Bever ayant eu l’idée de vous parler de mon livre, moi présent sans que vous sachiez que j’étais l’auteur. En tout cas, on n’a pas souvent l’occasion à notre époque, d’avoir, sur un livre, un article d’un écrivain, et vous m’avez fait un grand plaisir.
Agréez, je vous prie, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
P. Léautaud
La Revue hebdomadaire du 18 juillet 1903

Dans sa rubrique des livres de La Revue hebdomadaire du 18 juillet 1903, l’historien et conférencier Jules Bertaut (1877-1959) compare deux romans et deux auteurs : Leurs lys et leurs roses, du Suisse William Ritter (1867-1965), et Le petit Ami, tous deux parus au Mercure. Un gros (276 pages) et un petit livre. La Revue hebdomadaire est une revue littéraire fondée en 1892 par Fernand Laudet qui a paru jusqu’en 1939.
Fernand Laudet (1860-1933) a commencé une carrière diplomatique auprès du Saint-Siège avant de publier une étude sur Léon XIII, sûrement passionnante. Il est mort renversé par une voiture en sortant de la messe. Les voies du Seigneur sont impénétrables.
Voici le compte rendu de Jules Bertaut, qui commence page 316 :
Deux livres extraordinaires : l’un porte en exergue une devise de Stendhal, l’autre pourrait s’enorgueillir d’une approbation de Barbey d’Aurevilly ; deux livres aussi différents, du reste, de fond que de forme, et présentant, malgré tout, plus d’un trait de ressemblance, leurs auteurs étant issus l’un et l’autre de la grande famille des passionnés.

Deuxième paragraphe du texte de Jules Bertaut, qui continue ci-dessous
Une autre caractéristique de ces deux livres, c’est qu’ils sont, l’un et l’autre, d’une « amoralité » parfaite. Entendez bien « amoralité » et non « immoralité », car je ne suppose pas un instant que les personnages de M. Ritter ou ceux de M. Léautaud aient conçu, fût-ce un jour seulement, le soupçon de ce que pouvait être une idée morale ; et, si c’est une raison pour ne point laisser traîner de telles œuvres sur les étagères familiales, ce n’en est point une pour nous empêcher de les louer comme il convient, malgré leur brutal et inconscient cynisme
À la vérité, ce qui fait proprement le charme et la beauté de telles œuvres, c’est qu’elles nous révèlent de merveilleux tempéraments d’artistes. Plus que la trame du roman, la fable ou le récit vrai, sur lequel s’essaie leur talent, nous nous sentons disposés à louer l’esprit qui la conçut, le cœur qui la ressentit, la main qui l’écrivit. Tel un violon aux sons inimitables que des doigts inhabiles peuvent faire vibrer de la plus médiocre des mélodies et qui nous ravit cependant par la beauté de ses propres accents. C’est là le grand défaut et la grande qualité de ces passionnés : leur littérature a toujours je ne sais quoi d’excessif qui remplit d’admiration ou qui porte à l’exaspération, suivant la qualité d’esprit de celui qui les juge. Un Barbey d’Aurevilly, un Villiers de l’Isle-Adam, ou plus simplement un Octave Mirbeau soulèvent des rugissements de colère ou provoquent des applaudissements frénétiques. C’est qu’ils passent tout entiers dans chacune de leurs œuvres ; qu’ils vivent, qu’ils respirent, qu’ils sentent, qu’ils se manifestent par elle, si bien qu’un livre n’est plus pour eux une création indépendante, distincte, mais comme le prolongement de leur propre personne, comme le porte-voix grâce auquel ils peuvent répandre à tous vents et à tout auditeur leur propre parole enflée, décuplée, centuplée par la puissance de l’organe, c’est-à-dire du talent. De là chez ceux qui les haïssent ou qui les aiment, un semblable élargissement dans la haine ou dans la louange.
Ce grossissement d’une personnalité vue par et à travers une œuvre a souvent ceci de choquant qu’il se produit à l’occasion d’un livre dont la trame, le récit, est hors de proportions avec l’épique grandeur de l’esprit qui le conçut. C’est ainsi que certaines « diaboliques » de Barbey n’ont de diabolique que le titre, et qu’en réalité plusieurs sont assez puériles ; ainsi, certaines colères admirables de M. Mirbeau se manifestent à l’occasion d’aventures ou de raisonnements qui font simplement sourire. Ainsi, pour en revenir à nos deux livres jumeaux, l’intrigue imaginée par M. Ritter ou M. Léautaud est parfois d’une insignifiance notoire. Quand je dis l’intrigue, je songe simplement à Leurs lys et leurs roses, car le livre de M. Léautaud, lui, en est dénué totalement : imaginez l’histoire d’un être qui serait simplement le fils d’une demi-mondaine ; qui aurait grandi, vécu, aimé dans un certain coin de Paris ; qui aurait souffert de très bonne heure dans sa sensibilité précoce et qui n’aurait pourtant gardé ni rancune, ni dégoût pour la vie qui l’a malmené, rien qu’un peu d’apitoiement résigné sur lui-même, beaucoup de tendresse étouffée, dissimulée derrière un sourire crâne d’ironie et une fièvre ardente, insupportable, pour cette mère qu’il a si peu connue, et qui aurait pu cependant être si semblable à toutes les mères. Mais voilà : son existence devait être décidément entachée, dès son origine, d’une foule d’absurdités, d’incohérences, qui ne se voient nulle part et qu’il faut pourtant accepter, parce que cela est ainsi et que nous n’y pouvons rien. Je ne connais pas de récit où le moi se glisse au premier plan d’une façon plus insupportable et plus délicieuse : il y a là une sincérité, en même temps qu’une inconscience dans la morale qui est toute la base d’un talent. Cela doit paraître exquis ou exaspérant : un tel livre se devrait jeter à la centième page ou se garder précieusement à jamais.
Jules Bertaut
Le soir même de ce 18 juillet 1903, Paul Léautaud écrit à Jules Bertaut :
Paris, 29, rue de Condé
le 18 juillet 1903
Monsieur,
Je ne peux pas ne pas vous remercier. J’ai lu, j’ai relu, je viens de relire l’article que vous avez bien voulu écrire dans la Revue hebdomadaire sur le Petit Ami. Je n’en reviens pas, très sincèrement. Ce n’est pas la première fois, du reste. Les quelques critiques qui ont bien voulu accorder quelque attention à mon ouvrage ont tous été d’une bienveillance remarquable, louant, les uns ma sincérité, les autres le caractère particulier du livre, les autres encore l’intensité de certaines pages, une sensibilité qu’ils disaient rare, et jusqu’à cette tendresse que je n’ai pu dissimuler toute. Et moi qui croyais avoir fait un livre de hasard, à chaque fois je me regardais, en quelque sorte, avec étonnement, comme pour me dire : Tout de même, c’est de toi qu’on dit tout cela !
Aujourd’hui, Monsieur, ce que je lis est si exact et si compréhensif, par exemple la première moitié de la page 318, que mon étonnement va plus loin et se mélange d’une certaine émotion19. Je veux dire qu’il remonte un peu dans le passé, et cela tient sans doute aussi à ce que je sais que vous êtes un jeune homme et à ce que je sens, en vous lisant, que ce que vous avez écrit vous l’avez pensé vraiment, si grandement élogieux que ce soit, et je vous le dis, je remonte dans le passé, jusqu’à ce petit garçon que vous savez. Non, jamais je ne trouverai les mots pour dire combien exactement je le revois, et j’ai même songé souvent que c’est là une singulière sorte de dédoublement. Voilà donc ce qu’il est devenu, ce petit bonhomme qui bien certainement ne s’y attendait guère : un jeune écrivain dont d’autres écrivains disent, que dis-je ! écrivent qu’il n’est pas plus bête qu’un autre… Vous voyez bien, Monsieur, tout ce que je pourrais écrire n’y suffirait pas. Si vous le permettez, j’irais avec grand plaisir vous serrer la main.
Croyez bien, je vous prie, à mes sentiments de gratitude.
P. Léautaud
Le Soir du 31 août et Paris du deux septembre 1903

Le Soir a été fondé en 1869, soit un peu tard, par le bonapartiste Louis Outrebon (1830-1884). Trente-trois ans plus tard bien que sous la Troisième République les choses ont peu changé, Le Soir est toujours au service des puissants. C’est aussi l’un des principaux quotidiens français. On ne le confondra pas avec son homonyme Belge fondé en 1887 et toujours actif en 2023.

Paris est un quotidien fondé en 1881 par Charles Laurent, paru jusqu’au milieu des années 1930.
Dans l’un et dans l’autre, Paul Reboux donne le même texte, comme on l’a vu avec Hector Fleischmann dans Le Voltaire et La Politique coloniale.
Paul Reboux (André Amillet, 1877-1963), écrivain prolifique, journaliste et peintre. Paul Reboux est notamment connu pour ses recueils de pastiches littéraires, dont son Un mot à la hâte, de Marcel Proust. Parmi ses romans contemporains on peut citer sa Maison de danses (roman espagnol) paru chez Calmann-Lévy en 1904. De ce roman, Fernand Nozière et Charles Müller ont tiré une pièce en cinq actes créée au théâtre du Vaudeville du deux boulevard des Capucines (clin d’œil personnel à Fabrice Weill) avec Polaire dans le rôle d’Estrella. Maurice Boissard a donné un compte rendu de cette pièce créée le treize novembre 1909 dans le Mercure du premier décembre, page 526 (exceptionnellement, en remplacement d’André Fontainas).
Texte de Paul Reboux paru dans sa « Chronique littéraire » du Soir du 31 août 1903, page deux.
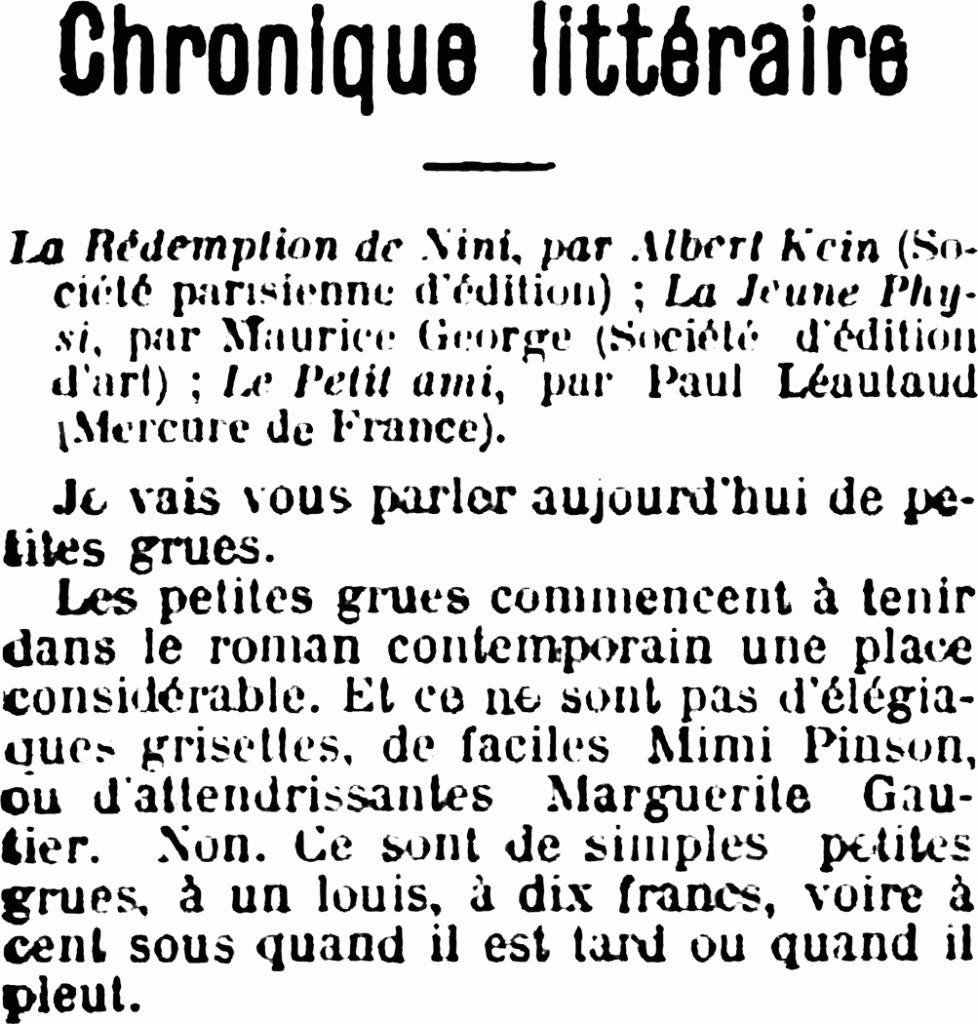
La fusion qui s’opère entre les classes de la société se marque par les tendances nouvelles de la littérature. Les célibataires, pantins habituels des comédies de salon et de chambre à coucher, renoncent aux liaisons mondaines. Ils s’amusent à retrouver dans les jeunes affranchies, les faiblesses, les candeurs, les perversités, les jalousies qui vivent dans l’âme des « chères madames ». Et, ma foi ! langage à part, la différence est moins grande qu’on ne serait tenté de le croire, Mlle Nini, de la Rédemption de Nini, Mlle Rose, de la Liaison fâcheuse20, Mlle Physi, de la Jeune Physi, et les très nombreuses demoiselles dont M. Léautaud nous cite si spirituellement les aventures, sont sœurs de Mme Hardan, de Mme Plotter21, ces jolies bourgeoises que connaît bien Maurice Donnay, et sœurs aussi, en versatilité, en inconscience morale, en duplicité, de ces dames, qui disent « vous » à leur amant rencontré au jour d’une de leurs amies, après l’avoir, une heure avant, tutoyé de toutes les façons.
* * *
L’inspiration du cher et regretté Jean de Tinan est sensible dans les pages du Petit Ami. Cela m’a rendu tout de suite très sympathique à ce livre. J’y ai retrouvé la séduction de Penses-tu réussir, l’indolence, la souriante paresse, le dédain des formes habituelles, le laisser-aller narquois, l’érudition joliment masquée de spirituel argot, la grâce qui caresse, chatouille, et va même jusqu’à paraître un peu agaçante à la longue, mais ne lasse jamais, car elle est faite de charme féminin, d’élégance, de délicatesse, et son attrait s’exerce si impérieusement, qu’on est amoureux de l’œuvre, véritablement amoureux.
Le Petit ami est fils d’un vieux bonhomme distrait et d’une demoiselle de Montmartre. Il a grandi librement, rue des Martyrs ; les petites filles du ruisseau, puis les filles tout-court du trottoir ou de la fenêtre furent ses seules compagnes. Il les aime, car il les connaît dans leur intimité morale, et il sait apprécier en elles le charme de la beauté fragile, de l’existence agitée et vide, de la frivolité, de la bonté — qui toujours accompagne la sensualité — et du cynisme enfantin. Peut-être aussi, en ces liaisons diverses, contente-t-il un peu son besoin d’amour filial. Il a conservé dans la mémoire l’odeur et le ton des cheveux de sa maman, et retrouve non sans émoi, cette odeur sur les joues qu’il embrasse, cette couleur aux cheveux oxygénés de ses amies.
Un jour, il voit sa maman elle-même. Une passionnette — qui pourrait être odieuse, et qui n’est que très touchante — s’ébauché entre eux. Ils ne sont point sans remarquer, elle, qu’il est fort joli garçon, lui, qu’elle est délicieuse ; et ne sont point sans pratiquer, lui, la tendresse un peu charnelle dont son cœur a l’habitude, elle, la coquetterie professionnelle, dont elle se sert avec innocence pour fortifier les sentiments de son fils. Puis ils se quittent, ou du moins cessent leurs affectueuses causeries leur correspondance. Alors le jeune homme retourne chez ses petites amies, et le voilà de nouveau, écrivaillant dans des intérieurs d’un modern-style Dufayel22 — cretonne et laqué blanc — tandis que du cabinet de toilette arrivent des parfums violents, et que, sur un lit bas et toujours prêt, flâne, les pieds en l’air et la cigarette aux lèvres, une demoiselle avec une simplicité édénique.
Ce jeune homme aux ambitions sans fracas est peut-être un sage. Sa morale, son éthique et sa métaphysique se résument en ces mots : « Gomme les autres on a fait le pantin, on a dit des mots à droite et à gauche, on a travaillé, on a fait l’amour, on a ri, on a pleuré, trainé sa forme comme on pouvait, puis, psitt, tirez le rideau, emportez le bonhomme la pièce est jouée. Rien n’a a tiré à conséquence, et l’on est le premier à n’y plus penser. » Et, pour évangile il a cette phrase de Chamfort : « La plus perdue des journées est celle où l’on point ri. »
Paul Reboux
Le cinq septembre Paul Léautaud remerciera Paul Reboux pour cet article du 31 août :
Paris, 29, rue de Condé
le 5 septembre 1903
Savez-vous bien, Monsieur, que je ne reviens pas de la sympathie que vous me témoignez. Déjà, quand le P.A. venait de paraître, vous avez bien voulu m’écrire une lettre charmante, et m’envoyer aussi cette Josette23, où il y a bien des pages que je voudrais avoir écrites, pour leur style simple et expressif, et l’histoire doucement triste qu’elles racontent. Et voilà qu’aujourd’hui, plus de six mois après la publication du P.A. vous avez pensé à en parler dans votre critique littéraire du Soir, et à en parler de façon détaillée, expliquant l’histoire, les sentiments qui y traînent, résumant la sorte de morale qui s’en dégage, tout cela avec les mots et de la façon qu’il fallait, et en répétant votre sympathie pour le livre. Comment voulez-vous que je vous remercie. Je n’ai pas affaire avec vous à un critique littéraire habituel, mais presque à un ami, ou du moins à quelqu’un que je devine presque un ami, et je pourrais vous écrire très longtemps sans vous remercier suffisamment. Déjà, quand vous m’avez écrit et après avoir lu Josette, j’avais pensé à aller vous remercier de vive voix. Puis je me suis dit qu’au fond ce serait peut-être ridicule, et je n’ai pas bougé. Je suis en ce moment à un travail pressé. Je dois de plus déménager très prochainement. Si vous le vouliez bien, quand je serai débarrassé de tout cela, un jour, vers la fin d’octobre, j’irai vous serrer la main.
En attendant, soyez bien certain que vous m’avez fait plaisir, et croyez à mes sentiments de sincère sympathie.
P. Léautaud
Les deux Paul se sont-ils rencontrés, cette année 1903 ? Peut-être si l’on se réfère à une lettre que Paul Léautaud écrira à Marcel Schwob le 21 décembre :
Quand j’aurai le plaisir de vous voir, je vous dirai un ou deux petits détails bien amusants sur Paul Reboux.
Notes
1 Antoine Prévost d’Exiles, dit l’abbé Prévost (1697-1763), romancier et historien, a écrit l’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut en 1753. Cette référence sera reprise dans le compte rendu de Rachilde.
2 Paul ne précise pas s’il s’agit des libraires parisiens ou français. Si l’on considère que 1 000 exemplaires ont été distribués, cela ferait 330 libraires. Au début des années 2000 il y avait un peu plus de 400 librairies à Paris pour 2 200 en France.
3 25 boulevard des Italiens, un petit immeuble sur quatre fenêtres, près de la rue de Choiseul. Il n’y a plus de librairie à cet endroit depuis longtemps.
4 Variante du tapuscrit de Grenoble : « le feuillette, le lisotte, et le repose. »
5 Lucien Monceau (1873-1907), est l’un des quatre frères de la comédienne Marguerite Moreno. Il est agent comptable au Mercure. Marguerite Moreno était l’aînée de quatre frères, tous morts jeunes : l’aîné, Gustave Monceau (1872-1914), Lucien, objet de cette note, Gaston (1876-1905) et Pierre (1878-1907).
6 Émile Buré (1876-1952), journaliste et patron de presse.
7 Dans cette même rubrique, Jean Ernest-Charles a traité du livre de Léon Frapié Marcelin Gayard, paru cet hiver chez Calmann-Lévy. Il y revient en fin d’article. Le prochain roman de Léon Frapié (1863-1949) sera La Maternelle, qui obtiendra le prix Goncourt 1904.
8 Henri Albert (Henri-Albert Haug, 1869-1921) signait de ses seuls prénoms et beaucoup pensaient ainsi qu’il se nommait Albert, comme ici Paul Léautaud. Spécialiste de Nietzsche et auteur Mercure depuis 1891, il y tint une rubrique de « Lettres allemandes » de janvier 1893 à juin 1921. Dans d’autres journaux il utilisait parfois le pseudonyme de Matin Gale. Lire dans le Journal littéraire, à l’occasion de sa mort, un court portrait au trois août 1921.
9 Plus tard PL fustigera cet emploi de « soi-disant ».
10 Note de Marie Dormoy dans la Correspondance générale : « Ernest-Charles, après avoir lu le Petit Ami, avait demandé à Léautaud une série d’articles sur Paris pour la Revue bleue. Léautaud en avait tout de suite trouvé le titre : le Paris d’un Parisien. Le premier article ayant été jugé trop libre et trop excessif, n’a pas été publié. Plutôt que de ne pas écrire avec liberté, Léautaud donna sa démission. »
11 Que Les Fumées de Jean Martineau, évoqué au paragraphe précédent.
12 Journal littéraire illustré de tendance populaire, paraissant le mercredi et le samedi, créé en 1891
13 Journal littéraire au 23 Août : « Depuis deux mois j’apprends l’anglais. »
14 Paul Vigné d’Octon (1859-1943), médecin de marine, se nomme Paul Vigné et a acheté une propriété à Octon, dans l’Hérault ; il ne doit pas aimer la mer. Son Les Baisers aurait du paraître en volume entre La Gloire du sabre (Flammarion 1900) et Le Pèlerin du soleil (Grasset 1910). Quelque chose nous manque.
15 Sic. « Declamatio suasoria », La Revue blanche, août-septembre 1892, p. 134.
16 Le Livre de mes amies est paru en ouverture de La Revue blanche de juin 1893 (pages 401-419).
17 Après des études de droit à Bordeaux, Jean Rodes (Eugène Moutou, 1867-1947), fonctionnaire colonial, a collaboré à La Revue Blanche avec « Un regard sur le Soudan » paru en ouverture du numéro du premier novembre 1899 et une « Enquête sur l’éducation » en ouverture du numéro du premier juin 1902. Pour cet étonnant voyageur, lire en ligne le mémoire de master 2 d’Hervé Bouillac : Jean Rodes ou l’impossible destin d’un « voyageur psychologue » (1867-1947) (Toulouse, septembre 2014).
18 Louis de Robert, Un tendre, Charpentier 1894, 271 pages.
19 Depuis « …imaginez l’histoire d’un être qui serait simplement le fils d’une demi-mondaine » jusqu’à : « il y a là une sincérité, en même temps qu’une inconscience dans la morale qui est toute la base d’un talent. »
20 Allusion au personnage du roman de Pierre de Querlon paru au Mercure l’an dernier.
21 Ces dames sont des personnages du recueil de nouvelles dramatiques, ou dialoguées, comme on voudra, Chères Madames, paru chez Ollendorff en 1895 et offert à Paul Hervieu. Madame Hardan, « mince, brune, yeux très bleus », apparaît dans le premier texte : « Visites », offert à Jacques Saint-Cère. Gotte Plotter, 22 ans, maîtresse de Paul Joyeux, apparaît dans le septième texte, « La Vrille », offert à Alfred Capus.
22 Le « Palais de la nouveauté » a ouvert en 1856, boulevard Barbès. Il s’agissait d’un « grand magasin » très populaire, couvrant environ un hectare, qui deviendra « Les grands magasins Dufayel » en 1888 pour être l’établissement le plus important du monde dans sa catégorie à la veille de la Première Guerre mondiale avant de fermer ses portes en 1930. Situé dans le quartier, encore très populaire de nos jours, du XVIIIe arrondissement de Paris, cet établissement a obtenu son succès en proposant des bons permettant aux clients d’acheter moyennant vingt pour cent à l’achat, puis d’échelonner le solde. Des encaisseurs passent chaque semaine au domicile des clients. Max Jacob fut employé aux écritures chez Dufayel.
23 Paul Reboux, Josette, Ollendorff, 1903, 327 pages. Ce roman daté 1903 est paru à la fin de 1902 et a été critiqué par Rachilde dans le Mercure de décembre 1902.